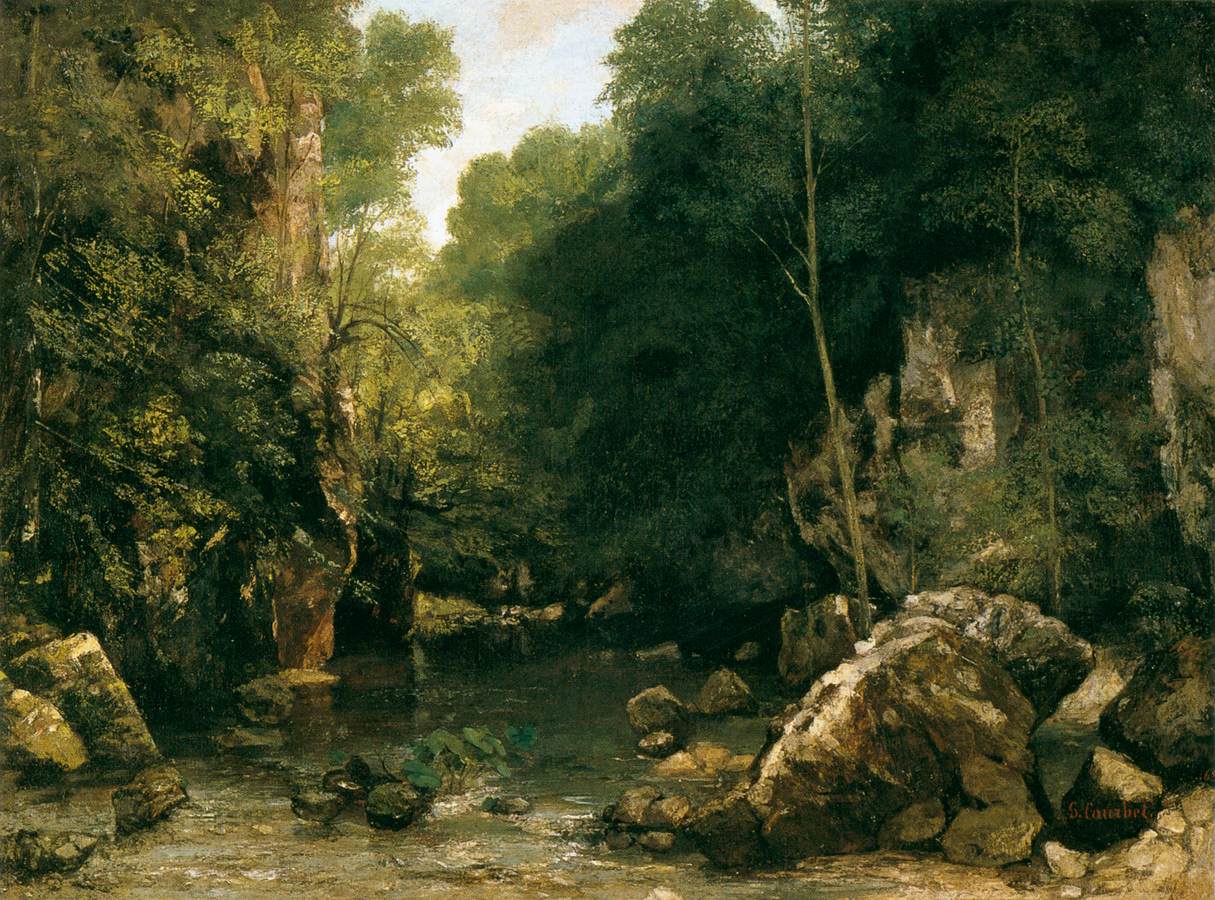En avril, je me suis rendu à Londres à l’occasion d’un festival littéraire. J’ai prié les organisateurs de prévoir une navette privée à l’aéroport de Gatwick. Ils m’ont paru réticents, mais ont fini par accepter. Le motif officiel de ma demande résidait dans le fait que le laps de temps entre l’atterrissage et l’événement public me semblait un peu court. Même s’il n’était pas si court que cela. Il est possible, en effet, que j’aie demandé un transport en voiture pour la seule raison que j’en avais la possibilité et parce que j’aime énormément franchir les portes coulissantes des arrivées et trouver un homme en veste qui m’attend, suivre une pancarte portant mon nom en m’écartant de la foule qui se dirige vers la gare. Le chauffeur, Baran, avait une Mercedes noire haut de gamme et, d’après Google Maps, nous avons mis, pour atteindre l’hôtel, tout juste quinze minutes de plus que par le train et le métro.
Le réceptionniste, Christian, a jeté un coup d’œil à la valise cabine que ma femme et moi partagions. Puis il a dit avec un petit sourire : « Avec tous vos bagages, vous aviez besoin d’un coffre adapté, je comprends. »
J’ai dû lui paraître troublé, parce qu’il m’a indiqué l’endroit, de l’autre côté de la baie vitrée, où la Mercedes kilométrique de Baran était garée un instant plus tôt.
Pendant que Christian enregistrait nos papiers, je me suis familiarisé avec certains détails du hall qui m’avaient échappé : les affichettes qui invitaient à produire « zero waste », les codes QR à lire pour approfondir « la politique de développement durable de l’hôtel » et, près d’un mur, une petite vitrine hébergeant une sélection de livres en vente : plusieurs textes de Naomi Klein, ainsi qu’un essai à la couverture vert d’eau, How Bad Are Bananas ? Sous-titre : « L’empreinte carbone de tout » (ce livre, comme je le découvrirais par la suite, évalue les émissions de gaz à effet de serre d’une variété d’objets physiques et d’actions impalpables de notre quotidien, depuis les boîtes de six œufs jusqu’à l’expédition d’un email de l’autre côté de l’Océan, encourage le lecteur à mener un « style de vie à cinq tonnes d’émission par an » et contient une multitude d’informations bizarres et accusatoires, par exemple le fait que l’achat d’un SUV anéantisse, à lui seul, dix années de ce style de vie vertueux à cinq tonnes, « avant même que nous nous asseyions au volant »).
Bref, je venais de pénétrer dans l’hôtel le plus écologiste d’Angleterre, un hôtel bien relié à Gatwick par le réseau de transports en commun, en débarquant triomphalement d’un gros engin de cinq mètres de long aux vitres teintées, dont j’avais tiré une valise cabine.
Dans ma jeunesse, je me croyais différent. Un bon touriste qui n’avait rien à voir avec la masse. J’étais persuadé que j’éviterais toute ma vie les itinéraires conventionnels, que j’utiliserais les transports en commun et parlerais les langues locales, que jamais au grand jamais, pas même dans les pires des cas, je ne mangerais dans un restaurant italien à l’étranger, pis, dans un fast-food. Je me déplacerais agilement dans le monde, sans m’unir au moindre groupe ni salir. Il existait une autre voie que la stupidité touristique, et je la choisirais. À bien y réfléchir, à l’époque je ne me serais même pas défini comme un « touriste » : j’étais un « voyageur », moi. J’avais 20 ou 25 ans, c’était donc il y a très longtemps.
À Londres, le matin qui a suivi le festival, ma promenade m’a mené à Piccadilly Circus. C’était juste là, sous les écrans incurvés, au milieu de la foule, lors d’un de mes premiers voyages d’études, que j’avais formulé ma très nette intention de ne pas devenir un voyageur conformiste. Par rapport à mes nouvelles normes, Piccadilly me semblait à présent particulièrement convenable, peut-être pas chic, mais presque. Et pourtant, je me suis soudain senti déprimé. J’ai proposé à ma femme de rentrer à la maison le soir même, sans attendre le vol du lendemain. J’ai acheté par téléphone deux billets, sans toucher aux autres, non remboursables, me contentant de me demander vaguement si réserver des places d’avion pour rien constituait une économie de carburants fossiles ou, au contraire, un gaspillage, penchant d’instinct pour la seconde hypothèse (le livre sur les bananes me le confirmerait). Nous avons récupéré nos bagages à l’hôtel écologique et pris la fuite.
En tant que voyageur responsable, j’ai échoué. À ma partielle décharge, je peux juste ajouter que c’est peut-être une certaine idée de voyage qui a échoué, alors que le tourisme a triomphé. Il est possible que je me rappelle même le moment exact où cela s’est produit : je suis devant mon ordinateur, encore chez mes parents, et je consulte le site flambant neuf de Ryanair. Ryanair, compagnie aérienne qui desservait autrefois des vols intérieurs, au Royaume-Uni, a inauguré des liaisons dans l’Europe unie, Italie comprise. On se fout que le trajet de Turin jusqu’à l’aéroport de Bergame Orio al Serio constitue un voyage en soi : le vol aller pour Londres Stansted coûte 99 centimes — 99 centimes ! — et je suis galvanisé. Je réserve. (Je me présenterais à l’aéroport sans avoir imprimé ma carte d’embarquement et j’expérimenterais une rage nouvelle, une rage low cost, qui serait la passion dominante de la nouvelle époque ; je paierais à contrecœur l’amende qui démultiplie le coût du billet — cela vous est arrivé à vous aussi, je le sais, oublier d’imprimer la carte d’embarquement Ryanair a été le rituel de passage d’une civilisation entière –, mais je ne changerais pas d’avis pour autant : parce que je veux voler, voler de plus en plus et toujours moins cher, voler partout et être laissé en paix. Et je le fais. Et nous l’avons fait. Londres Stansted à moins d’un euro.)
Il y a eu par la suite quelques tentatives isolées d’opposition. En 2014, j’ai participé, comme envoyé d’une revue de voyages, à une excursion en groupe sur les îles Svalbard. Un tour opérateur avait décidé de les inclure parmi les étapes de sa croisière en mer du Nord. Je n’avais rencontré personne ayant été aux Svalbard, c’était donc, là oui, une destination de vrai voyageur. Mais, à mon arrivée à Longyearbyen, j’en ai également compris la raison. La capitale se résumait à une rue de préfabriqués entourés de boue, les températures en novembre étaient déjà rédhibitoires, la nourriture était infecte et il n’y avait à visiter que des mines de charbon abandonnées et des étendues désolantes de permafrost, sur lesquelles il était obligatoire de marcher, un fusil en bandoulière, à cause des ours blancs. J’ai failli mourir sur un traîneau tiré par des huskies, le summum de cette expérience arctique.
La vérité, c’est que les plus beaux endroits du monde étaient déjà tous pris depuis longtemps. Seuls les gens qui les visitaient continuaient de grandir, et cela paraissait normal. Comme si la masse d’individus présents à l’intérieur des mêmes lieux, sur les mêmes routes, était compressible à l’infini, comme si notre « moi touristique » était un destin inéluctable. Dans un livre au titre emblématique, The Naked Tourist, « Le touriste nu », Lawrence Osborne écrivait : « Le problème du voyageur moderne, c’est qu’il ne sait plus où aller. Désormais la planète entière est devenue un équipement touristique. […] Le tourisme a transformé la planète en un spectacle uniforme. » Cet ouvrage date de 2006 et, depuis, le nombre de voyageurs internationaux a pratiquement doublé, passant de 850 millions par an à près d’un milliard et demi en 2019. Aujourd’hui, le tourisme est la cause d’environ 8 % des émissions globales de gaz à effet de serre, dus pour près de la moitié au trafic aérien.
Et pourtant, de telles données sont pratiquement absentes des sites qui rassemblent des statistiques à propos du tourisme. Omises ou jugées négligeables. On s’y occupe surtout des retombées positives que l’augmentation du tourisme entraîne sur le produit intérieur brut et sur les taux d’emploi. Les analyses soutiennent unanimement le principe selon lequel le tourisme est un secteur à encourager sans réserve, un indicateur de bien-être au même titre que l’espérance de vie ou le revenu moyen par habitant. Par conséquent, il importe de retrouver au plus vite le niveau de circulation prépandémique. Et la bonne nouvelle, c’est que nous y parvenons plus rapidement que prévu ! À long terme, la pandémie constituera une malheureuse oscillation dans une tendance de croissance implacable. Quant à l’invasion de l’Ukraine, elle ne sera même pas perceptible dans les histogrammes qui décrivent l’éblouissante évolution du tourisme global. Après quelques semaines d’un effroi essentiellement lié au prix du carburant, les départs de Russie se sont à leur tour stabilisés, avec une préférence macabre pour des destinations telles que les Maldives, les Seychelles, la Serbie et Cuba.
J’ai recommencé moi aussi à voyager. Au début avec réticence, puis en m’abandonnant à la frénésie. Au cours des derniers mois, j’ai emprunté les vols de Ryanair, EasyJet, Wizz, AirEuropa, ITA, Emirates et Vueling. Mon compte Genius sur Booking.com est en pleine forme. Pourtant, je connais des gens qui ont vraiment arrêté depuis la pandémie : ils ne prennent plus l’avion, ne scrollent plus sur Airbnb, ne franchissent plus les frontières, n’émettent et ne polluent plus. Que ce soit pour des raisons de conscience climatique ou pour sauver leur esprit, ils ont décidé de s’opposer au cauchemar de la modernité qui porte le nom de tourisme. Terminés, pour eux, le souci de s’accaparer les places « extra legroom », les luttes de survie pour l’espace dans les compartiments à bagages, les « cinq expériences à ne pas rater », les Tropiques, l’impératif moral du relax. Ces gens-là ne vivent pas en Italie, mais en Allemagne et en Hollande, et ils m’intimident un peu. Leur intégrité me chagrine aussi, parce que je sais que je suis différent. Je ne cesserai jamais de voyager. Je serai toujours un touriste.
Comme si cela ne suffisait pas, j’ai aménagé il y a cinq ans dans une ville très touristique : Rome. Depuis que j’y habite, mes réflexions sur le tourisme se sont faites plus assidues, mais également plus paradoxales et plus rageuses. Là où j’ai passé mes trente premières années, il n’y a qu’un seul hôtel, l’Hôtel Pace, et je n’ai jamais compris qui y allait coucher ni pourquoi. Vu de là, le tourisme constituait une tentation passionnée pour l’ailleurs, et il s’agit peut-être d’une définition plutôt convaincante de la « province » : un lieu d’où l’on ne peut que s’éloigner, dans une pleine liberté de choix. Ici, les choses sont différentes. Cette ville abrite la beauté et la mémoire. La pensée que la via dei Fori Imperiali représente mon trajet habituel pour atteindre le parc où je fais du sport me stupéfie encore et, je crois, ne cessera jamais de me stupéfier. Mais il y a des périodes de l’année, les plus tempérées, avril-mai et septembre-octobre, où le flot des touristes le long des forums se change en tout autre chose : en un raz-de-marée. Un essaim. Durant ces périodes, les guides non autorisés sont tellement fatigués, tellement engourdis, qu’ils ne regardent même plus qui se trouve devant eux, et malgré ma tenue de joggeur trempée de sueur, ils m’arrêtent pour me demander Do you have your ticket ?
Non, leur dis-je. I don’t have my ticket.
Le soir, quand l’essaim est passé, quand l’homme-sphinx et le musicien andin qui interprète l’Hallelujah de Leonard Cohen sur sa flûte de pan ont à leur tour quitté leur lieu de travail, le paysage qui s’étend autour du Colisée évoque la fin d’une razzia. Coupes à glace en carton par milliers et tout autant de cuillers en plastique, mouettes prudentes, ordures. On pourrait croire que, privé de la foule, le Colisée recouvre soudain son charme solennel, on le dit également, je l’ai dit moi aussi, mais il n’en est rien. Il paraît juste épuisé. Son âme, ou ce qui y ressemble et que le tourisme de masse agresse volontiers, lui a été volée. Des années peut-être ne suffiraient pas pour la reconstituer.
La même scène se produit au même moment à Piccadilly Circus, dans le quartier rouge d’Amsterdam, sur les Champs-Élysées et sur le Kurfürstendamm, elle se répète quelques heures plus tard dans la Ville interdite et à Times Square.
Il y a quelques mois, ici aux Forums, un touriste a introduit sa jambe entre les barreaux d’une grille. On ignore pourquoi, mais il est peut-être pédant de se le demander. Quoi qu’il en soit, la police est arrivée, et un monsieur à l’accent napolitain a prononcé une phrase pleine de bons sens pour rassurer le garçon en question : « Allons, allons, votre jambe est entrée, elle ressortira forcément ! » En effet, elle est ressortie après quelques contorsions. Une petite parabole touristique, dotée d’un happy end, qui me semble toutefois suggérer une vérité plus vaste et plus dérangeante sur notre compte : nous avons introduit notre jambe dans une grille, ça avait l’air amusant, mais nous ne savons plus comment l’en tirer. Et sommes-nous vraiment certains qu’elle en ressortira pour la seule raison qu’elle y est entrée ?
Il faudrait renoncer. Ou du moins renoncer beaucoup plus avec la sérénité mêlée de tristesse qui nous habite quand nous renonçons à ce que nous reconnaissons comme superflu. Mais en est-il vraiment ainsi ? Le tourisme est-il superflu ? Sans notre identité touristique, que resterait-il de nous à la mi-août, lors des ponts ensoleillés du printemps et durant tout le temps que nous passons à les attendre ?
En parcourant le dernier tronçon de la via Cavour, je jette un coup d’œil aux pizzas dans les assiettes des touristes, exsangues, maculées de tranches de saucisson oxydé. Je jette un coup d’œil aux autres plats indescriptibles, des plats contenant des moules, et je songe avec irritation à la façon dont ces touristes se font embobiner, à la gêne qu’ils me créent, aux cars qui les déversent par centaines et à l’état auquel ils réduisent ce coin du monde. Mais je sens aussi leur vexation et je sens leur puissant bonheur. Je les regarde, engourdis, et je me vois. Dans tous les ailleurs où je suis allé et où je retournerai. Après tout, à qui appartient la beauté ? Qui peut revendiquer la propriété de ces vestiges ?
Alors je me dis dans un élan libératoire : Mais oui, venez ! Venez et c’est tout ! Espagnols, Indiens, Saoudiens, Turcs et Mexicains, Américains et Français : venez ! Venez en masse, toujours plus nombreux, venez tous ! Déversez-vous ici avec vos trottinettes, vos side-cars, vos hoverboards et vos rickshaws, saccagez les immeubles et mangez des milliards de glaces simultanément, pour ne pas savoir ensuite que faire des coupes. Arrachez un fragment de cette merveilleuse ville délabrée : vous y avez droit. Il n’appartient pas plus à moi qu’à vous. Nous pouvons accueillir au Colisée huit mille visiteurs supplémentaires par jour sans même que vous vous en aperceviez. Par conséquent, venez, ici nous sommes Open to Meraviglia[1]. Tout ceci est irrépressible, nous le savons, n’essayons donc pas de le réprimer.
Il y a au moins une bonne nouvelle dans le livre de Mike Berners-Lee, l’ouvrage sur l’empreinte carbone des bananes : les bananes ne sont pas nocives comme le titre le laissait entendre. Chacune n’émet que 110 grammes de CO2 : ce n’est pas beaucoup, surtout lorsqu’on tient compte des bénéfices du potassium et des vitamines. Les deux sièges sur les vols au départ de Londres que j’ai réservés, mais pas occupés, ont émis à eux seuls plus de cinquante kilos d’anhydride carbonique. Cinquante kilos d’absence transformés en gaz à effet de serre, davantage que toutes les bananes que j’arriverai à manger au cours de cette existence, de la prochaine et de la suivante.
Traduit de l’italien par Nathalie Bauer.
[1] Allusion à la campagne très critiquée que le ministère du Tourisme italien a lancée en avril 2023, pour promouvoir l’image de l’Italie dans le monde, dont le slogan, « Italia. Open to Meraviglia », pourrait se traduire par « Italie. Ouverte à l’Émerveillement ».