Esquisse d’une doctrine de la politique française (27 août 1945)
Deux dangers guettent la France dans le monde d’après guerre. L’un est plus ou moins immédiat ; l’autre est beaucoup plus lointain, mais aussi incomparablement plus grave. Le danger immédiat est le danger allemand, qui est non pas militaire, mais économique et donc politique. C’est que le potentiel économique de l’Allemagne (même amputée de ses provinces orientales) est tel, que l’incorporation inévitable de ce pays, qu’on s’efforcera de rendre « démocratique » et « pacifique », dans le système européen, aboutira fatalement à un refoulement de la France au rang d’une puissance secondaire au sein de l’Europe continentale, à moins qu’elle ne réagisse d’une façon tout aussi énergique que raisonnée.
Le danger plus lointain est, il est vrai, moins certain. Mais il peut en revanche être qualifié de mortel, au sens propre du mot. C’est le danger que court la France d’être entraînée dans une Troisième Guerre mondiale et d’y servir à nouveau de champ de bataille, aérienne ou autre. Or il est bien évident que dans cette éventualité, et indépendamment de l’issue du conflit, la France ne pourra plus jamais réparer les dommages qu’elle devra nécessairement subir ; sur le plan démographique tout d’abord, mais aussi sur celui de l’économie et de la civilisation elle-même.
La politique française, tant extérieure qu’intérieure, se trouve ainsi en présence de deux tâches d’importance primordiale, qui déterminent pratiquement toutes les autres :
– d’une part, il s’agit d’assurer dans toute la mesure du possible la neutralité effective au cours d’une éventuelle guerre entre Russes et Anglo-Saxons ;
– d’autre part, il importe de maintenir le pays pendant la paix, et contre l’Allemagne, au premier rang économique et politique en Europe continentale non soviétisée.
C’est pour déterminer les conditions nécessaires et suffisantes dans lesquelles ce double but a des chances sérieuses d’être atteint, qu’ont été écrites les pages qui vont suivre.
I – la situation historique
1. Il n’y a pas de doute qu’on assiste actuellement à un tournant décisif de l’histoire, comparable à celui qui s’est effectué à la fin du Moyen Âge. Les débuts des Temps modernes sont caractérisés par le processus irrésistible de l’élimination progressive des formations politiques « féodales », qui morcelaient les unités nationales, au profit des royaumes, c’est-à-dire des États-Nations. A l’heure actuelle ce sont ces États-Nations qui, irrésistiblement, cèdent peu à peu la place aux formations politiques qui débordent les cadres nationaux et qu’on pourrait désigner par le terme d’« Empires ». Les États-Nations, tout puissants encore au xxe siècle, cessent d’être des réalités politiques, des États au sens fort du mot, tout comme cessèrent d’être des États les baronnies, les villes et les archevêchés médiévaux. L’État moderne, la réalité politique actuelle, exigent des bases plus larges que celles que représentent les Nations proprement dites. Pour être politiquement viable, l’État moderne doit reposer sur une « vaste union ‘impériale’ de Nations apparentées ». L’État moderne n’est vraiment un État que s’il est un Empire.
Le processus historique qui remplaça jadis les entités féodales par les États nationaux et qui supprime actuellement les Nations au profit des Empires, peut et doit être expliqué par des causes économiques, qui se manifestent politiquement dans et par les exigences de la technique militaire. C’est l’apparition des armes à feu, et notamment de l’artillerie, qui a ruiné la puissance politique des formations subnationales du Moyen Âge. Le « Prince » féodal : baron, évêque, ville, etc., était capable d’armer ses citoyens-vassaux d’épées et de lances, et il se maintenait politiquement tant que cet armement suffisait pour pouvoir soutenir une guerre éventuelle, qui avait pour enjeu son indépendance politique. Mais quand il a fallu entretenir une artillerie pour pouvoir se défendre, les bases économique et démo graphique des formations politiques féodales se révélèrent insuffisantes, et c’est pourquoi ces formations furent progressivement absorbées par les États nationaux qui seuls étaient capables de s’armer d’une façon adéquate. De même, les États-Nations étaient – et sont encore – des bases économiques et démographiques suffisantes pour entretenir des troupes qui n’ont pour armement que des fusils, des mitrailleuses et des canons. Mais de telles troupes ne sont plus efficaces à l’heure qu’il est. Elles ne peuvent rien contre une armée vraiment moderne, c’est-à-dire motorisée, blindée et impliquant une aviation comme arme essentielle. Or l’économie et la démographie strictement nationales sont incapables de mettre en ligne des armées de ce genre, que les Empires sont seuls à pouvoir entretenir. Tôt ou tard ces Empires absorberont donc politiquement les États-Nations.
Cette insuffisance foncière, démographique et économique, par conséquent militaire, et donc politique, des États nationaux est démontrée d’une façon particulièrement frappante par l’exemple du IIIe Reich. Pendant tout le Haut Moyen Âge, l’Allemagne a poursuivi un projet impérial, à la fois anachronique et prématuré, donc utopique, c’est-à-dire sans base réelle dans le présent et par conséquent irréalisable. La poursuite et l’échec inévitable de ce projet ont eu pour conséquence que l’Allemagne est entrée dans la période proprement féodale et en est sortie avec un retard de cent cinquante ans, qu’elle n’a jamais su rattraper depuis (n’ayant pas pu ou voulu brûler les étapes par un acte révolutionnaire). C’est donc avec un retard d’un siècle et demi qu’Hitler a commencé son action politique. Et c’est ainsi qu’il imagina et créa son IIIe Reich en tant qu’État strictement conforme à l’idéal « national », né à la fin du Moyen Âge et ayant déjà atteint sa forme parfaite dans l’idéologie et la réalisation révolutionnaires, signées des noms de Robespierre et de Napoléon. Car il est bien évident que le slogan hitlérien : « Ein Reich, ein Volk, ein Führer » n’est qu’une – mauvaise – traduction en allemand du mot d’ordre de la Révolution française : « La République une et indivisible. » Et on pourrait dire que « le Führer » n’est qu’un Robespierre allemand, c’est-à-dire anachronique, qui – ayant su maîtriser son Thermidor – a pu entreprendre lui-même l’action réalisatrice napoléonienne. D’ailleurs Hitler a fort bien exprimé le fond et le mobile de sa pensée politique en se mettant à la tête d’un mouvement qui s’appelle « national-socialisme », et qui s’oppose consciemment tant à I’« impérial-socialisme » soviétique qu’à I’« impérial-capitalisme » anglosaxon. D’une manière générale le IIIe Reich était sans aucun doute un État national, au sens propre et précis du terme. C’est un État qui, d’une part, avait pour but de réaliser toutes les possibilités politiques nationales, et qui, d’autre part, ne voulait utiliser que la puissance de la Nation allemande, en s’imposant consciemment en tant qu’État les limites (ethniques) de cette dernière. Eh bien, cet État-Nation « idéal » a perdu sa guerre politique décisive.
Pour expliquer l’échec total militaire, et donc politique, de cet État-Nation, on ne peut pas évoquer la dimension restreinte de sa base nationale, comme on est tenté de le faire quand on veut expliquer l’écrasement foudroyant des États nationaux polonais, norvégien, hollandais, belge, yougoslave et grec. On ne peut pas non plus parler d’incapacité militaire, comme on le fait parfois pour « expliquer » le sort de l’Italie fasciste (éminemment « nationale » elle aussi). Enfin il ne peut être question non plus de « causes » qu’on évoque souvent lorsqu’on parle de l’effondrement de la France : désordre, imprévision, malaise politique intérieur, etc. L’État national allemand disposait de quatre-vingts millions de nationaux dont les qualités militaires et civiques (sinon morales) se sont révélées être au-dessus de tout éloge. Néanmoins l’effort politique et militaire surhumain de la Nation n’aboutit à rien d’autre qu’à faire reculer une issue qu’on peut vraiment appeler « fatale ».
Et c’est bien le caractère éminemment et consciemment national de l’État allemand qui est la cause de cette « fatalité ». Car pour pouvoir soutenir une guerre moderne, le IIIe Reich a dû occuper et exploiter des pays non-allemands et importer plus de dix millions de travailleurs étrangers. Mais un État-Nation ne peut pas assimiler des non-nationaux et il doit les traiter politiquement en esclaves. Ainsi l’idéologie « nationaliste » d’Hitler aurait suffi à elle seule pour faire échouer le projet impérial de la « Nouvelle Europe », sans laquelle l’Allemagne ne pouvait pourtant pas gagner la guerre. On peut donc dire que l’Allemagne a perdu cette guerre parce qu’elle a voulu la gagner en tant qu’État-Nation. Car même une Nation de quatre-vingts millions de citoyens politiquement « parfaits » est incapable de soutenir l’effort d’une guerre moderne et donc d’assurer l’existence politique de son État.
L’exemple allemand prouve clairement que, de nos jours, une Nation quelle qu’elle soit qui s’obstine à maintenir son exclusivité politique nationale, doit tôt ou tard cesser d’exister politiquement : soit au cours d’un processus pacifique, soit à la suite d’un écrasement militaire. En dissipant les illusions de la guerre de 1914-1918, la guerre actuelle, menée par les Empires, marqua le dernier acte de la grande tragédie qu’ont jouée depuis cinq siècles les États nationaux.
2. L’irréalité politique des Nations, qui apparaît en fait, quoique d’une façon peu marquante, dès la fin du siècle dernier, a été plus ou moins clairement reconnue dès cette époque même. D’une part le libéralisme « bourgeois » proclamait plus ou moins ouvertement la fin de l’État en tant que tel, c’est-à-dire de l’existence proprement politique des Nations. En ne concevant pas l’État en dehors du cadre national et en constatant en même temps, plus ou moins consciemment, que l’État-Nation n’était plus politiquement viable, le libéralisme proposa de le supprimer volontairement. L’entité essentiellement politique, c’est-à-dire en fin de compte guerrière, qu’est l’État proprement dit, devait être remplacée par une simple administration économique et sociale, voire policière, mise à la disposition et au service de la « Société », qui était d’ailleurs conçue comme un agrégat d’individus, l’individu étant censé incarner et révéler, dans son isolement même, la valeur humaine suprême. Ainsi conçue, l’administration « étatique » libérale devait être foncièrement pacifique et pacifiste. Autrement dit, elle n’avait pas à proprement parler de « volonté de puissance », et par conséquent nul besoin opérant ni désir efficace de cette « indépendance » ou autonomie politique qui caractérise l’essence même de l’État véritable. D’autre part le socialisme « internationaliste » a cru pouvoir constater que la réalité politique était en train de passer des Nations à l’Humanité en tant que telle. Si l’État devait encore avoir un sens et une raison d’être politiques, il ne pouvait les avoir qu’à condition de se donner comme base « le genre humain ». Puisque la réalité politique déserte les Nations et passe à l’Humanité elle-même, le seul État (provisoirement national) qui se révélera à la longue comme politiquement viable, sera celui qui aura pour but suprême et premier d’englober l’humanité toute entière. C’est de cette interprétation « internationaliste », voire « socialiste » de la situation historique qu’est né le communisme russe de la première époque, qui associa en conséquence à l’État soviétique lame Internationale.
Or en fait l’interprétation internationaliste-socialiste est tout aussi erronée que l’interprétation pacifiste-libérale. Le libéralisme a tort de n’apercevoir aucune entité politique au-delà de celle des Nations. Mais l’internationalisme pèche par le fait de ne voir rien de politiquement viable en deçà de l’Humanité. Lui non plus n’a pas su découvrir la réalité politique intermédiaire des Empires, c’est-à-dire des unions, voire des fusions internationales de Nations apparentées, qui est précisément la réalité politique du jour. Si la Nation cesse effectivement d’être une réalité politique, l’Humanité est encore – politiquement – une abstraction. C’est pourquoi l’internationalisme est actuellement une « utopie ». A l’heure qu’il est, il apprend à ses dépens qu’on ne peut pas sauter de la Nation à l’Humanité sans passer par l’Empire. Tout comme au Moyen Âge, l’Allemagne a dû se rendre compte à son corps défendant qu’on ne pouvait pas arriver à l’Empire, sans parcourir les étapes féodale et nationale. Avant de s’incarner dans l’Humanité, le Weltgeist hégélien, qui a abandonné les Nations, séjourne dans les Empires.
Le génie politique de Staline consiste précisément dans le fait de l’avoir compris. L’orientation politique sur l’humanité caractérise l’utopie « trotskiste », dont Trotski lui-même fut le représentant le plus marquant, mais nullement unique. En combattant Trotski, et en abattant – en Russie – le « trotskisme », Staline a rejoint la réalité politique du jour en créant l’URSS en tant qu’Empire slavo-soviétique. Sans mot d’ordre antitrotskiste : « Le socialisme dans un seul pays », engendra ce « soviétisme », ou si l’on préfère cet « impérial-socialisme », qui se réalise dans et par l’État impérial soviétique actuel, et qui n’a que faire de l’internationalisme « classique », « deuxième », « troisième » ou autre. Et cet « impérial-socialisme », qui se révèle politiquement viable, s’oppose tout autant à l’utopie « trotskiste » du socialisme internationaliste « humanitaire », qu’à l’anachronisme hitlérien du « national-socialisme », fondé sur la réalité politiquement surannée de la Nation.
Et c’est encore par la compréhension de la réalité impériale que se manifeste le génie politique des dirigeants de l’État anglais, celui de Churchill notamment. Cet État avait déjà, avant la guerre, une structure « impériale », c’est-à-dire trans- et internationale, dans son aspect du British Commonwealth, de l’union de dominions. Mais même cet « Empire » encore trop « national » s’est révélé être insuffisant pour s’affirmer politiquement dans les conditions créées par la guerre actuelle. C’est l’Empire anglo-saxon, c’est-à-dire le bloc politico-économique anglo-américain, qui est aujourd’hui la réalité politique efficace et effective. Et le génie politique de l’Angleterre se manifeste par le fait de l’avoir compris, d’en avoir tiré et subi les conséquences. Aussi, au lieu d’escompter (à l’instar de l’Allemagne) les imaginaires et spectaculaires « différends » anglo-américains, qui – même s’ils existent – ne peuvent être que transitoires, il faudrait penser et agir politiquement en tenant compte de l’existence dans le monde moderne d’un bloc anglo-saxon, solidement et intimement uni, tant par son économie que dans sa politique.
3. Il serait vain de vouloir maintenir à la longue la réalité politique d’une Nation quelle qu’elle soit dans un monde où subsistent déjà des Empires : l’Empire anglo-saxon, voire anglo-américain, et l’Empire slavo-soviétique. Même la Nation allemande, de beaucoup la plus puissante des Nations proprement dites, ne peut plus y mener une guerre victorieuse, étant ainsi incapable de s’y affirmer politiquement en tant qu’État. Et on peut escompter que même ce peuple foncièrement « utopique » et caractérisé par une absence remarquable du sens des réalités politiques, n’entreprendra plus jamais une guerre simultanée contre les deux Empires en question. Autrement dit, l’Allemagne de demain devra adhérer politiquement à l’un ou à l’autre de ces Empires.
On peut, d’ailleurs, prévoir que l’Allemagne va s’orienter du côté anglosaxon. Et on ne risque guère de se tromper en supposant que le bloc anglo-américain se transformera d’ici peu en un Empire germano-anglosaxon. Car dans dix ou quinze ans, la puissance économique et militaire, c’est-à-dire politique, de l’URSS exigera .et suscitera un contrepoids en Europe. Or l’expérience de 1940 a prouvé que ce n’est certainement pas la France qui pourra le fournir. Seule l’Allemagne (soutenue par le monde anglo-saxon) est capable de jouer ce rôle, et il n’y a donc pas de doute que le spectacle d’une Allemagne réarmée va s’offrir à la génération à venir.
Certes, l’adhésion de l’Allemagne à l’Empire slavo-soviétique n’est pas absolument impossible, mais elle est fort peu probable, voire pratiquement exclue. D’abord parce qu’une hostilité méprisante, profonde et séculaire, oppose les Germains aux Slaves, tandis que la « parenté » nationale entre Allemands et Anglo-Saxons, doublée d’une sympathie sincère, quoique pas toujours partagée, pour l’Angleterre, suggère à l’Allemagne l’orientation anglo-saxonne. Ensuite parce que l’inspiration protestante de l’État prussoallemande rapproche des États anglo-saxons modernes, nés eux aussi de la Réforme, et l’oppose aux États slaves de tradition orthodoxe. De plus, les signes apparents de la puissance et de l’opulence anglo-saxonnes, dont témoignent entre autres le traitement des prisonniers et le comportement des troupes d’occupation, en imposent d’autant plus aux Allemands qu’ils ont toujours eu une admiration sans bornes pour leurs cousins d’outre Manche, tandis que les spectacles de désolation observés en URSS paraissent avoir produit une impression « antisoviétique » même dans les masses ouvrières et les milieux communisants. Tout fait donc supposer que les hommes qui seront un jour au pouvoir en Allemagne, opteront sans réserves pour les Anglo-Saxons s’ils ont à choisir entre eux et les Russes. C’est d’ailleurs ainsi qu’on semble envisager la situation à Londres. Et on dirait que même à Moscou, on n’envisage pas la possibilité d’une absorption politique de l’Allemagne. Car autrement on ne s’expliquerait ni la suppression de la IIIe Internationale, ni les aspects slavo-orthodoxes de la politique soviétique.
Mais en ce qui concerne les destins politiques de la France prise isolément, l’alternative qui s’offre à l’Allemagne ne présente, en dépit des apparences, qu’un intérêt tout théorique. Si l’Allemagne devait être « soviétisée », la France subirait certainement tôt ou tard le même sort. Et dans l’autre éventualité, elle sera réduite au rôle effacé d’un Hinterland militaire et économique, et par suite politique, de l’Allemagne, devenue l’avant-poste militaire de l’Empire anglo-saxon. Dans les deux cas la situation de la France est donc politiquement intenable. Mais, ce qui est peut-être moins évident quoique tout aussi indéniable, – cette situation reste intenable même si l’on fait abstraction de l’Allemagne, en supposant que – par impossible – 96 celle-ci reste à jamais politiquement et économiquement impuissante, c’est-à-dire désarmée. Le seul fait de l’existence des Empires anglo-saxon et slavo-soviétique rend illusoire l’autonomie politique de la Nation française comptant à peine quarante millions d’individus. Car elle est bien trop faible pour pouvoir pratiquer une « politique de bascule », en « jouant sur les différends » russo-anglo-saxons. Et son bon sens politique traditionnel ne lui permettrait d’ailleurs jamais d’essayer de reprendre à son compte le jeu politique absurde de la Pologne du colonel Beck. La France isolée devra choisir entre les deux Empires qui s’affrontent. Or la situation géographique, les traditions économiques et politiques, ainsi que le « climat » psychologique, déterminent d’une façon univoque le choix anglo-saxon. L’avenir de la France isolée est donc un « statut de dominion », plus ou moins camouflé. Et tel sera aussi le sort des autres Nations de l’Europe occidentale, si elles s’obstinent à rester dans leur isolement politique « national ».
Du point de vue social, économique et psychologique, cette solution peut paraître acceptable. Et en effet elle n’est inadmissible qu’au point de vue spécifiquement politique, car elle signifie la disparition totale et définitive de la Nation en tant qu’État vraiment digne de ce nom. Or l’expérience historique a démontré que, une fois privée de ses cadres politiques, la civilisation elle-même subit des transformations profondes, se stérilise et se désagrège peu à peu, et perd assez vite le poids spécifique qu’elle avait dans le monde tant qu’elle était la civilisation d’un État. Celui qui voudrait sauvegarder l’existence et le rayonnement de la civilisation traditionnelle latino-catholique qui est aussi celle de la France (et à laquelle la France a d’ailleurs contribué beaucoup plus que toutes les autres Nations latines prises ensemble), doit donc vouloir lui donner une base politique suffisante dans les conditions historiques données. Et celui qui le ferait servirait non seulement les intérêts culturels de son pays, mais encore ceux de l’humanité toute entière. Car les Anglo-Saxons, les Germains et les Slaves ne possèdent pas et ne posséderont jamais ce que les Latins, ayant les Français à leur tête, ont offert et offrent encore au monde civilisé.
Or si l’on veut maintenir les valeurs latines et catholiques, qui sont aussi les valeurs éminemment françaises, et leur assurer un rayonnement mondial, ou en d’autres termes, si l’on ne veut pas laisser le monde politique en partage aux forces réciproquement hostiles et antagonistes des Empires slavo-soviétique et anglo-saxon, si l’on veut compléter ces deux puissances – et civilisations – par une troisième, amortissante, pacifique, synthétique –, ce n’est pas une Nation, ce n’est pas en particulier la France qu’il faudrait leur coordonner. Aux côtés de l’Empire slavo-soviétique de tradition orthodoxe, et de l’Empire anglo-saxon, et peut-être germano-anglosaxon, d’inspiration protestante, il faut créer un Empire latin. Seul un tel Empire sera au niveau politique des deux Empires déjà existants, car lui seul serait capable de soutenir éventuellement une guerre où son indépendance serait en jeu.Et c’est seulement en se mettant à la tête d’un tel Empire que la France pourrait se maintenir dans sa spécificité politique, et par conséquent aussi culturelle.
Cette possibilité de faire la guerre ne signifie, d’ailleurs, nullement la nécessité de la mener effectivement. Bien au contraire, ce n’est qu’en s’englobant dans l’Empire latin qu’elle devra faire naître, que la France assurera la paix pour elle-même et pour l’Europe toute entière. Cet Empire ne sera jamais assez fort pour pouvoir attaquer les Empires qui lui seront coordonnés, de sorte que ses chefs n’auront pas la tentation trop fréquente de transformer en « impérialisme » leur politique impériale. Mais il sera suffisamment puissant pour enlever à quiconque l’envie de l’attaquer, à condition bien entendu de ne pas se brouiller à la fois avec ses deux adversaires impériaux possibles. Si ces deux Empires devaient s’affronter un jour dans une lutte guerrière, le seul fait de l’existence d’un Empire latin les obligerait à limiter leurs champs de bataille à l’Asie et au Pacifique, en épargnant l’Europe qui est décidément trop petite et trop précieusement « vieille » pour être soumise à l’épreuve des engins destructeurs de demain.
II. La situation de la France
1. L’analyse objective de la situation historique montre clairement que si la France reste politiquement isolée, si elle s’obstine à vouloir vivre en tant que Nation exclusive, elle devra nécessairement cesser tôt ou tard d’exister en tant qu’État proprement dit, en tant que réalité politique autonome. Elle finira fatalement par être politiquement absorbée par l’Empire anglo-saxon, qui a des chances de devenir un Empire germano-anglo-saxon. Or, étant donné les différences de « race », de culture, de langue et de religion, de traditions et de « style de vie », il ne peut être question d’une fusion véritable entre cet Empire et la France. Celle-ci y restera toujours un corps plus ou moins étranger, et elle ne pourra par conséquent y jouer qu’un rôle excentrique et donc effacé : le rôle d’un satellite, d’un « second » qui – en politique – n’est ni toujours ni nécessairement « brillant ». En un mot, dans cette hypothèse, la France cesse d’être un but en soi et s’abaisse au niveau d’un simple moyen politique.
Mais ce n’est pas seulement le poids spécifique politique de la France qui deviendra négligeable si celle-ci se laisse absorber par l’Empire anglosaxon. Son économie n’y jouera elle aussi plus qu’un rôle tout à fait secondaire. Aussi le fonctionnement économique de la France, et par suite sa structure sociale même, devront se transformer petit à petit pour se conformer et s’adapter aux modèles et aux exigences qui, venant du dehors, seront souvent en désaccord flagrant avec les traditions et les aspirations qui, tout en étant dans leur fond catholiques et latines, n’en sont pas moins authentiquement françaises. Enfin, n’étant plus soutenue ni par une activité économique indépendante, ni par une réalité politique autonome, la civilisation française elle-même ne pèsera pas lourd au sein du monde anglo-saxon, et par conséquent du monde en général. Loin de rayonner au dehors, la France subira à l’intérieur d’elle-même l’influence de la civilisation anglo-saxonne, foncièrement protestante dans sa forme moderne et au fond « germanique », qui sera soutenue par le prestige écrasant de la force politique et de la puissance économique du bloc anglo-américain. Influence dont on perçoit peut-être les premiers vestiges dans l’aspect physique et moral de la jeunesse française nourrie de films et de romans d’outreManche et d’au-delà d’océan. On peut donc supposer qu’en renonçant à l’existence politique autonome, c’est-à-dire à l’État, la France perdra non seulement « la face », mais encore son visage même.
Les signes avant-coureurs de cet état de choses se font d’ailleurs sentir dès maintenant. Ainsi l’attitude de certains pays étrangers et les réactions d’une partie des hôtes – militaires et civils – de la France donnent peut-être un avant-goût sinon du mépris du moins de l’indifférence du monde de demain vis-à-vis de ce pays et de sa civilisation. Mais ce qui est infiniment plus grave, c’est que les conséquences désastreuses de la dépolitisation se font jour dès maintenant au sein même de la Nation française. Car il n’y a pas de doute que la décadence de celle-ci, que nul ne conteste et sur laquelle il est inutile – et pénible – d’insister, va de pair avec l’amoindrissement politique du pays, qui de son côté se manifeste ou s’explique par la perte d’une volonté politique véritable, éclairée et opérante. Car il est bien difficile de nier ou même de ne pas voir que la France d’avant-hier, d’hier – et même d’aujourd’hui – n’a pas ou n’a plus d’idée politique nette et consciente. Non seulement en fait, mais dans sa conscience même, le Français moderne vit en « bourgeois » et non en « citoyen ». Il agit et pense en « individualiste » en ce sens que les intérêts « privés », « particuliers », sont pour lui les valeurs-suprêmes ou uniques. Et il est « libéral » ou « libertaire » et « pacifiste » surtout parce qu’il ne veut plus subir le poids et les exigences de la réalité « universelle » de l’État et des moyens qu’elle emploie pour s’affirmer et se maintenir dans l’existence.
Or il est bien évident que cette dépolitisation de la France et des Français se manifeste non pas seulement par une décadence politique proprement dite, tant extérieure qu’intérieure, mais encore par un amoindrissement général, tant économique et social que culturel et moral. On voit donc dès maintenant qu’en cessant d’être un État grand et fort, animé d’une volonté politique efficace – concrète, positive et précise –, la France cesse d’être le pays d’avant-garde qu’elle a toujours été jusqu’ici, et devient un pays arriéré – dans presque tous les domaines.
2. On a souvent posé la question du pouvoir de cette décadence de la France, qui contraste tellement avec le passé brillant et glorieux du pays. Les explications par la « dégénérescence », la « corruption », la « fatigue », etc., sont trop vagues et générales pour signifier vraiment quelque chose. On pourrait semble-t-il en donner une raison plus concrète et partant plus convaincante.
D’une part, dans le domaine de l’idéologie politique, le pays continue à vivre sur la base des idées qui furent définitivement élaborées au cours de la Révolution. L’idéal politique « officiel » de la France et des Français est aujourd’hui encore celui de l’État-Nation, de la « République une et indivisible ».
D’autre part, dans les profondeurs de son âme, le pays se rend compte de l’insuffisance de cet idéal, de l’anachronisme politique à l’idée strictement « nationale ». Certes, ce sentiment n’a pas encore atteint le niveau d’une idée claire et distincte : le pays ne peut pas, et ne veut pas encore le formuler ouvertement. D’ailleurs, en raison même de l’éclat hors pair de son passé national, il est particulièrement difficile pour la France de reconnaître clairement et d’accepter franchement le fait de la fin de la période « nationale » de l’Histoire et d’en tirer toutes les conséquences. Il est dur pour un pays qui a créé de toute pièce l’armature idéologique du nationalisme et qui l’a exportée dans le monde entier, de reconnaître qu’il ne s’agit là désormais que d’une pièce à classer dans les archives historiques, et d’adhérer à une nouvelle idéologie « impériale », à peine ébauchée d’ailleurs, et qu’il faudrait précisément élucider et mettre en formule pour l’élever au niveau de la cohérence et de la clarté logiques de l’idéologie « nationale ». Et pourtant, la vérité politique nouvelle pénètre peu à peu dans la conscience collective française. Elle s’y révèle d’abord négativement, par le fait que la volonté générale ne se laisse plus galvaniser par l’idéal de la Nation. Les rappels de la puissance de la République indivisible sonnent creux et faux, et l’appel à la grandeur de la France ne trouve plus l’écho qu’il provoquait encore lors de la guerre 1914-1918.
On pourrait presque dire que pour le « Français moyen », la guerre actuelle n’impliquait dès le début que deux possibilités politiques : la subordination politico-économique de la France soit à l’Allemagne, soit à l’Angleterre. Et en effet, par moments tout au moins, cette guerre ne provoquait en France des « passions » que dans la mesure où il s’agissait du conflit entre ces deux tendances « collaborationnistes », conflit où se cristallisait l’opposition traditionnelle, irréductible et désastreuse de la Droite et de la Gauche. Or c’est peut-être précisément à cause de cela que le soldat français n’a pas donné son plein en 1940, et qu’après la Libération le mouvement de la Résistance ne rappelle que de fort loin la levée en masse des temps jadis. Si le Français moyen se refuse visiblement à mourir, et même à se discipliner et à se « restreindre », pour que vive la France, c’est peut-être tout simplement parce qu’il se rend plus ou moins consciemment compte que « la France » de la tradition nationale et nationaliste est un idéal qui, politiquement, n’est plus viable à l’heure actuelle. Car aucun homme raisonnable ne voudra sacrifier ses valeurs particulières pour un but « universel » qui n’est qu’une idée abstraite, c’est-à-dire un mirage du passé ou un présent sans avenir, bref – un rêve nostalgique ou une aventure irresponsable.
3. Ainsi interprétés, l’effondrement militaire et moral de la France en 1940, ainsi que le malaise politique qui y règne jusqu’aujourd’hui, apparaissent comme des gages du redressement et de la renaissance du pays.
On pourrait dire qu’un pays tel que l’Allemagne, qui est capable de courir après une illusion jusqu’à la· dernière limite de ses forces, de s’enthousiasmer pour un rêve romantique et romanesque, de sacrifier les valeurs réelles à un idéal suranné et non viable, est politiquement sans espoir. Mais « l’objection de conscience » des Français dans cette guerre prouve que la volonté générale ne peut se former en France qu’autour d’une idée véritablement et réellement efficace, que la conscience politique y implique un sens aigu des réalités, et que d’une manière générale elle est fondée sur un solide bon sens.
Or rien ne prouve qu’un pays qui se dérobe au rêve se refusera à la réalité, que les hommes qui ne veulent pas se sacrifier à une illusion politiquement anachronique ne se subordonneront pas entièrement à une idée politique efficace dans le présent concret, en réalisant ainsi un redressement total de la vie collective. En tout cas, c’est là une expérience qui n’a pas encore été tentée dans la France contemporaine. C’est donc une expérience à y faire.
Pour tenter cette expérience il faudrait, en s’allégeant du poids devenu écrasant du passé glorieux et séculaire de la Nation, proclamer clairement et en toute franchise que la période « nationale » de l’Histoire est close, que la France est politiquement morte une fois pour toutes en tant qu’État-Nation. Mais il faudrait ajouter en le disant, que cette fin est en même temps un commencement, qu’ici encore la mort est aussi une renaissance. Car la Nation peut et doit se dépasser dans et par une union internationale de Nations parentes, où elle doit et peut réaffirmer sa spécificité culturelle, sociale et politique en l’imposant, dans une émulation pacifique, fraternelle, égalitaire et libre, à l’ensemble plus large qu’elle contribue à créer en se supprimant elle-même en tant que Nation exclusive et isolée. Si la Nation ne meurt que pour engendrer l’Empire, si l’abdication nationale est le prélude de l’accès au trône impérial, la proclamation au peuple de la fin de la République renfermée en elle-même et limitée par des frontières devenues trop étroites, ne sera rien moins que déprimante. Cette proclamation pourrait au contraire avoir un effet politique stimulant.
Dans la réalité concrète de la situation historique actuelle, une seule idée politique vraiment viable, ayant par conséquent des chances d’être acceptée par la conscience collective et d’engendrer et déterminer une volonté générale, semble pouvoir être présentée à la France. C’est l’idée-idéal de l’Empire latin, où le peuple français aurait pour but et pour devoir le maintien de son rang de primus inter pares.
Ill. L’Idée de l’empire latin
1. L’ère où l’Humanité prise dans son ensemble sera une réalité politique se situe encore dans un avenir lointain. La période des réalités politiques nationales est révolue. L’époque est aux Empires, c’est-à-dire aux unités politiques transnationales, mais formées par des Nations apparentées.
Cette « parenté » entre Nations, qui devient actuellement un facteur politique primordial, est un fait concret indéniable n’ayant rien à voir avec les idées « raciales » généralement vagues et incertaines. La « parenté » des Nations est surtout et avant tout, une parenté de langage, de civilisation, de« mentalité » générale ou comme on dit aussi, – « de climat ». Et cette parenté spirituelle se traduit aussi entre autres par l’identité de la religion.
Une parenté ainsi conçue existe sans aucun doute entre les Nations latines, française, italienne et espagnole en premier chef. Tout d’abord ces nations sont éminemment catholiques, même si elles sont « anticléricales ». En ce qui concerne la France par exemple, l’observateur étranger est frappé en voyant à quel point les « libres penseurs » et même les protestants et les israélites y sont pénétrés par la mentalité catholique plus ou moins laïcisée, dans la mesure tout au moins où ils pensent, agissent ou réagissent en Français. En outre, l’étroite parenté des langues rend le contact entre pays latins particulièrement aisé. En ce qui concerne en particulier la France, l’Italie et l’Espagne, il suffirait dans chaque pays de rendre obligatoire l’étude approfondie (d’ailleurs très facile) d’une seule des deux langues latines étrangères pour supprimer tous les inconvénients que provoque une diversité de langage. D’ailleurs les civilisations latines sont elles-mêmes proches parentes. Si certains retards dans l’évolution pourraient faire croire actuellement à des divergences profondes (du côté espagnol notamment), l’interprétation qui avait lieu à l’origine (ainsi qu’à l’époque de la Renaissance, qui est probablement la période historique latine par excellence) garantit la possibilité d’atteindre à brève échéance une harmonisation parfaite des divers aspects de la civilisation du Monde latin. D’une manière générale, les différences des caractères nationaux ne peuvent pas masquer l’unité foncière de la « mentalité » latine, qui frappe d’autant plus les étrangers qu’elle est si souvent méconnue par les Latins eux-mêmes. Il est, certes, difficile de définir cette mentalité, mais on voit immédiatement qu’elle est unique en son genre dans son unité profonde. Il semble que cette mentalité est caractérisée dans ce qu’elle a de spécifique par cet art des loisirs qui est la source de l’art en général, par l’aptitude à créer cette « douceur de vivre » qui n’a rien à voir avec le confort matériel, par ce « dolce farniente » même qui ne dégénère en simple paresse que s’il ne vient pas à la suite d’un travail productif et fécond (que l’Empire latin fera, d’ailleurs, naître par le seul fait de son existence).
Cette mentalité commune, qui implique un sens profond de la beauté associé généralement (et tout particulièrement en France) à un sentiment très marqué de la juste mesure, et qui permet ainsi de transformer en « douceur » aristocratique de vivre, le simple bien-être « bourgeois » et d’élever souvent jusqu’à la joie, les plaisirs qui dans une autre ambiance seraient (et sont dans la plupart des cas) des plaisirs « vulgaires », – cette mentalité n’assure pas seulement aux Latins la possibilité de leur union réelle, c’est-à-dire politique et économique. Elle justifie aussi en quelque sorte cette union aux yeux du monde et de !’Histoire. Du monde, – car si les deux autres Unions impériales seront probablement toujours supérieures à l’Union latine dans le domaine du travail économique et des luttes politiques, il est permis de supposer qu’elles ne sauront jamais donner d’elles-mêmes à leur repos la perfection à laquelle pourrait arriver dans des circonstances favorables l’Occident latin unifié. Et de !’Histoire –, car en supposant que les conflits nationaux et sociaux seront définitivement éliminés un jour (qui est peut-être moins lointain qu’on ne le pense), il faut bien admettre que c’est précisément à l’organisation et à I’ « humanisation » de ses loisirs que l’humanité future devra consacrer ses efforts. (Marx lui-même n’a-t-il pas dit, en répétant sans s’en rendre compte un mot d’Aristote, que le mobile dernier du progrès, et donc du socialisme, est le désir d’assurer à l’homme un maximum de loisir ?).
La parentélatine, fondée sur l’unité de substance et de genèse, est déjà un Empire en puissance qu’il s’agit seulement d’actualiser politiquement dans les conditions historiques concrètes de notre temps, qui sont d’ailleurs propices aux formations impériales. Et il ne faut pas oublier que l’unité latine est déjà dans une certaine mesure actualisée ou réalisée dans et par l’unité de l’Église catholique. Or, l’aspect religieux et ecclésiastique (nettement distinct de l’aspect « clérical ») n’est de nos jours rien moins que négligeable. D’une part on serait tenté d’expliquer l’essor prodigieux des pays germaniques et anglo-saxons au cours des Temps modernes par l’interprétation intime de l’Église et de l’État dans le Monde protestant ; et il n’y a. pas de doute que l’Empire anglo-saxon et germano-anglo-saxon, foncièrement « capitaliste », est aujourd’hui encore d’inspiration nette ment protestante. (Certains sociologues voient même dans le protestantisme la source dernière du capitalisme.) D’autre part, en dépit de ses débuts radicalement athées, l’URSS a redécouvert l’Église orthodoxe et utilise son appui tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (avant tout dans les Balkans) ; de plus en plus, l’URSS prend ainsi figure d’un Empire non seulement slavo-soviétique, mais encore orthodoxe. Il semble donc bien que les deux formations impériales modernes tirent une partie de leur cohésion et donc de leur puissance d’une association plus ou moins officielle avec les Églises correspondantes. Et on peut admettre que l’existence de l’Église catholique constitue dans les conditions historiques actuelles un appel à la formation d’un Empire catholique, qui ne peut être que latin. (N’oublions pas, d’ailleurs, que le catholicisme a surtout cherché, en faisant souvent appel à l’art, à organiser et à humaniser la vie « contemplative », voire inactive de l’homme, tandis que le protestantisme, hostile aux méthodes de la pédagogie artistique, s’est surtout préoccupé de l’homme-travailleur).
La parenté spirituelle et psychique qui unit les Nations latines semble devoir assurer à leurs relations à l’intérieur de l’Empire, ce caractère de liberté, d’égalité et de fraternité sans lequel il n’y a pas de démocratie véritable. Et on pourrait même croire que c’est seulement en instaurant la démocratie dans l’ensemble du Monde latin qu’on peut lui enlever ce caractère « municipal » qu’elle possède tant qu’elle reste renfermée dans des frontières purement nationales. Seul l’Empire avec ses ressources matérielles quasi illimitées semble pouvoir permettre de dépasser l’opposition stérile et paralysante de la Gauche et de la Droite, irréductible au sein de la seule Nation, par définition pauvre et donc sordide. Seules des tâches impériales semblent pouvoir engendrer ce Parti rénovateur dans la tradition, mais dans une tradition nullement « réactionnaire », qui a fait la force de l’Angleterre, que les pays latins n’ont jamais connu, et sans lequel la vie politique démocratique a toujours tendance à verser dans l’anarchie et le laisser-aller. Enfin, l’organisation de l’Empire latin, qui serait essentielle ment autre chose que le Commonwealth anglo-saxon ou l’Union soviétique, poserait à la pensée politique démocratique des problèmes inédits qui lui permettraient de dépasser enfin son idéologie traditionnelle, adaptée aux seuls cadres nationaux et par conséquent anachronique. C’est peut-être en déterminant les rapports entre les Nations au sein d’un Empire (et à la limite de l’Humanité) que la démocratie aura de nouveau quelque chose à dire au monde contemporain.
Cependant, en dépit – ou peut-être en raison même – de l’étroite « parenté » des peuples impériaux et donc du caractère « familial » de la vie de l’Empire, il y aura nécessairement, parmi les Nations unies, une Nation qui sera I’« aînée » des autres et la première parmi ses pairs. C’est le peuple russe qui joue ce rôle dans l’Empire slavo-soviétique, et ce sont probablement les États-Unis qui seront à la tête de l’Union de fait anglo-saxonne, même si elle est appelée à être complétée par des éléments germaniques. Quand au futur Empire latin, il est bien évident que c’est la France qui devra y occuper la première place. Des raisons politiques, économiques et culturelles l’y portent et l’y engagent. En particulier, en ce qui concerne l’Espagne, le facteur démographique assure à lui seul le premier rang à la France. Et par rapport à l’Italie, c’est-à-dire là où le facteur démographique est défavorable aux Français, c’est l’industrie française (située à proximité du minerai de fer et de la bauxite, ainsi que du charbon sarrois, belge et allemand) qui rétablira l’équilibre conforme au poids spécifique politique et culturel de la France.
2. Si la parenté spirituelle indéniable des peuples latins rend possible la création d’un Empire, elle ne suffit certainement pas à elle seule pour en assurer la réalité.
Pour pouvoir tenir tête aux deux formations impériales déjà constituées, il ne suffit pas à la France d’évoquer de temps en temps l’existence de « sœurs latines » ; il ne suffit pas aux Latins de conclure entre eux des « Pactes » plus ou moins balkaniques, ni de former des alliances dans le style des « Ententes », petites ou autres. Il s’agit de créer une unité politique, réelle et efficace, qui serait non moins une, réelle et efficace que le British Commonwealth of Nations ou l’Union des Républiques soviétiques.
S’il faut atteindre le degré d’unité et d’efficacité de ces deux formations impériales, ceci ne signifie pas qu’on doive imiter servilement la structure politique de l’une d’elles. Au contraire, tout porte à croire que les Latins devront, et pourront, trouver une formule impériale inédite. Car il s’agit pour eux d’unir des Nations riches d’un long passé indépendant. Et il est encore moins nécessaire de calquer l’organisation sociale et économique des deux Empires rivaux. Car rien ne prouve que le « libéralisme » à base de grands trusts autonomes et de chômage massif cher au bloc anglo-saxon et I’« étatisme » nivélateur et quelque peu «barbare» de l’Union soviétique, épuisent toutes les possibilités d’organisation économique et sociale rationnelle. En particulier, il est bien évident qu’une structure impériale « soviétique » n’a rien à voir avec le « communisme », et peut en être facilement détachée.
L’essentiel est que l’Union latine soit vraiment un Empire, c’est-à-dire une entité politique réelle. Or de toute évidence elle ne peut l’être qu’à condition de former une véritable unité économique.
Il semble bien que les peuples latins ne puissent créer une telle unité que si la France, l’Italie et l’Espagne commencent par mettre en commun les ressources de leurs patrimoines coloniaux. Autrement dit, les possibilités de travailler dans et pour les possessions coloniales doivent être les mêmes pour tous les ressortissants de ces trois pays (la France faisant, d’ailleurs, tout ce qui est dans son pouvoir pour obtenir des Alliés la restitution à l’Italie, voire à l’Empire latin, des colonies italiennes de l’Afrique du Nord). C’est l’Empire en tant que tel qui doit établir un plan unique de l’exploitation coloniale et fournir tous les moyens nécessaires à sa réalisation. Et c’est encore l’Empire dans son ensemble qui doit bénéficier des avantages résultant de cet effort commun de pensée planifiante et de travail organisé. Somme toute, c’est l’unité économique du bloc continu des possessions africaines qui doit être la base réelle et le principe unifiant de l’Empire latin.
Il se peut en outre que c’est dans ce monde latino-africain unifié que pourra être résolu un jour le problème musulman (et peut-être le problème « colonial » en général). Car depuis les Croisades, l’Islam arabe et le Catholicisme latins ont unis dans une opposition à plusieurs points de vue synthétique (influence de la pensée arabe sur la scolastique, la pénétration de l’art islamique dans les pays latins, etc.). Et rien ne dit qu’au sein d’un véritable Empire cette synthèse d’opposés ne puisse être dégagée de ses contradictions internes, qui ne sont vraiment irréductibles que tant qu’il s’agit d’intérêts purement nationaux. Or une entente entre la Latinité et l’Islam rendrait étrangement précaire la présence d’autres forces impériales dans le bassin méditerranéen.
Mais bien entendu, l’union économique coloniale doit être complétée par une union économique métropolitaine. Des ententes privées ou étatiques doivent mettre à la disposition de l’Empire l’ensemble des ressources minérales et agraires qu’offre le sol des pays impériaux. Ces mêmes ententes doivent également assurer une distribution rationnelle entre les participants des tâches imposées par la sécurité politique ou militaire et les besoins économiques et sociaux de l’ensemble impérial. Enfin, une doctrine concertée du commerce extérieur, soutenue s’il y a lieu par une politique douanière commune, doit assurer à l’Empire la possibilité d’affronter, à l’exportation, le marché mondial et d’opposer s’il y a lieu, à l’importation, un monopole d’achat à des éventuels monopoles de vente.
Qu’on ne vienne pas dire que du point de vue économique c’est la France qui fera tous les frais de la création de l’Empire envisagé, tandis que l’Italie et l’Espagne se contenteront d’en récolter les bénéfices. Même sans parler des ressources minérales espagnoles, on peut dire que ces deux pays participeront à l’économie impériale par la main-d’œuvre qu’ils mettront à la disposition de l’Empire (et donc de la France). Or il ne faut pas oublier que le travail, c’est-à-dire la main-d’œuvre et donc la population en général, sont la forme la plus authentique de la richesse nationale.
Tout le monde est d’accord pour dire que la population actuelle de la France ne suffit pas pour maintenir, ou pour élever, l’économie française au niveau de l’économie d’une grande puissance moderne. Or il serait utopique d’escompter une augmentation massive de cette population. Une politique démographique habile et efficace restera, certes, toujours d’une nécessité vitale pour ce pays. Mais elle pourra tout au plus maintenir la population proprement française à son niveau actuel. Quand à l’immigration, la France voit déjà se tarir la source européenne orientale de la main-d’œuvre qui lui fait défaut, et c’est vers ses voisins latins qu’elle doit de toute façon porter ses regards. Mais il est bien évident que dans le domaine de la main-d’œuvre la France sera aux prises avec les pires difficultés tant qu’elle restera purement et exclusivement nationale. De même, quoique pour une raison diamétralement opposée, le nationalisme isolant et exclusif (d’ailleurs politiquement impraticable et pratiquement déjà inexistant) ne profite pas non plus aux deux autres pays latins. Car les économies italienne et espagnole, limitées à leurs ressources nationales, ne suffisent visiblement pas pour assurer à leurs populations un niveau de vie tant soit peu acceptable par un Européen moderne, ni pour absorber l’accroissement démographique annuel qu’on y constatait jusqu’ici.
Par contre, un Empire latin comptant 110 ou 120 millions de citoyens (d’ailleurs authentiques, quant à leur mentalité et aspect extérieur) serait sans aucun doute capable d’engendrer et d’entretenir une économie de grande envergure, plus modeste certes, mais au moins comparable aux économies anglo-saxonne et slavo-soviétique. Cette économie permettrait de son côté d’élever dans l’avenir le niveau de vie dans l’ensemble de l’Empire, c’est-à-dire en premier chef en Espagne et en Italie du Sud. En améliorant dans ces régions les conditions matérielles de l’existence, on y verrait sans aucun doute monter en flèche la courbe démographique dans les décades à venir. Et cette extension continuelle (et en principe illimitée) du marché intérieur, secondée par une offre toujours accrue d’emplois, permettrait à l’économie impériale de se développer en évitant tant les crises cycliques inévitables de l’économie anglo-saxonne à marché intérieur pratiquement saturé que la stabilité rigide et opprimante de l’économie soviétique.
On peut donc escompter qu’à très brève échéance la France profitera elle-même des prétendus « sacrifices » consentis par elle au profit de l’Empire latin. Car insérés dans l’unité impériale, son sol métropolitain et ses colonies, même exploitées en commun, lui rapporteront sans aucun doute beaucoup plus que ne pourrait rapporter leur exploitation exclusive strictement « nationale », réglée par des principes économiques soi-disant « égoïstes », mais en réalité simplement surannés.
3. L’union économique est la condition sine qua non de l’unité impériale latine. Mais elle n’est pas la raison d’être de l’Empire latin. Le but dernier et véritable de l’union impériale est foncièrement politique, et c’est une idéologie spécifiquement politique qui doit l’engendrer et l’inspirer.
Or la catégorie politique fondamentale est celle de l’indépendance ou de l’autonomie. On dit généralement que la volonté politique est une volonté de puissance ou de « grandeur ». Sans doute. Mais il serait plus correct et plus précis de dire que toute volonté vraiment politique est avant tout une volonté autonome et une volonté d’autonomie. Car la « puissance » n’est qu’un moyen de réaliser l’autonomie, et la « grandeur » est une simple conséquence de cette réalisation. Considéré en tant qu’entité politique, l’État ne fait que matérialiser une volonté d’autonomie ; c’est par elle qu’il se crée et se maintient, car c’est par elle qu’il intègre et domine les volontés particulières par ailleurs disparates, en faisant surgir d’elles une « volonté générale », qui n’est rien d’autre que sa propre volonté d’autonomie devenue aussi explicite et efficace. Inversement, un État qui n’est plus animé par une volonté d’autonomie absolue, s’abaisse au niveau d’une simple administration, devant servir au mieux les intérêts privés qu’elle est d’ailleurs incapable de concilier.
Créer un Empire latin censé pouvoir exister en tant qu’entité politique, c’est donc créer et maintenir une « volonté générale » latine, autonome dans son vouloir et voulant le maximum d’autonomie compatible avec la situation politique générale du jour. Autrement dit, les agissements de cet Empire doivent découler en dernière analyse de la volonté d’union des peuples impériaux et être indépendants, dans la mesure du possible et du raisonnable, des volontés ou actions étrangères. Pratiquement cela signifie que les décisions prises par l’Empire et portant tant sur sa structure et son comportement interne que sur ces rapports avec l’étranger, ne doivent pas être prises uniquement en fonction des désirs et des actes des deux Empires rivaux déjà existants.
Si chacun des trois pays latins en question voulait s’inspirer dans son action collective, c’est-à-dire étatique ou politique, d’une volonté – éclairée par la raison et par conséquent « réaliste », voire efficace – d’autonomie latine, l’unité intégrante de leur triple activité en résulterait automatique ment. Mais si l’unité de l’action politique extérieure est une conséquence immédiate de l’existence d’une volonté d’autonomie, elle est aussi la prémisse nécessaire de la réalité efficace d’une volonté autonome. L’Empire ne peut donc exister qu’à condition d’établir un principe directeur unique de politique extérieure accepté par tous les participants, et ceci tant dans le domaine de la direction générale que dans celui de l’exécution pratique.
Comme toute volonté en général, la volonté politique d’autonomie ne peut se réaliser qu’en rencontrant et surmontant des résistances. Elle doit donc être armée contre ses dernières, et c’est pourquoi elle doit se concrétiser, entre autres sous la forme d’une armée – de terre, de mer et de l’air. Non pas qu’une volonté d’autonomie soit nécessairement « militariste » ou « belliciste », ni qu’une volonté impériale soit toujours « impérialiste ». Au contraire, le « militarisme » et I’« impérialisme » sont des excroissances d’une volonté d’autonomie au fond chétive, ne disposant pas de moyens d’exécution vraiment puissante (et c’est pourquoi le « militarisme » naît du danger, et surtout de la défaite, c’est-à-dire d’une faiblesse : seulement possible, ou déjà actualisée). Ce sont là des phénomènes qui caractérisent surtout l’existence politique nationale, une Nation étant toujours une base fragile pour la volonté d’autonomie qui l’anime. En lui procurant plus d’efficacité et la sécurité, une base impériale rendrait donc cette volonté foncièrement pacifique, sinon « pacifiste ». Car si l’on fait la guerre pour sauvegarder une autonomie menacée et donc chancelante, c’est dans et par la paix seulement que l’autonomie s’affermit, se réalise et s’épanouit. Mais tant qu’il y aura une pluralité d’Empires dans le monde, chacun d’eux conservera un reste de faiblesse « nationale », voire « nationaliste », et donc de susceptibilité « impérialiste » et belliqueuse. Et c’est pourquoi l’Empire latin aura besoin d’une armée. Il aura besoin d’une armée suffisamment puissante pour pouvoir lui assurer une autonomie dans la paix, et une paix dans l’autonomie et non dans la dépendance vis-à-vis de l’un des deux Empires rivaux. Bien entendu, cette armée impériale doit être une et unique, et elle doit être alimentée à tous les points de vue par l’ensemble de l’Empire. Seul un Empire peut, d’ailleurs, supporter le poids d’une armée efficace dans les conditions modernes, poids qui écraserait l’économie d’une Nation isolée quelle qu’elle soit. Et le potentiel militaire impérial permettrait même de limiter au strict minimum, du moins pendant un certain temps, les armements effectifs, toujours trop coûteux et vieillissant avant l’âge. Mais il est bien évident aussi que la France est appelée à jouer un rôle de tout premier plan dans l’effort militaire de l’Empire. Ici plus qu’ailleurs peut-être, ses vertus militaires séculaires et sa grande expérience lui permettent d’ailleurs d’affronter sans crainte la concurrence coopérante des éléments espagnols et italiens. Et en transmettant un caractère éminemment français à l’armée latine, la France s’assurera par contrecoup une prépondérance générale juste et justifiable au sein de l’Empire que cette armée maintient.
L’armée impériale dirigée par la France a pour but de rendre efficace la « volonté générale » d’autonomie latine en assurant, à l’intérieur et à l’extérieur, l’unité effective de l’Empire latin. Mais elle ne peut le faire qu’en se basant sur cette unité. Or l’unité impériale a pour pivot l’unité du patrimoine colonial, assurée par son exploitation commune. Le maintien de l’unité et de l’intégrité de son domaine colonial est donc la tâche première de la politique diplomatique et militaire de l’Empire latin. C’est dire qu’il ne suffit pas d’exploiter en commun ce domaine. Il faut encore qu’il soit d’un seul tenant et toujours accessible dans son ensemble. Les communications directes entre la métropole impériale et ses colonies doivent être assurées dans tous les cas et notamment en cas d’une guerre. Or il est bien évident que les océans ne sont pas à l’échelle de l’Empire latin (sans parler de la France prise isolément, qui ne saurait assurer même les communications méditerranéennes). Il ne faudrait certes pas en conclure que la France doit renoncer à ses possessions océaniennes, telles que l’Indochine, Madagascar, les îles, etc. Mais il serait vain et dangereux d’essayer de construire une flotte capable de contrôler les voies d’accès qui y mènent. Et ne l’essayant pas, il faut dès le début construire et diriger l’économie et la politique (diplomatique et militaire) impériales en tenant compte du fait que les possessions lointaines peuvent un jour être séparées de la métropole, temporairement ou même définitivement.
Ce qui présente par contre un intérêt vital, c’est que les colonies africaines soient vraiment accessibles à partir de la métropole. Et c’est dire que tout en abandonnant les océans aux rivalités des deux autres Empires, l’Empire latin doit se réserver l’exclusivité de la Méditerranée. Les problèmes stratégiques posés par cette mer sont sans aucun doute au niveau des possibilités militaires de l’Empire latin, qui, riche de la possession de Bizerte et de la Sicile, ainsi que du Hinterland et de l’autre rive de Gibraltar,
pourrait contrôler les communications avec une flotte navale et aérienne très modeste. C’est pourquoi l’idée d’une Méditerranée – mare nostrum pourrait et devrait être le but concret principal, voire unique de la politique extérieure des Latins unifiés. Et qu’on ne dise pas que cette devise a déjà été inscrite sur les étendards fascistes qui ne furent rien moins que glorieux. Le grotesque n’était pas dans l’idée, mais uniquement dans la prétention ridicule de pouvoir la réaliser avec les seuls moyens d’une Nation isolée et exclusive.
En revanche un Empire latin pourrait sans nul doute rendre tout son sérieux à cette vieille formule romaine. A condition, bien entendu, de faire de cette formule l’idée-pilote de toute sa politique et d’y consacrer toutes ses forces.
Bien entendu, il ne s’agit pas de refuser l’accès de la Méditerranée à qui que ce soit. Il s’agit uniquement de la possibilité matérielle de le faire. Ou bien en d’autres termes, il s’agit d’avoir le droit et les moyens de demander une contrepartie à ceux qui voudront circuler librement dans cette mer ou en exclure certains autres, l’accès et l’exclusion ne pouvant se faire qu’avec l’assentiment de l’Empire latin et par les moyens dont il est seul à disposer.
D’une manière générale l’Empire latin ne se fait pas pour attaquer, ni pour amoindrir les autres. Il ne se fait même pas en vue de participer à la guerre future. Bien au contraire, il a pour fin dernière d’assurer la paix à ses participants, et donc à l’Europe occidentale toute entière. Trop faible pour attaquer, il pourrait être suffisamment fort pour imposer sa neutralité et sauver ainsi de la ruine, le pourtour de la Méditerranée et tout l’Occident : latin, et autre. Par conséquent, si la France engendre l’Empire pour prolonger dans l’avenir l’autonomie et la grandeur que son présent purement national ne peut plus supporter, elle le fait aussi en sa qualité de première puissance européenne, qui est responsable de la conservation· d’une civilisation qu’elle a en grande partie créée. Et on peut dire ainsi que le but dernier de la politique impériale latine est le maintien de la paix dans l’Occident européen.
Certes, il ne faut pas surestimer les possibilités politiques de l’Empire latin. Il ne sera jamais assez fort pour s’assurer une autonomie absolue. Car il ne sera pas suffisamment puissant pour neutraliser la rivalité des deux autres Empires et empêcher le cas échéant leur conflit armé. Il se peut donc qu’un jour les Latins devront coordonner leur politique avec celle de l’un des deux rivaux, en s’opposant politiquement à l’autre.
Mais même dans cette hypothèse la France a intérêt à la création de l’Empire latin. Car si elle se présente elle-même à la tête d’un Empire, son poids politique et économique sera tout autre que si elle se rallie à une formation impériale étrangère en tant que Nation isolée. De même que l’Angleterre, en entrant dans le sillon de l’Amérique, essaye de s’entourer de satellites « nationaux » (parmi lesquels elle voudrait tant voir la France), la France ne devrait pas affronter dans l’isolement les avantages périlleux d’une « entente » avec une vraiment grande puissance. Et ceci d’autant moins que là où l’Angleterre doit se contenter de « clients », la France pourrait avoir des associés-partenaires.
En particulier (et c’est vraiment une occasion de dire fast not least), la formation d’un Empire latin autour de la France rendrait stratégiquement intenables les positions d’une éventuelle marche germanique de l’Empire anglo-saxon. Dans ces conditions personne n’aura donc intérêt à rétablir le potentiel économique et militaire de l’Allemagne, ce qui n’aurait pu se faire qu’au détriment de ses voisins occidentaux. Mais si la France resté isolée, même en s’alliant à l’Angleterre, il est plus que probable que la décision de défendre l’Occident contre les Russes aura pour conséquence (relativement proche, sinon immédiate) un appel à la puissance plus ou moins unifiée du monde germanique. Or si le danger d’une Allemagne ennemie semble être à jamais conjuré, les dangers économiques que présente une Allemagne « alliée » affrontée au sein d’un « bloc occidental » émanant de l’Empire anglo-saxon ne sont nullement chimériques, tout en étant incontestablement mortels pour la France, même sur le plan politique. Seul un Empire latin pourrait s’opposer indéfiniment à une hégémonie continentale allemande, exercée sans contrôle anglo-saxon. Tant en raison des « moyens
de persuasion » dont cet Empire disposera, que parce qu’il est lui-même capable de présenter ces garanties de force et de stabilité européennes qu’autrement on serait tenté d’aller quérir au-delà du Rhin.
IV. Moyens de réalisation
En ce qui concerne l’Empire latin, la clef de la situation n’est pas à l’étranger, mais en France. La France seule peut amorcer cet Empire, de même que seule l’adhésion à l’idée impériale latine peut permettre aux Français de sortir de l’impasse politique (et économique) où ils se trouvent. Mais il sera sans nul doute très difficile de transformer cette idée générale en un « projet » concret et d’en faire le but et le moteur d’une politique française « réaliste ».
D’abord à cause d’un préjugé antilatin très répandu, et qui n’est probable ment qu’une forme camouflée de ce « complexe d’infériorité », parfois « surcompensé », dont commence à souffrir la France. Ensuite, en raison de ce « quiétisme » économique et politique qui s’observe dans le pays depuis plusieurs décades et qui paralyse toute velléité d’action proprement dite, c’est-à-dire d’activité négatrice du donné, et donc créatrice ou rénovatrice. Or dans le cas de l’Empire latin il faudrait plus encore que « rénover », puisqu’il s’agit de rompre avec toute la tradition « nationaliste » qui depuis des siècles est aussi une tradition éminemment nationale, la France ayant été une « grande Nation » et la première « Nation » véritable qui est apparue dans le monde. Enfin, c’est la situation politique intérieure qui semble s’opposer d’avance à toute tentative d’axer l’ensemble des activités françaises autour d’une seule idée directrice. D’une part, l’opposition devenue traditionnelle et rigide entre la « Gauche » et la « Droite » divise profondément le pays, en faisant rejeter par l’une de ces parties toute idée acceptée par l’autre. (La tentative du général de Gaulle de s’élever au-dessus de cette opposition a eu pour résultat de lui créer une situation politique sans aucun doute « splendide », mais aussi absolument et irrémédiablement « isolée ».) D’autre part, l’existence de formations para politiques telles que la Résistance et le catholicisme, qui sont d’autant plus « inquiétantes » qu’elles sont largement répandues tout en restant insaisissables, et la présence de grands partis bien organisés tels que les Partis communiste, radical et socialiste, qui sont (comme le montre l’exemple des radicaux) d’autant plus intransigeants dans leur attitude que celle-ci est moins doctrinale, – rendent malaisée la création d’une « volonté générale » autour d’une idée politique nouvelle.
Et pourtant, en y regardant de plus près, on s’aperçoit que la situation actuelle est de beaucoup plus favorable à une renaissance politique que celle qu’on observait avant la guerre. On pourrait même dire qu’une grande action politique est aujourd’hui si difficile précisément parce qu’elle a des chances de réussir. En tout cas, les difficultés sont en quelque sorte « normales », car ce n’est certainement pas par des mesures « faciles » qu’on pourrait redresser la situation dans laquelle on se trouve maintenant.
Le facteur positif décisif est sans aucun doute l’existence du général de Gaulle. L’idée latine n’est qu’une concrétisation de la volonté française d’autonomie politique et de « grandeur ». Or cette volonté se manifeste incontestablement dans chaque parole et dans chaque acte du chef actuel du gouvernement. Malheureusement, jusqu’à présent tout au moins, la volonté politique de ce chef a pour but de galvaniser un passé, d’ailleurs attrayant et glorieux, bien plus que de créer un avenir – incertain peut-être, mais politiquement viable. En dernière analyse, la volonté hautement politique incarnée en de Gaulle est mise au service d’une utopie anachronique, et ce fait suffit à lui seul pour expliquer, voire justifier, l’impossibilité évidente de transformer cette volonté personnelle subjectivement si forte en une « volonté générale » objectivement efficace. Dans ces conditions la meilleure solution consisterait dans une « conversion » de de Gaulle à l’idée de l’Empire latin, conversion qui ne pourrait résulter que d’une suite de dialogues prolongés, menés à l’abri des rumeurs publiques. Mais rien ne dit que de tels dialogues soient actuellement possibles, et rien ne prouve qu’ils aboutiraient effectivement au résultat voulu.
Il ne faudrait donc pas lier au sort du général de Gaulle l’action à entreprendre en vue de restaurer politiquement la France en fonction de l’Empire latin. Il faudrait chercher et trouver une base plus large, et peut-être plus solide, dans l’ensemble du pays : une base qui assurerait le maintien, ou éventuellement le retour, du général de Gaulle au pouvoir, en lui permettant d’incarner en sa personne une « volonté générale » politique déjà constituée. Cette base élargie serait, d’ailleurs, nécessaire même dans le cas où un de Gaulle converti à l’idée de l’Empire devait dès le début s’appliquer lui-même à sa création.
Mais la France actuelle n’est pas une monarchie absolue. On s’y trouve en présence de partis organisés multiples et vivaces, et c’est avec eux, et non contre eux, que doit y être constituée la base réelle d’une action politique. Il y a d’abord le Parti communiste. Ce parti est important, car les moyens idéologiques et matériels dont il dispose lui permettent de saboter efficacement toute entreprise politique qu’il croira de son devoir de désapprouver. Dans la mesure du possible, il ne faudrait donc pas provoquer une opposition ouverte de sa part. Mais il faudrait en obtenir plus encore qu’une neutralité. Car la construction d’un Empire latin, et même un simple redressement « national » de la France, exigeront un grand effort de travail coordonné et soutenu fourni par la classe ouvrière, que seul le Parti communiste pourrait obtenir de cette dernière. Mais peut-on vraiment escompter une collaboration positive avec ce parti ?
En allant au fond des choses, et en écartant certains préjugés, on pourrait semble-t-il répondre par l’affirmative.
En fait, du moins dans la mesure où les grandes lignes de sa politique sont codéterminées par Moscou, le Parti communiste fait actuellement figure d’un parti conservateur, dont la devise pourrait être exprimée par la formule vichyssoise : « Travail – Famille – Patrie. » Ce parti est en fait « conservateur » parce qu’il veut conserver l’autonomie politique de la France (ainsi que de l’Italie et de l’Espagne) et la défendre à tout prix contre l’emprise du monde anglo-saxon, au prix même du maintien indéfini du statu quo économique, social et politique. En ce sens le Parti communiste comble providentiellement une lacune de la vie politique française, qui compromet trait sérieusement la stabilité de l’État et ses possibilités d’action énergique. Il s’agit de l’absence prolongée en France d’un parti appelé généralement « conservateur » qui ne serait pas réactionnaire, d’un parti donc qui attribuerait d’une part une valeur absolue à l’État pris en tant qu’État, et qui admettrait d’autre part que l’État ne peut vivre politiquement qu’à condition de s’adapter sans réserves à une évolution parfois radicale et souvent rapide. Or le Parti communiste français, tout en étant « conservateur » par la force des choses, n’est certes rien moins que « réactionnaire » dans ses intentions : il est au contraire ouvert à toutes les propositions visant une « modernisation » de l’État. Son seul défaut presque – mais ce défaut est très grave, consiste dans le fait que le « patriotisme » qui l’anime n’est… même pas soviétique, mais franchement russo-slave. Dans ces conditions le Parti ne collaborera jamais au projet de l’Empire latin tant que ce projet n’aura pas l’assentiment du gouvernement soviétique. Mais cet assentiment une fois acquis, il n’y a pas de doute que l’immense majorité des membres du Parti français seront très heureux de pouvoir remplacer par un patriotisme latin leur « patriotisme » russe. D’une manière générale, les meilleurs éléments du Parti communiste sont recrutés parmi ceux qui voudraient dépasser les cadres effectivement trop étroits qu’imposent à la vie économique, sociale et politique moderne les frontières d’une Nation. Et rien ne dit qu’après avoir reçu un contenu « impérial » concret, l’universalisme communiste ne puisse être utilisé avec avantage dans un travail constructif.
Il faut avouer cependant que le Parti communiste est un parti « conservateur » très sui generis, et qu’il n’est pas facile de lui faire jouer en France le rôle que jouaient en Angleterre par exemple, les Tories menés par Churchill. Car d’une part, à l’exclusion de certains de ses chefs peut-être, le Parti communiste français ne sait pas, et ne voudrait pas savoir, ni encore moins avouer, qu’il est un parti « conservateur », voire un parti « de droite ». Et d’autre part le général de Gaulle, et surtout les milieux politiques et économiques gouvernants actuels, sont certainement « gênés » par l’idée de devoir gouverner avec un appui décisif du Parti communiste. Or sans la personne et l’autorité de de Gaulle, il ne pourrait probablement pas jouer le rôle conservateur et en même temps constructif qu’on attend de lui. Et son activité resterait certainement stérile sans un accord (qui pourrait rester tacite, à condition d’être effectif et efficace) avec les couches dirigeantes réelles du pays.
Pour pouvoir faire œuvre politique utile, il faut donc créer en France un trait d’union entre les masses plus ou moins dirigées par le Parti communiste, la volonté politique représentée par le général de Gaulle, et les forces réelles détenues par l’élite économique, technique et culturelle.
Or par bonheur ce trait d’union existe actuellement, pour ainsi dire en puissance, en ce quelque chose de politiquement assez vague certes, mais de vivant et de vivace, qu’on appelle la Résistance. D’une part la Résistance groupe les éléments les plus actifs de la nation, elle a des velléités certaines de réforme profonde, et elle a déjà fait l’expérience somme toute pas trop désastreuse d’une collaboration politique avec les communistes. D’autre part elle est animée d’un patriotisme authentiquement français et elle a des attaches personnelles et directes tant avec le général de Gaulle qu’avec certains milieux français dirigeants. Seulement, étant formé en vue d’une résistance, étant donc né d’une pure et simple négation, ce mouvement reste encore privé d’idée directrice positive, et il manque par conséquent d’unité, voire de réalité politique véritable. Telle quelle, prise en bloc, la Résistance ne peut donc servir ni de force motrice, ni même de courroie de transmission ou d’organe de couplage.
Pour créer à partir de la Résistance le trait d’union efficace en question, il faut donc procéder à un choix. Ce choix est d’autant plus nécessaire, que ce mouvement a accaparé par la force des choses de nombreux éléments foncièrement nihilistes dits « intellectuels de gauche », pour lesquels le non-conformisme a en soi une valeur absolue au lieu d’être une conséquence parfois nécessaire, mais toujours regrettable, d’une volonté constructive concrète. Il faudrait refouler ces éléments foncièrement anti-étatiques dans le domaine littéraire qui lui appartient en propre et d’où ils ne sont sortis qu’au hasard des événements. Mais bien entendu il n’appartient à personne de juger les hommes et de les choisir à son gré. Aussi le choix envisagé doit-il s’opérer par l’idée politique elle-même, qui rejettera tous ceux qui la trouveront par trop « conformiste ».
Le fait d’avoir appartenu au mouvement de la Résistance est sans nul doute un indice favorable dont il faudrait toujours tenir compte. Mais il n’est pas une condition suffisante de la participation à la nouvelle élite politique constructive. Et il n’en est même pas une condition nécessaire. Car rien ne dit qu’un ancien « Vichyssois » doive être écarté en quelque sorte d’office. Certes il faut éliminer tous ceux qui ont opté pour Vichy parce qu’ils sont des réactionnaires bornés et inéducables ou des opportunistes pour ainsi dire convaincus. Mais il serait injuste et dangereux de vouloir se passer de tous ceux qui ont eu la foi en la « révolution nationale » et qui ont agi en conséquence. Car il doit être permis aux rares gens qui agissent et qui croient, de se tromper parfois, même si leur erreur est grave ; et l’État peut toujours se servir utilement d’un homme capable d’aller jusqu’au bout dans l’accomplissement d’un devoir, même mal compris. Ne serait-ce que parce que la crise française actuelle est beaucoup moins une crise d’intelligence et de compréhension, qu’une crise de volonté et de foi opérante. En bref, si l’idée politique proposée doit avoir là vertu d’écarter les « nihilistes » plus ou moins « résistants », elle doit aussi être capable de rallier les anciens « enthousiastes » plus ou moins « nationaux », ainsi que tous les fervents d’un travail bien fait et positif.
Somme toute, l’élite appelée à servir de trait d’union entre les masses communisantes, le général de Gaulle et les couches dirigeantes actuelles peut être recrutée dans tous les milieux sociaux et politiques. Et l’idée politique proposée doit se servir de tous les partis qui voudront bien la soutenir.
Il n’y a pas de doute cependant que certains partis français ne peuvent pas servir de base politique stable pour une action impériale latine. Tel est le cas du Parti radical-socialiste. En raison de sa composition sociale, il s’agit là, d’un parti de la consommation, et non de la production, c’est-à-dire d’un parti qui voudrait voir dans le gouvernement une simple administration civile et non le représentant d’un État tout-puissant. Aussi l’adhésion de la France au bloc anglo-saxon tentera ce parti beaucoup plus que la création d’un Empire latin, qui ne pourra garantir l’autonomie politique de la France qu’au prix de longs et durs efforts et de sérieuses restrictions. Il ne s’en suit pas pourtant qu’une collaboration parlementaire et administrative avec le Parti radical soit impossible.
Quant aux socialistes, ils ne sont pas dangereux. La situation qu’ils occupent entre les communistes et les radicaux les oblige à ériger le compromis en principe. Et ils auront même toujours une fonction utile, qui consistera à modérer la volonté de puissance de leurs voisins de gauche et de stimuler le zèle ne serait-ce que verbal de leurs voisins de droite. Pratiquement, le Parti socialiste pourra toujours être utilisé soit au sein d’une coalition parlementaire, soit comme ure « opposition » loyale.
Beaucoup plus importante, mais plus délicate aussi, est la question soulevée par le catholicisme. Car il s’agit ici moins de relations politiques avec un parti que d’une entente idéologique avec l’Église et d’un accord moral avec la population effectivement croyante ou se considérant comme telle. Mais ce problème devrait être discuté à part.
La question importante entre toutes concernant les rapports de l’idée politique et de son élite avec les milieux responsables de la vie économique du pays, demande également à être traitée à part. Pratiquement il s’agirait de gagner à l’idée et d’incorporer dans l’élite le personnel dirigeant des entreprises privées, en essayant avant tout de convaincre ceux qui n’ont pas encore obtenu ce qu’ils croient devoir être leur bâton de maréchal.
En définitive, ni la création de l’Empire latin, ni même le redressement économique et politique de la France, ne sauraient se faire sans la création préalable d’une certaine élite politique, qui réunirait des membres « positifs » de la Résistance, des fonctionnaires ayant conservé une foi en l’État, des techniciens aimant leur travail pour lui-même et des « capitalistes » encore imbus d’une volonté d’autonomie, d’expansion et de puissance économique. Car seule une élite de ce genre pourrait s’élever au-dessus du conflit « municipal » de la Gauche et de la Droite sans se trouver pour cela dans l’air archi pur mais irrespirable de la théorie abstraite ou du rêve.
L’effort politique et économique fourni par la France en vue de la création d’un Empire latin ne peut pas, et ne devrait pas, se passer de l’appui de l’Église catholique qui représente une puissance immense, quoique difficilement calculable et encore plus difficile à capter.
Il n’y a pas de doute que c’est le catholicisme qui a forgé et exprimé les énergies premières servant encore de source spirituelle profonde à l’ensemble de la vie française, et latine en général. Il est donc naturel et normal que le gouvernement cherche à coordonner son action impériale de catholicité laïcisée et laïque avec l’expression que ce même catholicisme trouve dans l’Église et par le Vatican.
Seulement, la réussite de l’action impériale présuppose non pas seulement une réforme politique radicale des gouvernements latins, mais encore une transformation profonde de l’Église catholique, notamment dans ses branches italienne et espagnole. Il faudrait avant tout « désitalianiser » le Vatican, sans l’ouvrir toutefois à des influences américaines par trop exclusives. C’est dire que la France, et plus tard l’Empire, doivent pourvoir aux besoins matériels des organisations centrales et internationales de l’Église. Mais c’est dire aussi que le Vatican doit surmonter sa méfiance, dogmatique et autre, vis-à-vis de l’Église française, et comprendre que l’Union latine à laquelle il aspire depuis longtemps ne peut se faire que par une initiative venant de France et formulée par elle. Or on pourrait espérer que l’Église puise dans la « catholicité » même de l’idée latine les forces nécessaires pour libérer le catholicisme des divisions et des limitations qui y ont été introduites par l’élément « national » extra-chrétien et par les formes économiques et sociales que cet élément apporte avec lui.
En fait, en raison précisément de sa « catholicité », l’Église a toujours transcendé les divers cadres imposés à et par la Nation quelle qu’elle soit. Mais elle a aussi subi le contre-coup de la lutte « anti-nationale ». C’est ainsi que la dialectique séculaire de l’Église (catholique) et de l’État-Nation, a abouti finalement à la doctrine et à la pratique de la « séparation » de l’époque libérale. Mais la période libérale, voire nationale ou nationaliste, étant révolue, tout le problème est à revoir du point de vue impérial. Dans une certaine mesure on revient donc aux temps de Grégoire VII, avec cette différence toutefois que l’Église aura désormais affaire sur le plan politique non pas à un Empire pré-national, mais post-national. Et ceci change complètement la situation, tout en exigeant de nouveau une attitude et une décision « totales ».
Si l’humanité réellement intégrée, c’est-à-dire unifiée politiquement, socialement et économiquement, conserve encore une structure ecclésias tique, celle-ci ne pourra certainement être fournie que par une Église universelle, c’est-à-dire catholique au sens propre et fort du terme. Mais le fait est que le morcellement réel de l’humanité a eu pour conséquence la division du christianisme universalisant en trois grandes Églises autonomes et rivales. Le fond chrétien, c’est-à-dire universaliste, de ces Églises leur a permis de dépasser toujours les limites strictement nationales qui s’imposaient à elles (et c’est certainement l’Église catholique, en restant la plus universaliste de toutes, qui a pu surmonter le mieux toutes les tentations « gallicanes »). Mais la séparation même des trois Églises chrétiennes rend pour le moment utopique leur velléité d’expansion universelle : car telles qu’elles sont actuellement, aucune d’elles ne pourrait – par impossible – devenir universelle sans être exclusive (des autres). Il semble donc que les Églises séparées ont pour contrepartie politique nécessaire l’existence de formations intermédiaires entre l’Humanité et les Nations, c’est-à-dire de formations impériales. Et en effet, l’Église protestante s’est rattachée dès le début à un monde anglo-saxon, qui est actuellement en train d’absorber le monde germanique. L’Église orthodoxe, qui semblait devoir perdre l’Empire russe, a en fait trouvé un Empire slavo-soviétique en voie de formation. Quant à l’Église catholique, elle aura peut-être d’ici peu la possibilité de ne pas se refuser à un Empire latin.
En envisageant la situation du point de vue historique, il semble bien que c’est dans cet Empire latin que l’Église catholique devrait actuellement chercher la base réelle dont aucune Église ne peut se passer. Étant une Église éminemment chrétienne, mais n’étant néanmoins en ce moment qu’une des trois Églises chrétiennes existant en fait, l’Église catholique semble ne pas pouvoir négliger l’appui, « réaliste » certes, mais peut-être aussi réalisateur, que pourrait lui apporter une formation impériale, qui dépasse les cadres rigides et étroits des Nations sans se perdre dans le lointain encore vague d’une Humanité unifiée, et qui pour des raison historiques évidentes ne peut être qu’une formation latine. Pour la première fois peut-être, une politique catholique serait ainsi à l’ordre du jour. Et une action politique latine d’inspiration chrétienne pourrait peut être s’associer à une volonté chrétienne se réalisant dans et par un catholicisme d’orientation latine. Il semble, d’ailleurs, qu’on commence à se rendre compte au Vatican (ne serait-ce qu’au sujet du problème polonais) que l’ère des simples « concordats » entre l’Église et les États séparés est révolue, et que la situation exige une collaboration des deux pouvoirs, qui est seule capable d’écarter définitivement le danger de leur conflit. Inversement, du côté laïque, on observe dans les pays latins et notamment en France une crise générale de conscience ou d’idéologie, qui fait qu’une partie de l’opinion voudrait y voir apparaître des idées concrètes, politiques, sociales et économiques, présentées ou patronnées par l’Église. Et si l’on ne peut certainement pas dire que tous les « hommes de bonne volonté » en France acceptent sans réserves l’idée d’une collaboration avec l’Église, il est indéniable que l’Église y a réussi à grouper sous son patronage un matériel politique humain d’une très haute valeur.
Certes, il ne peut être question de vouloir abaisser l’Église catholique au niveau orthodoxe, ni même protestant, l’Église « impériale », voire latine. Elle est appelée à rester l’Église universelle en puissance, et elle doit continuer à voir dans son universalité le but suprême de tous ses actes. Mais il se peut que la réalisation de cet idéal même exige une collaboration prolongée avec une réalité politique impériale et latine. Si l’Église a eu certainement raison de combattre le Saint Empire (germanique) effective ment prématuré, elle aurait peut-être tort de continuer à se lier au monde des Nations historiquement dépassé, en se désintéressant des mouvements impériaux qui sont à l’ordre du jour. D’ailleurs, en s’y intéressant, en acceptant le patronage spirituel de l’Empire latin, l’Église catholique aurait à y remplir un rôle politique concret et spécifique. Elle devrait rappeler constamment à l’Empire qu’il n’est qu’une étape de l’évolution historique, destinée à être dépassée un jour. Autrement dit, elle devrait veiller à ce que l’Empire ne se fige pas dans ses limites impériales comme les Nations se sont figées dans les leurs, en laissant aux guerres le soin de les faire sauter. En bref, c’est la catholicité de l’idée latine qui devrait lui permettre d’être impériale sans jamais devenir « impérialiste » – avec tout ce qui s’en suit.
De son côté, l’Empire latin pourrait peut-être contribuer à la réalisation du but suprême du catholicisme, qui est sa transformation en une Église universelle et unique. Ainsi par exemple, la coopération politique de l’Empire avec l’URSS pourrait préluder à une entente de plus en plus profonde entre l’Église catholique et l’Orthodoxie gréco-slave, entente qui rendrait un jour inutile l’indépendance canonique de cette dernière.
Quoi qu’il en soit, il est bien évident que l’union véritable des Églises présuppose une unification réelle du genre humain, et que cette unification ne peut pas se faire sans que l’évolution historique qui y mène passe par une période de concentrations de type impérial et « confessionnel ». Ce n’est qu’en passant par ce stade et en le dépassant que l’humanité pourra atteindre l’état d’unité finale qui permettra d’éliminer définitivement les conflits politiques, économiques et sociaux. Et c’est alors seulement qu’on pourra répondre à la question de savoir si l’avenir indéfini appartient à une religion humaniste prédite et préconisée par certains, ou à cette catholicité chrétienne qui est la fin dernière et la seule raison d’être du christianisme catholique, qui a engendré – entre autres – le monde spirituel latin.





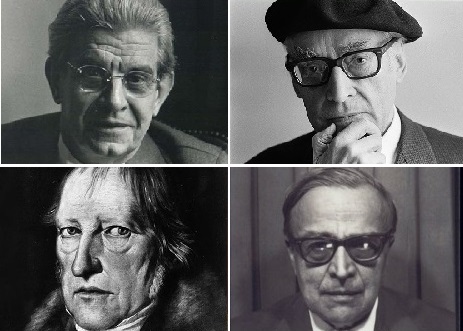

A lire ce texte, il semble plus sortir de l’esprit d’un nazi que d’un russe. Cependant celui-ci avait l’expérience de l’empire soviétique. Mais celui-ci a disparu comme tous les grands empire. Ce qui porte fortement à croire, que l’UE devenue empire va a son tour disparaitre, comme les empires suivants : le romain, l’arabe, l’espagnol, le portugais, le hollandais, l’otoman, le britanique, l’américain, Ce dernier est en éta de décomposition lente.
Ainsi cette analyse et très discutable.