C’est l’histoire d’un écrivain à qui l’on propose, fin 2019, un poste d’attaché culturel dans une ville industrielle chinoise. L’écrivain s’appelle Alexandre Labruffe, et l’on peut affirmer qu’il écrit diablement bien. La Chine, il connaît. Il a fait plusieurs séjours, jamais touristiques, toujours en immersion salariée ou missionnée, dans ce pays schizophrène, république populaire mais désormais ancré dans l’économie de marché. La productivité a un prix, exorbitant : la Chine est le pays de la pollution acceptée, du développement industriel à tout prix, de la main d’œuvre entassée. En courts paragraphes que l’on ne peut comparer à des clichés photographiques tant ils sont écrits, au vrai sens du terme, là où la photo ne ferait que décrire, Alexandre Labruffe tisse un texte en va-et-vient sur ses aventures chinoises depuis la fin du siècle dernier.
Labruffe a déjà vécu et déjà croisé, avant son séjour de la fin de l’année dernière, des crises sanitaires et des virus affolants, en Chine et en Corée. Et le 25 décembre 2019, lorsqu’il comprend que quelque chose est en train d’arriver à Wuhan où il réside, il prend toutes les précautions : gants, masque, isolement volontaire. Les chiffres de 41 personnes infectées et d’une seule victime, chiffres qui restent stables durant des jours, ne le rassurent pas. Au contraire, il en déduit que la crise est grave, puisque les vrais chiffres ne sont pas communiqués. Il rentre en France non par évacuation sanitaire, mais parce qu’il est invité dans un festival littéraire. A son arrivée en France, à l’aéroport, il est tout de même surpris de ne passer par aucun contrôle, pas de prise de température, pas de formulaire à remplir. Rien. Lui, il va bien. Quelques jours après son retour, sa fille Zoé tousse. Inquiet, il appelle le 15, où on l’assure que les cas asymptomatiques sont une pure invention – alors qu’un ami plus qu’informé, en Chine, lui a affirmé le contraire –, qu’il n’a pas à s’inquiéter de savoir s’il est porteur ou non du virus chinois, qu’il n’a en aucun cas pu infecter Zoé.
Un hiver à Wuhan n’est pas le journal d’une pandémie. Un hiver à Wuhan est le texte très très bien balancé d’un écrivain sachant écrire, parti avec l’idée de rédiger un roman dystopique, et qui se retrouve en pleine dystopie :
« Depuis que je suis arrivé à Wuhan la sensation de vivre dans une ville de science-fiction s’ancre en moi. Son architecture étrange, ses strates d’histoires mixées, entre gratte-ciel post-futuristes, vieux buildings décrépits et maisons basses des anciennes concessions étrangères, ses illuminations nocturnes, son air au goût d’éther, sa pollution, ses rues vides le soir, ses embouteillages monstres le jour, ses innombrables chantiers, ses échangeurs autoroutiers superposés… font que je la surnomme : LE GOTHAM CITY CHINOIS. »
Mais, et c’est là le point nodal de ce texte, il ne peut pas dire que la réalité dépasse la fiction. Parce que les possibilités de la fiction, ou de la science-fiction, sont intrinsèques au modèle de développement chinois. On dépose ses chaussons perpendiculairement à l’armoire, le matin, en partant travailler, et on les retrouve au soir dans une position différente. Les batteries des smartphones chauffent inexplicablement, enfin, on a une petite idée sur cette surchauffe, sans doute un logiciel espion. On constate que des fichiers que l’on n’a pas ouverts depuis des jours ont changé de date, comme ça, tout seuls. Et, tiens, même, on retrouve dans ses textes des mots barrés que l’on est sûr de ne pas avoir raturés. Mais c’est avant tout le mode de développement chinois, lié à la surconsommation, qui, pour Labruffe, explique l’apparition et la dispersion du virus : « La pollution favorise la dispersion du virus » ; « Ce virus, c’est la mondialisation qui se mord la queue » ; « Ce virus nous fait entrer de plain-pied dans le XXIème siècle, qui sera le siècle de la science-fiction. »
Un hiver à Wuhan n’est pas le journal d’une pandémie, ce n’est pas non plus la dénonciation de la gestion de la crise sanitaire en France. Un hiver à Wuhan est un texte écrit sur un mode presque candide par un homme qui sait de quoi il parle, un témoin de l’évolution irrémédiable de la politique, de l’économie et de l’intendance sociale d’un pays qui a les yeux fixés sur le cap 2049, centenaire de la proclamation de la république populaire. Alexandre Labruffe nous offre un récit généreux, avec quelques allusions à son histoire familiale, des mentions rigolotes (ou non) sur la paranoïa – par exemple ce type évoluant dans les sphères du pouvoir élyséen qui lui affirme que les virus sont véhiculés par des jeunes femmes envoyées de Chine sur tous les territoires pour diffuser le virus – ou des ressentis moins drôles, comme lorsque l’auteur se demande s’il n’est pas le patient zéro que toutes les autorités sanitaires recherchent.
On pourrait penser qu’en pleine période de confinement nocturne et de vie sociale limitée aux impératifs de transport et de travail, la lecture d’un tel livre semble pesante. Il n’en est rien. Alexandre Labruffe parvient, avec une acuité baignée d’humour, à donner à son expérience chinoise toute personnelle une portée d’analyse socio-économique. Les va-et-vient entre les différentes périodes de ses séjours en Chine, l’imbrication qu’il leur donne dans son texte en forme de mosaïque, produisent un effet de saisissante inéluctabilité. Lire Un hiver à Wuhan c’est être face à un très bon texte, et se mettre en position de réflexion sur l’actualité la plus vive.
Alexandre Labruffe, Un hiver à Wuhan, éd. Gallimard, coll. Verticales, septembre 2020, 128 p.

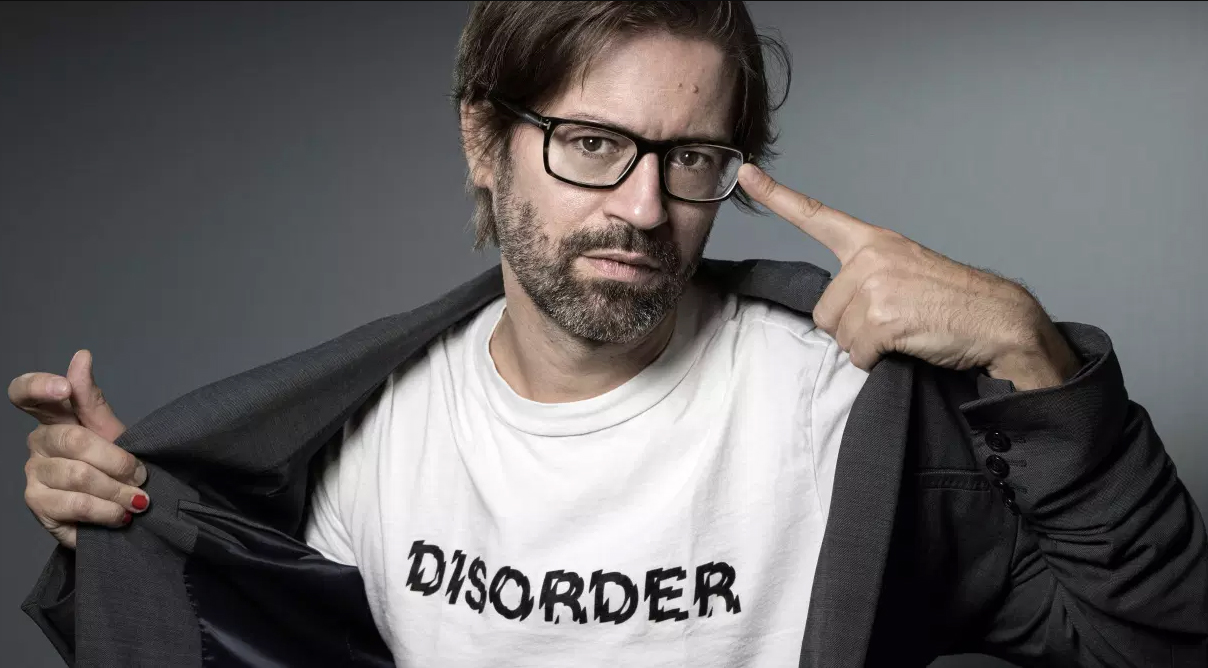




Les phrases extraites du livre se distinguent par leur conventionnalité. Etre banal, la nouvelle originalité ?