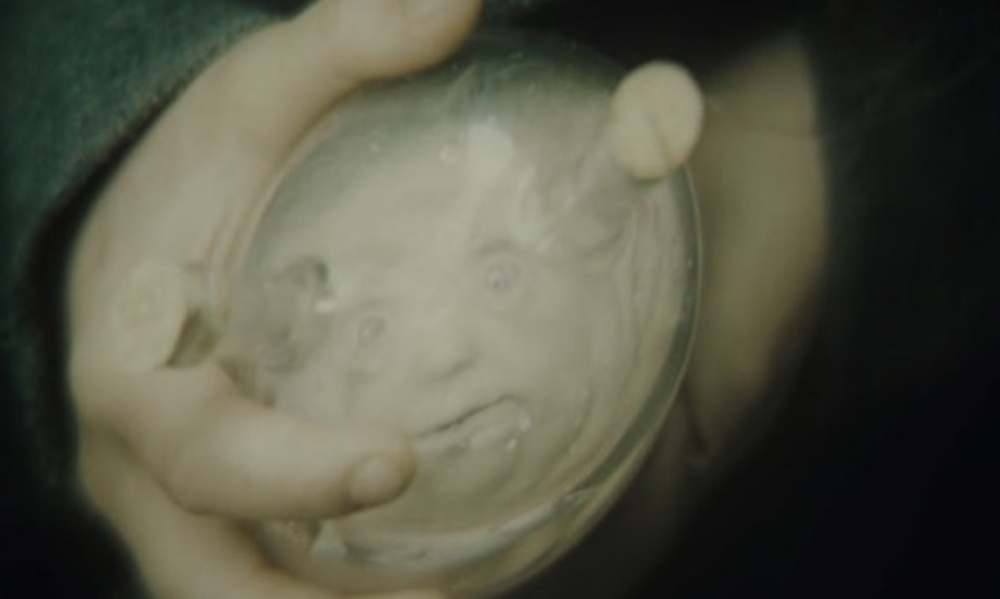Quel moment si opportun pour constater ce que Tirso de Molina (1579-1648) avait entrevu en avance sur son époque et sans besoin de pandémie. Il n’avait jamais rencontré de séductrice et encore moins de séducteur. Quand il a compris que tout mythe est un mensonge qui dit la vérité, a-t-il créé le sien ?
Je le suppose et imagine écrivant comme Anton Tchekhov (1860-1904) ses chefs-d’œuvre dans un couloir sans vouloir entendre le charivari de la marmaille. Ou comme Thérèse (1515-1582) à quatre pattes pendant qu’elle nettoyait sa cuisine, fâchée de devoir écrire par ordre supérieur rien de moins que l’histoire de sa vie (sa géniale œuvre maîtresse !). Tirso de Molina inventa son mythe par-dessus la jambe, pour lui, aucune importance. Pourtant c’était à ce moment le seul de notre civilisation. Celle-ci capable de réaliser l’excellence, mais si irrésolue à l’heure de forger ses mythes.
Deux cents ans plus tard Johann Wolfgang von Goethe (1749-1872), le jeune auteur du quasi-insurpassable, à mon humble avis, Les souffrances du jeune Werther (publié anonymement en 1774 à Leipzig), devient le conseiller secret du duc germain Carl-August de la cour de Weimar. Ce duc l’anoblit (en lui ajoutant la particule von) et le nomme commissaire à la Guerre, puis directeur des Finances de l’État. À partir de 1782, Goethe écrit une pièce de théâtre en deux parties : Faust. La louange est unanime dans les palais occidentaux et leurs colonies : c’est «le» mythe. Le seul qui grandit son époque. Qu’auraient-ils pu faire, les partisans clairsemés du curita madrilène, fils de domestiques ? Même s’il ne s’appelait pas Tirso de Molina mais José López.
Pas plus que lui, je n’ai rencontré de séductrice ni de séducteur. Pourtant je pense avoir fréquenté ceux qui sont réputés être les plus séduisants du siècle et du monde : acteurs hollywoodiens, de Broadway, le-tout-Paris, artistes surréalistes, paniques, dadaïstes, pataphysiciens, comédiens du Grand Théâtre du Monde, ou poètes pauvres et maudits para no hacer mudanza en su costumbre.
J’ai cru comprendre que la séduction est notre mythe. Un zéro en attente de son heure. Un bobard masculin. Un canular exponentiel. Les démocrates invitent-ils à retourner sa veste alors que les sauriens sont incapables d’indisposer les muses ?
Quand quelqu’un me dit, généralement sans connaître la personne : untel ou unetelle est un conquérant ou une donjuane, je pense que lui-même voudrait s’assurer, plein d’espoir, qu’il y a ou qu’il y a eu des donjuan(s) ou des conquérantes. Les cyclopes n’ont jamais couru dans les vélodromes.
Le premier mythe, Don Juan, est le plus étonnamment actuel et toujours le plus révélateur… ici ou là, de jour comme de nuit. C’est celui supposé créé par Tirso de Molina. À juste titre pour Ortega y Gasset, «Don Juan est le problème le plus secret, le plus abstrus et le plus aigu de notre temps». J’ose ajouter : de tous les temps. Cependant on préfère souvent le Faust de Goethe infiniment moins essentiel. Il y a celui qui ne cherche qu’à regarder sans voir… souvent seul parmi les autres.
Bien que je ne parvienne pas à être le reflet de mon apparence, précisément à Madrid, au Teatro Real, j’ai présenté pour la première fois mon opéra Faustbal. Au Faust allemand couronné par tous il manque quelque chose qui lui fait absolument défaut: la présence de femmes scientifiques. Ce Faust ne connaît, loin de là, ni Trotula de Salerne, ni Agnodice d’Athènes, ni Hypatie d’Alexandrie. Celles que Faustbal considère comme des sœurs. Le hasard advient toujours sans saluer personne.
Pourquoi nos stupéfiantes hâbleries se répètent-elles? Les bourdes outrecuidantes, l’arrogance et la morgue des copieurs tels que les Casanova, les Molière, les Zorrilla, ou celles du librettiste de Don Giovanni: Lorenzo da Ponte?
Selon les statistiques, loin de séduire, les hommes violent depuis le temps de ma mère l’Oye… pour commencer, leurs propres compagnes, partenaires, amantes ou épouses. Par la force des baïonnettes, ou de l’habitude, ou par négligence.
Mais grâce à notre «merveilleuse» civilisation, en outre, on a même réussi à violer le mythe de «Don Juan». Personne n’ose le présenter tel qu’il a été pensé et écrit par Tirso : son Abuseur de Séville. En d’autres termes, un menteur incapable de séduire.
Malgré toutes ses craques et fourberies le séducteur (le premier Don Juan), celui de Tirso donc, ne peut faire naître l’amour par ses propres charmes. Pas même en se faisant passer, dans l’obscurité, pour le fiancé de la victime. Exactement comme n’importe qui hier et avant-hier ?
Mais le personnage du mythe est devenu un champion, un titan et un demi-dieu: un ardent ennemi révolutionnaire de Dieu. Et encore mieux, un vrai superman. Capable de se glisser dans un lit, selon son serviteur Leporello, en toute hâte, au grand galop, à fond de train, à tout berzingue, en toute urgence et ipso facto.
Dans la scène 5 du premier acte de l’opéra, Leporello s’adresse à Donna Elvira: Madamina, le catalogo è queste : «Très chère dame voici la liste des belles que mon maître a conquises; une liste que j’ai dressée moi-même; observez-la, lisez-la avec moi… : parmi celles-ci y a des paysannes, des suivantes, des citadines, des comtesses, des baronnes, des marquises, des princesses; il y a des femmes de toutes les conditions, de tous les genres, de tous les âges. Des blondes, il a pour habitude de vanter la prestance; des brunes, la constance; des blanches, la douceur. Il veut la grassouillette pour l’hiver, il veut la maigrelette pour l’été; la grande est majestueuse, la petite est plus gracieuse. Il fait la conquête des vieilles pour le plaisir de les mettre sur la liste; Sa passion prédominante est la jeune débutante. Il se moque qu’elle soit riche, qu’elle soit laide, qu’elle soit belle; pourvu qu’elle porte jupe, vous savez ce qu’il fera». Par cette trahison du mythe de Tirso le déplorable Don Juan se transformera définitivement en un métrosexuel qui couche, en Italie, avec six cent quarante femmes; en Allemagne, avec deux cent trente et une; une centaine en France; en Turquie, quatre-vingt-onze…
…ma à Ispagna so gia mille e tre
Caramba!
Une étoile ne peut-elle s’admirer (et encore moins s’éblouir) que de loin? Nombre de nos ancêtres croyants ou athées, doués ou stupides, poètes ou rimailleurs, arrivés ou arrivistes, patrons ou domestiques sont morts syphilitiques. Comme Nietzsche et Casanova, François Ier et Maupassant, Baudelaire et Liszt, Lord Byron et Lénine, Feydeau et Antonio Machado, Balzac et Howard Hughes, Van Gogh et Flaubert, Schubert et Sade, Gauguin et Manet, etc., etc. Toutes les existences s’achèvent-elles inachevées? Entre le XVe et le XVIIesiècles en Italie, on appelait la syphilis le mal français, en France le mal napolitain, en Russie la maladie polonaise, en Pologne la maladie allemande, au Japon le morbide chinois, aux Pays-Bas la maladie espagnole, en Turquie la maladie chrétienne, en Espagne le mal portugais.
Parce que personne ne pouvait maîtriser l’envie de copuler avec un balai affublé d’un soutien-gorge. C’est pourquoi nos ancêtres ont choisi, dominés par leurs «pulsions», le plus dangereux et le plus simple: s’offrir une prostituée. Et pourtant, hier, on savait qu’il n’existait aucun remède contre la syphilis. Qu’on mourrait dans les pires tortures, d’horribles troubles mentaux et les parties les plus nobles traversées par des fers brûlants. Mais même connaissant la fin barbare de leur vie, les hommes ne pouvaient s’empêcher d’adopter la seule solution à leur désir effréné: batifoler avec la première venue…
Jusqu’avant la pandémie, les services rendus par la professionnelle la plus étrange ou la plus choquante étaient toujours d’actualité. Les clients faisaient même souvent mine de violer ces prostituées. Les authentiques lupanars étaient toujours pleins et évidemment toujours aussi nombreux. Généralement appelés «lieux de rencontre», ou «salons de massage». Ils étaient fréquentés par une grande majorité d’hommes: plus de 95%. Contre une minorité de femmes: moins de 5%.
L’extraterritorial (selon lui) Georges Steiner, a été l’un des critiques les plus reconnus, les plus précis et les plus éminents de notre époque. Depuis 1985, il écrivait chaque semaine dans le Times Literaty Supplement. À la dernière minute, il s’est défini comme Don-Juan-International. Cher et très admiré Steiner: il me semble qu’il n’y a jamais eu de Don Juan, ni international, ni national, ni domestique, ni voisin.
Quant à sa femme, l’impressionnante et vertigineuse Zara, l’imparfait de l’indicatif lui va de mieux en mieux. Il y a un demi-siècle, elle m’a parlé de relations sexuelles les plus précises que j’aie entendues. En d’autres termes, ce que Denise, l’épouse de Klossowski, m’a également dit en 1999. En fait, elle n’a jamais été nommée Roberte.
Un après-midi, mangeant dans son petit logement avec son mari, je lui ai demandé comment elle se sentait nue entourée d’un nain vicieux, d’un géant sadique et du poète immuable et perplexe, Michel Butor; elle m’a dit quelque chose d’aussi surprenant qu’exact. Alors que son mari, à 96 ans, venait de s’en aller vers le soleil le 11 août 2001, elle et moi assis sur une tombe, j’ai décidé d’essayer de faire rire cette femme stupéfiante et lucide. Elle a éclaté de rire comme un dernier hommage à l’inoubliable Pierre Klossowski.