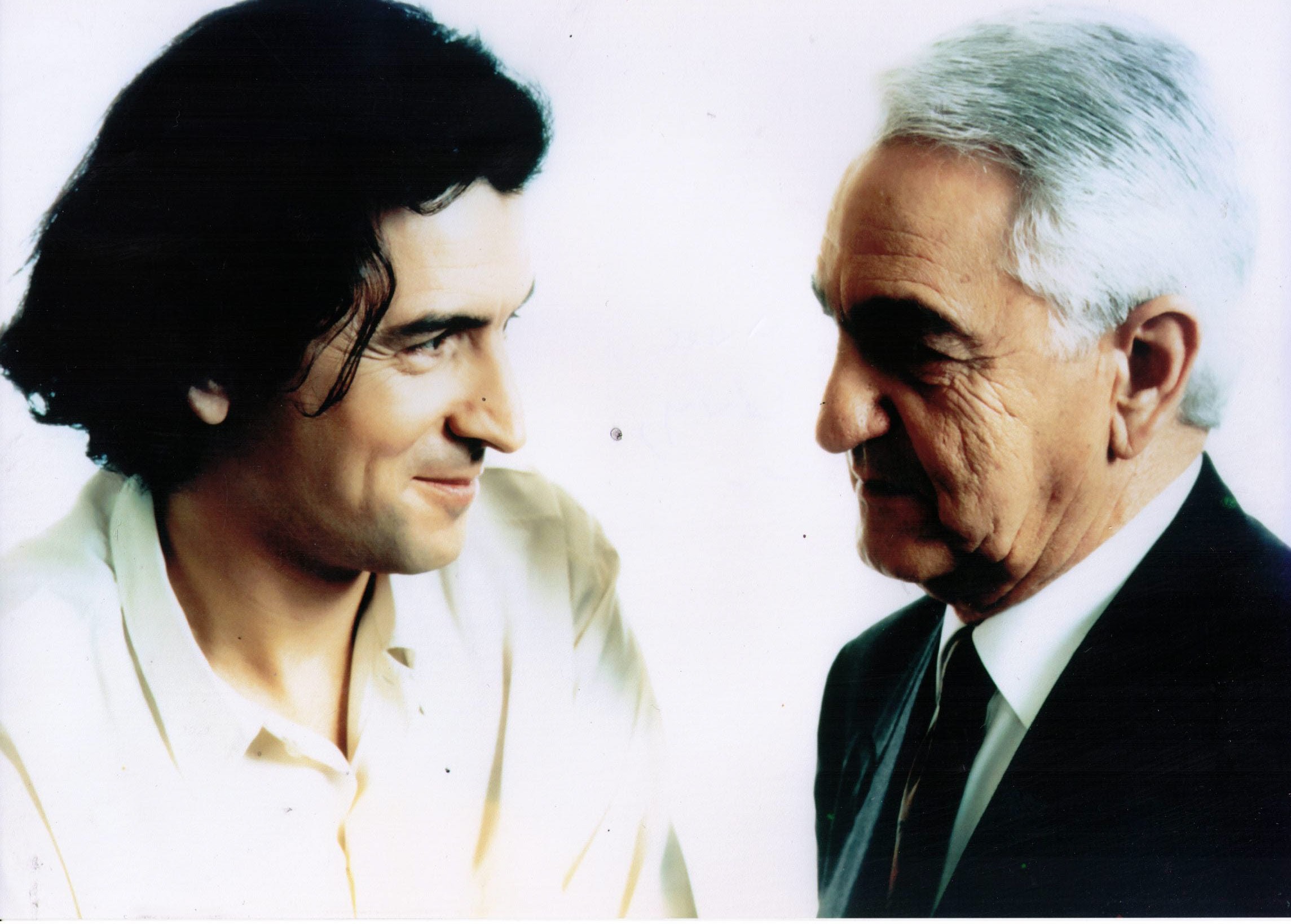Ce sont deux cinémas mythiques de la culture américaine. L’un, le Quad, à New York, a été la figure de proue de la contre-culture de Greenwich Village, et lorsqu’il a réouvert en 2013, le maire de la ville a parlé d’un endroit «magique». L’autre, le Nuart, à Los Angeles, est l’une des galaxies californiennes qui dessine une vaste nuit américaine, berçant la cité des anges de strapontins, de premières historiques, d’aficionados à la Tarantino passant leurs jours et leurs nuits dans les salles art et essai. Eh bien ce sont ces deux salles qui programment, dans le cadre d’un festival honorant les films engagés, Bernard-Henri Lévy, lors d’une rétrospective mettant à l’affiche ses œuvres de combat et de guerre : Bosna !, Le Serment de Tobrouk, Peshmerga, La Bataille de Mossoul.
Chacune de ces œuvres vaut en elle-même. «Bosna», c’est, comme L’Espoir de Malraux, le récit sur le vif, d’une guerre civile déchirant la conscience européenne : Sarajevo comme une Troie assiégée et enneigée, les scènes de la morgue, les snipers et l’indigence des Nations Unies ; une œuvre événement qui fit prendre conscience, en plein festival de Cannes 1994, des vrais pouvoirs du cinéma. Le Serment de Tobrouk ? La célébration d’une guerre juste faite à contre-coeur empêchant que la Libye ne devienne une Syrie – un pays certes encore déchiré mais où le tyran n’a pas eu les mains libres pour assassiner trois cent mille civils, jeter des millions d’autres sur les routes de l’exil, et fomenter un califat pour Daech. Peshmerga ? La noble lutte des Kurdes du nord de l’Irak qui repoussent peu à peu Daech, mais surtout un très beau film de cinéma : on se souvient longtemps de la disparition, en plein cours du récit, d’un des héros principaux, ou de la scène d’ouverture, digne d’un récit de Kapuscinski. La bataille de Mossoul en est la suite mais presque le démenti – alors que le premier opus avait en lui l’optimisme de la victoire proche, la «Bataille» dévoile déjà quel sera le futur réservé au peuple kurde : avec ces brigades chiites instrumentalisées par l’Iran qui volent leur victoire aux vaillants Peshmergas.
Mais, cette quadrilogie dessine surtout un chemin de cinéma et d’engagement. Un combat, de Sarajevo à Erbril, pour montrer un islam démocrate, ami de la liberté, coexistant avec civilité et respect, en doux commerce, en Bosnie avec les orthodoxes, en Irak avec les yézidis. Une exhortation continue à repousser ce long suicide de l’Occident qui lâche trop souvent ses alliés de cœur et d’esprit – les démocrates musulmans de Sarajevo, les Kurdes, les rebelles libyens. Et, un rappel utile de ce que peut (et doit) faire le septième art – des images qui, remplaçant les mots, s’incrustent, frappent, émeuvent, transportent, réfléchissent la réalité, font réfléchir ceux qui la façonnent, changent la vraie vie plus utilement que des diplomates ou des militaires.
Qu’une telle rétrospective ait lieu dans l’Amérique de Trump, moins d’un an avant l’élection présidentielle de novembre, n’a rien d’innocent. Ces quatre films sont une exhortation à ce que l’Amérique – et Hollywood – ont eu de meilleur : le cinéma de guerre de Capra, de la First Motion Picture Unit, ce cinéma traversé par la noblesse des idéaux et le souci du grand art, plutôt que le mercantilisme, l’ethnicisme, le réconfort nationaliste. Que, de la côte Ouest à la côté Est, se donnent à voir ces œuvres au moment où Trump laisse assassiner les Kurdes, et, paradoxalement, tardivement, et inconséquemment, se lance dans une escalade iranienne, rappelle le meilleur visage de l’Amérique – celle de Clinton et des frappes sur Belgrade, celle d’Obama refusant de donner un blanc-seing à Kadhafi, celle qu’aiment les Kurdes ou pour laquelle meurent des peshmergas oubliés – celle de Jefferson et de Roosevelt. Le message sera-t-il entendu ? En tout cas, de New York à Los Angeles, c’est le fleuron de la contre-culture américaine qui juge important de le faire entendre à cette heure.