Invité par Google Europe à un séminaire de réflexion sur le déclin de la vérité, la montée des fake news et les moyens de l’enrayer, je commence par réinscrire la chose dans son histoire et son contexte.
Je cite les «Réflexions sur la guerre d’Espagne» où George Orwell explique que «l’histoire s’est arrêtée en 1936» car c’est là, en Espagne, qu’il a découvert, «pour la première fois», des «articles de journaux qui n’avaient aucun rapport avec les faits» ; là qu’il a eu «l’impression» que c’est «la notion même de vérité» qui, ruinée par les fascismes rouge et brun, était «en train de disparaître de ce monde» ; et là, au fond, que Goebbels devint possible («c’est moi qui décide qui est juif et qui ne l’est pas») ou, un jour, Trump («vous avez vos faits ? nous avons les nôtres – qui sont des faits alternatifs !»).
Je poursuis en évoquant, en amont et en aval de cette révolution totalitaire, les ébranlements que furent :
1. le «criticisme» kantien, qui, en séparant le noumène du phénomène, en limitant notre connaissance au second et en posant que nous n’en pouvons savoir que ce qu’en laissent entrevoir les formes de la sensibilité, les catégories de l’entendement et les idées de la Raison, injecte dans le rapport à la vérité une part de subjectivité dont les partisans, par exemple, du Brexit seraient aujourd’hui les lointaines victimes ; 2. un «perspectivisme» nietzschéen qui, en faisant de la vérité un «point de vue», en faisant juger «vrai» le point de vue qui renforce un vivant et «faux» celui qui l’attriste et le diminue, provoque un deuxième choc dont on peut très bien imaginer que l’onde se soit diffusée jusqu’aux fake news de Poutine ou encore Trump ;
2. le «déconstructionnisme» de ces post-nietzschéens qui, en historicisant la «volonté de vérité» (Foucault), en en mettant l’objet «entre guillemets» (Derrida), en séparant cet objet de son référent («la connaissance du sucre n’est pas sucrée», Althusser), en noyant son évidence, enfin, dans un nuage de graphes et de schèmes (Lévi-Strauss) ou de noeuds borroméens (Lacan), nous ont fait perdre le contact avec ce qu’il pouvait avoir, le Vrai, de simple, de robuste, d’irréfutable.
Et je situe, alors, la responsabilité d’Internet et de ses Gafa au terme du processus et d’un dernier enchaînement dont les étapes sont, en gros, les suivantes.
Nombre, presque infini, des paroles libérées par la démocratie digitalisée.
Le Web devient une cohue, pour ne pas dire une foire d’empoigne, où chacun y va de son opinion, de sa conviction et, dit-il, de sa vérité.
Et, au terme d’un glissement rendu inaudible par le grondement de ces acouphènes que sont les tweets, retweets et posts divers dont nous bombardons la Toile, voilà que, pour cette vérité nouvellement affirmée, nous réclamons le respect que l’on devait à l’ancienne.
On est parti du droit égal, pour chacun, à exprimer sa croyance – on en arrive à dire que toutes les croyances exprimées ont une valeur identique.
On a commencé par exiger : «écoutez, entendez ce que j’ai à dire» ; puis : «respectez, quoi que vous en pensiez, ce dire qui est le mien» ; et on aboutit à : «ne venez pas objecter que tel dire est supérieur à tel autre et que, dans cette parlote mondialisée où nous nous bousculons pour arracher notre bout de gras, il y aurait une échelle des vérités».
On croyait démocratiser le courage de la vérité cher au dernier Foucault ; on pensait donner à tous les amis du vrai les moyens techniques de contribuer, eux aussi, avec témérité et mesure, aux aventures de la connaissance ; mais non ! c’est un festin que l’on a convoqué ! c’est le corps de la Vérité que l’on a mis sur la table ! et, mû par un instinct cannibale, chacun a entrepris de le dépecer ! chacun s’est cousu un patchwork de certitudes et de soupçons à partir de ces lambeaux sanglants puis pourrissants ; et ne voilà-t-il pas qu’a resurgi, à l’élégance grecque près, la perversité de ces fameux sophistes tenant que la vérité n’est qu’une ombre incertaine, que l’homme est la mesure de toute chose et que la vérité de chacun vaut strictement celle du voisin ?
A partir de quoi, et puisque c’est de Google que je suis l’hôte, je propose à Carlo D’Asaro Biondo, son «président en charge des partenariats et des relations stratégiques», trois idées concrètes et, me semble-t-il, assez «stratégiques».
Un hall of shame qui, en partenariat avec les 50, 100 ou 200 plus grands journaux du monde, listerait, en temps réel, les fake news les plus mondialement dévastatrices.
Un concours qui, sur le modèle des académies du XVIIIe siècle français d’où sortirent (excusez du peu !) les deux «Discours» de Rousseau, inviterait le peuple du Web à proposer le texte, la vidéo, l’œuvre dont la puissance de vérité ou la drôlerie vitrifieraient les fake news les plus nuisibles – et, bien sûr, doterait et produirait le gagnant.
Et puis, deux siècles et demi après Diderot, la rédaction d’une nouvelle «Encyclopédie» – eh oui ! une encyclopédie ! une vraie ! le contraire, donc, de Wikipédia et de son bouillon de mauvaise culture ! car qui d’autre qu’une des Gafa, ces entreprises-monde, a le pouvoir, si elle le décide, de rassembler des milliers de vrais savants capables, dans toutes les disciplines, de dresser un état des savoirs disponibles en ce début du XXIe siècle ?
Encyclopédie ou ignorance.
Recoudre le tissu de la vérité ou se résigner à son déchirement définitif.
S’enfoncer dans la Caverne, dans sa profusion obscure et vociférante, ou commencer, peut-être, de s’en extraire.
Je ne voudrais pas accorder à ce séminaire Google plus d’importance qu’il n’en a. Mais se pourrait-il que ce soit le début d’une prise de conscience ? Le signe d’une remise en question et d’un redressement du gouvernail ? Se pourrait-il que revienne aux mêmes la responsabilité du pire et du meilleur ?
De défaire et de réparer ? De désoeuvrer le monde et de le remettre sur le métier ? Nous sommes, tous, à la croisée des chemins.



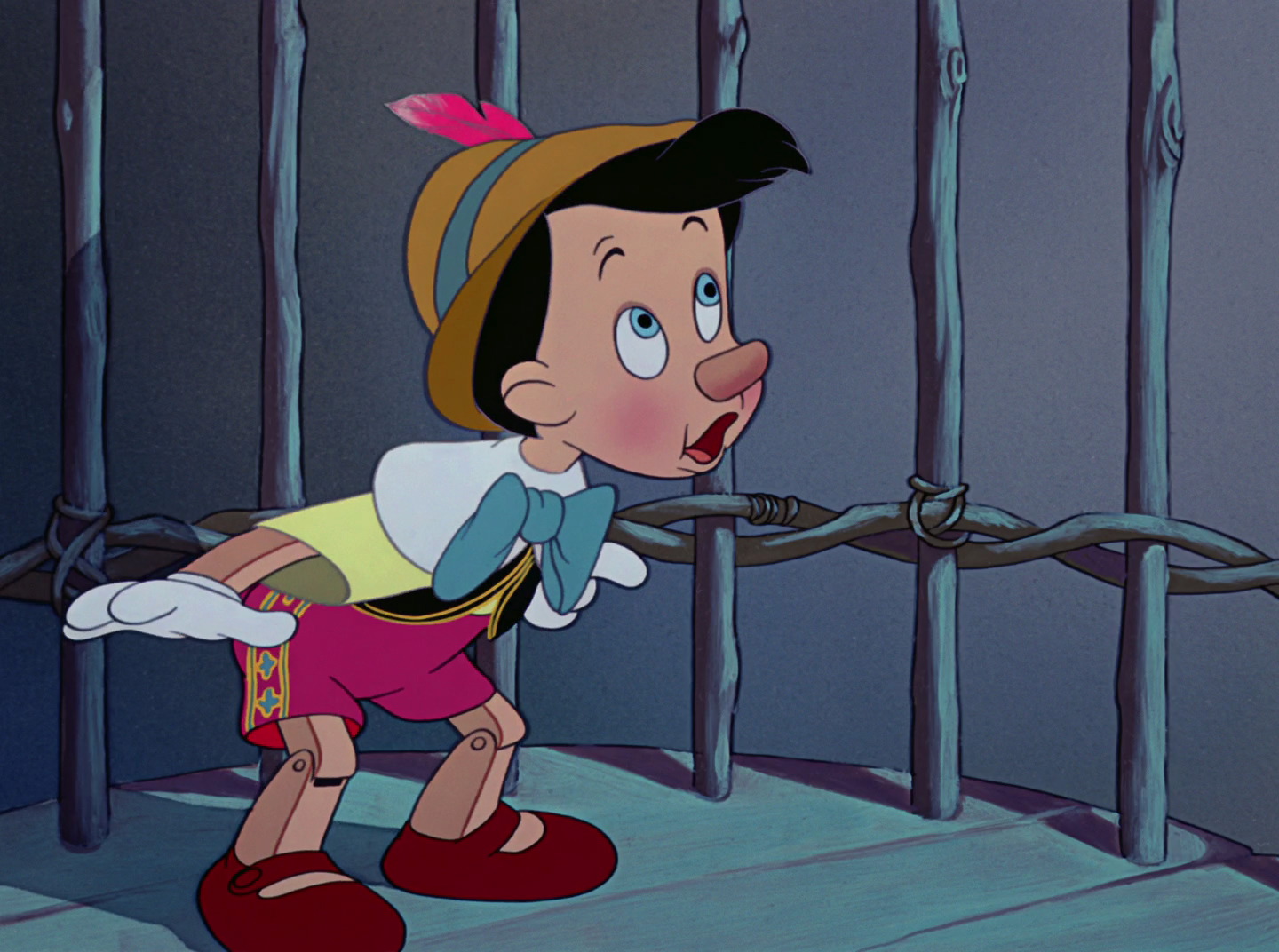




Nous aurions, maintenant, été un peu vite en besogne quand, à l’évocation de la russosphère, nous en conclûmes que notre émanation civile administrait une douche froide à son homologue russe alors qu’invraisemblablement, elle ne s’en était prise qu’aux seuls médias panslaves. Sommes-nous sommés de dépictographier, aux quatre murs de la cage de lecture dans laquelle s’atrophie la langue véhiculaire des justes, le fait qu’en un pays où deuxième et troisième pouvoirs sont les organes transsubstantiels d’un seul et unique bloc d’autodéification projective-collective, il est vain de vouloir accorder ne serait-ce qu’un soupçon d’indépendance au quatrième d’entre eux ?
La seule attitude qui trouverait grâce aux yeux du lecteur d’un seul livre qui passe pour un génie auprès des camarades analphabètes qu’il alerta sur le complot sioniste, serait que nous laissions enfin ces pseudo-damnés de la Terre dont il partage le fonds de commerce débarrasser le monde de l’État souverain et vertigineusement moderne du peuple juif. Ils peuvent toujours attendre. Si la communauté internationale n’a pas encore cédé à la partie d’elle-même qui, ayant entrepris un dur travail de restauration narcissique, s’est fixé comme objectif n° 1 de rayer Israël de la carte, cela ne tient pas au fait que la majorité des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies est constituée de pantins dont les fils seraient accrochés aux doigts crochus de la main invisible, mais bien plus simplement à ce que les leaders du monde libre ne sont pas des nazis.