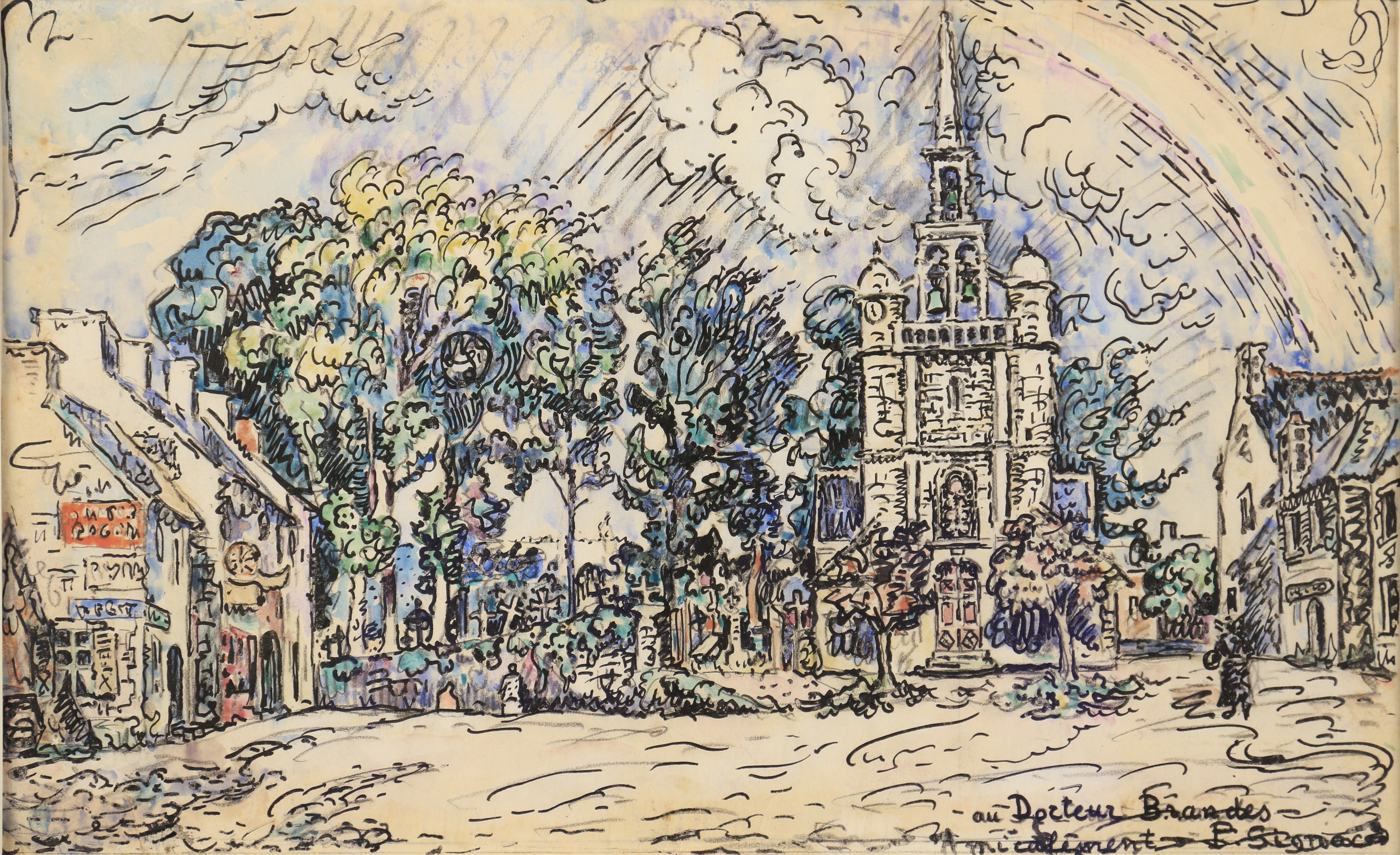Après l’habituelle pause hivernale – qui n’existe que parce qu’entre deux évènements les institutions ont besoin de temps pour démonter l’ancien et préparer le nouveau – le cycle des expositions a repris dans les musées parisiens : comme en septembre-octobre, l’offre est dithyrambique et, en ce printemps 2018, elle paraît même plus alléchante qu’à l’automne dernier. On ne sait déjà plus où donner de la tête et on n’aura jamais le temps de tout voir : la fulgurante ascension du Tintoret au musée du Luxembourg, le magnétisme de Kupka au Grand Palais, les figures de Corot au musée Marmottan, l’impressionniste américaine Mary Cassatt au musée Jacquemart-André, l’avant-garde russe au Centre Pompidou, Delacroix au Louvre et on en oublie. On les voit gambader d’un vernissage à l’autre les journalistes qui doivent se hâter de publier leur papier (quoique beaucoup d’entre eux écrivent leur texte bien avant que les expositions ouvrent leurs portes, à partir des dossiers de presse). On les voit heureux comme jamais les mondains, ces gens bien comme il faut ou un peu excentrique dont on ne sait pas bien pourquoi ils sont invités partout, les conservateurs (il y en a de deux types : ceux qui ne ratent jamais une occasion de se montrer en public et ceux qui cultivent la discrétion à l’excès, passant presque inaperçus dans les salles des expositions remplies par les huiles du monde de l’art et du tout-Paris), les experts, les administrateurs, etc. Tout cet entregent empêche de bien voir les œuvres. Il faut préférer les jours d’ouvertures et les heures creuses. Si l’on est véritablement consciencieux et qu’on en a le courage, il faut choisir les nocturnes afin de jouir des œuvres comme on le ferait d’un bon livre au coin du feu ou dans son lit – au calme. Un tableau ne mérite pas moins d’attention qu’une page écrite. Rien n’est pire que cette consommation automatique de toiles et de sculptures induit par cette passion moderne de l’exposition éphémère : une œuvre = une seconde. En cette semaine d’inaugurations effrénées, il était pourtant un endroit dont a moins parlé et où l’on pouvait regarder sans se presser et sans être pressé. Un endroit qui valait toutes les expositions précitées : le Salon du Dessin, organisé comme chaque année au Palais de la Bourse, où une quarantaine de galeries présentaient pendant une semaine un univers d’encre et de couleurs qu’on ne voit nulle part ailleurs.
Ce sont des milliers de feuilles de toutes les époques, de tous les styles, de toutes les techniques, des sanguines aux lavis embués en passant par les fraîches aquarelles, des esquisses nerveuses jetées d’un trait d’encre grasse aux études tracées avec un crayon fin comme fil de fer et aux feuilles rehaussées d’or et de couleurs poudreuses. Des artistes connus, d’autres moins, des découvertes, des redécouvertes mais, surtout, des œuvres qu’on ne voit qu’une fois : vendues à des privés ou à des musées, à l’issue du salon elles rejoignent demeures particulières et réserves. Après les expositions, on peut toujours aller voir les Tintoret, les Delacroix et les Kupka dans les différents musées d’Europe qui hébergent leurs œuvres. Pas ces dessins.
Cette année, les feuilles de la Renaissance italienne étaient particulièrement nombreuses. Retenons, au hasard, une petite étude de Federico Zuccari, le dernier grand représentant du maniérisme, pour la plus grande fresque peinte en Europe au Cinquecento, celle ornant l’intrados de la coupole de la cathédrale de Florence, Santa Maria del Fiore [Voir illustration en tête d’article]. Le sujet en est le Jugement dernier, comme à la chapelle Sixtine. Commandée en 1574 par le grand-duc Côme Ier de Médicis – celui qui fit de la Toscane un état dynastique – pour marquer son triomphe et son alliance avec l’Église et l’Espagne, cette immense composition à l’imagerie très politique fut confiée à Giorgio Vasari. A la mort prématurée de celui-ci, Zuccari, le peintre le plus rapide et le plus cultivé d’Italie après Vasari hérita de la tâche titanesque, dont il s’acquitta avec sprezzatura en cinq ans à peine. Dans cette fresque comme dans la vie, l’Enfer est bien plus intéressant que le Paradis, composé de ribambelles de figures statiques plaquées sur le ciel. A l’ordre répétitif du firmament répond le chaos joyeux des tourments éternels : les sept péchés capitaux qui conduisent au châtiment permanent sont représentés dans une déflagration de flammes colorées sur un fond de paysage rocheux parcouru par des bêtes fantastiques affamées. Les langues de feu du brasier lèchent des damnés nus et désarticulés précipitant dans le vide depuis le séjour divin qui leur a été refusé. Des diables aux têtes grotesques rappelant les masques de pierre des jardins de Bomarzo près de Rome les attrapent au vol et s’en donnent à cœur joie, tels des satyres : les supplices qu’ils leur infligent s’apparentent au péché qui les a conduit à l’Enfer, selon la logique dite du contrappasso à l’œuvre chez Dante. Le dessin en question, rougeoyant comme il se doit, montre la punition de la gourmandise. Un démon force une damnée à boire un liquide répugnant, qui lui brûle les entrailles. On retrouve exactement la même scène sur la fresque : Zuccari a préparé toute sa fresque par des centaines de dessins très précis, qu’il répliquait ensuite a fresco avec ses aides sur la coupole.

Figure plus apaisée malgré son attirail martial, notons ce soldat en pied soigneusement immortalisé par Salvator Rosa, peintre et poète napolitain du Seicento qui passa une bonne partie de sa carrière à Rome puis en Toscane. Sous son casque et son armure d’apparat, le hallebardier esquisse un demi-sourire tandis que des ombres rehaussent élégamment sa silhouette. Il appartient à une série de soixante-deux personnages d’états divers (paysans et soldats principalement) que Rosa dessina pour prouver, dit-on, qu’il n’était pas qu’un peintre de paysages incapable de faire des figures. On en juge sur pièce. Rosa savait observer son époque. Et il savait faire le reste également : sa Bataille héroïque conservée au Louvre est peut-être la plus belle mêlée jamais peinte, son Autoportrait à la National Gallery est un chef-d’œuvre d’introspection mélancolique et ses peintures de démons, héritées de Bosch et des flamands du XVIe siècle, des unicum absolus dans l’Italie du XVIIe siècle. On se croirait ici en face d’un personnage sorti d’une estampe de Callot, d’un soldat de la guerre de Trente Ans qui mit à feu et à sang une bonne partie de l’Europe dans la première moitié du XVIIe siècle.

Le vénitien Giovanni Antonio Pellegrini est moins connu que ses compatriotes du XVIIIe siècle Ricci, Piazzetta et Tiepolo mais les deux dessins aux cadres moulurés qui lui sont attribués sont à coup sûr les feuilles italiennes les plus captivantes du salon. La mise en espace est particulièrement habile, les figures s’enchaînent avec vivacité dans la profondeur dans une belle variété de poses : ce sont des spectres de lavis jetés sur la feuille, à la fois précis et incertains, un théâtre d’ombres afférées à de mystérieuses cérémonies dans un temple salomonique à l’architecture écrasante. Les cadres ovales donnent au spectateur l’originale impression de découvrir la scène à travers une fenêtre tout en répondant intelligemment à l’architecture circulaire de l’arrière-plan.

Dans un registre tout à fait différent, on rencontrait une délicate tête d’ange colorée de Guido Reni, typique des figures androgynes et vidée de leur personnalité qu’affectionnaient ce fameux représentant de l’école bolonaise du Seicento. Avec son cou un peu allongé, son regard mielleux et son oreille rose bien en chair, ce buste est préparatoire à l’une des figures angéliques d’une grande Annonciation peinte par Reni pour une église de Fano, dans les Marches, une peinture un peu ennuyeuse mais bien faite. Elle est très semblable à celle qui se trouvait autrefois dans le couvent des Carmélites de la rue de Saint-Jacques et dont Le Bernin dit, lors de son séjour à la cour de Louis XIV, qu’elle valait à elle seule la moitié de tout ce qui se trouvait à Paris. Par son classicisme et sa recherche de pondération, Reni fut naturellement l’un des peintres italiens les plus appréciés en France au XVIIe siècle. La tête de l’ange, grandeur nature, présente la particularité d’avoir ses contours incisés, ce qui permettait aux assistants de l’artiste de la transposer sur la toile : à la fin des fins, c’est bien la peinture qui est une réplique de ce dessin, c’est dans le dessin et non sur la toile que se trouve toute l’invention du peintre. Sur la feuille, l’artiste a pris le soin de tout mettre en place, de la forme à la couleur en passant par l’expression. Ce qui n’était pour lui qu’un outil de travail est pour nous, spectateurs modernes si attachés à la notion d’original, le lieu de l’expression de son talent autographe.

Passons en France face à un portrait dessiné et parfaitement achevé de Charles de La Fosse, peintre renommé de la fin du règne de Louis XIV, décorateur des salons de Versailles et du dôme des Invalides. Les grands artistes du règne se faisaient souvent effigier par leurs confrères à l’imitation des aristocrates – dont ils ambitionnaient le statut, qu’ils parvenaient parfois à obtenir, tels Charles Le Brun et Pierre Mignard anoblis en remerciement des services rendus aux muses royales – dans une sorte de mimétisme qui les poussaient à s’en remettre aux mêmes artistes que Louis XIV ou le duc d’Orléans et à se faire peindre dans les mêmes poses autoritaires. Le meilleur dans ce registre était Hyacinthe Rigaud, dont la carrière s’envole dans les années 1690. La Fosse était un ami de Rigaud : il fut l’un des premiers à en appeler à ses talents, dès les années 1680, et il l’aida à intégrer l’Académie royale de peinture et de sculpture. Autant les portraits d’aristocrates perruque au vent et toge moirée sont parfois tout à fait ridicules par leur grandiloquence forcée, autant ceux d’artistes sont plus facilement appréciables car généralement d’appareil plus simple, plus proches du modèle et de sa psychologie que de la fonction et de son statut. Ce n’est pas tout à fait le cas ici : il est clair que La Fosse veut faire oublier le caractère manuel de son travail et se donner à voir en véritable gentilhomme. Oubliés palette, pinceau, bonnet et tablier – il reste juste une innocente toile vide à l’arrière-plan, qui par sa blancheur ne fait que mieux ressortir la magnificence de la veste de satin, le geste de commandement désinvolte de la main gauche et le regard fier portant au loin.

Pour terminer ce bref tour d’horizon et montrer le plaisir propre au Salon du dessin qui permet de passer du coq à l’âne sans aucun cloisonnement, voilà un tout autre type de portrait que les purs anges de Reni et les artistes suffisants de Rigaud : une tête féérique et onirique d’Odilon Redon, celle d’une rêveuse éthérée dont le songe se matérialise par des couleurs et des formes brumeuses autour d’elle, composant une tapisserie sensible de sons et de motifs vagues qui se répondent, s’harmonisent et valent bien un grand tableau.