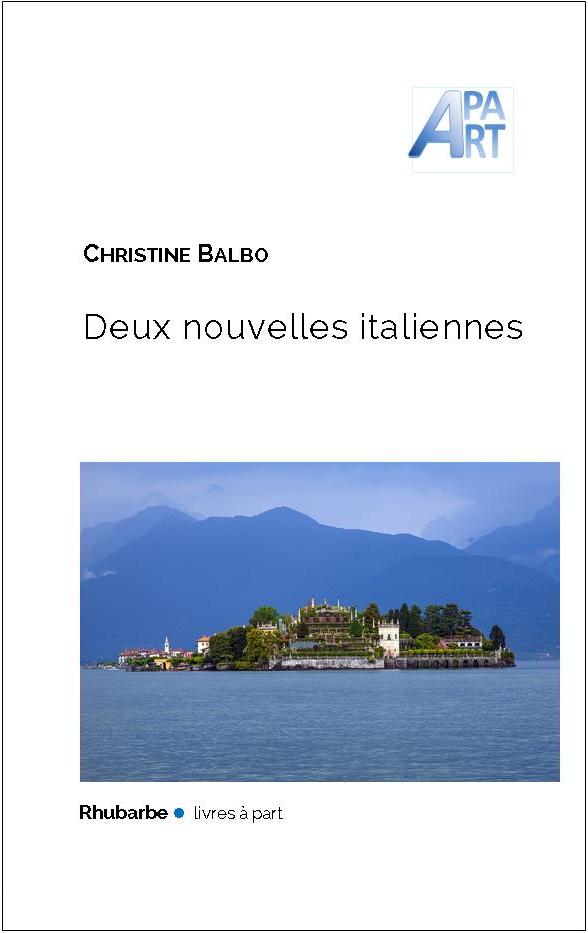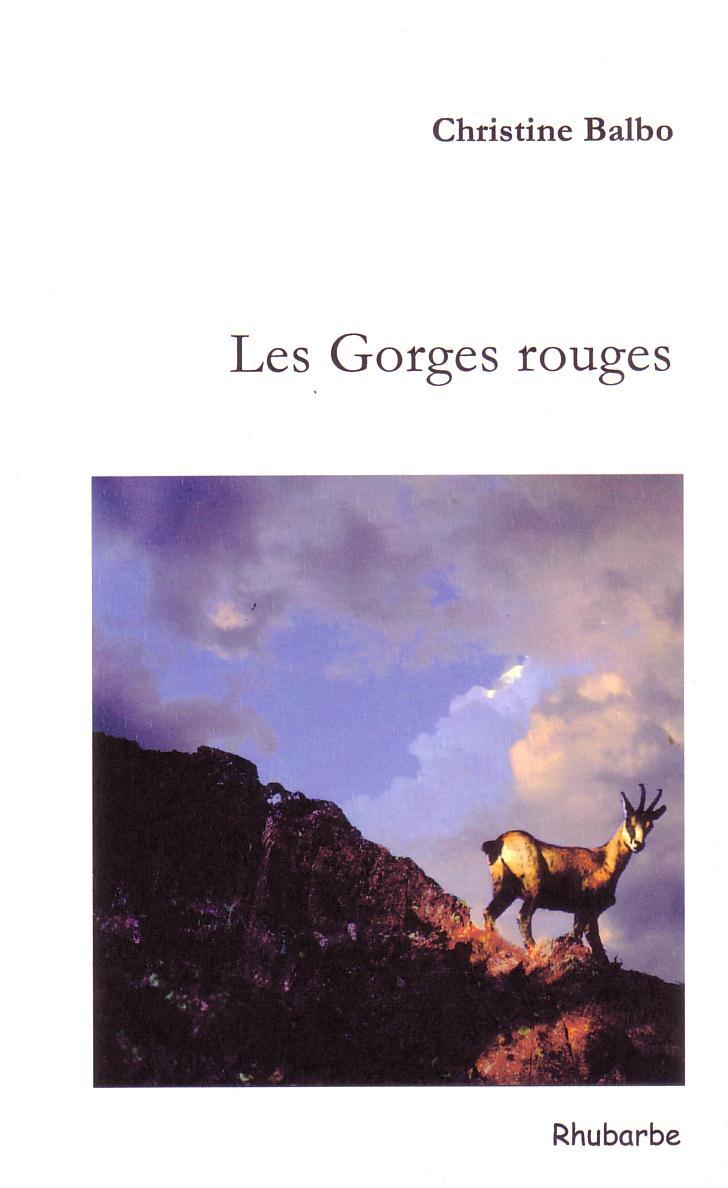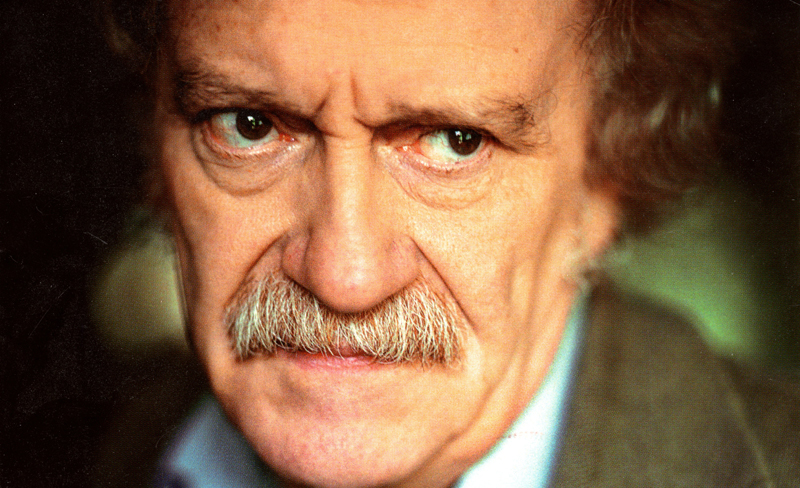Curieux univers que celui des éditeurs… Tandis que tous les arts s’ouvrent aux formats courts et aux narrations alternatives, les grandes maisons d’édition persistent à ne signer que des récits strictement calibrés (jamais moins de deux cents pages, pas plus de quatre cents) surtout dans le cas d’un premier roman. Il fut pourtant un temps béni au cours duquel la nouvelle tenait le haut du pavé. C’était au XIXème siècle. Maupassant, Gogol, Flaubert, Sand, Tourgueniev et bien d’autres firent les beaux jours du genre. Genre qui, curieusement, s’épanouissait formidablement à une époque où le temps était long. Ainsi, alors que l’on avait tout loisir de lire en savourant, on s’évertuait à dévorer des récits courts. Les temps ont changé. Les écrans sont omniprésents, le temps consacré à la lecture s’est réduit comme peau de chagrin. Paradoxalement, l’accélération de nos rythmes de vie a inversé le cours de la littérature. Elle a rendu le roman long et fait (presque) disparaître la nouvelle. Presque. Car, bien heureusement, quelques irréductibles continuent à perpétuer cet art difficile. Parmi eux, Christine Bini, que les habitués de La Règle du jeu connaissent bien puisqu’elle leur propose régulièrement ses critiques littéraires. Bini dont on referme à l’instant deux recueils proposant des histoires ciselées, douces-amères, plus vraies que nature. Il faut avoir du courage, à notre époque, pour publier un ouvrage de 54 pages format plus petit que poche. C’est le cas de Deux nouvelles italiennes, publié chez Rhubarbe : à découvrir vite car tellement actuel ! Au programme : deux histoires de femmes. Deux récits placés sous le signe d’étranges vacances (le mot « vacances » étant entendu au sens propre, celui d’absence et au figuré, comme repos après le travail). Dans la première nouvelle, Le Sac, une chanteuse flâne sur une piazza ensoleillée, à Sienne. Elle passe le temps mollement avant sa séance de répétition. Une petite fille l’alpague, trouble le farniente. Les parents de l’enfant semblent à la fois proches et terriblement lointains. La femme et la fille partagent une glace. Toutes les deux portent le même prénom : Dorothée. Nous n’en diront pas plus mais il faut lire cet écrit étonnant, dérangeant parfois, jusqu’à sa chute. Comme il faut découvrir la seconde nouvelle de l’ouvrage, intitulée Stresa, se déroulant, comme son nom l’indique, aux abords du lac Majeur. D’Isola Bella à Isola Madre en passant par l’isola dei Pescatori, on retrouve l’ambiance élégante et feutrée du nord de l’Italie. Tout y passe comme un songe, les apparitions, comme les disparitions…
En refermant Les Gorges rouges, autre recueil de nouvelles signé Christine Bini, plusieurs certitudes affleurent. Il se pourrait que le peu de pages nourrisse l’imaginaire (de l’auteure comme de son lecteur). En somme : moins de mots, plus de projection mentale. Autre certitude, presqu’une redécouverte : le pouvoir politique de la nouvelle. En multipliant les entrées en matière in media res, c’est-à-dire au cœur de l’action, en proposant souvent (mais pas toujours) des chutes inattendues, le genre prend son lecteur par le col. Elle réveille l’art bourgeois, en démonte la mécanique, fait de la littérature un art de l’impact. Un pied dans les codes, l’autre en dehors. Mentions spéciales, donc, pour plusieurs nouvelles signées Bini : la puissante et éponyme Les Gorges Rouges qui nous fait basculer dans une autre géographie, provinciale, une autre échelle de valeurs, régionaliste et montagnarde. La troublante Nourrir le monstre, s’appuyant sur l’évolution cruelle de ce Mammouth nommé Education nationale. Et enfin, puisqu’il faut bien boucler la boucle, Les Gobelins. Le lecteur y trouvera toutes les raisons de se moquer de ces littérateurs pédants, qui mettent les auteurs sous cloche. Impertinentes nouvelles que celles de Bini, qui taclent et chroniquent ceux que l’on n’ose trop peu passer sous le feu de la critique !