Palais Garnier, un soir de printemps. On y donne Così fan tutte. Louis Craon, le célèbre maestro, dirige l’orchestre de l’Opéra de Paris. La représentation est diffusée en direct à la télévision. Et voilà que Louis Craon, avant d’attaquer l’ouverture, lève son bras droit face à la scène et crie « Heil Hitler ». Stupeur. Tout le monde est tétanisé. Dans la fosse, au bout de quatre longues secondes, un homme se lève, tourne le dos au chef d’orchestre, renverse son alto sous son aisselle comme un soldat mettrait crosse en l’air. Les autres membres de l’orchestre se lèvent à leur tour, puis tous les spectateurs. Le chef s’éclipse, le premier violon prend la baguette. On joue vaille que vaille jusqu’à l’entracte, puis on change le programme, Mahler et Beethoven sont convoqués en deuxième partie de spectacle, pour signifier l’indignation, pour souligner que sur la terre tous les hommes sont des frères.
Dans L’Effroi, François Garde suit pas à pas cet altiste qui s’est levé, cet « homme qui a dit non » pour reprendre le titre d’un magazine revenant sur l’affaire. Le musicien s’appelle Sébastien Armant, il est un homme dans la foule, ou tout au moins un homme dans la fosse, anonyme ou tout comme, ni soliste ni vedette, un membre du grand corps de l’orchestre. Ce petit homme à la vie sereine et rangée – il est marié, père de deux enfants, ne s’intéresse pratiquement qu’à la musique – voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain : il est invité sur tous les plateaux télé, du journal de 20h aux émissions de jeux, il donne une conférence à l’ENA, déjeune avec un communiquant qui a tout de Jacques Séguéla, et la plus belle actrice du moment l’embrasse dans les jardins d’un palace parisien. Il faut dire que Sébastien Armant a été pris en mains par la chargée de com’ de l’Opéra de Paris. Armant ne s’appartient plus vraiment, il se laisse balloter, sans regimber toutefois, tout cela lui semble étrange.
Il n’est cependant pas dupe. On lui prête des intentions qu’il n’avait sans doute pas. Mais on l’oblige, aussi, à réfléchir sur son geste, quand son geste, justement, n’était pas réfléchi :
« Rien d’autre ne m’importait que d’échapper au sentiment d’effroi qui m’avait saisi. Mon immobilité était celle des victimes d’un accident, du souffle d’une explosion. Pour la première fois, la musique ne me servait plus à rien, n’expliquait plus rien, ne me consolait plus. Elle glissait à mes pieds comme un manteau inutile et me laissait nu. J’étouffais. Il me fallait fuir à tout prix.
Alors je me suis levé. Je l’ai fait lentement, non pour rendre mon geste plus théâtral, mais pour m’éviter le ridicule de renverser mon pupitre ou ma chaise. »
François Garde brosse ainsi le portrait, dès les premières pages, de son personnage : un type peu sûr de lui – et qui le restera –, un type bien qui se trouve tout à coup sidéré, en proie à ce qu’il nomme l’effroi, un sentiment qui n’a rien de la frayeur. Ce qui est effrayant n’est pas effroyable. Ce mot, « effroi », peu employé dans le langage courant, s’il est à peu près synonyme d’épouvante, se situe un cran plus haut. L’effroi est un paroxysme glacial et glaçant qui, au lieu de paralyser Armant, le force au mouvement. Il se lève. Coincé dans la fosse d’orchestre, il ne peut sortir. Alors il reste là, son instrument calé sous le bras, statique mais sorti de l’immobilité. Ce mot, « effroi », va rythmer la trentaine de jours durant laquelle nous allons suivre le petit altiste.
Le roman se déroule sur plusieurs plans, le premier et le plus évident étant la critique des milieux de la communication et de la télévision. Les travers et le ridicule des présentateurs, journalistes et vedettes montantes de la chanson sont mis en lumière avec un humour ravageur. Armant, balloté de plateau en plateau, est le témoin candide d’un PAF lamentable. L’agitation médiatique est mise en parallèle avec les moulinets du président de conseil d’administration de l’Opéra, Jean-Pierre Chomérac. Ce type doit sa carrière à son amitié avec le président de la République, il a été préfet, ambassadeur, il n’a atterri à l’Opéra qu’en attendant un poste plus prestigieux, il ne connaît rien à la musique et ne veut rien en connaître. Il parade, c’est tout ce qu’il fait, et il le fait assez bien d’ailleurs. A un niveau moindre, mais tout aussi intéressant, le roman explore le monde dérisoire des groupuscules néo-nazis. Le geste inexplicable, et inexpliqué, du chef d’orchestre Louis Craon, une bande dirigée par un certain Général et un certain Colonel – ce sont leurs noms de l’ombre – se l’approprie. Des tracts laissent entendre qu’Armant est juif, un chahut est organisé lors de la première d’une œuvre de Janaček, aux cris de « Armant, dégage ! ». Une commissaire de police, bienveillante, suit l’affaire de près et s’emploie à protéger l’altiste devenu héros. Car la vie d’Armant a basculé doublement : il est devenu une vedette, mais aussi une cible. Au sein même de l’orchestre, il est indésirable.
Chomérac, lors de sa première entrevue avec Armant après le coup d’éclat du chef d’orchestre, utilise le jeu d’échec qui trône dans son bureau – un cadeau du directeur du Bolchoï – pour filer une métaphore explicite sur la place de chacun sur l’échiquier. Il dit à Armant :
« Vous n’êtes pas délégué syndical, ni chef de pupitre. Vous ne détenez aucun mandat, aucune fonction particulière dans l’orchestre. Altiste de rang… Pour moi, vous êtes un pion. Ne le prenez pas mal. Aucune pièce aux échecs n’est inutile ou secondaire. Un pion peut être sacrifié. Il peut défendre une position stratégique. Il peut concourir à un échec et mat. Ou au terme de son parcours, à la huitième case, être promu. Je ne sais pas encore quoi faire avec le pion Armant. »
Après cet entretien, et au vu du déferlement médiatique autour de l’altiste, le petit pion devient bel et bien indispensable. Les échecs sont une représentation élégante de la hiérarchie acceptée. Si chacun a sa place sur l’échiquier, celui qu’il faut défendre, c’est bien le roi. Le maestro Craon ne s’est jamais expliqué sur son geste, sur ce bras droit levé un 20 avril, jour de l’anniversaire du Führer. Le maestro Craon a disparu. Armant ne pourra reprendre sa vie en mains qu’après avoir parlé avec lui. En quelques pages frappantes d’évocations et d’allusions, François Garde emmène son petit altiste à la confrontation. C’est comme remonter un fleuve et aller affronter le Kurtz de Conrad. Une espèce d’odyssée hallucinatoire, entre TGV trivial et limousine glissant au cœur des Alpes, sans heurt au long de lacets mortels, dont le point d’arrivée est un bunker à baies vitrées donnant sur un lac de ténèbres. L’image est saisissante, magnifique, effroyable. Si Chomérac, petit apparatchik sans autre motivation que son ambition, s’en remettait aux échecs pour signifier le rang de chacun, le chef Craon, lui, ne s’en remet qu’à la musique : « Aucun chef d’État n’est respecté comme un chef d’orchestre », dit-il à l’altiste qui lui a tourné le dos au soir de Così. Et d’ajouter : « D’un léger mouvement du poignet droit, je déclenche les clarinettes et fais taire les bassons. Qui se plaint d’une aussi parfaite hiérarchie ? »
L’Effroi est un roman impeccable. Le lecteur suit pas à pas le cheminement d’un narrateur déboussolé, qui se laisse faire puis se reprend. Le cheminement d’un petit homme qui, parce qu’il a fait ce qu’il pensait devoir faire, sans en mesurer les conséquences mais sans jamais renier son geste, va jusqu’au bout de sa logique, après avoir traversé les épreuves du feu des projecteurs, et de l’attitude glacée de ses collègues, voisins et amis. L’épilogue, exemplaire, balaie l’orchestre pour la musique de chambre, et l’exécution pour l’enseignement. Ne plus suivre la baguette du chef, mais transmettre le don de l’émotion.


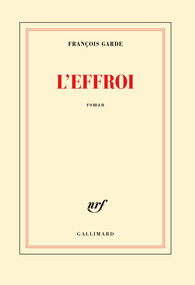






L’histoire d’un Gentil très (trop) gentil quoi…