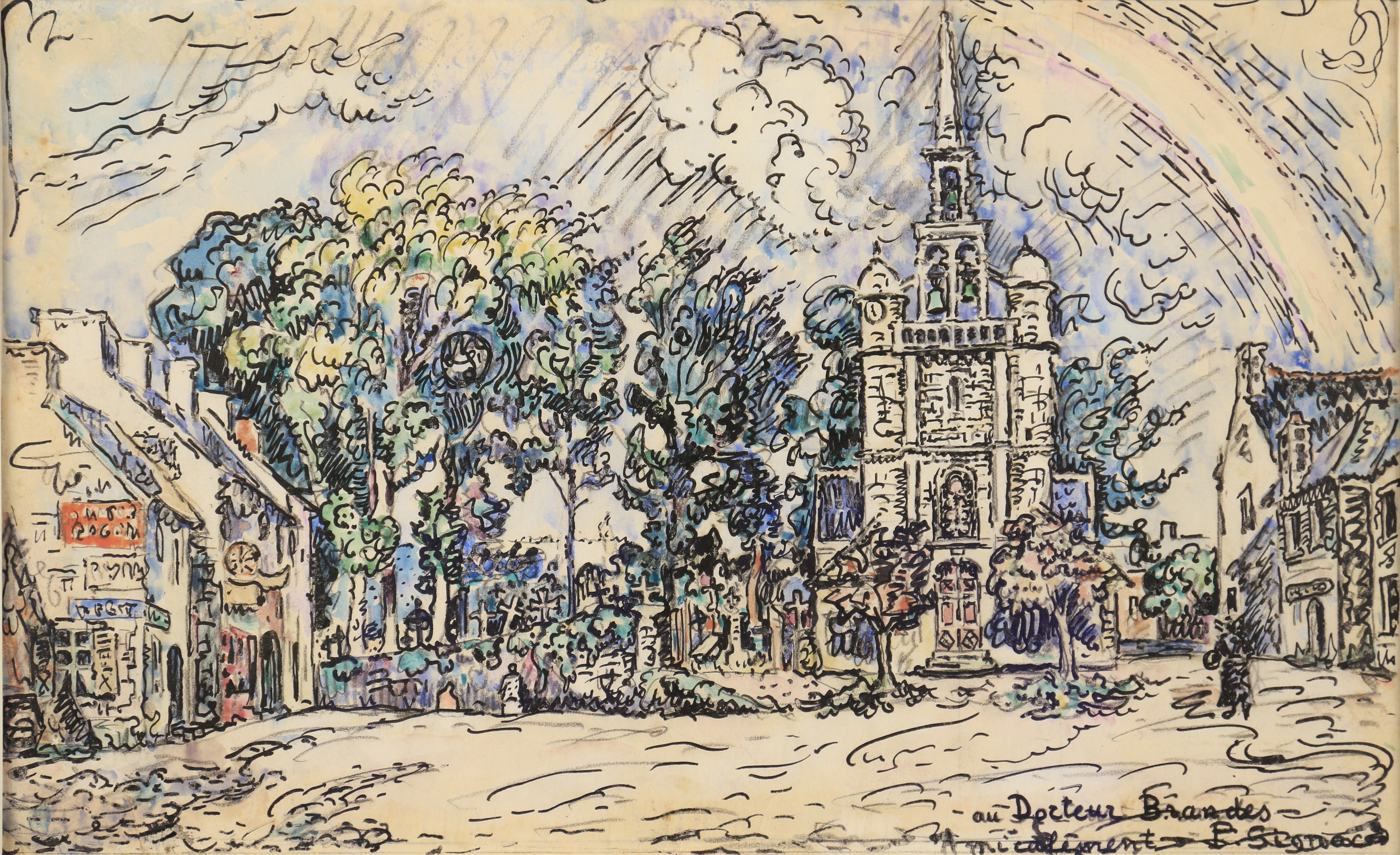Pour la cinquième année de suite, à la mi-novembre, les grandes galeries européennes spécialisées en peinture ancienne, des primitifs du Moyen Âge aux artistes de la fin du XIXe siècle, investissent le temple néoclassique du palais de la Bourse, dans le deuxième arrondissement parisien, le temps d’une escapade de quatre jours dans les mondes reposants que sont ces tableaux de toutes provenances, autant de fenêtres sur d’autres contrées, d’autres époques et d’autres mystères. C’est une sensation différente que celle qu’on ressent en arpentant les salles d’un musée dans l’atmosphère veloutée de ce salon à taille humaine : les styles et les époques, parfois même les écoles de peintures, sont mélangées sur un même stand et, sauf chez les galeries véritablement spécialisées (Weiss pour les portraits), on est toujours cueilli par la surprise, les dialogues incongrus qui s’établissent entre, par exemple, une nature morte du XVIIe siècle et un paysage fluide du XIXe siècle accrochés l’un en regard de l’autre. Il y a là vingt-cinq galeries, cinq-cents œuvres environ.
Le jour du vernissage, comme d’habitude, les allées sont arpentées par ce mélange de vielles dames élégantes, de collectionneurs chevronnés, de grands mondains courant d’un vernissage à l’autre – et qui semblent intéressés au moins autant par le champagne que par les œuvres, de marchands aux airs de grands bourgeois mais aussi de critiques et journalistes courant pour faire tous les stands tandis que de jeunes historiens de l’art, stagiaires en galeries ou dans les musées, découvrent avec excitation toutes ces œuvres qu’ils aimeraient pouvoir s’offrir.
Commençons d’abord cette courte chronique en relatant l’événement, non pas mondain mais artistique, du vernissage. Sur le stand de la galerie lyonnaise Michel Descours, une souscription spontanée a été lancée par un conservateur du Louvre, Guillaume Kientz, et par Jean-Pierre Cuzin, ancien directeur du département des peintures de ce même musée, pour acquérir un tableau… et l’offrir à un musée. Immédiatement suivie par de nombreux conservateurs et amateurs, l’initiative a permis d’acheter pour le musée des Beaux-Arts de Lyon un petit format dû au pinceau du Lyonnais Claudius Jacquand (1803-1878). Peintre de la veine Troubadour en vogue dans la première moitié du XIXe siècle, le tableau acheté est son premier connu. Il représente Un soldat soigné par une religieuse dans un cloître qui n’est autre que le cloître de l’abbaye Saint-Pierre, qui accueille le musée lyonnais. Millionnaires ces conservateurs ? Non, juste passionnés, d’autant que le petit tableau était proposé à un prix fort raisonnable.
Ces fonctionnaires zélés qui se substituent aux deniers publics pour continuer à agrandir les collections des musées en période de restrictions budgétaires récompensent un musée vertueux. Malgré les coupes, Lyon, grâce au mécénat notamment, est l’un des rares musées publics qui continuent régulièrement à enrichir ses collections. Au très fin portrait d’homme de Corneille de Lyon à plusieurs centaines de milliers d’euros qu’il vit d’acquérir, vient ainsi s’ajouter une jolie pièce pour la collection de peintures du XIXe siècle de l’école lyonnaise que l’institution ne cesse, année après année, d’étoffer tout en parvenant, chose encore plus remarquable, à faire des acquisitions dans d’autres domaines.

Sur le stand de Delestre et Stoppenbach, on remarquait d’autres toiles de la fin du XIXe siècle : un joli Maximilien Luce pointilliste comme il se doit, représentant le Pont-Neuf dans le clair de la nuit froide qui s’installe sur Paris, ainsi que deux tableaux de Henry Moret très différents l’un de l’autre. Le premier, pour ce qu’il a de classique, n’en est pas moins admirable : il est un parfait exemple de cet impressionnisme méditerranéen que pratique Moret, qui méridionalise la Bretagne, la cueille sous ses jours les plus cléments. On sentirait presque l’odeur du maquis se substituer à l’ajonc et à l’air iodé de l’Atlantique. L’autre n’a rien à voir avec le Moret auquel on est habitué : couleurs irréelles, aplats de couleurs, ligne pour circonscrire des formes géométrisées, rendues primitives. Ici le peintre s’essaie clairement à la manière bretonne de Gauguin et de l’école de Pont-Aven.
Louis Cretey, la nouvelle vedette des peintres lyonnais du Grand Siècle est, comme chaque année depuis cinq éditions, présent sur le stand de Descours, pour notre plus grand bonheur (nous avons un faible pour celui qui, jusqu’en 2011 et l’exposition du musée des Beaux-arts de Lyon, n’était qu’un illustre inconnu, dont on ne connaissait même pas le bon prénom). Mais il faudrait être un peu monomaniaque pour ne voir que Cretey chez Descour : une très belle et grande toile signée François-Joseph Navez trône au centre du stand du marchand lyonnais, représentant L’Obole de la veuve. Ce beau morceau de peinture religieuse a été rapidement vendu.

Pour rester dans les grandes compositions du XIXe siècle, citons, chez Talabardon et Gautier, un bel Henri IV rapporté au Louvre de dimensions également généreuses. Daté de 1836, il est signé par Joseph-Nicolas Robert-Fleury, un autre de ces peintres dits Troubadours qui se plaisent à dépeindre dans une veine pathétique des drames historiques, avec le souci du costume d’époque s’il vous plaît, comme cela se faisait alors au théâtre des romantiques.
Porcini, la grande galerie de Naples, propose une sélection toujours très locale, à l’instar de l’année dernière où elle n’avait, à une exception près, montré que des œuvres napolitaines : l’un des tableaux les plus intéressants du stand et de la foire est justement dû à un peintre de Naples très peu connu ailleurs (aucun musée français ne possède de ses toiles). Richesses infinies de l’Italie : Marco Pino est un Siennois du XVIe siècle, mais transplanté à Naples, foyer artistique cosmopolite à la Renaissance, avant que son école de peinture autochtone n’émerge au XVIIe siècle. Il représente Saint-Michel terrassant le démon dans une pose toute maniériste, élégante et musculeuse, sur un fond jaune d’œuf, dans des couleurs crémeuses. La pose de l’archange rappelle deux œuvres de même sujet du plus grand peintre siennois de l’époque : Beccafumi, qui fut le maître de Pino qui répète donc exactement la formule. Parmi les autres napolitains, outre un Ribera qui ressemble à un Stanzione ou un Guarino, on s’arrêtera pour compléter ses connaissances en peinture napolitaine devant deux autres peintres rarement présentés hors de Naples : Giovanni Ricca et Teodoro d’Errico, un Hollandais émigré aux pieds du Vésuve. Enfin, perle de rareté que beaucoup ont remarquée : une Crucifixion du bon larron sur ardoise de Michelangelo Cerquozzi, dans son cadre mouluré à plusieurs baguettes, d’origine. Comble du luxe, ce petit tableau est repris à l’identique par le peintre dans une composition plus grande, un de ses autoportraits qui est aussi l’une de ses meilleures œuvres. La comparaison des deux, ces jeux de miroirs et de mise en abyme constituent toujours un plaisir que ne se privent pas de goûter les connaisseurs.

Enfin, Paris-Tableau suscite, comme chaque année, de nombreuses expositions chez les galeristes et marchands qui n’y participent pas : c’est ainsi que, place du palais Bourbon, le Londonien Derek Johns, propose un accrochage très réussi de tableaux exclusivement français, du XVIIe et XVIIIe siècles : outre un délicieux petit portrait ovale de dame peint sur cuivre par Pierre Mignard, on est frappé par une magnifique toile de Sébastien Bourdon, l’un des meilleurs peintres du Grand Siècle. Le sujet (et la qualité) sont la même que l’un de ses tableaux les plus célèbres, dans les collections de la National Gallery of Art de Washington : Moïse et les filles de Jethro. La scène est poussinienne, avec ces nombreux personnages aux visages calmes, lisses et semblables, disposés en frise devant un paysage idéal. Certains passages rappellent même le célèbre Eliezer et Rebecca de Poussin au Louvre. Cependant, le traitement est typiquement celui de Bourdon, dont on reconnaît facilement la pâte : il rend « baroque » le classicisme de Poussin en ajoutant à ses personnages des drapés virevoltants, animés d’un souffle qui n’existe pourtant pas. La scène devient plus colorée, plus animée également, avec un sentiment décoratif qu’on retrouve moins chez le sérieux, chez le philosophique et le moraliste qu’est Poussin.
L’an prochain Paris-Tableau sera intégré à la Biennale des Antiquaires, grand salon qui se déroule début septembre au Grand Palais (et qui deviendra annuel). On s’était habitué à ce rendez-vous automnal parisien du palais de la Bourse, charmant par sa taille réduite et son atmosphère feutrée. Mais dans un monde de l’art désormais de plus en plus compétitif et internationalisé, il faut réunir les forces, proposer toujours plus de galeries et d’œuvres dans un même endroit pour attirer les collectionneurs venus de loin et faire face à la concurrence de mastodontes comme la TEFAF ou la BRAFA, ces foires artistiques qui réunissent entre 150 et 250 galeries chaque année.
Adieu donc aux tableaux de novembre.