Dans la famille Mayfield, les deux filles portent des prénoms shakespeariens. L’aînée s’appelle Juliet, la cadette Cressida. Juliet est la « jolie », elle a 22 ans, est fiancée à un jeune homme, Brett Kincaid, qui est parti combattre en Irak et en est revenu défiguré, perturbé, claudiquant autant dans sa marche que dans sa pensée. Cressida a 17 ans, elle est « l’intelligente ». Peut-être autiste – Asperger ? –, elle n’entre pas dans la norme, pose sur le monde un regard acide, cynique. Elle dessine à l’encre des personnages imités de Escher, qui montent et descendent des escaliers improbables, suivent des pentes qui à la fois sont l’endroit et l’envers d’une réalité insaisissable. A l’insu de sa famille, elle se rend dans un bar mal famé afin de persuader le caporal Kincaid qu’ils sont faits l’un pour l’autre, lui le gueule-cassée, elle l’inadaptée. Cressida ne rentre pas au domicile familial. Dans la Jeep accidentée du caporal, on découvre du sang, des traces de luttes. La jeune fille est portée disparue. Brett Kincaid est jugé, condamné, incarcéré.
Dans Carthage, Joyce Carol Oates dissèque les Etats-Unis de 2005 à 2012, ces USA post 11-Septembre qui ont vu des jeunes gens s’engager pour aller combattre en Irak et revenir chez eux en héros déboussolés. La période circonscrite par le roman a son importance, elle résonne dans les conversations familiales et dans les consciences de cette petite ville de l’Etat de New-York : « À Carthage, il y a des gens qui ne “soutiennent” pas la guerre – les guerres. Mais ils soutiennent nos troupes, ils le disent clairement. » Le retour des héros déglingués n’est qu’un motif – même s’il semble premier – dans l’ample roman de Joyce Carol Oates. Comme souvent dans son œuvre, elle se penche ici sur la famille, son fonctionnement, ses bases et ses vacillements. Zeno, le père, n’est pas sûr d’aimer d’un amour égal l’une et l’autre de ses filles. Lorsque Cressida disparaît, il refuse de croire qu’elle est morte. Arlette, la mère, prend sur elle le fardeau de la disparition, tombe malade, se relève, va rendre visite à celui qui s’est accusé du meurtre de sa fille, et pardonne. Juliet, la sœur, qui avait juré amour et fidélité au héros de guerre, jouissant du sacrifice qu’elle s’imposait, tourne casaque et rentre dans le rang d’une normalité petit-bourgeois. Quant à Cressida, elle a toujours été persuadée que si elle venait à disparaître, personne n’éprouverait de chagrin. Les réactions des différents protagonistes passent par des points de vue narratifs différenciés, mais ne font pas de Carthage ce qu’il est convenu d’appeler un roman choral. Joyce Carol Oates agence subtilement son intrigue, et lorsqu’elle le décide, renverse tout.
La deuxième partie de Carthage repose presque entièrement sur la visite d’une prison de Floride, en 2012. Nous sommes loin de l’Etat de New-York, et pourtant, sans rien dévoiler du retournement du roman, nous y sommes aussi. Le couloir de la mort, et la chambre d’exécution. La simulation, pour les besoins d’une visite complète du système carcéral et judiciaire américain, d’une injection létale. Une jeune fille se prête au jeu, quand elle sait, elle, qu’il ne s’agit pas d’un jeu. Les réparties terrifiantes du surveillant qui officie en tant que guide dans sa prison et les réactions partagées du groupe de « touristes » donnent à entendre l’opinion américaine. Elle est diabolique, Joyce Carol Oates. Elle nous offre, soudain, une sorte de novella exemplaire, dont on peut supposer qu’elle a été rédigée en amont de la conception de Carthage. Le personnage principal en est un homme aux cheveux blancs, à la mise impeccable, qui est appelé l’Enquêteur. Il dénonce, dans des ouvrages dont les titres commencent tous par Honte !, les scandales de l’Amérique contemporaine liés aux institutions, corruption de juges ou fonctionnement des établissements psychiatriques, par exemple. L’Enquêteur visite la prison avec sa Stagiaire, une jeune femme chétive, qui use d’une fausse identité, qui considère que sa vie est « minimaliste ». Auprès de l’Enquêteur, elle se sent à l’abri. Cette novella prend place dans le roman tout naturellement et lui donne son point d’ancrage, quand on croyait que le nœud du texte était le deuil d’une famille après un crime horrible.
Du deuil, il en est question, bien entendu. De ses sursauts, de ses abîmes. De crime aussi, il est question, bien sûr. Et de crimes de guerre. Et de religion. Comment pourrait-il ne pas être question de religion dans un roman qui interroge la société américaine contemporaine par le prisme d’une petite ville ? Zeno Mayfield, le père, a été maire de Carthage, un bon maire, soucieux du bilan comptable de sa ville. Plus jeune, il a été avocat, a défendu « un professeur de biologie, suspendu de ses fonctions pour avoir enseigné la théorie de l’évolution de Darwin et dénoncé le “créationnisme”. »
La ville américaine de Carthage, Joyce Carol Oates ne la confronte qu’imperceptiblement à la Grèce antique. On connaît l’exhortation de Caton, delenda est Carthago. Dans Carthage, ce n’est pas la ville qui est détruite, c’est la famille, une famille particulière. Qui éclate après la disparition de Cressida mais qui, vaille que vaille, se reconstruit. Différemment. Le père, la mère, la fille aînée, tous trouvent un nouvel espace où se lover. Où se mettre à l’abri, peut-être, comme Brett Kincaid se sent à l’abri en prison. Le prénom du père, Zeno – Zénon – renvoie à un paradoxe bien connu, celui de la flèche lancée mais immobile. Comme si la trajectoire de Cressida, qui est le cœur palpitant du roman, était à la fois figée et mouvante. Un exemplaire du Phédon tient une place particulière dans les relations entre la fille cadette et son père : Cressida ne pardonne pas à Socrate de s’être suicidé, de s’être entêté. Elle a découvert le texte de Platon dans un des livres de son père, un livre d’étudiant, dont les marges sont pleines d’exclamations et d’annotations manuscrites. Mais Carthage n’est pas une transposition du monde grec. Joyce Carol Oates est bien trop habile pour ne s’en tenir qu’à une toponymie trop évidente, ou à une onomastique shakespearienne, via le personnage de Cressida, renvoyant par la bande à la guerre de Troie. Ce qui se joue à Carthage, dans l’Etat de New-York, n’a pas grand-chose à voir avec les guerres puniques, et se déroule loin du regard des dieux homériques.
La pierre de touche d’un roman abouti est sa construction. Et la construction de Carthage est vertigineuse : un prologue, trois parties et un épilogue, en frise chronologique, à l’intérieur desquels des spirales de retours en arrière éclairent la partie qui se joue. Comme un jeu d’échecs en trois dimensions, quand la platitude du plateau est impuissante à rendre compte de la réalité psychologique et politique du monde. Carthage n’est pas un thriller, on l’aura compris. Carthage est un édifice romanesque qui n’a que peu à voir avec la banalité d’une enquête policière. Le roman met à plat différentes formes de violences et de chagrins, d’abandons et de colères. Les voix narratives alternées et les divisions du texte – disparition, exil, retour – montrent à quel point rien n’est jamais figé, au contraire de la flèche de Zénon d’Elée. Il n’y a pas les bons d’un côté, et les méchants de l’autre, chez Joyce Carol Oates. La pâte humaine malaxée dans ce roman remarquable est façonnée d’émotion glaciale et brûlante. Carthage est un roman gothique contemporain, qui puise au cœur des hantises de l’actualité politique et sociologique pour explorer la psyché.


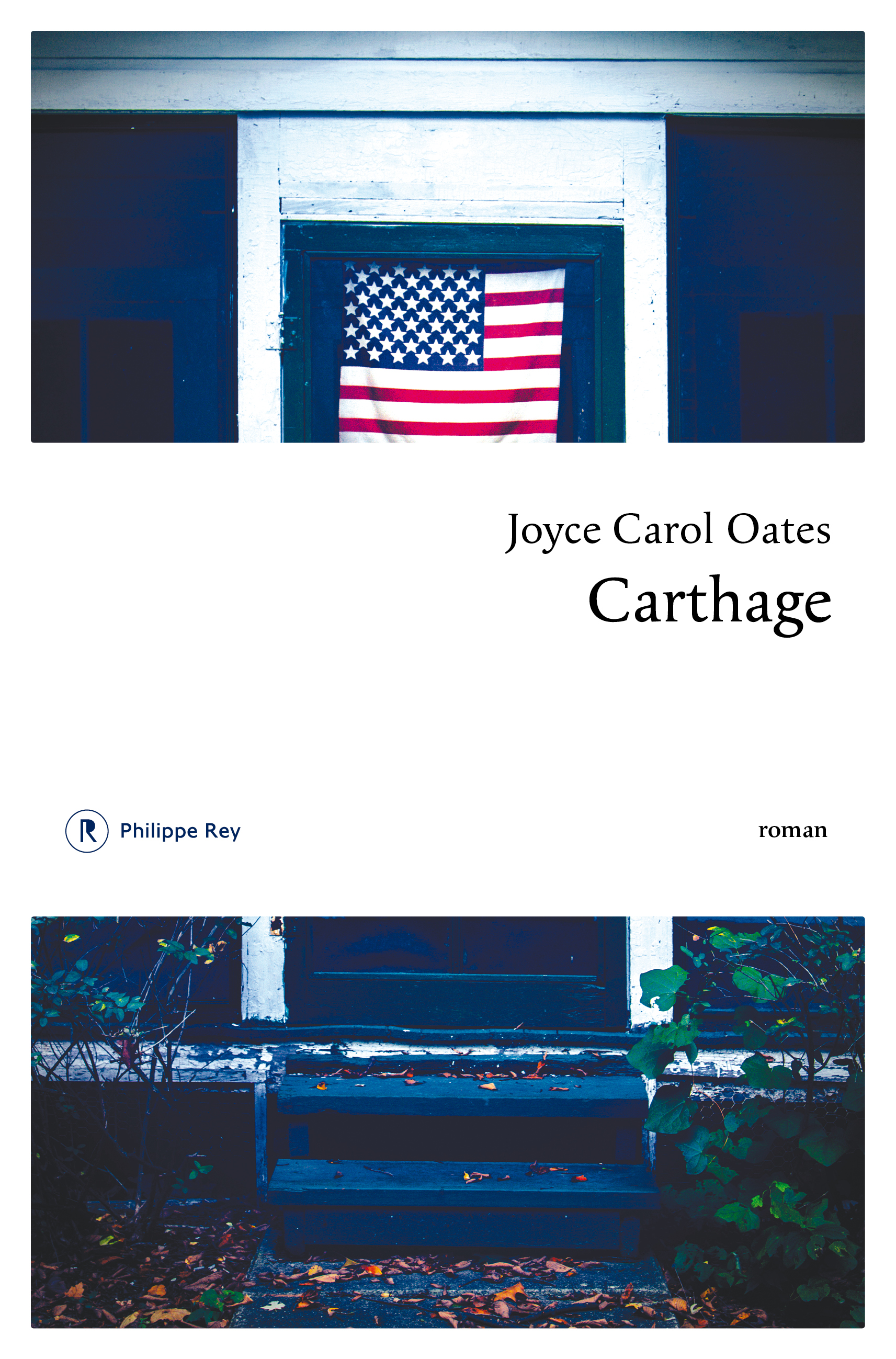






Joyce Carol Oates a toujours su appuyer là où ça fait mal lorsqu’elle dénonce les travers des USA, ici la guerre en Irak, les couloirs de la mort… Au delà de la psyché des personnages, elle explore la psyché de son pays. Un pays qui entend s’exporter comme modèle à travers la planète mais qui est en réalité plein de contradictions.