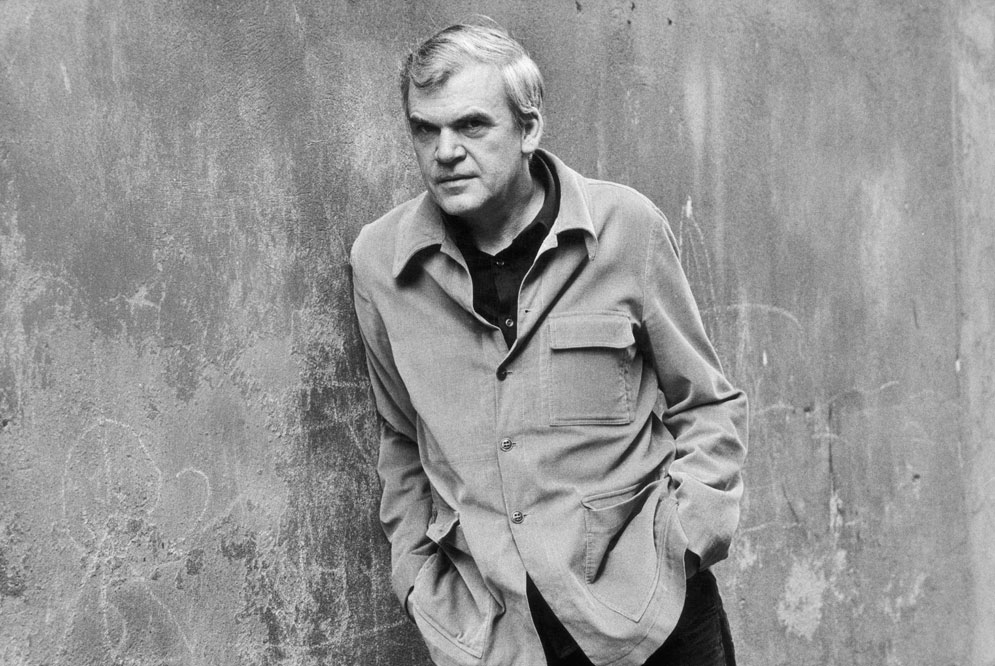La référence à François Rabelais apparaît de plus en plus insistante dans les écrits de Milan Kundera. Dans cet entretien à La Règle du jeu, l’auteur de L’immortalité précise la raison de cette insistance – et en tire un certain nombre de leçons qui, au-delà du salut au créateur du genre romanesque, valent aussi, surtout, pour notre présent.
Guy Scarpetta : Dans notre entretien publié dans le numéro 6 de La Règle du Jeu, tu déclarais : « Je suis toujours surpris par le peu d’influence que Rabelais a pour la littérature française. Diderot, bien sûr. Céline. Mais en dehors de cela ? » Et tu rappelais que Gide, en réponse à une enquête, en 1913, excluait Rabelais de son panthéon romanesque, alors qu’il y incluait Fromentin… Quelle est l’importance de Rabelais dans ton propre « art du roman » ? Quelles leçons de Rabelais, selon toi, peuvent être réactivées aujourd’hui ?
Milan Kundera : Gargantua-Pantagruel, c’est un roman avant la lettre. Un moment miraculeux et irrévocable où un art ne s’est pas encore constitué en tant que tel et n’est donc pas encore normativement délimité. Dès que le roman commence à s’affirmer comme un genre spécial ou (mieux) comme un art autonome, sa liberté originelle se rétrécit ; arrivent des censeurs esthétiques qui pensent pouvoir décréter ce qui répond ou non au caractère de cet art, et un public se constitue qui a bientôt ses habitudes et ses exigences. Grâce à cette liberté première du roman, l’œuvre de Rabelais recèle d’immenses possibilité esthétiques dont quelques unes se sont réalisées, et d’autres jamais. Or, le romancier reçoit en héritage non seulement tout ce qui a été réalisé mais aussi tout ce qui a été possible. Rabelais le lui rappelle.
G. S. : Céline, donc, est l’un des seuls écrivains français, le seul peut-être, à s’être explicitement réclamé de Rabelais. Que penses-tu de son texte ?
M. K. : « Rabelais a raté son coup (…) Ce qu’il voulait faire, c’était un langage pour tout le monde, un vrai. Il voulait démocratiser la langue (…) faire passer la langue parlée dans la langue écrite… » Selon Céline, c’est le style académique qui a gagné. « … Non, la France ne peut plus comprendre Rabelais : elle est devenue précieuse… » L’insupportable, stérile préciosité, oui, c’est la vraie malédiction de la littérature française, de l’esprit français, je suis d’accord. Mais malgré tout mon accord, je suis un peu réticent quand je lis dans le même texte de Céline : « Voilà, l’essentiel de ce que je voulais dire. Le reste (imagination, pouvoir de création, comique, etc.) ça ne m’intéresse pas. La langue, rien que la langue. » A l’époque où il l’a écrit, en 1957, Céline ne pouvait pas encore savoir que cette réduction de l’esthétique au linguistique deviendrait l’un des axiomes de la bêtise universitaire future (qu’il aurait détesté, sans aucun doute). En effet, le roman, ce sont aussi : les personnages ; l’histoire (story) ; la composition ; le style (registre de style) ; l’esprit ; le caractère de l’imagination ; etc. Pense par exemple au registre des styles chez Rabelais : prose, vers, énumérations cocasses, discours scientifiques parodiés, allégories, lettres, descriptions réalistes, dialogues, monologues, pantomimes, etc. Parler d’une démocratisation de la langue n’explique rien de cette richesse de formes, virtuose, exubérante, ludique, euphorique et très artificielle (artificielle ne veut pas dire : précieuse). La richesse formelle du roman de Rabelais est sans pareille. On ne la retrouvera que trois siècles et demi plus tard chez James Joyce.
G. S. : Par opposition à cet « oubli » de Rabelais de la part des romanciers français (que tu désignes comme « réduction de la fonction même du roman »), Rabelais est une référence essentielle pour nombre de romanciers étrangers : tu as mentionné Joyce, bien entendu, on pourrait penser à Gadda, mais aussi à des écrivains contemporains : pour ma part, j’ai toujours entendu parler de Rabelais avec la plus grande ferveur par Danilo Kiš, Carlos Fuentes, ou toi-même… Tout se passe, donc, comme si cette « origine » du genre romanesque était méconnue dans son propre pays, et revendiquée à l’étranger. Comment expliques-tu ce paradoxe ?
M. K. : Je n’ose parler que de l’aspect le plus extérieur de ce paradoxe. Le Rabelais qui m’a envoûté quand j’avais à peu près dix-huit ans, c’est un Rabelais écrit dans un admirable tchèque moderne. Etant donné son vieux français aujourd’hui difficilement compréhensible, Rabelais sera un Français pour toujours plus poussiéreux, plus archaïque, plus scolaire que pour quelqu’un qui le connaît à travers une (bonne) traduction.
G. S. : Quand Rabelais a-t-il été traduit en Tchécoslovaquie ? Par qui ? Comment ? Et quel fut le destin de cette traduction ?
M. K. : Il fut traduit par un petit collectif d’excellents romanistes qui se sont appelés La Thélème bohémienne. La traduction de Gargantua est parue en 1911. L’ensemble des cinq livres fut édité en 1931. A ce propos, cette remarque : après la guerre de Trente Ans, le tchèque en tant que langue littéraire a presque disparu. Quand la nation a commencé à renaître (comme d’autres nations centre-européennes) au XIXème siècle, son pari était : faire du tchèque une langue européenne égale aux autres. Réussir la traduction de Rabelais, quelle preuve éclatante de la maturité d’une langue ! Et en effet, Gargantua-Pantagruel est l’un des plus beaux livres qu’on ait jamais écrit en tchèque. Pour la littérature tchèque moderne, l’inspiration rabelaisienne fut considérable. Le plus grand moderniste du roman tchèque, Vladislav Vancura (né en 1891), était un rabelaisien passionné et ce, non seulement par ses déclarations, mais par sa pratique littéraire : 1) une orgie de la langue : élargissement inouï du vocabulaire à toutes couches linguistiques : couches archaïques, moderne argotique, dialectale ; néologismes ; syntaxe (contrairement à Céline) monumentale (prédominance de périodes hypotactiques) évoquant la prose de la Renaissance, (défi lancé à l’histoire malheureuse d’un pays qui n’a pas eu de grand passé littéraire) ; 2) le narrateur intervenant dans l’histoire, s’adressant sans cesse au lecteur (défi lancé à l’objectivité descriptive de la littérature conventionnelle dite réaliste) ; 3) l’esprit libertin, hédoniste, joyeux (défi lancé à la mentalité traditionnelle centre-européenne, portée au moralisme, à la gesticulation sentimentale).
G. S. : Et si j’élargis ma question précédente à toute l’Europe centrale ?
M. K. : L’histoire de l’Europe centrale est une version tronquée de l’histoire européenne idéale : une Renaissance relativement pauvre ; puis, l’art baroque qui s’est épanoui en musique et en architecture, sans laisser grand-chose dans la littérature ; un XIXème siècle un peu plus fort, mais déformé par les obligations nationales qui pesaient sur la liberté de sa culture. Le magnifique XXème siècle, assoiffé de tout ce que l’histoire centre-européenne a manqué. C’est là, la raison de l’adoration de Rabelais ; il représentait pour l’Europe centrale ; la Renaissance manquée ; la liberté de l’imagination manquée ; la raison critique, irrespectueuse et provocatrice manquée ; le sens du réel manqué ; l’hédonisme manqué ; l’érotisme manqué ; l’humour manqué ; etc. Gombrowicz se réclame de lui à chaque occasion. Rimbaud et Baudelaire, c’est une référence habituelle pour tous les artistes modernes. Se réclamer de Rabelais, c’est plus rare. Les surréalistes français ne l’aimaient pas. A l’ouest de l’Europe centrale, le modernisme avant-gardiste était puérilement anti-traditionnel, et se réalisait presque exclusivement dans la poésie lyrique. Le modernisme de Gombrowicz est différent. C’est avant tout le modernisme du roman. Et puis, Gombrowicz ne voulait pas contester naïvement la tradition mais plutôt la « reconstruire », la « réévaluer » (dans le sens nietzschéen : Umwertung aller Werte). Rabelais – Rimbaud : c’est une telle umwertung des valeurs, perspective inattendue ; et une orientation dont pourraient se réclamer les plus grandes personnalités du modernisme centre-européen.
G. S. : Dans la tradition scolaire française (celle qui s’exprime, par exemple dans les manuels de littérature), il y a une tendance à ramener Rabelais à l’ « esprit de sérieux », à en faire un simple penseur humaniste, – au détriment de la part du jeu, d’exubérance, de fantaisie, d’obscénité, de rire, qui irrigue son œuvre : de cette part « carnavalesque » que Bakhtine a mis en valeur. Comment apprécies-tu cette réduction, ou cette mutation ? Faut-il y voir un refus de cette part d’ironie envers toutes les orthodoxies, toutes les pensées positives, qui caractérise selon toi l’essence même du genre romanesque ?
M. K. : C’est encore pire qu’un refus de l’ironie, de la fantaisie, etc. C’est un refus de l’art : on ne regarde pas l’œuvre de Rabelais comme une œuvre d’art. Le refus de l’art, le mépris de l’art, la misomusie, c’est un grand phénomène de notre temps. Et on rencontre la misomusie même chez ceux qui s’occupent de l’art, non seulement chez ceux qui le vendent mais aussi chez ceux qui écrivent sur lui : leur misomusie se manifeste comme une tendance à détourner l’art du domaine de l’art, du domaine esthétique. Etant donné que l’historiographie littéraire devient de plus en plus misomuse, il n’y a que des écrivains qui puissent vous dire quelque chose d’intéressant au sujet de Rabelais. Dans une interview, on a demandé à Salman Rushdie ce qu’il aimait le plus dans la littérature française ; il a répondu : « Rabelais et Bouvard et Pécuchet ». Cette réponse laconique en dit plus que bien de longs chapitres dans les manuels. Pourquoi Bouvard et Pécuchet ? Parce que c’est un autre Flaubert que celui de L’Education sentimentale ou de Madame Bovary. C’est le Flaubert du non-sérieux. Et pourquoi Rabelais ? Parce qu’il est le pionnier, le fondateur, le génie du non-sérieux. Par ces deux références, Rushdie met en valeur le principe même du non-sérieux qui est précisément cette possibilité de l’art du roman, qui, pendant toute son histoire, est restée plus ou moins négligée ; ces deux références rendent clair le credo esthétique de Rushdie. Et elles nous font comprendre cet énorme scandale : c’est parce qu’il n’était pas sérieux que Rushdie fut condamné à mort. Condamné par le tribunal des agélastes (c’est par ce néologisme que Rabelais désignait ceux qui ne savent pas rire, qui haïssent ce qui n’est pas sérieux ; ce sont eux qui l’ont traqué, à cause desquels il a failli, selon ses propres mots, ne plus écrire). Rabelais avait réussi à échapper au bûcher. Quatre cents ans après, son disciple fut condamné à sa place.