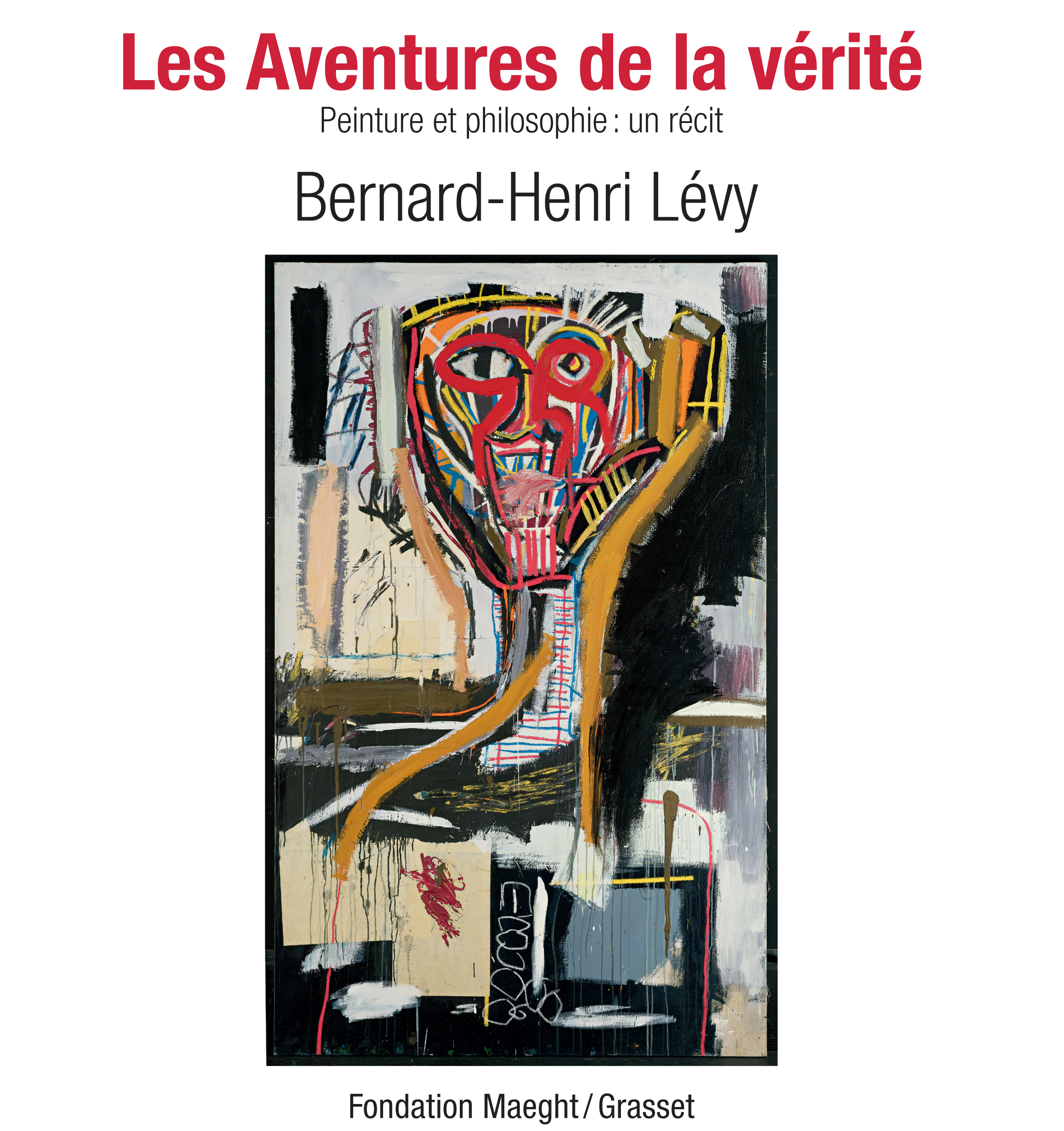Faut-il que l’époque soit devenue folle, ou absurde, ou amnésique, pour s’étonner qu’un intellectuel, attentif à son temps, engagé dans la défense de la liberté en Libye ou en Syrie, hanté par la barbarie d’un siècle «débordé» et venant, cette semaine encore, avec la mort d’un jeune homme, Clément Méric, rappeler que l’Histoire, en Europe, est loin d’en avoir fini avec le tragique et l’horreur, s’intéresse aussi à l’art et lui consacre un livre ?
On rappellera ici la définition du mot «intellectuel» à l’heure de sa naissance, c’est-à-dire chez Zola et les premiers dreyfusards : un écrivain, ou un peintre, ou un savant, interrompant le travail de son œuvre, son face-à-face avec ses démons, pour prendre la défense d’un innocent.
Celle de Maurice Blanchot énonçant, mais à l’envers, dans un article de 1984 sur son propre engagement au moment de la guerre d’Algérie, la même loi d’airain : marcher sur une seule jambe, oublier l’autre face-à-face, non plus avec le feu du siècle, mais avec le feu des mots, laisser le vacarme de la politique couvrir la difficile articulation du dire littéraire ou poétique, c’est «subir un dommage irréparable» et «perdre pour toujours le droit à la parole».
On se souviendra du Sartre des avant-dernières années donnant, d’une main, les textes de foudre et de colère que lui commandaient ses jeunes camarades maoïstes et travaillant, de l’autre, la nuit venue, au coeur d’un espace intérieur où Joyce recommençait de dialoguer avec Freud et le Tintoret, la philosophie avec le roman et les songes invaincus de Pardaillan avec ceux de l’enfant Gustave, à un «Idiot de la famille» dont il était le premier à dire que le personnage principal, Flaubert donc, avait été, par son silence, à l’égal des frères Goncourt, «responsable» des massacres de la Commune.
Engagé n’est pas un métier, voilà la vérité.
Intellectuel n’est pas un état, voilà ce que notre époque pressée, et qui caporalise ses écrivains, tend à perdre de vue.
On l’est – engagé et intellectuel – par moments, par séquences et intermittences, jamais professionnel de la chose, encore moins machiniste de son indignation ou de la détresse d’autrui – saisi plutôt ; requis ; emporté sans l’avoir voulu et, souvent, à regret ; brûlé ; bien obligé.
Tantôt l’action, tantôt l’écriture.
Tantôt les barricades de Baudelaire, tantôt la belle folie (dont Claudel faisait reproche à Mallarmé) de «laisser l’initiative aux mots».
Ou tantôt (quand, des brûlures du siècle et du serment fait à nos pères et nos enfants de ne plus jamais laisser «ça» se reproduire, on fait des romans, des récits, des films) les deux à la fois : hantises, non plus successives, mais se recouvrant, se répondant, se parasitant pour le meilleur, se métamorphosant – lequel, du geste ou du texte, est alors le palimpseste de l’autre ? où, dans le gexte, est l’embrayeur et où ce à quoi il commande ? quand un écrivain embrasse la grande Histoire, quand il part pour la Catalogne ou pour Missolonghi, s’agit-il seulement de politique ou encore de littérature ?
Dieu sait si j’ai épousé mon temps.
Et Dieu sait si l’actualité a pu me solliciter et me sollicitera encore – ici même, chaque semaine, le Bloc-notes.
Mais je sais aussi que cette actualité, quand on s’y livre tout entier, est une menace pour l’esprit.
Je sais que l’«actu», cette version soft de la «com», est comme le sable dans le sablier, avec un sens immanent à soi, qui ne veut qu’être enregistré, surtout pas être conçu ni pensé.
Je sais que l’«actu» c’est la mort, la mort même, celle de Clément Méric, celle des massacres en Syrie, ou celle (spirituelle, morale) d’un Occident qui ne lève ni ne lèvera le petit doigt pour arrêter le massacre.
Je sais qu’il y a un point commun, oui, à ces meurtres, ces hécatombes, ces cauchemars éveillés ou somnambules, ces paroles gelées ou déchaînées, ces bêtises paranoïaques, maniaques, lepéniaques, simoniaques, qui font le trafic et le train du monde : c’est que tout cela est, toujours, peu ou prou, du côté de la laideur, de la violence, du désastre, du désêtre.
Et je sais qu’il y a, même quand elles prennent à bras-lecorps la négativité, le mal, la part sombre ou maudite, de l’espèce et de son histoire, un point commun, au contraire, à toutes les pratiques que l’on continue, aujourd’hui encore, de placer sous le pavillon de l’art : c’est qu’elles sont du côté de l’être, ou de ce que j’appelle le contre-être ou, d’une manière ou d’une autre, de la vie.
Temps et contretemps.
Se tenir du côté de la mort et de son accumulation de désespoirs ou du côté de la vie et de l’espérance intérieure qui est, quand même, toujours là dans le geste des peintres.
Se laisser enfermer dans la gangue asphyxiante de l’événement – ou, par l’art qui, comme la Loi selon Levinas, est toujours plus saint que lui, briser cette mauvaise enveloppe.
Tel est l’enjeu pour un écrivain ou un philosophe d’aujourd’hui ; telle est l’urgence si l’on veut tenter, au moins, le bond hors du rang des nihilistes – fussent-ils, naturellement, ceux de l’art contemporain lui-même !
Pourquoi, aujourd’hui, l’art contemporain ?
par Bernard-Henri Lévy
12 juin 2013
Faut-il que l’époque soit devenue folle, pour s’étonner qu’un intellectuel attentif à son temps s’intéresse aussi à l’art ?