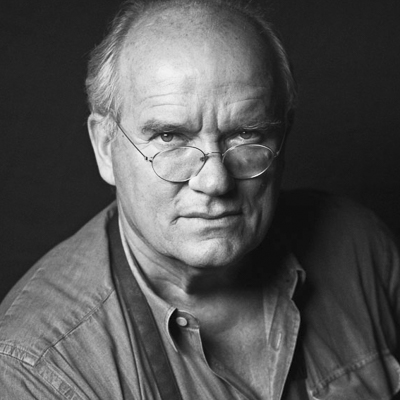Après cinq ans de reconstruction, le Bolchoï a rouvert. Mais ce n’était pas cela qui intéressait Peter Lindbergh, photographe. Il n’est pas du bâtiment, comme on dit. Qu’après un siècle et demi de bons et loyaux sévices, ce temple moscovite de la danse et du pouvoir russes, où les tsars puis Staline et ses sbires venaient du Kremlin voisin parader et puiser leurs maîtresses officielles, menace ruine, que le nouveau maître de la Russie, Vladimir Poutine, ait fait, à son tour, son petit César russe, qu’après cinq ans de travaux pharaoniques, un milliard de dollars dépensés, des tonnes d’or finement utilisées pour dorer de sept couches les stucs de l’énorme machin, des milliers de litres de vodka pour les nettoyer et de queues d’écureuil pour les polir et des armées de babouchkas pour frotter le tout, le Grand Théâtre ait rouvert, que la Russie éternelle soit de nouveau éternelle, et que les petits-bourgeois russes en soient tout fiers, cela n’intéressait pas vraiment Peter Lindbergh.
Un stuc doré n’a jamais passionné le photographe qu’il est, moins encore un ex-kagébiste devenu tsar, mais les êtres humains, en revanche, oui, et parmi eux les femmes, et parmi les femmes les danseuses. Bref, « qu’est-ce qu’un corps (de femme) ? », s’est demandé pour la ixième fois Peter Lindbergh — qui en avait déjà « shooté » quelques bons milliers pour Madame la Mode — durant les deux semaines qu’il a passées dans les salles de répétition du Bolchoï juste avant la réouverture du beau Monstre, naviguant en souverain, parmi les deux cent cinquante danseuses et danseurs que compte le corps de ballet le plus fourni au monde.
Jour après jour, il a vu, dès l’aube jusqu’au soir, chaque danseur et danseuse apparaître, répéter dix minutes exactement sa partie solitairement devant le maître de ballet et disparaître dans l’attente du jugement. La danse, ici, comme un Tribunal suprême, sans appel. Il a vu les muscles énormes des jambes, des mollets, des épaules des danseurs et des danseuses, puis il les a vus se déplier, se mettre en mouvement, s’affiner, se délier, s’allonger, devenir comme des félins. Car le danseur, au Bolchoï, doit être, athlétiquement, le meilleur du monde. Il doit sauter le plus haut, rester en l’air en lévitation le plus longtemps, bondir le plus loin, multiplier les entrechats et les pointes à l’infini, tourbillonner le plus grand nombre de fois sur lui-même ou elle-même. Ici, cela ne se discute pas. Peter Lindbergh a vu l’art extrême mêlé à la souffrance, à la fatigue, à l’ennui de l’attente, il a vu la sueur après l’exercice implacable, les pieds en sang des danseuses à force de pointes, le bout de leurs chaussons tapissé de viande. Il a ressenti le questionnement et même l’angoisse de ces êtres solitaires à l’exercice ou photographiés au repos, leur corps réduit à ne plus servir que de corps à leur propriétaire, corps inutiles et beaux tout de même. Que leur voulait ce grand type, cet étranger qui les photographiait hors de la grande scène où ils brillent de tout leur art, font assaut de légèreté diaphane, multiplient les prouesses physiques les plus époustouflantes ? Pour quelle fin, quel usage ces photos véritablement d’identité, le nom en moins ? N’était-il pas lui-même peu ou prou un tribunal, l’oeil du pouvoir, peut-être même celui, encore une fois, du Kremlin ? Pourquoi ces clichés ? Qui, le commanditaire ? Pour un livre ? Oui, pour le livre officiel du nouveau Bolchoï. Tristesse muette de ces danseurs et danseuses anonymes, privés de danse, en attente de sublimation, de transfiguration. Ce serait pour plus tard, pour la réouverture du Bolchoï. En attendant, ils étaient là, seuls avec eux-mêmes, comme perdus, résignés à leur être terrestre. C’est cela que Peter Lindbergh a magnifiquement dépeint. Une attente d’êtres sans maître. Comme le fameux Marteau du même nom.
Dépassons le cas du Bolchoï. Qu’est-ce que la danse en Russie ? Que signifie la danse ? C’est, avec la poésie et la musique, l’art russe fondamental. Marius Petipa, Nijinski, Noureev, la Pavlova, Maïa Plissetskaïa, Barychnikov, les Ballets russes, Diaghilev, Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, ces noms sont tout pour les Russes. Art total, art spirituel et moral, art populaire et collectif non moins qu’art officiel, où le corps de ballet danse impeccablement comme à la parade, mais où le danseur étoile, la prima ballerina assoluta défient et s’émancipent de la lourde pesanteur, celle-là même où se sait vivre le peuple russe, qui voit sur scène ses chaînes et sa servitude se briser magnifiquement par l’exploit d’elfes de chair, ivres d’eux-mêmes, aériens, délivrés du sol. La danse, ici, est protestation contre la soumission à l’ordre terrestre qui symbolise l’ordre du monde. Soumission et révolte, fatalisme et véhémence : la danse oscille entre ces deux pôles de l’âme russe, les marie.
Un dernier mot, qui va dans ce même sens, que j’emprunte à Dominique Fernandez, dans son beau Dictionnaire amoureux de la Russie. « L’école russe de danse, écrit-il, se distingue par l’attention plus poussée accordée à la moitié supérieure du corps, les épaules et les bras. Serait-ce une indication, que cette préférence donnée au bras sur la jambe, à la partie haute sur la partie basse ? » Et de citer Maïa Plissetskaïa qui inventa dans Le Lac des cygnes le mouvement ondulatoire des bras, partout depuis imité.