C’est le 21 mai 1981 que François Mitterrand prend officiellement ses fonctions de président de la République française. Soit deux jours après la date normale – mais Giscard a demandé un délai ; Giscard a demandé du rab. Une façon, symbolique, de piétiner un peu, de fouler du pied un septennat qui ne lui appartient pas. Une manière, stérile (et immature, et un peu pathétique) de contaminer de sa présence, de son fantôme (de son spectre) un avenir qui commence sans lui. Il a prié Mitterrand, il a supplié Mitterrand de la laisser jouer encore quelques heures au président, de résider un peu encore, illégalement, sur le lieu suprême de la légalité. Illégitime (et illusoire) résidant de la légitimité. C’est Giscard clandestin qui (dans ses murs qui n’ont désormais de sens que pour un autre, et qui piaffent d’impatience de se soumettre à la volonté, de se mettre au service, de son successeur) arpente les couloirs, se donne de sensations, se fait beaucoup de mal. C’est de la rétention de pouvoir ; et c’est de la rétention de réalité. En « choisissant » sa date de départ, l’orgueilleux Giscard veut se donner le sentiment d’avoir choisi de partir. Mais il n’y a pas que l’orgueil : Giscard sait que dehors, c’est la mort qui l’attend. Il sait que dehors, il y a demain et que demain, c’est du futur mais pas forcément, pas nécessairement de l’avenir. Giscard sait, Giscard sent qu’en guise d’avenir, il n’aura sans doute que son passé. La précocité inverse souvent l’ordre du temps : à force d’avoir épuisé son avenir avant l’âge d’être vieux, avant l’âge de cet avenir, on n’a plus devant soi, au moment de commencer à vieillir, que le souvenir de ce qu’on a déjà obtenu.
Quand on ne peut plus progresser dans sa carrière parce qu’on a effectué, jeune, la carrière des carrières, et même la carrières des carrières des carrières, quand on n’a plus aucune marche à monter, aucune étape à franchir dans la gloire et dans la consécration, l’avenir n’est plus qu’un futur aveugle où les jours sembleront n’être là que pour abritrer le temps qui passe. A l’Elysée, le temps n’est qu’un instrument politique de plus – il n’est qu’une des variables, une des faces du pouvoir. Il est un cas particulier de la volonté d’un homme. Mais dehors, le temps va se venger de celui qui, pendant sept ans, avait cru pouvoir le défier ; le narguer ; l’utiliser, l’instrumentaliser.
Dehors, le temps non seulement va continuer à s’écouler, mais il va reprendre en compte les sept années passées à l’abri de son écoulement réel et naturel. Le temps guette le président sortant – il est là, faubourg Saint-Honoré. Dans la rue. Dans le noir. Et il va faire valoir ses droits. Il est venu demander des explications. Il est venu se venger. Il est venu réparer le préjudice. Robert De Niro, dans les Nerfs à vif de Scorsese (1991) incarne un ancien taulard qui a passé quatorze ans de prison parce que son avocat, interprété par Nick Nolte, a « oublié » de joindre une pièce au dossier. De Niro sort de prison : il veut, il va retrouver Nolte ; et lui faire payer, une à une, ces années de prison – ce qu’incarne ici De Niro, ce n’est pas seulement le crime, ce n’est pas non plus la vengeance (ce n’est pas seulement la vengeance), et ce n’est pas tellement le mal. Ce qui incarne De Niro, c’est le temps. Le temps qui passe – le temps, surtout, qui a passé.
Pour Nolte, le temps n’a fait que passer ; il a été écoulement inconscient : les obligations professionnelles, sociales, familiales ont absorbé ce temps comme un buvard, une tache d’encre. C’a a été un temps de rendez-vous, de cycles, de saisons – un temps qui passe, mais aussi un temps passif. Au sens où le temps a semblé vivre sa vie parallèlement à la nôtre, distinctement de la nôtre, un temps qui s’est juxtaposé à l’activité humaine (aux nombreuses activités humaines) ; un temps qui a vécu sa vie de temps pendant que nous vivions, pendant que Nick Nolte vivait sa vie d’homme. C’était un temps dont on savait bien (dont Nolte savait bien) qu’à force de s’écouler, qu’à force d’écoulement il nous ferait vieillir, qu’il nous ferait prendre de l’âge ; mais c’était aussi, c’était en même temps un temps qui ne nous obligeait pas à constater chaque jour son travail et son œuvre, et son office sur nos artères et sur nos plis, et sur nos rides et sur nos articulations ; et sur notre mémoire. C’était un temps gentil – qui s’écoulait cool – qui nous laissait, qui laissait Nick Nolte tranquille. C’était un temps qui ne venait pas contrarier Nolte tout le temps – c’était un temps bien élevé, très poli, et surtout extrêmement discret, et qui ne venait pas embêter Nolte, qui ne venait pas nous embêter toutes les cinq minutes. C’était un temps élégant – c’était un temps galant. (Pas du tout, par exemple, un temps à vous faire remarquer que le temps passe ; pas le genre de temps – comme il en existe ailleurs (on va le voir avec De Niro) – à vous prendre tout votre temps. Pas un de ces petits temps mesquins, terre-à-terre, grossiers, très impolis, pas un de ces temps rustres à vous rappeler (tout le temps) qu’il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps de Nolte n’est pas un temps qui présente l’addition avant qu’on ne passe à table ; non seulement c’est un temps qu’apporte l’addition après le dîner (avec un petit digestif en sus) ; c’est-à-dire une fois le repas consommé. Et comme ce temps est un temps chic (un chic temps, vraiment) il a l’élégance de na pas mettre les prix sur la carte. (A ce propos, d’ailleurs (à propos des prix sur la table au restaurant) je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Tous ceux qui ont eu la chance d’aller au moins une fois dans un grand restaurant savent (et ceux qui y vont souvent par conséquent le savent bien) que les prix des plats, des menus, des boissons, ne sont indiqués que sur la carte que l’on remet à l’homme).
 Eh bien, j’ai toujours trouvé cela d’une bêtise sans nom. Et ce, pour des multiples raisons. D’abord, parce que l’effet obtenu est contraire à l’effet recherché. Ce qui est recherché, c’est une certaine classe ; c’est un certain chic. Un certain standing. Or, lorsqu’une jeune femme (lorsqu’une femme tout court – et pas forcément, pas obligatoirement, pas nécessairement jeune) s’aperçoit que les prix n’apparaissent pas sur la carte, qu’est-ce qu’elle se dit ? Hein ? Qu’est-ce qu’elle se dit ? Elle se dit ceci : « ce minable essaye de m’impressionner. De m’en foutre plein la vue. » Elle se dit ceci : « Cet abruti croit qu’il va m’acheter avec son dîner ». On perd donc tout du point de vue de la classe.
Eh bien, j’ai toujours trouvé cela d’une bêtise sans nom. Et ce, pour des multiples raisons. D’abord, parce que l’effet obtenu est contraire à l’effet recherché. Ce qui est recherché, c’est une certaine classe ; c’est un certain chic. Un certain standing. Or, lorsqu’une jeune femme (lorsqu’une femme tout court – et pas forcément, pas obligatoirement, pas nécessairement jeune) s’aperçoit que les prix n’apparaissent pas sur la carte, qu’est-ce qu’elle se dit ? Hein ? Qu’est-ce qu’elle se dit ? Elle se dit ceci : « ce minable essaye de m’impressionner. De m’en foutre plein la vue. » Elle se dit ceci : « Cet abruti croit qu’il va m’acheter avec son dîner ». On perd donc tout du point de vue de la classe.
Mais il est évident qu’on perd tout également du côté financier. Car s’il est vrai que la femme, dans un restaurant moins chic (et donc moins cher), qui a les prix sous les yeux aura tendance, pour peu qu’elle soit bien élevée (ou du moins humainement viable) à choisir des plats pas trop chers (en tout cas pas les plus chers), celle-ci, en revanche, aura tendance – parce qu’elle se dit que vous avez forcément les moyens – à choisir dans un restaurant chic (et donc cher), sans les prix sous les yeux, un plat (des plats) dont elle se doutera (tout en s’en moquant, par conséquent) qu’ils sont (parmi) les plus chers. Je récapitule : dans un restaurant pas cher, la femme aura tendance à prendre un plat qui n’est pas le plus cher ; et dans un restaurant très cher, la femme aura tendance à prendre le plat qui est le plus cher – et ce, tout en vous prenant pour un pauvre baltringue qui essaye de l’impressionner avec son fric.
J’aimerais (par conséquent) qu’on m’explique quel peut bien être l’avantage de ces menus, de ces cartes muettes pour les femmes. Sans compter que je me demande bien à qui le garçon donne la carte muette lorsqu’il s’agit d’un couple d’homos – ou de lesbiennes. Mais revenons-en à Nike Nolte, d’abord, pour pouvoir en revenir, ensuite, à Giscard – ce qui nous permettra d’en revenir à Mitterrand, et donc à notre sujet (même si j’affirme que tout ce que je vous dis là, sur le temps, sur De Niro, n’est pas hors sujet du tout ; le hors sujet, c’est un truc de profs ; ça ne regarde pas, ça ne concerne pas les écrivains).
Le temps de Nolte, (donc), est un temps sympa – compréhensif – qui n’est pas regardant. Un temps qui n’est pas à la minute. Un temps qui peut attendre. Ce n’est pas un temps pressé ; ce n’est pas un temps qui met la pression – ce n’est pas un temps comptable. Ce n’est pas un temps, ce n’est pas du temps qui tient, à chaque seconde, ni même à chaque minute, ni même à chaque semaine, ni même à chaque année, sa comptabilité. Le temps de Nolte, le temps noltien est un temps qui semble hors du temps. Il est un temps qui se présente à nous, à Nolte, comme une réserve dans laquelle on peut infiniment se servir. Comme un capital dans lequel on peut infiniment puiser. Dans lequel on peut infiniment puiser sans que cela n’ait d’incidence ; sans que cela ne se remarque – sans que cela ne se voie.
Le temps noltien, il n’a qu’à passer, on verra ça après : on a tout le temps avec le temps noltien. C’est un temps qui nous préserve de l’obsession du temps ; c’est un bunker de temps : un temps un peu illusoire certes (on s’en doute, on n’est pas bête, et Nolte n’est pas non plus le dernier des imbéciles), parce que c’est un temps dont on abuse et qui nous abuse : le temps noltien nous fait croire (et on le croit volontiers, et Nolte le croit volontiers) que nous sommes éternels – ou plutôt, que nous sommes momentanément éternels ; que nous sommes provisoirement éternels. Le temps noltien a l’apparence de la gratuité : en réalité il est aussi payant que le vrai – celui de De Niro. Mais le temps de De Niro, c’est De Niro tout court : et c’est le temps réel qui vient faire payer l’addition au temps noltien. C’est le vrai temps qui vient se venger du temps évasif. C’est le temps vécu qui vient régler ses comptes avec le temps p – c’est le temps passé qui vient affronter le temps passif. C’est quatorze ans de prison qui viennent demander justice à quatorze ans de maison. C’est le temps éprouvé qui vient sonner chez le temps méprisé. C’est le temps des secondes qui se dresse devant le temps des années ; et c’est le temps des minutes qui se dresse devant le temps des siècles. C’est le temps infligé qui vient s’expliquer avec le temps négligé. C’est le temps de la patience qui vient en découdre contre le temps de l’inadvertance. C’est le temps de la détention contre le temps de la rétention. C’est le temps de la petite aiguille contre le temps de M. Jourdain. De Niro vient sonner chez Nolte pour lui montrer la vrai facture : celle des durées réelles. De Niro n’est pas le diable : il est le temps effectif. Il est les millions de tours de cadran d’objectifs. Les années de Nolte ont eu la même durée, du point de vue des scientifiques, que les années de De Niro : mais les années de Nolte n’ont pas vu les années passer – tandis que les années de De Niro, elles, ont vu passer, ont vu se dérouler chaque seconde.
Ce qui attend Nick Nolte au terme du temps de ces quatorze ans, ce n’est pas un assassin (ce n’est plus un assassin) : c’est le temps – De Niro assassin… Mais c’est le temps, surtout, que De Niro, en prison, a dû tuer. Le temps, au pénitencier, n’était pas un temps qui faisait crédit – c’était un temps qu’il fallait éprouver tout de suite, et régler rubis sur l’angle. C’était un temps en direct – un temps sur place ; pas un temps à emporter – ce n’était pas un temps patient : c’était un temps à vivre, à consommer au fur et à mesure qu’il se déroulait. C’était un temps grandeur nature, très prenant, très exigeant. Un temps qui n’offrait rien d’autre que du temps ; un temps dont il ne fallait plus, au bout de quatorze ans, qu’il ne reste une seule miette. C’était un temps qui ne nous laissait pas le choix – un temps qui ne laissait pas le choix à De Niro.
 Tel est le temps des prisons, qui n’est pas le temps de la vie. Tel est le temps de De Niro, qui n’est pas le temps de Nolte. Il y a dans le temps noltien une « ruse de la raison temporelle » : c’est un temps qui fait croire que le temps est gratuit, sans conséquence : illimité. Le temps de Nolte ne se ressemble jamais : tel est le temps de la liberté. Le temps de la liberté change tout le temps : il a plusieurs milliers de temps, de temporalités, d’écoulements, de façons de s’écouler à sa disposition. Son sablier n’est pas euclidien. C’est un temps qui glisse, puis hop, fait des loopings, revient, repart, fait du parachute, du saut à l’élastique, puis se repose, s’endort, se réveille brusquement, se met à courir, accélère encore, s’arrête net, se met à flâner, à regarder le paysage, puis à s’oublier, à (faire mine de) revenir sur ses pas. Ce n’est pas un temps qui dure : c’est un temps qui vit. Les enfants grandissent, jouent dans le jardin, sont amoureux pour la première fois, le chien meurt, l’aînée s’inscrit en fac de droit, on fête ses dix ans de mariage : voilà comment se mesure le temps noltien. Avec des épisodes de vie. Des moments d’existence ; avec des saisons humaines ; avec des obligations humaines et des réceptions, et des célébrations humaines. Avec des anniversaires et des croissances osseuses ; et la mesure du temps noltien c’est le passage dans la classe supérieure, l’augmentation du salaire et un nouvel heureux événement en prévision. C’est un temps déguisé en autre chose que du temps. C’est un temps déguisé en choses – et c’est un temps déguisé en existence et en vie. Un temps travesti en étapes, en évolutions en transformations, en mutations, en gestations. C’est un temps maquillé en projets. C’est un temps maquillé en prospectives, et en perspectives : un temps où l’on avance, où l’on progresse avec l’impression (avec la conviction) de ne pas vieillir. C’est un temps qui fait progresser mais pas vieillir ; progresser dans la vie, mais pas vers la mort.
Tel est le temps des prisons, qui n’est pas le temps de la vie. Tel est le temps de De Niro, qui n’est pas le temps de Nolte. Il y a dans le temps noltien une « ruse de la raison temporelle » : c’est un temps qui fait croire que le temps est gratuit, sans conséquence : illimité. Le temps de Nolte ne se ressemble jamais : tel est le temps de la liberté. Le temps de la liberté change tout le temps : il a plusieurs milliers de temps, de temporalités, d’écoulements, de façons de s’écouler à sa disposition. Son sablier n’est pas euclidien. C’est un temps qui glisse, puis hop, fait des loopings, revient, repart, fait du parachute, du saut à l’élastique, puis se repose, s’endort, se réveille brusquement, se met à courir, accélère encore, s’arrête net, se met à flâner, à regarder le paysage, puis à s’oublier, à (faire mine de) revenir sur ses pas. Ce n’est pas un temps qui dure : c’est un temps qui vit. Les enfants grandissent, jouent dans le jardin, sont amoureux pour la première fois, le chien meurt, l’aînée s’inscrit en fac de droit, on fête ses dix ans de mariage : voilà comment se mesure le temps noltien. Avec des épisodes de vie. Des moments d’existence ; avec des saisons humaines ; avec des obligations humaines et des réceptions, et des célébrations humaines. Avec des anniversaires et des croissances osseuses ; et la mesure du temps noltien c’est le passage dans la classe supérieure, l’augmentation du salaire et un nouvel heureux événement en prévision. C’est un temps déguisé en autre chose que du temps. C’est un temps déguisé en choses – et c’est un temps déguisé en existence et en vie. Un temps travesti en étapes, en évolutions en transformations, en mutations, en gestations. C’est un temps maquillé en projets. C’est un temps maquillé en prospectives, et en perspectives : un temps où l’on avance, où l’on progresse avec l’impression (avec la conviction) de ne pas vieillir. C’est un temps qui fait progresser mais pas vieillir ; progresser dans la vie, mais pas vers la mort.
Tandis que le temps de la prison, lui, est un temps fidèle à lui-même : un temps qui à l’infini se ressemble ; c’est un temps droit, linéaire et sans boucles, un temps tout entier fait de temps et d’où toute nuance, d’où toute arabesque, d’où toute fantaisie est chassée. D’où toute originalité est bannie. C’est un temps qui est, à chaque seconde, le temps éternel de l’éternité. C’est un rien d’où rien ne sort, et d’où rien ne jaillit, et que rien ne vient contrarier, un temps que rien ne vient perturber. Ce n’est pas le temps de la vie, mais le temps de la mort. C’est un temps à tuer et c’est un temps qui tue. Ce qu’on attend du temps, pour que la vie soit supportable, ce qu’on attend du temps pour que la vie soit vivable, c’est que le temps ne se voit pas – c’est que le temps ne se montre pas. Ce qu’on demande au temps c’est qu’il aille jouer ailleurs – c’est qu’il aille s’écouler ailleurs. C’est qu’il opère sous d’autres cieux – qu’il aille voir là-bas si j’y suis. Ce qu’on veut, c’est que le temps aille se faire voir chez les grecs. Cachez ce temps que je ne saurais voir. Mais De Niro est en face du temps : le temps le regarde, le temps le fixe droit dans les yeux. Et ce, jusqu’à ce que De Niro finisse par se confondre avec lui – par ne plus faire qu’un avec le temps.
Quand Nolte voit le temps, le vrai, venir perturber son temps relatif, son temps libre : il panique. Il sait que l’heure est venue, pour lui, de penser à la mort. Il sait, il comprend que ce qui va se dérouler, à partir de ce moment, à partir de maintenant, c’est l’action du temps objectif – et c’est tout le temps amassé, c’est tout le temps capitalisé en captivité qui, en sus, va s’abattre sur ses épaules. Non seulement Nolte va apprendre à éprouver la durée réelle des secondes, des minutes et des heures, non seulement il va devoir affronter un temps réel qui use, vieillit, affaiblit et érode les êtres mais il va devoir, en plus, éprouver à rebours, le temps accumulé, le temps réel accumulé objectivement par le monde, par les choses, par De Niro pendant quatorze années. Ces quatorze années passées à traverser passivement le temps, il va falloir les revivre, psychologiquement, non plus à l’aune des aléas des insouciances de la vie, non plus à la vitesse subjective de l’existence, mais à l’aune de la trotteuse d’une montre implacable entre les murs d’une cellule.
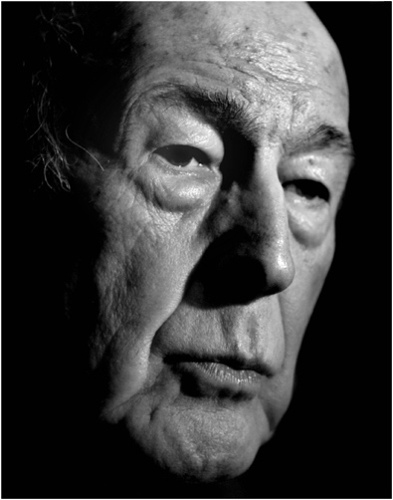 Et c’est ce temps-là qui, dehors, attend Giscard. Avec un choc plus grand encore que le choc que représente le temps de Nolte au temps de De Niro – le temps de Nick au temps de Bob – car le temps de Nolte, c’est un peu notre temps à tous. Car le temps de Nolte ; c’est même beaucoup notre temps à tous ; tandis que le temps giscardien est encore plus coupé de la durée réelle que le temps noltien. Le temps noltien se déroule dans l’inconscience – presque dans l’inadvertance – alors que le temps giscardien se déroule dans la puissance – presque dans la toute puissance. Il y a, il existe le même écart (psychologique), dans la perception de leur écoulement, entre le temps de De Niro et le temps de Nolte d’une part, qu’entre le temps de Nolte et le temps de Giscard d’autre part.
Et c’est ce temps-là qui, dehors, attend Giscard. Avec un choc plus grand encore que le choc que représente le temps de Nolte au temps de De Niro – le temps de Nick au temps de Bob – car le temps de Nolte, c’est un peu notre temps à tous. Car le temps de Nolte ; c’est même beaucoup notre temps à tous ; tandis que le temps giscardien est encore plus coupé de la durée réelle que le temps noltien. Le temps noltien se déroule dans l’inconscience – presque dans l’inadvertance – alors que le temps giscardien se déroule dans la puissance – presque dans la toute puissance. Il y a, il existe le même écart (psychologique), dans la perception de leur écoulement, entre le temps de De Niro et le temps de Nolte d’une part, qu’entre le temps de Nolte et le temps de Giscard d’autre part.
Dégringoler du temps noltien au temps bobien (au temps de Bob (De Niro)), c’est déjà un choc ; c’est déjà un traumatisme – c’est déjà un choc psychologique important. Une étape mentale à franchir. Dégringoler du temps giscardien au temps noltien, c’est à peu près le même choc ; c’est à peu près le même drame. Or, Giscard ne dégringole pas (comme on pourrait logiquement s’y attendre) du temps giscardien au temps noltien, du temps du pouvoir au temps de liberté. De par la nature du pouvoir, de par l’essence même du pouvoir, Giscard, à la fin de son mandat présidentiel, va passer du temps giscardien au temps bobien. Ce n’est pas Nick Nolte (comme on pourrait logiquement s’y attendre) qui va venir sonner à l’Elysée pour ramener Giscard à la maison : c’est De Niro lui-même. C’est De Niro en personne. Giscard ne va pas vivre, à une échelle supérieure, à une altitude plus élevée, la même chute (proportionnellement) que la chute de Nolte. Giscard ne va pas se prendre le temps de Nolte en pleine gueule comme Nolte s’est pris en pleine gueule le temps de De Niro – le temps que va prendre Giscard en pleine tête, comme une avalanche qui va s’abattre sur lui en une milliseconde, c’est le temps de De Niro.
Car le temps du pouvoir, c’est encore autre chose : ce n’est pas le temps noltien, le temps qui-peut-bien-passer-on-verra-après ; le temps du pouvoir, le temps présidentiel – élyséen – est un temps qui appartient au pouvoir ; ce n’est pas un temps parallèle, ce n’est pas un temps avec lequel on peut composer, ce n’est pas, comme le temps noltien, un temps avec lequel on peut s’arranger sur le moment – ce n’est pas ce temps insouciant qui donne aux humains en liberté, aux humains occupés par la vie, la sensation que le temps ne passe pas vraiment sur eux, passe moins sur eux ; le temps élyséen, c’est encore autre chose. C’est encore un autre temps. C’est encore une autre espèce de temps : ce n’est pas le temps bobien que l’on subit ; ce n’est pas le temps noltien que l’on corrompt ; c’est le temps que l’on fabrique. Le temps du pouvoir, ce n’est pas tant une partie du temps qu’une partie du pouvoir. Le temps du pouvoir est moins proche de la nature du temps qu’il ne l’est de la nature du pouvoir.
Le temps élyséen est un temps politique : c’est un instrument ; il n’est chargé que de sens – Et chaque seconde de ce temps signifie quelque chose. C’est un temps à très haute teneur en conséquences. C’est à la fois un temps risqué et un temps dompté ; un temps maîtrisé ; c’est un temps organisé – c’est un temps hiérarchisé – et c’est un temps morcelé en dates, nationalisé en rendez-vous, en échéances, en sommets internationaux, en voyages, en représentations. C’est un temps qui obéit au doigt et à l’œil. C’est un temps à forte densité de décisions – c’est un temps qui est façonné, un temps sur mesure. Dans la cellule de De Niro, De Niro est prisonnier du temps. Dans le palais de l’Elysée, c’est le temps qui est prisonnier du palais. Dans sa cellule, De Niro se fond dans le temps, se confond avec le temps jusqu’à devenir lui-même une horloge, une horloge humaine. A l’Elysée, c’est le temps qui vient se fondre dans Giscard.
A l’Elysée, ce n’est pas Giscard qui regarde le temps passer : c’est le temps qui regarde passer Giscard. Il y a une certaine quantité de temps, dévolue à Giscard, une quantité toute entière contenue dans un septennat, avec laquelle Giscard peut faire ce qu’il veut. C’est du temps qui appartient à Giscard. Du temps disponible, avec des bornes bien définies. C’est un temps vierge à disposition de Giscard. Giscard est alors supérieur au temps qui passe – Giscard est alors supérieur au temps : le temps, lui, ne sait pas, en entrant à l’Elysée, qu’il va durer sept ans – le temps ne sait pas qu’il est là pour sept ans – le temps ne sait pas qu’on peut prélever sur lui sept années de temps de pouvoir. Il ne sait pas qu’un homme a sur lui le pouvoir de l’utiliser à sa guise en lui mettant des bornes – en le découpant, en le saucissonnant comme bon lui semble ; en l’utilisant comme une arme (politique). En faisant de lui un outil (décisionnel) ; un instrument (électoral) ; un moyen (de pression) ; une période (de l’histoire). Le temps se voit détourné de sa vocation pure de temps, qui est de simplement s’écouler en faisant vieillir les cellules des hommes et des choses, pour entamer une carrière politique. Pour devenir un bloc isolé, un morceau prélevé (sur son écoulement) à la merci du pouvoir. Pour devenir un temps politique comme on dit « homme politique ».
Pour devenir un temps balisé, un temps informatisé – un temps monétarisé ; pour devenir un temps monétaire. Un temps industrialisé ; un temps industriel. Ce n’est plus, comme chez De Niro, le ministère du temps ; mais c’est le temps ministériel. Ce ne sont plus des hommes soumis au temps mais du temps soumis aux hommes. Ce n’est plus le temps qui, sur un morceau d’homme, sur une portion de l’homme, va s’affairer pour faire vieillir ce morceau et cette portion de vie ; c’est le président de la République qui, sur un morceau de temps, sur une portion du temps, va s’affairer pour obtenir ce qu’il entend obtenir de ce morceau, de cette portion. Le temps de la prison prend tout l’espace dans la cellule du détenu ; le temps du pouvoir tient dans la main du président élu. Le détenu sait qu’il sera libéré dans quatorze ans : mais pendant quatorze ans il sera le jouet, le cobaye, la victime et la proie du temps. L’élu sait qu’il est élu pour sept ans : mais pendant sept ans c’est le temps qui sera le jouet, le cobaye, la victime et la proie du pouvoir. De Niro mis, par la société des hommes, à la disposition du temps ; le temps mis, par la société des hommes, à la disposition de Giscard.
Le temps de Nick Nolte, c’est le temps de tout le monde – (c’est même le temps du monde). C’est le temps de vous et moi. Mais le temps de De Niro et le temps de Giscard d’Estaing ne sont pas le temps de tout le monde. Pendant quatorze ans, le temps pourra faire ce qu’il voudra de De Niro ; pendant sept ans, Giscard pourra faire ce qu’il voudra du temps. La société a accordé au temps une certaine quantité, une certaine portion de la vie de De Niro ; la société a accordé à Giscard une certaine quantité, une certaine portion de la vie du temps – on voit bien que ce sont là deux façons exceptionnelles, non noltiennes, de traverser le temps, d’appréhender le temps – de vivre, non pas avec son temps, non pas avec le temps, mais de vivre le temps.
Nous autres, les noltiens, le temps, nous vivons avec. Comme dans l’expression « il faut bien vivre avec » ou « il faut faire avec ». Alors le temps est cette chose dont on ne s’aperçoit jamais vraiment. Parce que nous vivons avec le temps mais ne vivons pas le temps. Giscard et De Niro vivent le temps ; ils sont le temps. Pour le premier parce qu’il le commande et le dirige, pour le second parce qu’il est commandé et dirigé par lui. Le temps obéit (pendant sept ans) à Giscard. De Niro obéit (pendant quatorze ans) au temps. Alors, Giscard a peur de s’en aller : il demande du rab à Mitterrand ; dehors, il y a De Niro qui guette, qui rôde – qui attend. De Niro avec des tatouages partout ; De Niro avec une énorme montre. De Niro calendrier géant. Giscard angoisse : les deux jours supplémentaires demandés à François Mitterrand, nouveau président de la République française avec 51,76% des suffrages, sont deux jours passés en passager clandestin de la République, en clandé du suffrage universel, dans un no man’s land juridique, historique, politique, démocratique.
 C’est que Giscard voudrait bien passer le restant de ses jours dans le lieu de sa gloire. Il ne veut pas sortir. La démocratie ne l’amuse plus (du tout). Qu’est-ce qui l’attend, dehors ? Après ça ? La vie d’après, pour Giscard, c’est la vie d’avant. Avec une nuance : De Niro. La vie d’après, pour Giscard, c’est la vie d’avant plus les sept ans à présent décomptés, plus les sept ans gratuits dont il devra s’acquitter auprès de De Niro – non pas auprès de Nick Nolte, car passer de l’Elysée à la rue, de la gloire à la citoyenneté normale, ce n’est pas passer du temps élyséen au temps noltien, ni passer du temps noltien au temps bobien ; mais c’est directement passer du temps élyséen au temps bobien. C’est passer d’un temps exceptionnel à un autre temps exceptionnel. Il existe un couloir qui mène (on l’a vu) du temps noltien au temps bobien ; il existe aussi un couloir qui mène du temps élyséen au temps bobien. Il n’existe aucun couloir menant du temps élyséen au temps noltien – il n’existe pas non plus, dans le couloir qui mène du temps élyséen au temps bobien, une étape, une aire de repos qui serait le temps noltien – la vie d’après, pour Giscard, c’est la vie d’avant plus l’âge. C’est la vie d’avant avec la vieillesse en plus. La vie d’après, pour Giscard, c’est la vie de sa jeunesse avec la vieillesse dedans.
C’est que Giscard voudrait bien passer le restant de ses jours dans le lieu de sa gloire. Il ne veut pas sortir. La démocratie ne l’amuse plus (du tout). Qu’est-ce qui l’attend, dehors ? Après ça ? La vie d’après, pour Giscard, c’est la vie d’avant. Avec une nuance : De Niro. La vie d’après, pour Giscard, c’est la vie d’avant plus les sept ans à présent décomptés, plus les sept ans gratuits dont il devra s’acquitter auprès de De Niro – non pas auprès de Nick Nolte, car passer de l’Elysée à la rue, de la gloire à la citoyenneté normale, ce n’est pas passer du temps élyséen au temps noltien, ni passer du temps noltien au temps bobien ; mais c’est directement passer du temps élyséen au temps bobien. C’est passer d’un temps exceptionnel à un autre temps exceptionnel. Il existe un couloir qui mène (on l’a vu) du temps noltien au temps bobien ; il existe aussi un couloir qui mène du temps élyséen au temps bobien. Il n’existe aucun couloir menant du temps élyséen au temps noltien – il n’existe pas non plus, dans le couloir qui mène du temps élyséen au temps bobien, une étape, une aire de repos qui serait le temps noltien – la vie d’après, pour Giscard, c’est la vie d’avant plus l’âge. C’est la vie d’avant avec la vieillesse en plus. La vie d’après, pour Giscard, c’est la vie de sa jeunesse avec la vieillesse dedans.
Naïf Giscard. Pathétique Giscard. Orgueilleux Giscard. Infantile Giscard. Mauvais joueur Giscard. Traumatisé Giscard. Il veut reculer le moment de sortir, le moment d’être dehors ; le moment d’être comme tout le monde. Il redoute l’instant du Giscard citoyen-comme-les-autres ; il redoute la configuration d’un Giscard lambda – lui qu’autrefois, à l’X, fut grand alpha, il est inconcevable qu’il devienne à présent grand lambda. Il veut rester quelques heures en son palais – président déçu, roi déchu. Des fois que, soudain, les français changeraient d’avis. Des fois que les français, au bout de 48 h, déjà déçus par Mitterrand, viendraient lui demander, finalement, de rester à l’Elysée, de rester président. Giscard veut bien, comme de Gaulle, connaître sa traversée du désert, mais pas plus de deux jours. Alors pendant quarante-huit heures (quarante huit heures de pur temps De Niro, car Giscard est prisonnier volontaire – de l’Elysée – et prisonnier involontaire – de son personnage), Giscard va attendre que les français, soudain pris de remords, soudain réveillés de leur gueule de bois, s’apercevant brusquement de la terrible bourde, mon Dieu, qu’ils viennent de commettre, Giscard va attendre que les français, que le peuple français, que la nation française lui adressent des excuses, le supplient (de bien vouloir (avoir la gentillesse de)) revenir. Giscard reste seul en son palais quelques heures de plus au cas où. Pour vérifier que c’est bien ça que les Français veulent : Mitterrand. La garde qu’il monte, pleine d’orgueil, est une garde de contrôle. C’est plus sûr ; il sera plus tranquille. Mais ce que Giscard ignore (fait mine d’ignorer), c’est qu’à cet instant où il hante les couloirs du palais, l’Elysée est le seul endroit en France où le pouvoir n’est pas. Où le pouvoir n’est plus.
Giscard le fait-il exprès ? Ne voit-il pas – ne comprend-il pas ? que le pouvoir est partout sauf ici ; partout en France, dans chaque village et sur chaque trottoir, dans chaque allée, venelle, lieu-dit, chaque ville, chaque agglomération, chaque salle à manger, partout sauf à l’Elysée. Le pouvoir n’est plus ici ; il est dehors (il est à l’extérieur – il est désormais extérieur). Dérisoire combat de trop de Giscard qui ne veut pas se rendre. Qui ne veut pas rendre la France. Qui ne veut pas rendre le pouvoir. Ni le temps. Qui ne veut pas se rendre ; qui ne veut pas se rendre à l’évidence – qu’espère-t-il ? Lui qui ne veut pas confier la France à la gauche, à François Mitterrand ? Espère-t-il que Mitterrand lui-même l’appelle, en pleine nuit, pour lui dire que finalement il renonce, que finalement l’élection lui suffit, mais qu’il n’a pas envie, qu’il ne se sent pas capable d’aller plus loin, qu’il a mal à la tête, à l’estomac ? Giscard ne sait pas ; il ne sait plus – ni qui, ni quoi attendre, ni à quoi s’attendre, ni qu’espérer.
Giscard est entré plus tôt que prévu à l’Elysée (à l’âge de 48 ans, « grâce » au décès de Pompidou). Il veut en sortir plus tard que prévu (48 heures plus tard) – 48 ans d’un côté ; 48 heures de l’autre : 48 est son chiffre. Mais De Niro lui présentera la facture tout à l’heure : 55 ans. Il a devant lui sa jeunesse d’hier, une jeunesse d’hier faite de la vieillesse de demain. Son avenir ne sera fait que de son passé ; sa vieillesse sera la version descendante de sa jeunesse. Sa vieillesse, ce sera sa jeunesse à l’envers. Une jeunesse entière pour apprendre à entrer à l’Elysée ; une vieillesse entière pour apprendre à en sortir. Mitterrand, lui, n’est pas pressé ; il n’est pas à quarante-huit heures près. C’est lui désormais que le temps suit partout comme un chien-chien ; le temps fait la fête à son nouveau maître. C’est rue de Bièvre qu’il remue la queue, sautille et aboie – et c’est à l’Elysée que Mitterrand lui essaye une nouvelle laisse, le caresse avec amusement, le flatte et lui envoie la baballe – et le temps, comme un chiot qui va grandir de 0 ans à 7 ans, va chercher la baballe.
Mais il y a autre chose qui blesse, qui vexe, qui meurtrit Giscard. C’est que Mitterrand entre plus confortablement à l’Elysée contre lui, que lui n’était entré contre Mitterrand il y a sept ans, en 1974. Non seulement les français ne l’aiment plus, mais ils aiment d’avantage Mitterrand aujourd’hui qu’ils ne l’aimaient lui en 1974, à l’époque où ils l’aimaient. Le vainqueur se sent doublement vaincu ; quant à Mitterrand, pendant ces quarante-huit heures, il se sent un vaincu doublement vainqueur. Le 19 mai 1974, Giscard l’avait emporté sur Mitterrand avec 50, 80% des suffrages exprimés, soit 423000 voix de plus que le candidat socialiste ; le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu par 51,75% des suffrages exprimés, soit plus d’un million de plus que Valéry Giscard d’Estaing. Les communistes ont reporté leurs voix sur François Mitterrand.
Valéry Giscard d’Estaing a demandé du rab à Mitterrand ; qui est alors président de la république ? Dans les faits, c’est Mitterrand ; dans les meubles, c’est Giscard. Dans les urnes, c’est Mitterrand ; dans les murs, c’est Giscard. Valéry Giscard d’Estaing demande à François Mitterrand une ultime faveur – comme un condamné à mort demande une dernière cigarette : celle de le laisser (oui, s’il te plaît !) présider un dernier conseil des ministres (ce, afin de « présider ses adieux au gouvernement ») – comme s’il n’avait pas pu faire ça ailleurs (brasserie, gymnase, relais-château, etc.)
Le dernier, hein ? a fait promettre François Mitterrand.
Oui, oui ! Promis ! Juré ! Le tout dernier des derniers ! Aprèfs je m’en vais ! Je laisse la place.
D’accord, a laissé tomber Mitterrand, grand seigneur.
Giscard a obtenu son hochet ; il refait deux trois tours de son palais de carton-pâte – il arpente, en tout sens, la demeure où loge la démocratie ; l’hôtel particulier de la République.Il aime bien ces quelques heures accordées par son successeur. Ca crée comme une petite zone tampon : ça fait s’accoler les deux septennats, celui qui vient de s’achever et celui qui va commencer. Si Mitterrand avait pris le relais le lendemain même du terme du septennat giscardien, ça aurait mis les septennats à égalité, ça les aurait confondus – ça aurait banalisé le mien, marmonne Giscard. Tandis que là, ça crée une délimitation ; une frontière (symbolique, certes, mais une frontière). Ca fait comme un sas de décontamination : il ne faut pas que, de manière rétrospective, le septennat de Mitterrand vienne contaminer le mien.
Ces quarante-huit heures de rab sont là pour former une zone de neutralité, une zone vierge destinée à ce que, malgré la continuité de l’Etat, et malgré la continuité et l’unité de la République – dont les élus ne sont a priori que la passagère, que l’éphémère incarnation – l’histoire ne mélange pas le septennat de Mitterrand avec le mien (se dit Giscard). On ne mélange pas les torchons et les serviettes ; je n’aurais pas cru (continue Giscard, in petto) que la République eût été capable de me faire ça – de (se) continuer sans moi. De se dérouler sans moi dans l’avenir. J’avais connu la gloire totale et absolue : mon septennat avait une valeur historique considérable en regard de mes prédécesseurs, et surtout de mon vrai, de mon seul prédécesseur réel : de Gaulle (Pompidou, ça ne compte pas, hein, ça ne compte pas, n’est-ce pas : il n’est pas allé jusqu’au bout). Mais voilà que l’élection de Mitterrand transforme, sans prévenir, cette gloire absolue en gloire relative – voilà que Mitterrand, qui n’y connaît rien, qui ne m’arrive pas à la cheville, vient relativiser mon importance dans l’histoire. L’importance que m’avait octroyé mon illustre prédécesseur, voilà que mon indigne successeur l’abîme – et la brade ; et l’effrite – il aurait mieux valu que. J’aurais préféré que. J’aurais mieux aimé que ce soit. Qui me – succède – qui ? En réalité, il n’y a pas de successeur possible à un président. Il n’y a pas de successeur dont la réalité ne soitinsoutenable. Le seul successeur à la mesure, à la hauteur de l’idée que je me suis forgée de moi ; c’est elle, c’est la mort. Celui qui transmet ses pouvoirs à la mort, celui qu fait succéder sa propre mort à ses fonctions présidentielles, celui-là seul est un homme heureux. Serein. Accompli. Je ne parle pas de Pompidou : Pompidou n’a rien transmis du tout : il n’a pas fait succéder sa mort à son septennat – c’est la mort qui est venue le cueillir dans son septennat, en plein dedans ; il n’a pas réussi, il n’est pas parvenu à être plus fort qu’elle, à être plus têtu qu’elle. A être plus légitime qu’elle – à avoir plus de pouvoir qu’elle. A être plus historique qu’elle ; à être plus important qu’elle. A décider du temps à sa place. Il n’est pas parvenu à imposer son calendrier à la mort. Le seul successeur digne au pouvoir, c’est la mort. Le seul successeur digne à la mort politique, c’est la mort biologique. Seul le terme de la vie peut succéder à son apothéose. Seule l’entrée dans la mort peut venir remplacer l’entrée dans la gloire. Même de Gaulle n’a pas réussi cet exploit (se dit Giscard). Pompidou encore moins. De Gaulle est parti en démissionnant – ce que Mitterrand prendra sans doute à coeur (se dit Giscard) de ne jamais faire : une manière de substituer à la (soi disant) grandeur de la démission (qui est qu’on le veuille ou non un aveu de faiblesse ; une défaite de la volonté) la grandeur de l’obstination ; à la grandeur du sacrifice, la grandeur de l’entêtement. Pourtant, (se dit Giscard), si je me souviens bien (et je me souviens toujours de tout, très exactement, très précisément de tout) que le 22 janvier 1969, le Général, en réplique au « moment venu » romain, au « moment venu » divin de Pompidou, avait annoncé sa ferme intention de mener son mandat jusqu’à son terme. Le terme de ce mandat, c’était 1972. (On aurait dû, en réalité, avoir le élections suivantes – on y reviendra – si personne n’était mort ou parti : 1965, puis 1972, puis 1979, puis 1986, puis 1993, puis 2000… puis 2007 : seules la première et la dernière seront respectées). Puis Giscard se tait – quelques centaines, quelques milliers de mètres carrés encore, à arpenter une dernière, toute dernière fois. Au milieu des fantômes. Un tour de parc. Les arbres, l’étang.

Je remercie M. Valéry Giscard d’Estaing de me rendre la parole. Le terme du mandat de De Gaulle était normalement 1972 : mais de Gaulle est mort en 1970. Serait-il mort en 1970 s’il s’était (lui-même) maintenu au pouvoir ? Non, sans doute ; le temps du pouvoir, le temps élyséen l’aurait emporté sur le temps bobien (sur le temps de De Niro). Mitterrand serait mort bien avant 1996 s’il n’avait pas eu l’occasion, pendant quatorze ans, d’être le maître du temps. Le pouvoir politique, c’est la survie biologique – c’est l’assurance d’une prolongation biologique. C’est pourquoi Giscard a si peur de ce qui l’attend après ; car il sait qu’à l’extérieur, c’est de la mort. De Gaulle est mort avant la fin de sa vie. De Gaulle est mort avant la fin de sa vie biologique parce qu’il a anticipé sa mort politique. Personne, rien ni personne ne l’a forcé à partir. Cette réforme sur le Sénat, cette réforme sur les régions, étaient-elles si vitales ? Si importantes ? Arrivaient-elles à concurrencer les gloires passées du Général ? Ses faits d’armes ? Ses fulgurances ? Ses batailles et ses conquêtes ? Et ses victoires (militaires, électorales, internationales, médiatiques, politiques, littéraires) ? Non. Nenni. Niet. No. Nein. De Gaulle n’est pas allé jusqu’au terme de son existence biologique parce qu’il n’est pas allé jusqu’au terme de son existence politique. Il s’est lui-même précipité dans son après. Il s’est lui-même anticipé comme fini ; et alors De Niro est venu le chercher, et de Gaulle a pris dans la gueule, en plein dedans, toutes les années de vieillesse que le pouvoir lui avait épargnées ; que le pouvoir lui avait dissimulées, que le pouvoir avait reléguées à plus tard – le moment venu, – le vrai moment venu – lui, le visionnaire, s’est considéré désavoué à la suite de la victoire du « NON » au référendum et son orgueil l’a poussé à partir ; et sa fierté lui a conseillé de s’en aller. Mais le visionnaire a-t-il vu, a-t-il compris que ce qu’on lit dans l’avenir dépend du moment où cet avenir habite : est-ce le temps du pouvoir ou celui des hommes ? Est-ce le temps élyséen ou celui des horloges ? Est-ce le temps élyséen ou le temps bobien ? L’histoire punit (de mort) ceux qui cherchent à l’interrompre pour cause d’abattement, d’orgueil ou de vieillesse ; Mitterrand ne fera pas la même erreur : il sera, dans cette histoire qu’il aime tant et connaît si bien, le seul à partir au moment légal, au moment désigné par l’histoire, ne cédant son fauteuil présidentiel qu’à une mort biologique le dédouanant à jamais de toute défaite, de toute défection – et, même, de toute succession.
L’orgueil, Mitterrand ne l’a pas placé dans un caprice ; dans l’infantile comédie d’un vieillard militaire et cacochyme qui, vexé comme un pou, et à l’ego cisaillé, a décide de s’en aller tambour battant, persuadé d’abandonner la France à un marasme inéluctable (c’est ça, d’ailleurs, qui était gonflant, à force, chez de gaulle, ce côté : « moi ou bien le chaos »). Mitterrand sera beaucoup plus fort – Mitterrand sera cent fois plus malin. Il a tellement eu de mal à y entrer, dans l’histoire, et à s’y faire une place, qu’il n’aura pas la tentation (malgré ce qu’il a pu dire à certains, dans certaines périodes, brèves, anecdotiques de découragement et de douleurs physiques dues à sa maladie) d’en partir aussi facilement, aussi déceptivement, aussi petitement. On entend souvent dire (on entend tout le temps) dire que la grandeur du Général fut de démissionner après l’échec de son référendum : la grandeur aurait au contraire été de rester. Ce n’était pas la première fois que de Gaulle s’en allait (il aimait bien ça, le vieux, se faire désirer, ah oui, c’était son truc). C’était bien la peine de crâner en mai 68 avec son fameux « dans les circonstances actuelles je ne démis-sion-ne-rai pas », (alors que là, il avait – peut-être – des raisons (pas sérieuses, c’est vrai, mais des raisons) si c’était pour démissionner à cause du sénat et des régions ! Sénat, régions, dont tout le monde se foutait éperdument.
Disons, pour être clément, qu’il a voulu que le peuple lui dise par écrit, par les urnes, et non pas par les cris, par les pavés, qu’il ne voulait plus de lui – et là, effectivement, sans trouver la moindre trace de grandeur, on trouvera toutefois un honorable respect des règles de la démocratie – et ce, même si les règles de la politesse républicaine exigeaient de lui qu’il reste ; qu’il accomplisse son devoir jusqu’au bout. C’est dans la dernière ligne droite qu’on juge le bon combattant. Sinon, ce n’est pas la peine d’entamer un septennat (quand on n’est pas capable de le terminer, quand on n’est pas foutu de le mener à bon port). Mitterrand, abattu par le maladie tiendra jusqu’au bout. De Gaulle, abattu par la fatigue (pas un cancer, non : un coup de barre, un simple coup de pompe !) ne tiendra pas. Je dis que c’est Mitterrand ici qui est grand ; et je dis qu’ici c’est de Gaulle qui est petit. Mitterrand a tenu la mort en respect pour achever son mandat – ce pourquoi on l’avait élu. De Gaulle, penaud, péteux, est allé la retrouver prématurément, elle qui était prête à attendre jusqu’en 1972. Abréger son destin politique, c’est anticiper sa mort biologique.
 Vous allez me dire que le raisonnement ne marche pas sur Pompidou – que la règle ne s’applique pas à Pompidou – que si elle était exacte, cette règle, que si elle était vraie, cette loi, alors Pompidou serait resté à l’Elysée jusqu’en 1976. C’est que je considère que Pompidou n’a jamais été au pouvoir. C’est que je considère que Pompidou, simple excroissance, simple avatar cellulaire, protozoaire de De Gaulle, n’a pas incarné le pouvoir, ne s’est pas réalisé dedans – et que le pouvoir, en retour, ne s’est pas fondu en Pompidou. Pompidou s’est réglé sur le pouvoir. Il s’estgreffé, par conséquent, sur la temporalité du pouvoir ; il s’est adapté au temps élyséen. Et, sans toutefois, dans le palais de l’Elysée, être le jouet des turpitudes du temps de De Niro, il a été soumis, non au temps élyséen, mais au temps noltien. Le temps est entre les mains du pouvoir, le temps est un instrument de la politique, il est la propriété (momentanée) du chef de l’Etat à condition que ce chef de l’Etat soit réellement (et non pas seulement légalement, et non pas seulement électoralement) un chef de l’Etat – soit réellement un chef d’Etat. Pompidou ne l’a pas été. Tout comme son « fils » Chirac (est-ce un hasard) ne l’a pas été. Chez Pompidou comme chez Chirac, on n’a jamais eu l’impression (à laquelle on reconnaît les vrais chefs d’Etat) que le pouvoir avait une emprise sur le temps. On a eu l’impression contraire : que c’était le temps qui décidait à la place du pouvoir. Que le pouvoir, ce n’était que du temps. Et que le temps, ce n’était jamais du pouvoir. Chirac : toujours en train de jouer sur le temps, avec le temps, de vouloir gagner du temps. Le temps a cessé pour lui d’être un instrument (de la) politique – comme peut l’être aujourd’hui l’économie par exemple) : il est devenu le pouvoir lui-même. Le pouvoir de dissoudre de l’assemblée, qui politiquement exige une raison, qui demande une raison politique, s’est ainsi vu ramené ; s’est ainsi vu rabaissé, s’est ainsi vu transformé en question de date – s’est ainsi vu métamorphosé en machine à gagner du temps. Il s’agissait, en effet (ce fut raté), en 1997, pour Chirac, de prolonger le gouvernement d’Alain Jupé en anticipant les élections législatives, prévues normalement pour 1998, d’un an.>
Vous allez me dire que le raisonnement ne marche pas sur Pompidou – que la règle ne s’applique pas à Pompidou – que si elle était exacte, cette règle, que si elle était vraie, cette loi, alors Pompidou serait resté à l’Elysée jusqu’en 1976. C’est que je considère que Pompidou n’a jamais été au pouvoir. C’est que je considère que Pompidou, simple excroissance, simple avatar cellulaire, protozoaire de De Gaulle, n’a pas incarné le pouvoir, ne s’est pas réalisé dedans – et que le pouvoir, en retour, ne s’est pas fondu en Pompidou. Pompidou s’est réglé sur le pouvoir. Il s’estgreffé, par conséquent, sur la temporalité du pouvoir ; il s’est adapté au temps élyséen. Et, sans toutefois, dans le palais de l’Elysée, être le jouet des turpitudes du temps de De Niro, il a été soumis, non au temps élyséen, mais au temps noltien. Le temps est entre les mains du pouvoir, le temps est un instrument de la politique, il est la propriété (momentanée) du chef de l’Etat à condition que ce chef de l’Etat soit réellement (et non pas seulement légalement, et non pas seulement électoralement) un chef de l’Etat – soit réellement un chef d’Etat. Pompidou ne l’a pas été. Tout comme son « fils » Chirac (est-ce un hasard) ne l’a pas été. Chez Pompidou comme chez Chirac, on n’a jamais eu l’impression (à laquelle on reconnaît les vrais chefs d’Etat) que le pouvoir avait une emprise sur le temps. On a eu l’impression contraire : que c’était le temps qui décidait à la place du pouvoir. Que le pouvoir, ce n’était que du temps. Et que le temps, ce n’était jamais du pouvoir. Chirac : toujours en train de jouer sur le temps, avec le temps, de vouloir gagner du temps. Le temps a cessé pour lui d’être un instrument (de la) politique – comme peut l’être aujourd’hui l’économie par exemple) : il est devenu le pouvoir lui-même. Le pouvoir de dissoudre de l’assemblée, qui politiquement exige une raison, qui demande une raison politique, s’est ainsi vu ramené ; s’est ainsi vu rabaissé, s’est ainsi vu transformé en question de date – s’est ainsi vu métamorphosé en machine à gagner du temps. Il s’agissait, en effet (ce fut raté), en 1997, pour Chirac, de prolonger le gouvernement d’Alain Jupé en anticipant les élections législatives, prévues normalement pour 1998, d’un an.>
Transformer du temps en de la politique, c’est le privilège, et c’est la tache, et c’est la grandeur d’un chef d’Etat. Et c’est son devoir. Transformer de la politique en temps, c’est la honte, c’est l’écueil, c’est la décadence, c’est la preuve d’incompétence d’un chef d’Etat. Enrichir le temps de son action, de sa pensée, c’est être capable d’être président de la République, de Gaulle, Giscard, Mitterrand, chacun à leur manière, chacun à leur rythme, chacun avec leur vision, leur nature, leur sensibilité, leur personnalité, ont utilisé le temps pour gagner du pouvoir. Pompidou, Chirac, chacun à leur manière, ont utilisé le pouvoir pour gagner du temps. Le temps passé par de Gaulle à l’Elysée, ce n’est que de l’action. Le temps passé par Chirac à l’Elysée, ce n’est que du temps. Ce n’est que du temps passé par Chirac à l’Elysée. De Gaulle a injecté sa vision du monde dans le temps qui lui était imparti : son temps était riche en décisions, en actions, comme on dit d’un sol qu’il est riche en sels minéraux. De Gaulle avait une vision, une pensée : il rendait le temps intelligent ; et les secondes et les minutes, et les heures (élyséennes) intelligentes. Même chose pour Giscard – qui n’était pas, qui n’avait jamais été gaulliste. Et même chose, évidemment, pour François Mitterrand. Tandis que Pompidou, lui, n’a pas eu la vision de Pompidou : il a eu la vision de De Gaulle. Quant à Chirac, c’est pire encore : il n’a pas eu la vision de Chirac : il a eu la vision de Pompidou. Il a eu la vision de quelqu’un qui a eu la vision de De Gaulle. Pardon ?
 Comment ça je suis sévère avec Pompidou ? Non-non je ne suis pas sévère (avec Pompidou). Quel a été le bilan de Pompidou et quelle a été son œuvre ? Sa personnalité ? Pompidou a été une sorte de machine humaine à s’élever socialement – un ascenseur humain. Un obsessionnel ascenseur humain. Une sorte de psychopathe de l’ascension sociale. Il adorait Proust ? Proust l’aurait adoré ! Aurait, du moins, adoré tirer son portrait d’affairiste arriviste lettré mondain féru de poésie amateur de bonne bouffe bonhomme cool à clopes au bec rigolo gros moderniste bibendum la vie est belle. D’abord Pompidou est un prof : c’est jamais très bon, au sommet de l’Etat, les profs. Professeur de lettres (non, pas comme Mussolini, arrêtez, Mussolini était instituteur – c’est jamais très bon, au sommet de l’Etat, les instituteurs.) Ceci est un texte sur Mitterrand – c’est sur Mitterrand que j’ai eu envie de m’interroger ; de réfléchir. Décrire. Et ce n’est pas sur Pompidou (pour le moment) que j’ai envie de m’interroger : mais il n’est pas tellement difficile (il ne serait pas tellement difficile) de (dé)montrer que Pompidou n’a pas été un homme d’Etat – qu’il n’a fait, à l’Elysée, que passer le temps ; il a été aidé par une conjoncture « favorable », disons. Et c’est vrai : c’est vérifiable dans tous les manuels d’histoire.
Comment ça je suis sévère avec Pompidou ? Non-non je ne suis pas sévère (avec Pompidou). Quel a été le bilan de Pompidou et quelle a été son œuvre ? Sa personnalité ? Pompidou a été une sorte de machine humaine à s’élever socialement – un ascenseur humain. Un obsessionnel ascenseur humain. Une sorte de psychopathe de l’ascension sociale. Il adorait Proust ? Proust l’aurait adoré ! Aurait, du moins, adoré tirer son portrait d’affairiste arriviste lettré mondain féru de poésie amateur de bonne bouffe bonhomme cool à clopes au bec rigolo gros moderniste bibendum la vie est belle. D’abord Pompidou est un prof : c’est jamais très bon, au sommet de l’Etat, les profs. Professeur de lettres (non, pas comme Mussolini, arrêtez, Mussolini était instituteur – c’est jamais très bon, au sommet de l’Etat, les instituteurs.) Ceci est un texte sur Mitterrand – c’est sur Mitterrand que j’ai eu envie de m’interroger ; de réfléchir. Décrire. Et ce n’est pas sur Pompidou (pour le moment) que j’ai envie de m’interroger : mais il n’est pas tellement difficile (il ne serait pas tellement difficile) de (dé)montrer que Pompidou n’a pas été un homme d’Etat – qu’il n’a fait, à l’Elysée, que passer le temps ; il a été aidé par une conjoncture « favorable », disons. Et c’est vrai : c’est vérifiable dans tous les manuels d’histoire.
Pompidou ? Aucune imagination ; pas la moindre innovation – pas la moindre créativité : un prof, quoi. Un homme de commentaire ; un homme de glose : un type bon en grammaire et en commentaires composés. Qui aura passé sa vie à étudier, à bachoter de Gaulle comme il avait passé ses premières annexes, ses années d’étudiant, puis de prof, à étudier, à bachoter Lamartine et Corneille. Et Rimbaud. Et Desnos. Eluard (« c’est l’Eluard. »). Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas l’écrire ? Pompidou était mou – prof en mou – dur en flicaille, en fliquage, en répression. Mais non en création, mou en imagination. Dur en arrestations ; mais mou en visions. Dur en réaction, mais mou en action. Il a tenté de se faire un nom de l’histoire avec sa soi-disant « modernité » (qui chez lui se limitait à accrocher deux toiles de Vasarely dans son living-room) alors que le jour où son premier ministre Chaban-Delmas (qui n’était pas un mauvais, et qui était sans le moindre doute meilleur que Pompidou lui-même) proposa son projet de « nouvelle société », Pompidou joua encore les mous. Il a voulu incarner le « bon sens » ; et il a voulu marquer son septennat (qui sera à peine un quinquennat) de son « réalisme », de son « pragmatisme ». C’est bien ce que je disais : Pompidou n’était pas un homme d’Etat : le bon sens, le réalisme, le pragmatisme, c’est bon pour Matignon. Ce sont les qualités qu’on demande (qu’on exige) à Matignon – et c’est sans doute à Matignon, où il sera resté si longtemps (six ans) que Pompidou avait le plus, avait le mieux sa place. L’Elysée n’a jamais été l’endroit du bon sens, du réalisme ou du pragmatisme : l’Elysée a été inventé, a été sécrété par la République pour que la République puisse rêver – ou du moins, pour que la République puisse espérer. Pour que la République puisse aspirer à. Pour que la République puisse respirer. Et pour qu’elle puisse s’élever : par l’ambition, mais aussi par le rêve, par l’utopie ; par des projets.
La République a crée l’Elysée pour être protégée. Elle a crée Matignon pour être gérée et l’Elysée pour être. La République a crée Matignon pour être protégée et l’Elysée pour être projetée. La République a crée Matignon pour être rangée et l’Elysée pour être dérangée. Elle a crée Matignon pour être resserrée et l’Elysée pour être relâchée. La République s’est donnée un premier ministre pour la calmer et un président pour l’exciter. Elle s’est dotée d’un chef du gouvernement pour la rassurer et d’un chef de l’Etat pour la tester. De Matignon pour la préserver et de l’Elysée pour l’éprouver. De Matignon pour la cajoler et de l’Elysée pour la malmener. D’un premier ministre pour la soigner et d’un président pour l’expérimenter. Matignon est un dortoir ; l’Elysée, un laboratoire. Matignon est un calmant, l’Elysée est un excitant.
Le vrai chef d’Etat, le grand chef d’Etat – et par conséquent le seul, c’est celui qui ne se laisse pas impressionner par la soi-disant immuabilité de la République : si une République vit, il faut qu’elle remue ; il faut qu’elle bouge. Le vrai chef d’Etat, c’est celui qui essaye des trucs sur la République ; qui fait des expériences – qui regarde ce que ça fait. Qui regarde ce qu’on peut faire avec – tout ce qu’on pourrait, tout ce qu’on peut faire avec (d’inédit, de nouveau). Tout ce que ça regorge, comme possibilités, une République ; et comme richesses – et comme réserves. Et comme avenir(s). Et aussi comme utopies. Et comme niveaux de lecture. A Matignon, on est là pour (é)prouver la rigidité de cette République ; à l’Elysée, on est là pour (é)prouver sa souplesse – et non pas le contraire – car on croît souvent que c’est le contraire : que la pérennité et la taxidermie, que le mètre étalon, la fixité, l’immobilité, l’immuabilité, l’inoxydabilité, l’éternité de la République c’est à l’Elysée que ça se passe ; et que la mobilité, et que la vélocité, que la fluidité, que la légèreté, que l’élasticité de la République, c’est à Matignon que ça se passe. Impossible : car il faut une vision pour faire bouger la République.
 L’Elysée est le lieu de la vision : Matignon n’est que celui de la visibilité. L’Elysée est le lieu de l’action : Matignon n’est que celui de l’activité. On est à Matignon pour collaborer : on est à l’Elysée pour élaborer – on est à Matignon pour recommencer : on est à l’Elysée pour renouveler. On est à Matignon pour reproduire : on est à l’Elysée pour produire. Si l’exercice du pouvoir a lieu à l’Elysée, c’est parce que le président a le devoir de s’exercer sur la République, de faire des exercices. Et de lui faire faire de l’exercice ; il a le devoir de l’éprouver, de la solliciter, de la tordre, de la distendre (attention : sans toutefois trop l’abîmer). Le premier ministre, c’est Eric Clapton : mais le président, c’est Jimi Hendrix. Le premier ministre, c’est Matisse : mais le président, c’est Picasso. Matignon, c’est le présent ; l’Elysée, le futur.
L’Elysée est le lieu de la vision : Matignon n’est que celui de la visibilité. L’Elysée est le lieu de l’action : Matignon n’est que celui de l’activité. On est à Matignon pour collaborer : on est à l’Elysée pour élaborer – on est à Matignon pour recommencer : on est à l’Elysée pour renouveler. On est à Matignon pour reproduire : on est à l’Elysée pour produire. Si l’exercice du pouvoir a lieu à l’Elysée, c’est parce que le président a le devoir de s’exercer sur la République, de faire des exercices. Et de lui faire faire de l’exercice ; il a le devoir de l’éprouver, de la solliciter, de la tordre, de la distendre (attention : sans toutefois trop l’abîmer). Le premier ministre, c’est Eric Clapton : mais le président, c’est Jimi Hendrix. Le premier ministre, c’est Matisse : mais le président, c’est Picasso. Matignon, c’est le présent ; l’Elysée, le futur.
On est à Matignon pour faire beaucoup ; on est à l’Elysée pour défaire un peu. On est à Matignon pour cauchemarder ; on est à l’Elysée pour rêver. Le temps de Matignon, c’est le temps noltien ; le temps de l’Elysée, c’est le temps élyséen. Pompidou, Chirac étaient faits pour Matignon – étaient au mieux, étaient au plus faits pour Matignon. Faire date, pour Chirac, c’est changer le calendrier ; marquer son temps, pour Pompidou, c’est construire des HLM. Pompidou et Chirac ne sont pas des hommes de vision, ni de création. Ce ne sont pas des hommes d’expérimentation – ce ne sont pas des hommes d’action : ce sont des hommes d’exécution. Ce ne sont pas des hommes de réflexion : ce sont des hommes de réflexes.
Le vrai, le véritable chef d’Etat est celui en lequel se mêlent, en lequel se fondent, se confondent l’action et la réflexion. Un peu comme, en littérature, le grand écrivain est celui chez lequel on ne peut délier le fond de la forme, celui chez lequel on ne peut isoler la forme du fond. Un grand président (un vrai, du moins – Giscard fut un vrai président sans pour autant en être un grand) c’est un président chez qui, pour qui l’action est indissociable de la réflexion et la réflexion, indissociable de l’action – et, plus qu’indissociable : synonyme. L’action d’un chef d’Etat, c’est le fruit de sa réflexion ; la réflexion d’un chef d’Etat, c’est le résultat de son action. Chaque action est non seulement réfléchie, mais réflexive ; chaque réflexion est non seulement activée, mais active – mieux : chaque réflexion est traduite en actes ; mais simultanément : comme on parle de « traductions simultanées » à l’ONU ou ailleurs, dans les sommets, les colloques (les réunions, les commémorations, les célébrations).
Pompidou ? Aucune imagination : rien. Aucune création. Aucune passion. Sans doute pas la moindre vocation. Sans doute pas la moindre motivation. Moins d’ambition pour lui que pour la France. Or un (vrai) chef d’Etat, c’est celui chez qui l’ambition personnelle et l’ambition pour la France ne font qu’un. On ne peut demander à un homme, on ne peut exiger d’un homme de mettre entre parenthèses son ambition personnelle – ce serait absurde : ce serait mettre en péril la société elle-même, et la République elle-même ; l’ambition personnelle est sans doute le seulmoteur qui puisse permettre d’accéder à l’Elysée.
Mais ce qu’on demande à un (vrai) chef d’Etat, outre que son action soit synonyme de sa réflexion et que sa réflexion soit synonyme de son action, c’est qu’une fois parvenu au pouvoir suprême, il parvienne à laisser son ambition pour la France à hauteur de son ambition personnelle (dont l’essentiel du travail est fait). On ne lui demande même pas (nous ne sommes pas nés de la dernière pluie) que son ambition pour la France dépasse son ambition personnelle, mais qu’au moins, mais qu’au minimum, mais qu’au pire elle l’égale. Ca n’a pas été le cas de Pompidou ; et ça n’a pas été le cas de Chirac. Pompidou et Chirac ont commis un premier crime de lèse-Elysée : ils ont souillé le temps Elyséen avec du temps noltien. Ils ont laissé le temps avoir du pouvoir sur le pouvoir, alors que ce qui est attendu d’un président, c’est qu’il s’arrange pour que le pouvoir ait du pouvoir sur le temps. Le deuxième crime de lèse-Elysée perpétré par Pompidou et Chirac, c’est de n’avoir eu que de la visibilité là où il eût fallu avoir une vision ; c’est d’avoir eu qu’une activité là où il eût fallu avoir une action. Donc (troisième crime, induit par le deuxième, corollaire mécanique du deuxième) de n’avoir pas eu de possibilité de réflexion – puisqu’ils n’ont pas eu de capacité d’action. Quatrième crime (de lèse-Elysée) : leur ambition personnelle est perpétuellement restée au-deçà de leur ambition pour la France – que ce soit dans leur ascension vers le pouvoir (ce qui est tolérable) ou que ce soit une fois installés au pouvoir (ce qui n’est pas tolérable). Le temps de l’ambition personnelle est un temps noltien ; le temps de l’ambition pour la France est un temps Elyséen : Pompidou et Chirac ont essayé de gagner en temps noltien ce qu’ils n’ont jamais réussi à traduire en temps Elyséen. Ce sont des VRP du pouvoir ; s’ils n’avaient été élus en parfaite légalité au regard des institutions (démocratiques) de la République française, on serait tenté de les qualifier d’imposteurs. Selon la légalité, ils sont à leur place ; selon la capacité, ils ne le sont pas. Selon l’apparence, ils le sont ; selon la compétence, ils ne le sont pas.
On ne parlera pas ici du bilan de Pompidou ; ni celui de Chirac. On rappellera seulement que Pompidou n’a pas fait grand-chose et que Chirac n’a rien fait du tout. Ils ont passé du temps à l’Elysée : point. Pompidou, rondouillard, fut un flic obtus qui fit voter une loi « anti-casseurs » (le 4 juin 1970) persuadé qu’un complot contre « l’ordre établi » était en train de se tramer. Pompidou, c’est l’homme du moment venu et de l’ordre établi : qu’est-il donc allé faire à l’Elysée ? Elysée : lieu où les moments sont imprévus et le désordre établi. Pompidou, c’est le gros mec cool, à gitanes et pommettes gonflées souriantes hilares franco-françaises qui condamne Gilles Griot, élève de maths-sup, à six mois de prison pour « violence à agent » alors qu’à part des maths, Gilles Griot n’avait rien fait. Pompidou de Montboudif : joli personnage pour Proust, disais-je, mais pour Daudet aussi, question burlesque – et question sonorité. Pompidou, c’est le mec sympa cool gros, à col roulé et bouteille d’Orangina à la main, amateur de pétanque et de soleil et de beaux textes et de beaux tableaux révolutionnaires, et de bonne chère qui supprime la quasi-totalité des sursis (printemps 1973). C’est le très très mégacool mec, Pompidou de Montboudif, qui a passé sa vie à mettre les étudiants et les ouvriers dans la rue à cause de ses réformes réacs matinées de gaullisme mal digéré – le gaullisme étant par nature une chose que seul le Général de Gaulle parvenait à digérer d’une part, et à faire avaler aux français, d’autre part. Pompidou, c’est le gros rigolo, là, le gros gentil qui méprise (de toutes ses forces), a méprisé René Dumont quand René Dumont tente d’expliquer (ce qui lui est presque impossible) que l’équilibre écologique de la planète est menacé par l’industrialisation outrancière de nos sociétés – pendant ce temps-là, Pompidou pollue tout ce qu’il peut ; c’est le king du monoxyde de carbone, ce gros-là. Il adore – c’est son dada – les déchets nucléaires, les déjections, les monoxydes et le plastic, c’est son péché mignon. L’industrialisation, son violon d’Ingres. Il s’amuse comme un fou (toujours clope au bec – toujours : il se pollue lui-même). Pour faire croire aux électeurs (et pour se faire croire à lui-même) que René Dumont dit peut-être vrai, le mou Pompidou (qui n’est dur que de la matraque) va mollement créer un « Ministère mou de l’Environnement » (MME), bientôt rebaptisé « Ministère de la mollesse et de la qualité de la vie » (MMQV). Pompidou, le gros très gros cool très cool rigolo mec, c’est celui qui n’a pas réussi (contrairement à Giscard d’Estaing, véritable chef d’Etat, lui) à faire voter la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Pompidou n’a pas réussi à être chef d’Etat dans un contexte d’expansion économique continue ; Giscard, son successeur, a réussi à être chef d’Etat dans un contexte de récession économique continue (due aux deux chocs pétroliers). L’économie ne fait pas le présent ; et il est évident que le président ne fait pas (non plus) l’économie.
Pompidou, Chirac ne sont pas de chefs d’Etat ; de Gaulle, Giscard d’Estaing, François Mitterrand sont des chefs d’Etat. Pompidou et Chirac n’étaient pas capables d’être président de la République. Giscard était capable d’être président de la République. Quant à de Gaulle et Mitterrand, eux, ils n’étaient pas capables de ne pas être présidents de la République.
 François Mitterrand, disais-je, ne prend officiellement ses fonctions que le 21 mai. A 9h30, il pénètre dans l’enceinte élyséenne. Valéry Giscard d’Estaing le reçoit : grâce à ces fameuses quarante-huit heures accordées par Mitterrand à ce dernier, il y a passation des pouvoirs et non pas transmission ; le contact est atténué – on se frotte moins (les deux septennats se frottent moins l’un à l’autre). Les deux présidents, celui qui ne l’est plus et celui qui ne l’est pas encore s’entretiennent pendant quarante-sept minutes (il y a des journalistes, dehors, qui se sont amusés à chronométrer) dans le « salon bleu » – dont je n’ai jamais vu la moindre photographie à ce jour. « On est prisonnier, ici, vous verrez… » balance Giscard après avoir remis à François Mitterrand le code secret permettant au seul président de la République de déclencher l’arme nucléaire. Alors, le président qui ne l’est plus est raccompagné jusqu’au perron par celui qui l’est enfin.
François Mitterrand, disais-je, ne prend officiellement ses fonctions que le 21 mai. A 9h30, il pénètre dans l’enceinte élyséenne. Valéry Giscard d’Estaing le reçoit : grâce à ces fameuses quarante-huit heures accordées par Mitterrand à ce dernier, il y a passation des pouvoirs et non pas transmission ; le contact est atténué – on se frotte moins (les deux septennats se frottent moins l’un à l’autre). Les deux présidents, celui qui ne l’est plus et celui qui ne l’est pas encore s’entretiennent pendant quarante-sept minutes (il y a des journalistes, dehors, qui se sont amusés à chronométrer) dans le « salon bleu » – dont je n’ai jamais vu la moindre photographie à ce jour. « On est prisonnier, ici, vous verrez… » balance Giscard après avoir remis à François Mitterrand le code secret permettant au seul président de la République de déclencher l’arme nucléaire. Alors, le président qui ne l’est plus est raccompagné jusqu’au perron par celui qui l’est enfin.








Je viens de passer un délicieux moment de lecture. Vous avez servi mon temps bobien et je vous en remercie.J’ai ri autant que j’ai réfléchi et c’est si rare de nos jours de savoir combiner les deux. Les gens se prennent trop au sérieux dés qu’ils abordent des sujets moins légers. Mais c’est le meilleur moyen pour lasser, ennuyer, barber, et ne pas avancer. Vous avez l’art et la manière de ce savoir faire. L’origine de vos réflexions (ces 48h oubliées) autant que la forme de vos textes, autant que l’articulation de vos idées avec des références (si « modernes ») et qui pourrez être sans lien, offrent une cohérence époustouflante qui emportent le Lecteur et l’amène de manière didactique là où vous le souhaitez.
Puis je me permettre de vous demander ce qu’il en est de Sarkozy qui ne s’est pas installé à l’Elysée? peut-être préfère-t-il le temps de sa Rolex au temps élyséen?
Bien à vous
Olivia Zarka