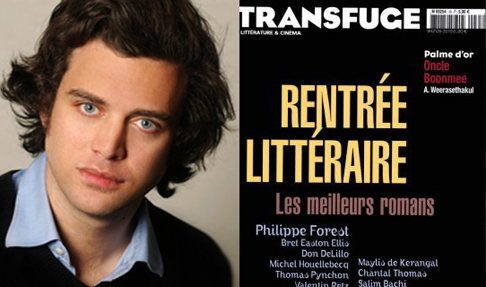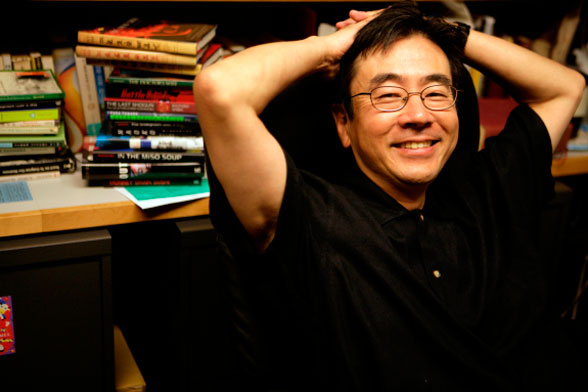On pourrait dire de ce roman que c’est l’histoire d’un tableau. Que ce qui nous est raconté dans la première partie, qui occupe largement les quatre cinquièmes du roman, est un prologue, ou l’explication en amont d’une toile qui sera peinte bien des années après, quand tout sera consommé et que la mort des parents sera venue. Alors, en une nuit de rhum, l’autoportrait pourra surgir.
Dans la ville qui a vu naître Victor Hugo vivent un père, une mère et deux frères, Jérôme et Norbert. Le père est forgeron, le beau et taiseux Jacky est son ouvrier. La forge est le monde du feu, et de l’art. On y tord, dans la fournaise et les escarbilles, le fer chauffé à rouge et à blanc. La forge, c’est l’antre d’Héphaïstos, un lieu mythologique et chtonien qui a peu à voir avec le catéchisme que l’on enseigne aux enfants. Jérôme, le narrateur, regarde son père et l’ouvrier œuvrer. L’enfant a cinq ans, la forge le fascine et l’effraie, le poitrail de Jacky le bouleverse. Cet homme, arrivé un beau jour sur sa moto, est à la fois une apparition et une révélation sensuelle. Le petit monde de Jérôme est circonscrit entre la forge, la maison, un grand champ, une friche, le chemin vers le centre-ville et un dépôt de locomotives. Guy Boley écrit – et non décrit – ces lieux selon des lignes de perspective qui délimitent le masculin du féminin, l’enfance de l’âge adulte. La friche est le domaine des enfants, on y joue aux cow-boys et aux Indiens. La forge et le dépôt de locos celui des hommes, du travail qui salit. Les femmes sont à la lessive ou à la cuisine. Ce monde très délimité, ancré dans une réalité sociale, est rendu dans le roman de façon mythologique et magique. Lorsque la grand-mère prépare les grenouilles que l’on va manger, c’est tout le merveilleux horrifique des contes qui surgit :
« Assise sur le muret, les bras quasiment nus, bottée de caoutchouc et protégée du haut par un lourd tablier qu’elle avait emprunté à son forgeron de fils, grand-mère, d’un geste sûr attrapait une première grenouille et d’un coup de hachoir lui décollait la tête. Puis tirait sur sa peau d’un geste simple et sec, et la déshabillait du cou jusqu’aux arpions qu’elle tranchait eux aussi d’un seul coup de hachoir. Restait une écorchée qu’elle jetait sans viser dans le seau en fer-blanc ou en galvanisé, petit paquet de nerfs monstrueux qui ne cessait de sauter en se cognant aux parois qui résonnaient ding-ding. » (p. 52).
Guy Boley sait imposer un rythme à son écriture, qui passe souvent par l’alexandrin. Dans l’extrait ci-dessus, on en entend au moins trois. Le père Hugo veille : le rythme élégant du vers phare de la métrique française sert ici une scène quotidienne et triviale, chez des gens de peu. La grand-mère incarne aussi ce terre-à-terre brut et vital. Donner à manger nécessite des actes barbares dans lesquels le paganisme le dispute au symbolisme. C’est Giono dans le Doubs. L’enfant absorbe ces moments quotidiens, la cuisine, la lessive, la ruée des femmes lorsque le vent tourne et que les locomotives maculent le linge étendu – les dessous des femmes et des hommes étalés, comme des voiles, laissant apparaître des carrés de blanc sur le ciel, comme une toile, déjà.
Lorsque meurt le petit frère Norbert, la mère accepte et n’accepte pas. Le talent de Guy Boley donne à la folie maternelle un tour d’évidence, qu’une voisine avait anticipé. L’enfant mort n’est plus, mais est encore. On lui prépare ses repas, on l’embrasse au front le soir, on lui achète des livres neufs pour l’école, on s’extasie devant sa mention au baccalauréat. Le petit frère disparu est toujours là, sans consolation. Jérôme vit avec ça, la folie de la mère, le chagrin et la violence du père.
« Et mine de rien on s’habitue, à vivre avec un mort-vivant. C’est même parfois plaisant. Sans doute maman n’avait-elle pas tort. Elle continuait à dresser la table pour nous cinq, au début, puis, lorsque ma sœur quitta la maison, juste pour nous quatre (papa, maman, mon frère et moi), et à servir des assiettées de purée-jambon à mon petit frère, sans ostentation, ni parole déplacée. Juste parfois plus pour elle-même que pour nous autres, un fluet t’as tout fini, je peux débarrasser ? et l’assiette de mon frère, encore fumante et pleine, lui était retirée. » (p. 101)
Fils du feu est un roman qui mêle et rassemble le sensible et l’essentiel, dans une rythmique d’écriture et de perception. La logique de la folie de la mère est parfaitement intégrée par le fils narrateur, et d’une parfaite fluidité dans la narration. Les failles sont mises en avant avec tendresse et empathie, tandis que les fuites – triviales – sont comme escamotées. La grande sœur, par exemple. Elle est pratiquement absente du récit de l’enfance, et réapparaît dans les dernières pages. Elle, elle est « normale », selon les canons habituels. Elle a quitté sa famille, s’est mariée, on la retrouve avec époux et grands enfants à la mort des parents, très terre-à-terre lorsqu’il s’agit de vider la maison d’enfance, et ne voyant dans les toiles de Nicolas de Staël que des taches non signifiantes lorsque Jérôme et elle parlent peinture. Mais, reprenons le fil de notre lecture, Fils du feu est avant tout l’histoire d’un tableau. Jérôme est devenu peintre, et s’est installé en Arles. De Hugo à Vincent, voilà sa trajectoire, qui passe par un épisode psychiatrique, des bifurcations d’études universitaires, des mensonges et des aveux à sa mère à propos de sa sexualité. Le feu primaire, primordial, de la forge de l’enfance et de la folie maternelle, Jérôme l’a à la fois évacué et ingurgité. On ne sait rien de sa peinture à l’âge de la maturité, on en devine tout juste les contours éclaboussés. Le tableau – LE tableau – qu’il peint durant une nuit de veille qui a tout d’une veillée d’armes, Jérôme a dans l’idée qu’il représente ses parents. Puis il s’aperçoit que le petit frère est aussi sur la toile. Mais c’est bien la sœur, celle qui est rentrée dans le rang social canonique, qui comprend que ce tableau est un autoportrait.
Fils du feu est le premier roman d’un véritable écrivain qui a été maçon, ouvrier d’usine, chanteur des rues, saltimbanque, scénariste, chauffeur de bus, garde du corps et cascadeur, entre autres. S’y exprime une sensibilité qui ne passe ni par le pathos ni par l’apitoiement, mais par une écriture torsadée, en parfaite adéquation avec la forge de l’enfance et les volutes de la vie qui va. Le parcours de Jérôme, le narrateur, du feu des fourneaux au soleil d’Arles, trace aussi un parcours d’acceptation comprise, complice, avec les femmes de sa vie : la mère, et la sœur. Ce premier roman est un vrai coup de cœur, qui mérité d’être salué.