Il faut maintenant introduire d’autres références afin d’approcher la situation présente, déclenchée par les événements du 7 octobre 2023. Ne pouvant ici être exhaustif – et je n’en ai de toute manière pas les compétences –, je m’en tiendrai, et de manière évidemment trop synthétique, à George Steiner, Martin Buber, Emmanuel Levinas, et Jacques Derrida.
George Steiner voyait dans l’antisémitisme non seulement un préjudice social ou une idéologie politique, mais encore (et surtout) un phénomène culturel et métaphysique ancré dans la civilisation occidentale. Sa position a ceci de particulier qu’elle lie étroitement la haine des Juifs aux fondements mêmes de la pensée occidentale. En effet, il voit dans l’antisémitisme une réaction aux exigences intellectuelles et morales du judaïsme, lesquelles découlent du monothéisme, de l’absolutisme moral (les commandements éthiques liant tous les hommes), et d’une culture centrée sur l’interprétation, le débat, et la mémoire (le peuple du Livre). Ces exigences font naître ressentiment, rancune, haine. C’est ce qu’il appelle le « cadeau impardonnable » (ungorgivable gift) des Juifs à l’humanité : l’idée d’une loi morale transcendante, laquelle impliquant que l’histoire a un sens et que l’humanité doit obéir à une éthique.
Pour ces raisons, Steiner refusait de voir la Shoah comme une aberration de l’histoire : elle fut au contraire, selon lui, l’aboutissement (culmination) catastrophique de très anciennes tensions inhérentes à la culture occidentale, aboutissement soutenu par la bureaucratie, la science, et le soi-disant rationalisme ; et motivé non seulement par la haine, mais encore par le désir d’éradiquer les témoins que sont les Juifs de la faillite morale de l’Occident. Cette interprétation est surtout développée dans Bluebeard’s Castle et Language and Silence. Et ce qui distingue l’antisémitisme d’autres formes de racisme, c’est qu’il vise les idées, la mémoire, et le sens (plutôt que tels ou tels traits matériels observables) : les Juifs sont les représentants à la fois de la transcendance éthique et de la conscience historique. C’est ce qui expliquerait sa persistance au fil des époques et des idéologies. L’antisémitisme serait donc une hostilité structurelle envers l’héritage éthique, intellectuel, et spirituel du judaïsme.
On voit donc de quelles manières les positions de Steiner et de Arendt divergent : là où Steiner voit l’antisémitisme comme quelque chose d’inhérent à la civilisation occidentale, de trans-historique (qui connaît de multiples transformations mais qui ne disparaît jamais), Arendt refuse les explications métaphysiques, insiste sur la nécessité de comprendre l’antisémitisme historiquement et politiquement (et non comme une haine éternelle). C’est pourquoi elle distingue l’antisémitisme « moderne » (XIXe et XXe siècles) des anciennes formes d’anti-judéisme religieux ; et c’est pourquoi elle pense que la Shoah résulte de circonstances politiques spécifiques, non comme un événement inévitable. Là où Steiner voyait des causes civilisationnelles, elle voyait des mécanismes historiques spécifiques. Steiner pensait que les Juifs sont haïs pour ce qu’ils ont légué à l’humanité, Arendt insistait sur les positions et les fonctions sociales et politiques que les Juifs occupaient. Steiner insistait sur les idées juives, Arendt sur les rôles sociaux imposés par l’histoire. Steiner voyait dans le christianisme une hostilité structurelle envers le judaïsme, Arendt pensait au contraire que l’antisémitisme moderne s’est développé à la faveur du déclin de l’autorité religieuse et de la transformation des idéologies laïques en mouvements politiques. Là où Steiner voyait une continuité théologique, Arendt voyait une rupture laïque. Steiner voyait la Shoah comme le développement extrême de l’hostilité occidentale envers le judaïsme, Arendt comme le produit du totalitarisme, de la faillite de l’État, de l’effondrement des normes juridiques, de la banalité du mal (ou de l’obéissance bureaucratique). Steiner y voyait une révélation culturelle, Arendt une catastrophe politique. Là où Steiner voyait un déterminisme tragique, Arendt voyait des contingences et des responsabilités singulières.
C’est pourquoi leur approche du sionisme est si différente. Pour Steiner, le sionisme est une nécessité tragique, une réponse à la catastrophe historique, il n’est en rien un projet politique idéal. Après Auschwitz, l’apatridie (statelessness) est pour lui moralement et pratiquement intenable. Israël devait exister parce que le monde s’était révélé incapable de protéger les Juifs. Pour autant, la souveraineté juive demeurait à ses yeux tragiquement paradoxale en ce qu’elle risquait de trahir l’héritage éthique juif. Arendt, quant à elle, avait soutenu le premier sionisme mais s’était opposée au nationalisme juif. Elle craignait que l’État-nation juif ne reproduise les pires aspects des rationalismes européens. Le sionisme était à ses yeux devenu dangereux dès lors qu’il eut abandonné les solutions fédéralistes, bi-nationales, ou régionales. Elle pensait que la sécurité des Juifs exigeait intégration politique, et non souveraineté ethnique. Le danger ne résidait pas à ses yeux dans le pouvoir juif en tant que tel, mais dans l’absence de pluralité politique. Quant à Steiner, il était très mal à l’aise avec l’idée d’un pouvoir étatique juif, craignant que devenant « normal » (une armée, des frontières, la coercition) il verrait sa singularité morale érodée. Le soldat israélien était pour cette raison à ses yeux une figure tragique : nécessaire mais éthiquement déstabilisante.
Arendt accordait davantage d’importance à la manière dont le pouvoir est structuré qu’au pouvoir en tant que tel – fût-il juif. Opposée à toute idée de souveraineté ethniquement définie, elle affirmait que le pouvoir devait s’ancrer dans des institutions politiques dirigées par les Juifs et les Arabes.
Et puis il y a une autre question tout aussi importante à propos de laquelle leurs positions étaient divergentes : celle de l’apatridie (statelessness). Steiner pensait en effet que les accomplissements les plus importants du judaïsme avaient eu lieu dans et grâce à la diaspora. Il pensait que l’exil était essentiel à la créativité juive, autant intellectuelle qu’éthique, et que l’existence même de l’État d’Israël était une menace pour cette créativité. Pour autant, il reconnaissait que l’exil sans refuge possible était au XXe siècle devenu meurtrier. Arendt, quant à elle, pensait que l’apatridie était le mal politique le plus radical de notre modernité, et que sans citoyenneté la question du droit – le droit d’avoir des droits – n’a plus de sens. Et c’est à ce problème que le sionisme veut apporter une solution – mais il risque, disait-elle, de le reproduire pour les Palestiniens. En résumé : Steiner regrette la perte, ou l’abandon, de l’exil ; Arendt craint le retour de l’apatridie – pour tout citoyen. C’est pourquoi elle mit très tôt, et explicitement, en garde Israël contre le risque de faillite morale et politique à déposséder les Arabes de leur terre.
Quant à la Shoah, elle était ce qui pour Steiner rendait nécessaire, et donc justifiait, l’existence d’Israël, la vulnérabilité juive ne pouvant, de son point de vue, qu’être permanente, vulnérabilité contre laquelle la souveraineté politique est une protection nécessaire bien qu’imparfaite. Arendt, elle, refusait d’en appeler à la mémoire de la Shoah pour asseoir toute base, tout fondement, politique : la légitimité politique doit prendre appui sur le pluralisme, non sur le rappel du trauma. Steiner se demande s’il est possible de survivre à l’obtention du pouvoir ; Arendt si le pouvoir peut être structuré de manière telle que personne ne perde le droit à ses droits. Steiner en vient finalement à accepter Israël en tant qu’inévitable tragédie de l’Histoire ; Arendt affirme qu’accepter l’inévitabilité de la tragédie est une faillite politique. Steiner pense que l’Histoire est tragiquement irréparable ; Arendt soutient que la fonction de la politique est justement de nous prévenir contre la tragédie.
En résumé : Arendt se demande ce que le politique rend possible ; Steiner ce que l’Histoire inévitablement, tragiquement, détruit. Mais il y a une troisième voix qu’il faut ici faire entendre, celle de Martin Buber, qui pensait que l’éthique devait, devrait pouvoir, structurer le politique. Nous avons donc trois modèles, trois conceptions, de la politique juive.
Buber concevait le sionisme comme un retour, un renouveau, de la question de l’identité, de la souveraineté, non comme un moyen d’asseoir une domination sur un autre peuple. Il soutenait l’idée d’un État bi-national fondé sur la collaboration (il disait, en allemand, Ich-Du, Moi-Toi), État dont le pouvoir devait être pensé selon les préceptes de l’éthique juive : une reconnaissance mutuelle des peuples, des structures confédérales ou fédérales, les fondements de la sécurité basés sur la légitimité morale. Car, pensait-il, un État fondé contre la volonté des voisins ne peut survivre. Sa conception du sionisme, autrement dit, était normative : il devait dire ce que la politique juive devrait être, proche en cela de Arendt, qui soutenait l’idée d’un réalisme institutionnel, lequel devait clairement dire ce que la politique juive devait structurellement éviter (must structuraly avoid). Ces positions, on le voit, sont assez éloignées de celles de Steiner, qui pensait que le sionisme était rendu nécessaire par la catastrophe, et non par un quelconque idéal ; que la création d’un État juif était moralement risquée bien que historiquement inévitable ; et que le génie juif résidait (belonged) – paradoxalement – en exil. Et donc risquait de s’éteindre avec l’obtention de la souveraineté territoriale. C’est en quoi Steiner incarne l’acceptation tragique de ce que la politique juive ne peut éviter.
Il faut maintenant examiner quel usage est aujourd’hui fait des réflexions que ces penseurs nous ont léguées.
Martin Buber. Il reste une référence pour les sionistes libéraux, pour les partisans d’un État bi-national ou confédéral, et il est invoqué comme « preuve » qu’un « autre » sionisme est possible. Ce qui lui vaut d’être traité de naïf et accusé de méconnaître l’Histoire ; de voir sa pensée réduite à un vague sentiment moral ; enfin, que l’on fasse un usage purement rhétorique de sa pensée sans en tirer les conséquences institutionnelles.
Hannah Arendt. Elle demeure une référence importante pour les opposants à l’ethno-nationalisme, pour les défenseurs de la démocratie libérale, pour les opposants à l’état d’urgence permanent. Cela lui vaut d’être accusée d’anti-sionisme, et de rendre les Juifs, grâce à une lecture erronée de Eichmann in Jerusalem (en particulier sur la question de la banalité du mal), responsables de l’antisémitisme. La vérité est qu’elle était opposée au nationalisme juif, non à l’auto-détermination des Juifs.
George Steiner. Il est invoqué par les pessimistes culturels, les Juifs de la diaspora critiques du pouvoir israélien, et les intellectuels qui soutiennent que la mémoire de la Shoah est primordiale. Mais il est fréquemment malhonnêtement utilisé par ceux qui veulent légitimer la paralysie politique (« Tout est de toute manière tragique »), qui soutiennent que l’injustice est inévitable, qui refusent toute responsabilité.
Il nous restera à examiner, avec Levinas et Derrida, comment toutes ces réflexions peuvent nous aider à penser ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023.
À suivre.


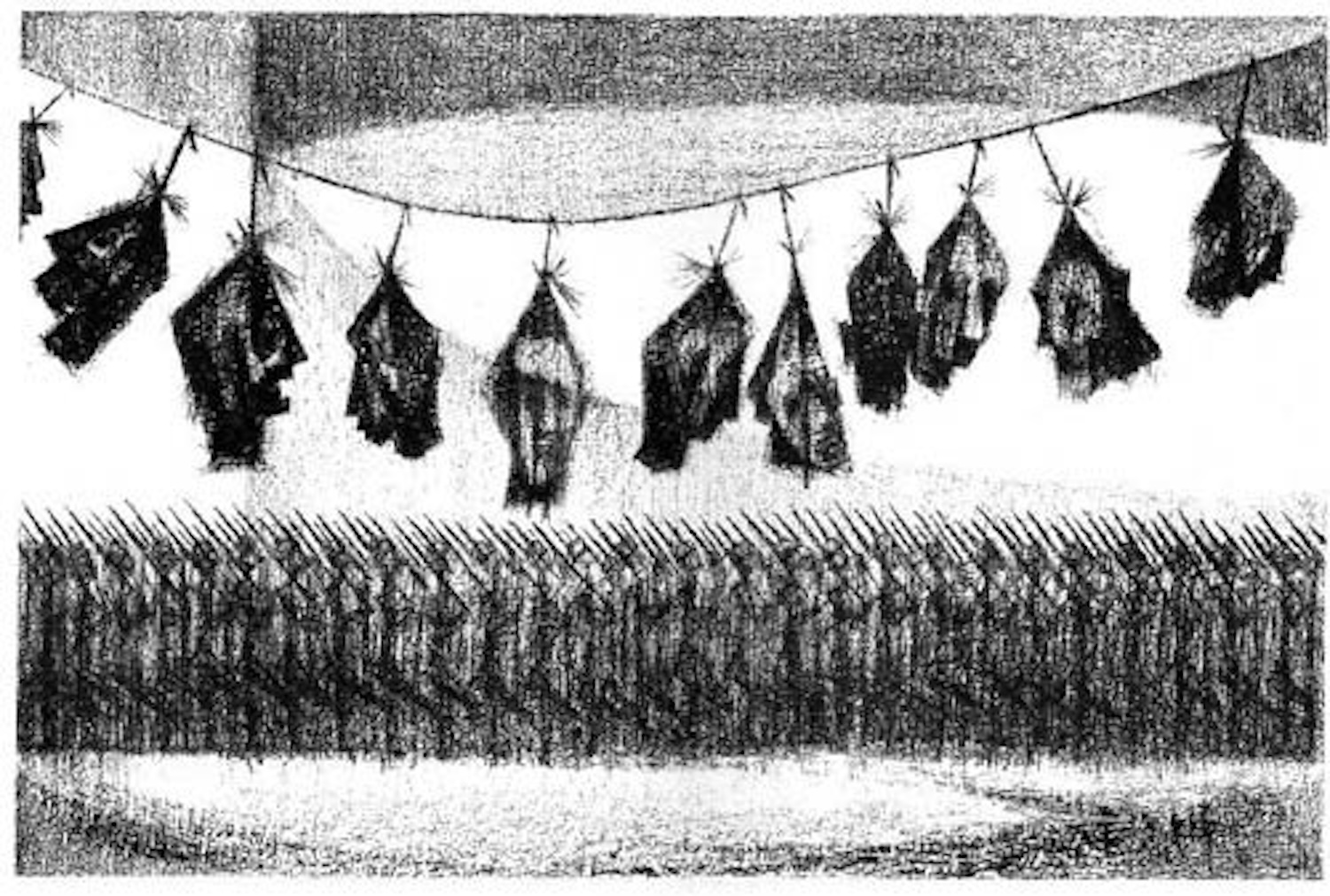
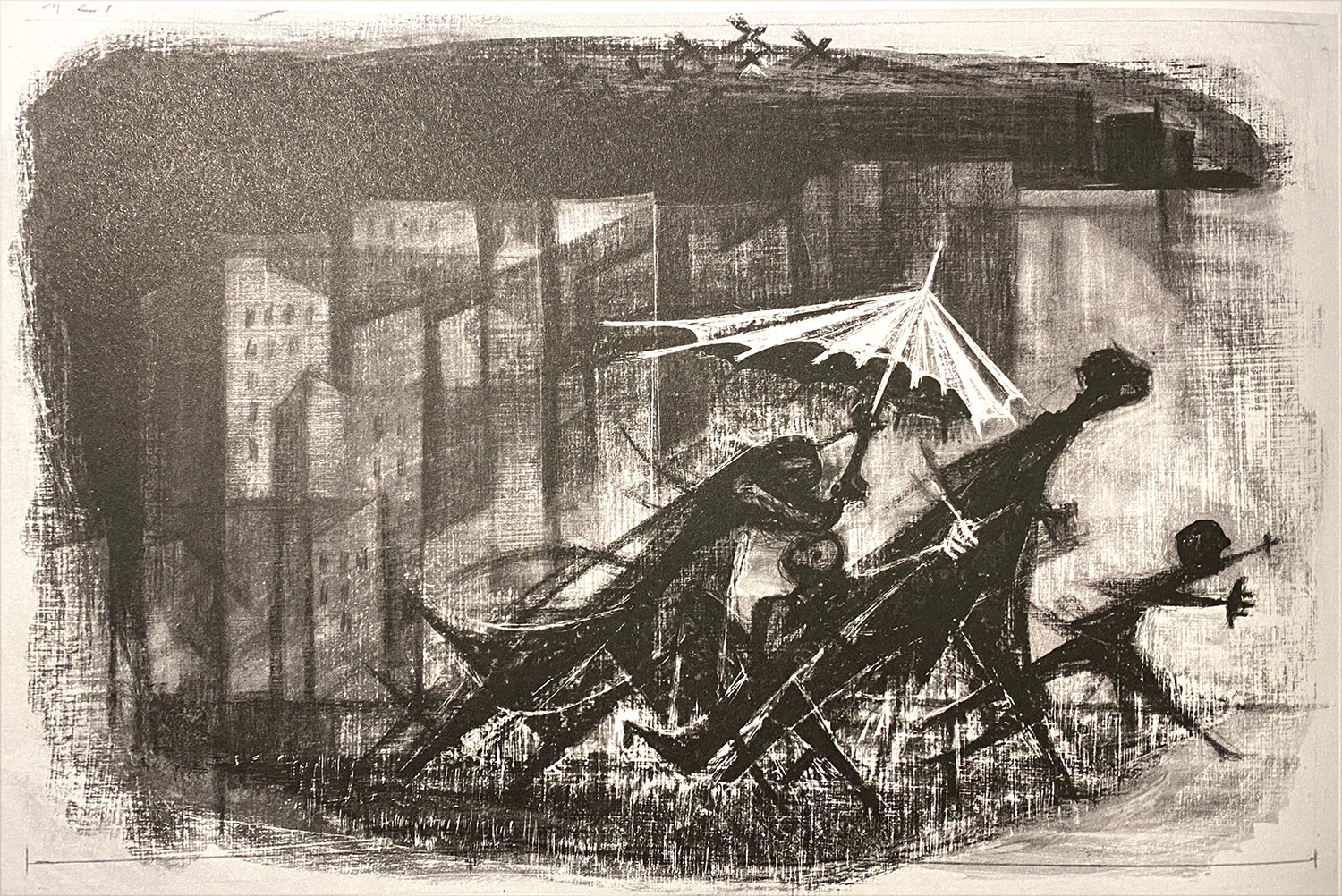




Outre la satisfaction de voir les leaders du monde libre remettre l’église de l’humanisme au milieu du Village et empêcher qu’on n’y poursuive en accéléré le processus de perversion des lois, du droit, des idéaux et du réel, je suis soulagé à l’idée que la République de Zola dont le génie jaloux ne renierait jamais son ADN pour un plat de lentilles, cette patrie des Lumières qui ne laisserait personne la prédestiner à l’extinction, soit à l’abri d’un sabordage, dès lors que, dans l’éventualité sinistre d’une victoire de la Néo-Française Peste aux prochaines présidentielles, nous pouvons désormais être sûrs que Jean-Luc Mélenchon ne finirait pas sa première nuit à l’Élysée avant d’être exfiltré manu militari vers le Grand Satan de l’imam Khomeini, et que cette nation phare d’un continent à la dérive dont les ressources inexploitées s’expatrient trop souvent, que cette incomparable civilisation trop consciente de sa mortalité pour se complaire dans le stade du coma profond, cette France éternelle que sa maîtrise des lois de la gravitation a sacrée championne de voltige aérienne, aurait la chance d’être provisoirement administrée par la plus grande démocratie du monde jusqu’à reprise complète de ses esprits.