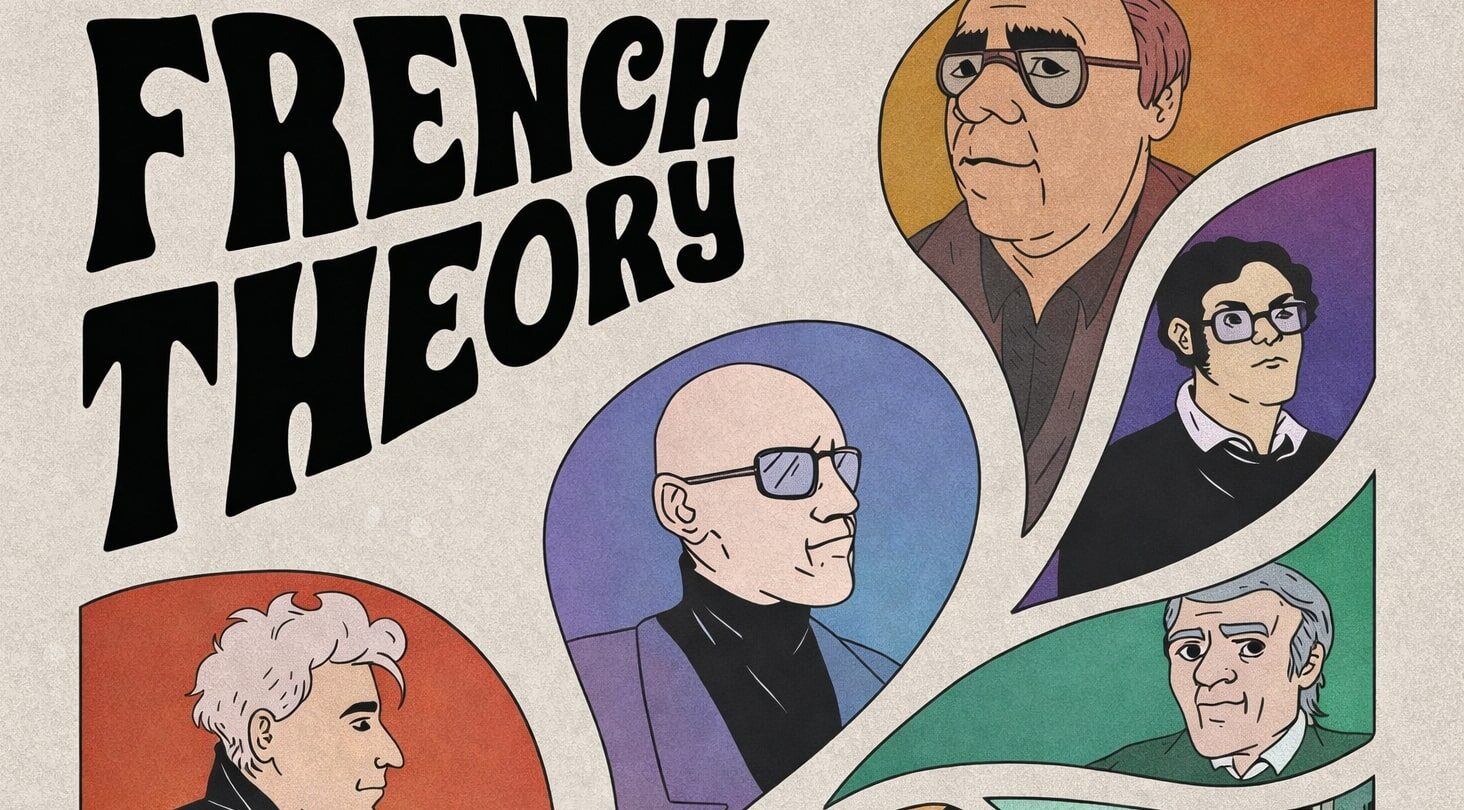Séance du mercredi 2 juillet 2025
Quelle œuvre pourrait le mieux caractériser l’ensemble de la création monumentale d’Anselm Kiefer, création totale, inclassable, qui tient aux grands mythes, à la métaphysique autant qu’à la politique et à la poétique ? Pour ma part, je citerai comme une évidence I Sette Palazzi Celesti – Les sept palais célestes –, au HangarBicocca, à Milan, et sous le titre Die Himmelpaläste – Les palais célestes – à la Fondation Eschaton-Anselm Kiefer, à Barjac. Lorsque j’ai revu ces tours à Barjac, voici quelques semaines, l’idée qu’elles pouvaient être à Kiefer ce que l’Homme qui marche est à Giacometti et à son œuvre, ce que La Cathédrale ou Le Baiser sont à Rodin, s’est imposée à moi. Les sept palais célestes sont comme une figure, une représentation moderne de ces tours du Mois de décembre que l’on doit aux frères de Limbourg dans Les très riches heures du duc de Berry. Que sont Les sept palais célestes, sinon « l’image miroir d’un voyage à l’intérieur de soi-même », comme l’écrit Kiefer ?
Je voudrais présenter Anselm Kiefer en trois temps, pour le situer à la fois dans l’histoire de la seconde moitié du XXe siècle et dans celle de la première partie du XXIe ; d’abord, par quelques dates phares, puis par quelques lieux qui habitent sa vie et que ses œuvres habitent. Enfin, dans une troisième partie, je voudrais aborder son œuvre au miroir de la Kabbale, des Sefirot et des « palais célestes », rendus célèbres par le Livre hébreu d’Hénoch et qui ont acquis une place centrale dans sa vision artistique, dans sa vision de la création et de la place de l’artiste, du créateur de formes qui est aussi créateur de mondes.
Anselm Kiefer, qui vient de fêter son quatre-vingtième anniversaire, est né le 8 mars 1945, au moment des dernières marches de la mort, des évacuations et des libérations des camps nazis, deux mois avant l’Armistice. L’année zéro de l’Allemagne contemporaine, les ruines, le désastre, puis la coupure de son pays en deux États : autant de traces, de blessures indélébiles dans l’esprit et l’inconscient devenu épidermique de cet homme. Il a beaucoup à nous dire sur le principe de l’abstraction, sur la représentation des formes, mais également sur la question de l’interdit de la représentation, qui n’a pas fini de nous hanter. À côté des œuvres de Beuys, Baselitz, Richter, Kiefer se pose la question de la mémoire d’une façon unique, à la fois comme Allemand, comme résident hors d’Allemagne, et comme intellectuel avide de culture et d’histoire universelle.

Dates : chronologie de l’artiste et de l’homme Kiefer
En 1969, les horreurs du nazisme s’estompent dans la conscience allemande, engagée dans une course folle à l’individualisme et à l’effacement de ce passé qui encombre. Mais pas pour le jeune Anselm Kiefer qui entreprend son Besetzungen – Occupations –, où il se met en scène devant son objectif dans toutes les tenues, y compris en uniforme de soldat de la Wehrmacht – qui fut celui de son père – faisant le salut nazi, le « Sieg Heil ». Il ajoute à ses théâtralisations un caractère grotesque lorsqu’il se met au garde-à-vous, bras droit levé, nu dans la baignoire de sa grand-mère, héritage de l’ère nazie. D’un seul geste, il devient célèbre, car ses Besetzungen enracinent immédiatement Kiefer dans l’histoire allemande dans ce qu’elle a de pire. S’il faut y voir un acte aussi puissamment provocateur que dénonciateur, il faut également prendre en considération sa dimension d’anamnèse.
Ainsi, durant plusieurs décennies, Kiefer parcourra-t-il des villes comme Rome et son Colisée, Pompéi, Montpellier et son Arc de triomphe, Arles et sa nécropole romaine, les Alyscamps, refaisant devant son objectif le geste au nom duquel des millions d’êtres humains furent assassinés parce qu’ils étaient nés. On peut se demander quel effet il aurait produit si, au lieu de prendre la posture du bourreau, du nazi, il avait pris celle de l’enfant juif de Varsovie avec sa casquette, les mains en l’air devant les soldats bottés, mitraillette au poing, devenue l’icône de l’insurrection et de la liquidation du ghetto de Varsovie.
Sur l’une de ses Occupations, il écrit : « Der gestimte Himmel über uns und das moralische Gessetz in uns » – « Le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous », célèbre citation de Kant. À la même période, il peint plusieurs huiles sur toile intitulées Unternehmen Barbarossa – Opération Barbarossa.
En 1970, à Montpellier, il rencontre Boltanski, auquel le liera un rapport à la mémoire du traumatisme, l’un portant la mémoire des bourreaux, l’autre, celle des victimes, qui furent parfois des héros.
En 1992, Anselm Kiefer quitte l’Allemagne et, après avoir hésité à s’installer au Portugal, il achète une ancienne magnanerie, ou plus exactement une ancienne filature de 40 hectares, à Barjac, dans le Gard, pour y construire ses ateliers, ses souterrains avec leurs cryptes parfois habitées par des empilements de livres, ses hangars et ses serres qui ne conservent que ses Frauen der Antike – Femmes de l’Antiquité – et ses Himmelpaläste – Palais célestes.
À l’occasion du Festival d’Automne 2000, Kiefer a le privilège d’investir la Chapelle de la Salpêtrière, avec une exposition inaugurant un nouveau cycle au titre étrange, incompréhensible pour les non-initiés : Shevirat ha-Kelim (le « bris des Vases »), titre et thématique qu’il reprendra à Tel Aviv onze ans plus tard. Pour entrer dans ce XXIe siècle d’une manière unique, Kiefer a choisi de s’arc-bouter, si l’on peut dire, à la Kabbale, la mystique juive telle qu’elle fut élaborée, au XVIe siècle, par Isaac Louria « le kabbaliste mystique majeur d’après l’expulsion », comme le qualifie Gershom Scholem qui, au XXe siècle, rendit visible l’universalité de la Kabbale. Pour l’artiste allemand de formation catholique, la découverte de la Kabbale à travers les œuvres d’Isaac Louria et de Scholem fut, au sens propre, une révélation intellectuelle, spirituelle et artistique. Avant d’aborder cet immense champ de l’œuvre de Kiefer, je mentionnerai encore quelques dates capitales dans la biographie de l’artiste.
En 2007, il occupe le Grand Palais pour la première manifestation Monumenta, avec Sternenfall – Chutes d’étoiles –, titre qu’il reprendra notamment à Florence en 2024, bien que les deux expositions soient fort différentes, la première largement consacrée à Ingeborg Bachmann, Paul Celan et au Voyage au bout de la nuit de Céline, tandis que celle du Palazzo Strozzi donnera à voir des œuvres toutes récentes : Verstrahlte Bilder – Peintures irradiées –, dans lesquelles Kiefer utilise abondamment toutes les variantes de l’or.
En 2010, il lui est proposé d’inaugurer la chaire annuelle de Création artistique au Collège de France. Sa leçon inaugurale, le 2 décembre, s’intitule « Die Kunst geht knapp nicht unter » (« L’art survivra à ses ruines ») – où il a été donné de voir Kiefer, si antiacadémique par tant d’aspects de sa personne, se plier à une certaine pompe, non sans en être pourtant un peu mal à l’aise. Pour la dernière séance du 29 avril 2011 – plutôt une expédition –, Kiefer fait affréter un TGV pour Avignon et des bus pour transporter plus de trois cents invités – parmi lesquels quelques présidents et directeurs des grands établissements publics et musées – dans son domaine de Barjac, devenu aujourd’hui la Fondation Eschaton-Anselm Kiefer.

Lieux
Évoquons à présent certains lieux marqués d’une pierre blanche dans la destinée d’Anselm Kiefer.
En 1963, âgé de 19 ans, l’étudiant en droit et en langues romanes, futur étudiant à la Staatliche Akademie der bildenden Künste de Karlsruhe, obtient une bourse pour partir sur les pas de Van Gogh à Amsterdam. Sa passion Van Gogh ne l’a jamais quitté, et, de mars à juin derniers, le Van Gogh Museum et le Stedelijk Museum d’Amsterdam ont consacré une monumentale exposition aux liens entre Anselm Kiefer et Van Gogh, au titre chargé d’une angoisse certaine : Sag mir wo die Blumen sind – Dis-moi où sont les fleurs –, d’après la célèbre chanson allemande inspirée d’un chant populaire ukrainien, reprise en 1955 par Pete Seeger et dont Marlène Dietrich a laissé une mémorable version. On voit combien Kiefer ne cesse d’inscrire son art dans une approche et une vision politiques. Dans l’art contemporain et postmoderne, les rapprochements sont souvent très aléatoires et l’on ne voit pas bien ce qui relie l’artiste vivant à son illustre prédécesseur. Mais dans le cas des dialogues de Kiefer avec Van Gogh comme avec Rodin, la parenté du démiurge avec l’un et l’autre de ces artistes géniaux est stupéfiante, tout comme la manière dont il comprend leur puissance créatrice en restant absolument Kiefer.
Deux ans plus tard, en 1966, Anselm Kiefer part sur les traces de Le Corbusier, d’abord à Ronchamp, puis surtout au couvent des frères dominicains de La Tourette, où il passe dix jours mais aurait espéré passer trois semaines. Le dominicain Marc Chauveau, féru d’art, qui organisa l’exposition Kiefer à La Tourette à l’automne 2019, se demandait s’il n’y avait pas une sorte, non d’influence, mais de convergence entre « les bétons du couvent dans leurs agencements corbuséens » et la prépondérance du béton dans les tunnels, les cryptes et les hangars de la Fondation Eschaton-Anselm Kiefer de Barjac.
Après le scandale de ses Occupations publiées en 1975 par la revue Interfunktionen sous le titre Entre l’été et l’automne 1969, j’ai occupé la Suisse, la France et l’Italie, la revue fut boycottée et menacée d’interdiction de publication. Mais cinq ans ont passé lorsque, en 1980, Anselm Kiefer est choisi, avec Georg Baselitz, par la République fédérale d’Allemagne pour la représenter à la 39e Biennale de Venise. Leur exposition commune suscite une autre vive réaction de la part de la presse allemande qui voit encore une provocation, non seulement de Kiefer mais aussi de Baselitz.
Les liens de Kiefer avec la Sérénissime ne se sont plus démentis. En 2022, il a les honneurs du Palais des Doges et en particulier, grâce à la Fondazione Musei Civici di Venezia, son exposition est en dialogue avec la Sala dello Scrutinio du Palazzo Ducale autant qu’avec l’histoire de Venise. Cette exposition consacre Kiefer peintre d’histoire.
J’aborderai maintenant une ville, une histoire, un livre et une mystique qui vont marquer très profondément Anselm Kiefer et son projet artistique, et dont j’ai tenté de rendre compte dans Les sept palais célestes. La ville est Jérusalem, l’histoire, trine et insondable de complexité, est celle qu’ont fabriquée tour à tour les Hébreux puis les Juifs, ensuite les Chrétiens, enfin les Musulmans – et depuis un siècle et demi, les Palestiniens et les Juifs sionistes devenus les Israéliens. La mystique est la Kabbale.
L’ami de longue date d’Anselm Kiefer, devenu son éditeur puis son biographe, José Alvarez, avant de laisser la parole à l’artiste, écrit ces mots dans son livre : « En 1984, comme si elle l’attendait depuis toujours, Anselm Kiefer entreprend son premier voyage en Terre sainte, où une exposition lui est consacrée à l’Israel Museum de Jérusalem. “Dans une autre vie, j’ai dû être Hébreu davantage que Juif. Aujourd’hui encore, je me souviens avec précision du choc ressenti quand, de la fenêtre du King David, je découvris le mont des Oliviers. Une vive émotion qui depuis lors ne m’a pas quitté. Un choc qui a déterminé la nature de mon travail, ma pensée, mes sentiments.”[1] » Voilà comment Kiefer qualifie sa découverte de Jérusalem. Alvarez ajoute : « Ce voyage en Terre sainte infléchira l’œuvre de Kiefer de manière très significative. Ainsi le plomb, vecteur auparavant de son intérêt pour son rôle dans la transmutation de métal noble chez les alchimistes et les kabbalistes, c’est désormais sur le plan mystique, philosophique, qu’il l’appréhende et en use. »
Il fait deux autres voyages en Israël, en 1990 et en 2011 pour l’inauguration de nouveaux bâtiments du Tel Aviv Museum of Art dont il est le héros avec son exposition Shevirat ha-Kelim. Mais le plus saisissant des deux voyages est celui de 1990 car Yitzhak Rabin, l’homme de la paix assassiné, le reçoit à la Knesset, rare privilège pour un artiste, où il lui remet le prix de la Wolf Foundation. Le discours qu’Anselm Kiefer a prononcé à Jérusalem, en réponse à celui du Premier ministre, a été jugé si important par l’artiste lui-même, par son éditeur et par Catherine Bédard-Arasse, qu’il a été placé, non pas en annexe, mais en épilogue aux fascinants dialogues façonnés par Daniel Arasse, Rencontres pour mémoire[2], publiés sept ans après la disparition de l’éminent historien de l’art. La profondeur avec laquelle Daniel Arasse comprenait l’art d’Anselm Kiefer a saisi nombre d’auditeurs de France Culture et de lecteurs de ce livre capital pour qui s’intéresse à Kiefer – et aussi à l’œuvre de Daniel Arasse (1944-2003).
Cette même année 1990, Anselm Kiefer, qui a déjà découvert Paul Celan, a une autre révélation poétique : Ingeborg Bachmann. La connaissance des œuvres d’Ingeborg Bachmann, la poétesse la plus proche de son oreille et de son cœur, et celle qu’il a de Paul Celan, qu’il qualifie souvent de plus grand poète de langue allemande du XXe siècle – la poétesse autrichienne et le poète juif –, lui sont consubstantielles pour mieux appréhender la tragédie allemande et européenne que fut la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.
N’oublions pas l’importance de l’Asie dans l’œuvre de Kiefer. En 1991, il découvre la Corée et la Japon avec leurs temples, puis l’Indonésie, la Thaïlande, la Chine ; ensuite, ce sera l’Australie. Il est probable que les deux pays d’Asie qui ont le plus marqué l’artiste visionnaire sont le Japon et l’Inde, qu’il découvre en 1993 et où il retourne à deux reprises en 1996 et en 1999. À Ahmedabad, il visite les architectures de Louis Kahn (1900-1974) et les photographie. On sait que l’architecte américain bâtit aussi l’Assemblée nationale et les palais d’État du futur Bangladesh, achevés seulement après l’indépendance du pays en 1971 et la mort de Kahn. Les puissantes architectures d’Ahmedabad ont inspiré les premières toiles dédiées à Paul Celan.
Kiefer est au nombre des rarissimes artistes à être entrés de leur vivant au Louvre, insigne privilège que ne connut pas Soulages, qui eut certes une exposition pour son centenaire mais non de commande d’œuvre. L’illustre prédécesseur de Kiefer fut Georges Braque dont le célèbre plafond orne la salle Henri II depuis 1954. Après Kiefer, Cy Twombly y est entré en 2009, François Morellet en 2010, et plus récemment Jean-Michel Othoniel et Elias Crespin – on y attendrait enfin UNE artiste…
Il est impossible de ne pas évoquer un dernier lieu où Kiefer est entré vivant, un lieu où ne sont à perpétuelle demeure, en leur tombeau, que d’illustres hommes et encore trop peu d’illustres femmes. Pour l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix avec « Ceux de 14 », le 11 novembre 2020, une commande publique exceptionnelle du président de la République a été faite à Anselm Kiefer et Pascal Dusapin : pour ce dernier, une composition musicale, et pour le plasticien, une série d’œuvres. L’œuvre de Dusapin, In Nomine Lucis, est l’émanation sonore, vocale, immatérielle, du livre de Genevoix, Ceux de 14, comme les œuvres multiples que Kiefer a créées pour le Panthéon en sont l’émanation picturale, sculpturale et visible – dans une certaine mesure seulement. De grandes toiles y ont été accueillies pour quelques semaines, comme La Voie sacrée, qui évoque les grandes batailles de la Marne, et plusieurs autres dédiées à Paul Celan. Aujourd’hui demeurent dans la nef du temple laïque six vitrines, parmi lesquelles Celles de 14-Ceux de 14 – car, pour Kiefer, rappeler le rôle et si souvent le sacrifice des femmes partout où l’on se souvient d’abord de ceux des hommes est un devoir éternel. L’œuvre est composée d’un empilement de livres de plomb au milieu d’un paysage de verre, d’émulsion, de fil de fer sur toile… Citons encore Qu’est-ce que nous sommes ?, où l’on voit du fusain sur zinc, des racines, de l’argile, du bois et de la cendre. Nous savons combien Kiefer, depuis des décennies, est hanté par les vers de Paul Celan « Ich bin allein, ich stell die Aschenblume » – « Je suis seul, je mets la fleur de cendre/dans le verre rempli[3]) » –, extraits de Pavot et mémoire, auquel il a consacré de nombreuses toiles. Die Aschenblume – La fleur de cendre – est l’un des plus puissants symboles de l’œuvre de Kiefer, tout comme de celles de Paul Celan, naturellement, et d’Ingeborg Bachmann, inséparable d’eux.
« Je ne suis pas seulement présent au Panthéon mais aussi au Louvre comme unique artiste vivant. Mais ce n’est pas si important, car un jour ou l’autre, je serai mort », se plaisait à dire Anselm Kiefer en 2021.

Venons-en pour finir aux Sefirot et aux sept « palais célestes » dont est habité cet artiste. Ce ne sont pas seulement les Sefirot, émanations divines qui forment l’arbre de vie et sont développées par la Kabbale, qui fascinent Kiefer. Nous voulons souligner que ces concepts principiels de la spiritualité et de la mystique juives sont aussi des concepts universels que l’on trouve dans le christianisme et dans l’islam, en particulier dans le soufisme, mais également dans la philosophie du Vedanta et dans le bouddhisme.
1- Béréshit, בראשית, « au commencement », est le premier fondement pour Kiefer, au sens du re-commencement. Je suis certain qu’il serait heureux – et pas surpris outre mesure – d’apprendre qu’un philosophe et talmudiste franco-israélien, Beno Gross, aimait – selon une méthode d’inversion des lettres familière à la tradition juive talmudique aussi bien qu’ésotérique – lire ce premier mot de la Torah en inversant les consonnes resh et shin (rappelons qu’en hébreu, seules les consonnes s’écrivent), ainsi : Beshérit, c’est-à-dire : ce qui survit, ce qui reste.
2- La Shekhinah, שכינה, est le principe féminin de la divinité, et Kiefer ne pouvait qu’y être très sensible. On ne compte plus ses œuvres qu’il a nommées Shekhinah. La présence de la femme dans sa création est immense, depuis ses cinq cycles féminins[4], d’abord Les Femmes de l’Antiquité, Les Reines de France, Les Femmes de la Révolution, qui furent suivis par les Extases féminines inspirées du livre du philosophe Jean-Noël Vuarnet. Enfin, au début des années 2010, ce fut la découverte des Cathédrales de France de Rodin et la série exceptionnelle du même nom. Regardons les aquarelles vertigineuses, au sens théologique aussi bien que philosophique, de la série Les Cathédrales de France. Il peint une femme nue chevauchant et dominant de très haut le vaisseau d’une cathédrale. Lui qui est d’origine catholique donne ici à la femme une place prépondérante : c’est elle qui domine le prêtre et l’évêque, donc le pape lui-même, et au-delà, dans une vision universelle, le rabbin orthodoxe (car l’orthodoxie rabbinique interdit par principe le rabbinat aux femmes – à l’exception du mouvement du Modern Orthodox Judaism[5]), le pope et bien sûr l’imam. La femme fut si longtemps cachée, écrasée, dominée par les lieutenants autoproclamés de Dieu, que l’artiste doit lui redonner toute sa place.
3- Le troisième concept ou principe auquel Kiefer a consacré une place importante est celui du « Tsimtsoum », צמצום, c’est-à-dire de la « contraction » de Dieu, son retrait de sa création. Quand le divin se rétracte ou se contracte et qu’il se retire du monde, que reste-t-il ? Le chaos, la guerre, les exterminations et les génocides, mais aussi l’art… Au début, il y a le Livre, il y a le chant, il y a l’art. Les mannequins acéphales d’Anselm Kiefer nous obsèdent par leur présence. Tant de ses sculptures féminines se terminent par un livre ou un empilement de livres en guise de tête ; et l’une d’elles, conservée dans la serre de Barjac dédiée aux Frauen der Antike, aux Femmes de l’Antiquité, porte en guise de tête l’arbre séfirotique aux dix chiffres (de 1 à 10), correspondant aux dix Sefirot.
Citons juste quelques-unes des Sefirot : 1. Kéther, le diadème royal ; 2. ‘Hokhmah, la sagesse ; 4. Daath, la Sefira cachée ou grande bibliothèque cosmique qui renferme toutes les mémoires de l’univers, suivie immédiatement, en 5, par ‘Hessed, le principe de l’amour. En 9, vient Yessod, le centre qui produit la réalité de la matière ; et la dixième Sefira est la Shekhinah ou Malkhouth, autrement dit le « Royaume », comme figure féminine par excellence symbolisant la réalité physique qui gouverne le monde créé.
4- Le quatrième concept capital dans la Kabbale, comme dans toute la philosophie hébraïque – et donc pour Kiefer –, est le « Ein Sof », אין סוף, le « Sans limite ». Dans son discours de Jérusalem, l’artiste s’est tout particulièrement attardé sur cette question :
« Selon la tradition, les Juifs ne désignent jamais Dieu par un nom explicite. Ils emploient des circonvolutions, des termes négatifs qui signifient “le rien sans limite”. On peut comparer la venue au monde d’un tableau à ce que le rabbin Isaac Louria nous dit du “tsimtsoum” (la contraction) : un espace vide et gardé en retrait par le “Ein Sof” (Lumière sans fin), dans lequel le monde peut se déployer de manière imparfaite et figurative. Le tableau, dans son échec (et il échoue toujours), éclairera fût-ce faiblement la grandeur et la splendeur de ce qu’il ne pourra jamais atteindre[6]. »
5- Abordons en quelques mots la dimension cosmique de la « Shevirat ha-Kelim », שבירת הכלים, le « bris des Vases », qui a donné lieu aux deux expositions déjà citées de La Salpêtrière et de Tel Aviv. Ce « bris de Vases » pensé par les kabbalistes peut être vu comme une anticipation, dans l’histoire de l’Allemagne nazie, de la Nuit de Cristal (9-10 novembre 1938), durant laquelle des milliers de vitrines de magasins juifs et de synagogues furent détruits, et de nombreux Juifs envoyés dans les premiers camps de concentration. Ces images traversent plusieurs œuvres de l’artistes. Ses « palais célestes », avec leurs tours brisées, sans vitres, sans escaliers, sans portes, et d’autre part, partout et toujours, ses cendres, expriment avec force cet état de destruction, de ruine. On ne compte plus non plus ses tournesols morts, ses livres cautérisés, ses lignes de chemins de fer qui ne conduisent nulle part… Comment ne pas mentionner encore cette œuvre effroyable qui a pour titre Salle de plomb, exacte réplique d’une chambre à gaz ?… Avec toutes ces créations, on comprend que Kiefer n’ait jamais eu besoin de faire une œuvre explicite sur la Shoah – l’interdit de la représentation !
La « Shevirat ha-Kelim » marque-t-elle la mort de Dieu ou ce que Levinas appelait (en référence à 1941) le moment où Dieu « est retourné à son irrévélation[7] » ?
« L’art survivra à ses ruines. » (Anselm Kiefer)
6- Il s’agit à présent d’évoquer le « Tikoun olam », תיקון עולם, c’est-à-dire la « réparation du monde » – ou des mondes. Mais on ne répare pas ce qui a été détruit de façon irrémédiable, définitive. C’est ici que l’art prend sa destination transcendante ou transcendantale. Il est probable que dans l’ordre de l’irréparable, de l’irrémédiable, la religion écartée, seul l’art puisse être une « rectification du monde », comme Malraux l’écrit dans son Saturne. Le destin, l’art et Goya : « L’art est une des plus puissantes rectifications du monde[8]. » Or les créations de Kiefer sont par excellence des œuvres réparatrices de ce qui ne peut pas être réparé.
7- Mon dernier mot est pour ouvrir le champ sans fin de la « Merkaba », מְֶרכָָּבה, figure géométrique qui est tout à la fois le chariot de Jacob dans la Genèse ou le char de feu de Hénoch comme du prophète Elie. Dans le Talmud, le premier chapitre d’Ézéchiel est appelé « Maasseh Merkaba » (« L’œuvre du Char »). Kiefer y voit la transcendance de l’art. La Merkaba, qui a inspiré tant d’œuvres à l’artiste, est liée au Sefer Hekhalot ou Livre des Palais, et il en est question dans le Livre hébreu d’Hénoch.
Dans Les voix du silence, Malraux écrit : « Bien peu de voix ont parlé à la douleur humaine la langue qu’elle peut réellement entendre. » Il est certain que Kiefer est l’une de ces voix, qui aura le plus puissamment été capable de parler du « bris des Vases » de l’humanité, c’est-à-dire de l’incommensurable douleur humaine, de la Shoah aussi bien que des crimes sans nom commis par Staline puis par Mao, crimes sans fin, jusqu’à la guerre de Poutine contre l’Ukraine. Ce qui nous ramène à l’hymne de Pete Seeger, « Sag mir wo die Blumen sind », qui a donné son titre à l’exposition de Kiefer à Amsterdam :
« Dis-moi où sont les fleurs
Où sont-elles passées ? […]
Dis-moi où sont les filles,
Où sont-elles restées ?
Dis-moi où sont les filles ?
Que s’est-il passé ?
Dis-moi où sont les filles.
Des hommes les ont prises vite.
Quand allons-nous comprendre ?
Quand allons-nous comprendre ?
Dis-moi où sont les hommes,
Où sont-ils passés ?
Dis-moi où sont les hommes.
Que s’est-il passé ?
Dis-moi où sont les hommes
Partis au loin […] »
On peut comprendre que pour beaucoup, Kiefer soit l’un des artistes, l’un des témoins, l’un des plus grands démiurges de notre temps.
[1] José Alvarez, Anselm Kiefer. Biographie, Paris, Éditions du Regard, 2021, p. 203.
[2] Anselm Kiefer, Daniel Arasse, Rencontres pour mémoire, Paris, Éditions du Regard/France Culture, 2010.
[3] Paul Celan, Choix de poèmes réunis par l’auteur, traduit de l’allemand et préfacé par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Gallimard, « Poésie », 1998, p. 67.
[4] Les cinq cycles sont : Les Femmes de l’Antiquité, Les Femmes de la Révolution, Les reines de France, Extases féminines, Les Cathédrales de France.
[5] Je rappelle le livre que Myriam Ackermann-Sommer et moi-même avons publié : Revenir. Dialogues sur les figures du Retour dans la tradition juive, Arles, Actes Sud, 2023.
[6] Anselm Kiefer, Daniel Arasse, Rencontres pour mémoire, op. cit., p. 94.
[7] Emmanuel Levinas, Humanisme de l’autre homme, rééd. Paris LGF, « Biblio essais », p. 46.
[8] André Malraux Œuvres complètes IV : Ecrits sur l’art 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2004, p. 99.