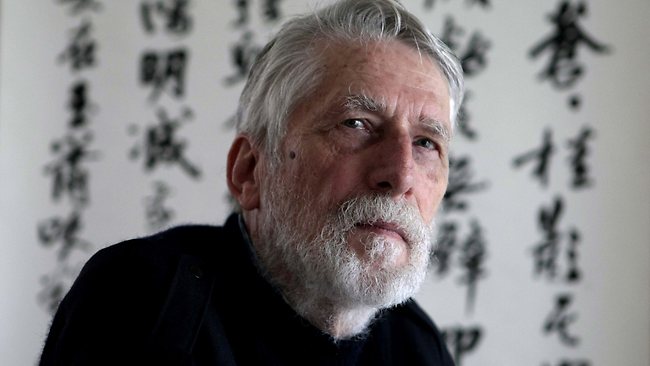Françoise,
Il est minuit j’apprends votre disparition. Mes réseaux sociaux sont inondés de photos de vous. La jeunesse pleure. Elle pleure parce qu’elle sait. Elle sait qu’avec vous, elle a perdu une part de sa grâce, de sa finesse, de sa pudeur. Elle pleure parce qu’elle a peur. Françoise, croyez-vous que ce soit normal d’être nostalgique d’une époque qu’on n’a pas vécue ?
En noir et blanc, je regarde vos traits. Vos yeux surtout, ce contour au liner noir, le regard hagard. Je regarde vos cheveux, votre frange, cette robe Paco Rabanne qui glissait sur votre peau. Suggérer, laisser la porte ouverte, respecter toujours les imaginaires.
Il est minuit et demi et mon téléphone ne cesse de me parler de vous. Il m’envoie tous ces mots que je n’entends plus. Ils disent les rêves, les filles et les garçons, l’amour, les adieux, les questions. Ils sont comme une caresse, un baiser sur la joue, ils me rassurent. Jamais ils ne touchent le sol. Ils sont comme ça, en l’air, au-dessus de moi, ils m’effleurent et remettent les idées en place. C’est peut-être pour ça d’ailleurs que vous, la discrète, la maladivement timide, me faites signe. Ça fait trois jours que j’étouffe mais ce soir vous êtes ma virgule. Vous me rappelez la liberté. Pas celle qui dit qu’il faut faire ce que l’on veut quand on veut mais celle des années soixante-dix. Celle où l’on avait encore le droit de fumer dans les cafés, de tout plaquer par amour, d’arriver ivre sur les plateaux télés, de parler léger, de rester nuancé. Juin est lourd. L’élégance me manque. Vous écouter cette nuit me fait du bien. Françoise, le monde vous pleure ; il est seul à crever et il ne sait pas où vous êtes.
Françoise Hardy, message personnel
par Valentine Carrion
12 juin 2024
Croyez-vous que l’on puisse être nostalgique d’une époque qu’on n’a pas vécue ?