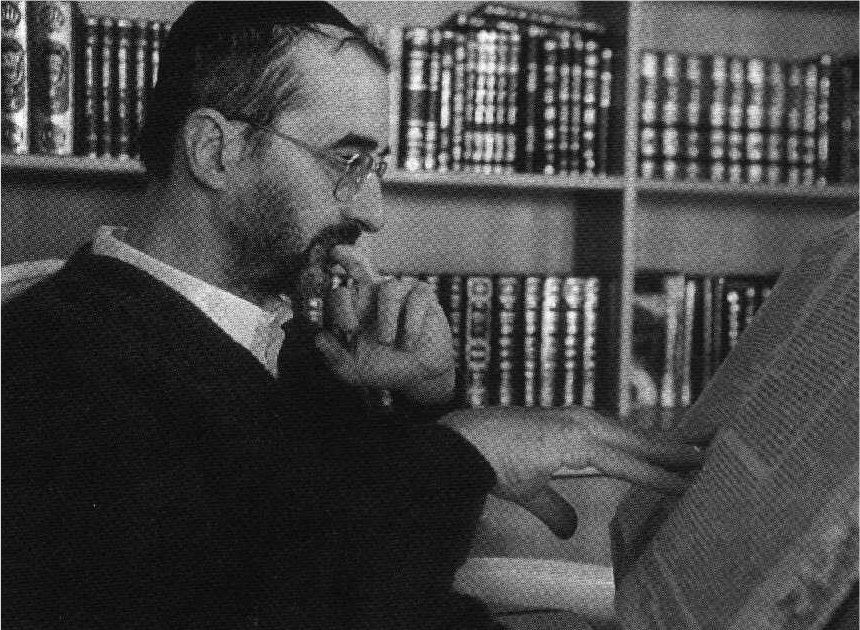La chute du mur de Berlin en 1989, plus que la chute d’une pierre. Avec elle, des générations entières orphelines. La fougue de la révolte, la violence de la lutte, l’espoir d’un monde meilleur, tombaient dans les affres de la fin de l’histoire. La flamme légère et dévorante du projet socialiste s’était mutée en la masse lourde, informe de l’appareil communiste.
Pierre Victor fut l’une de ces figures françaises du combat pour l’égalité, pour le refus de la fatalité. Ce maoïste de la deuxième heure, immigré d’Égypte, né en 1945 dans un monde qui ne demandait qu’à reprendre la route effrénée de la vie, avait trouvé refuge sur les côtes européennes. D’abord en Belgique puis à Paris, sur les bancs d’école de la rue d’Ulm. Pierre Victor était un de ces nombreux nomades de l’après-guerre. Apatride. En exil sur la terre, ces milliers de Pierre Victor n’avaient d’autre choix que de faire advenir le monde capable de les accueillir. 1968 constitua l’une des marches décisives pour la conquête de ce nouveau monde. L’aventure de Pierre Victor prit cependant un tour inédit, une fin abrupte. Son feu révolutionnaire fut soudainement éteint par le cycle de violence dont il était l’un des porte- étendards. 1972 : alors que ses troupes de la Gauche prolétarienne s’adonnent à l’enlèvement d’un cadre de la régie Renault, alors que ses sbires exultent de joie lors de l’assassinat sauvage d’athlètes israéliens dans la ville de Munich, Pierre Victor découvre avec stupeur et effroi, le monstre répugnant qu’il a contribué à engendrer.
Faisant à nouveau l’expérience de l’étrangeté, il part en quête d’un nouveau maître, d’une nouvelle pierre sur laquelle il pourra rebâtir son église. Il fait la rencontre de Jean-Paul Sartre, cette Pythie des Temps Modernes. Il devient très rapidement son assistant, son homme de confiance, son élève, et ce jusqu’à la mort de Sartre en 1980.
Alors que partis un jour d’été dans le Gard pour échapper au tumulte de la vie parisienne, Sartre découvre avec étonnement son assistant, Pierre Victor, absorbé par une lecture mystérieuse. Les yeux ébahis, Sartre perçoit la métamorphose du visage de son élève. Peut être Sartre l’a-t-il alors compris ? Le masque de Pierre Victor vient à jamais de tomber. Et c’est au travers du visage de Benny Lévy que ses yeux de maoïste endeuillé, ceux d’un Pierre redevenu Benny, découvre ce texte trimillénaire : le sefer yetisrah (livre de la formation). C’est un livre dont la tradition juive rapporte qu’il a été composé de la main même d’Abraham. Ce texte d’une rare complexité enseigne la formation du monde par les lettres. Ce même Abraham, qui hier brisait les idoles dans le magasin de son père en Chaldée, vient de fissurer à jamais la vision du monde de ce communiste chevronné. De Moïse à Mao, Benny décidait alors de penser le retour, de Mao à Moïse.
Retour à ce qu’il était, plus que pierre, plus que chair, un souffle qui aspire et inspire à tellement plus que la matière[1].
La bouleversante aventure de Benny Lévy résonne avec la destinée de tant de femmes et d’hommes. Ce mouvement de brisure des idoles est au cœur de la vie de la pensée. Socrate est l’une des figures emblématiques de la brisure : à coup de questions, il met à mal les certitudes de ses contemporains, les dérange, les déroute. « À coups de marteau », Nietzsche entreprend lui aussi de faire advenir le « crépuscule des idoles ». Avant eux, Abraham incarne déjà la figure du briseur d’idoles (Midrash Bereishit 38:13). Cet attachement à la destruction des idoles dans la Torah surprend. Elle est tant de fois répétée, martelée.
Qu’est-ce qu’une idole ? Que représente l’injonction de s’en affranchir ? Elle semble totalement impensable aujourd’hui. Très peu nombreux sont les peuples qui vénèrent des statues et les considèrent comme des dieux. La Torah pourrait-elle s’être hasardée à nous mettre en garde contre une tendance purement historique ? Cela la consignerait tristement au rayon des livres historiques et mettrait un terme à ses prétentions universelles.
Prenons au sérieux le texte et essayons de comprendre ce que l’on entend par idole. Lorsque la Torah décrète cette interdiction, elle dit : « Lo iyé lehra élokim aréhrim al panai » / « Tu ne reconnaitras pas d’autres dieux en ma présence » (Exode, chapitre 20, verset 3), on parle bien ici d’ « elokim » c’est-à-dire de dieux et qui signifie aussi en hébreu « puissance ». On marche sur la tête ! Le texte de la Torah vient donner à ces vulgaires amas de pierre, ces idoles, une forme de divinité. Pourtant elles ne sont qu’objets, matière sans pouvoir et sans volonté. Elles n’ont aucun statut valable de dieu. Comment le verset peut-il alors les appeler dieux ? Le premier verset du chapitre 19 du Lévitique (« ne vous tournez pas vers les idoles, et les dieux de métal vous ne vous en ferez pas ») propose une idée encore plus ambitieuse. L’individu qui « se tourne », c’est- à- dire qui dirige son regard vers un objet inanimé, finit par lui donner un pouvoir. Cet objet, cette institution, cette personne, n’a peut-être en soi aucun pouvoir. Mais parce que je projette sur elle un pouvoir, je lui accorde une confiance et je décide de m’y soumettre. Je fais de cette idole un dieu. L’homme enfanterait les idoles pour mieux les servir ensuite…
De quoi s’affranchir ?
Derrière toutes ces dimensions de l’idolâtrie se cache une même idée, celle que je transforme la chose inerte devant moi en réalité. La croyance peut être si forte et pourtant si friable, balayée d’un revers de la main par l’Histoire. Une brisure se forme, la confiance se perd et soudain ce que nous pensions éternel s’évanouit sous nos yeux ébahis.
Plusieurs siècles de philosophie, avec à sa tête Hegel, ont amené l’homme à percevoir le monde comme un système, un vase clos, où seul existe ce qui pour l’homme est perceptible. Les matérialismes, qu’ils aient engendré communisme ou capitalisme, ont tous fixé la matière comme mesure de toute chose, et son accumulation comme le déterminant du progrès. « Tout est ici, tout m’appartient ; tout à l’avance est pris avec la prise originelle du lieu, tout est com- pris…. » : voici comment Lévinas décrit, dans Totalité et infini, l’approche que ces penseurs du système ont instillé dans nos esprits. Plus de place pour le ressenti, l’ailleurs, ce qui m’échappe. Rosenzweig et son Étoile de la Rédemption ont certainement été l’une des plus grandes sources d’inspiration de Lévinas. Cette œuvre magistrale de Rosenzweig débute comme un cri, un cri de révolte contre ces philosophies du système. Mais de quel crime ultime ces pensées sont-elles coupables ? Le plus ultime selon lui est d’avoir rangé la mort dans la catégorie du non-être. Quelque chose au fond de l’homme refuse qu’on lui dise que sa mort n’est rien, que la vie terrestre est « Tout ». L’homme sait qu’un jour il devra accepter que le rideau se baisse, qu’il disparaisse de ce monde. La mort est ce trou béant dans la pensée du Tout. Je ne peux TOUT appréhender, il y a cette réalité humaine qui viendra un jour me cueillir, mais dont je ne pourrai rien savoir, moi être mortel. La mort selon Rosenzweig, c’est le plus brillant message de l’impossibilité d’un monde fermé sur lui même. Nous entrons et nous sortons. Nous ne faisons pas entièrement partie de ce monde puisque nous finissons par y échapper.
Je voudrais ici te rassurer, ami lecteur. Je ne tiens pas à démontrer ici l’existence de quelque chose au-delà de la mort, d’un monde au delà du monde, ni même de Dieu au delà de la nature. Ce serait bien manquer de modestie face à une entreprise d’une rare complexité.
Ce point d’interrogation au cœur de notre questionnement humain fait l’objet d’un chemin de réflexion long et complexe et que peu d’hommes ont achevé. Même après d’infinies réflexions, nous resterons toujours dans le doute. L’absolu de la connaissance de Dieu, comme de toute connaissance, est impossible. Ma périlleuse tentative est de chercher à déchirer un voile que l’on prend souvent pour la limite de notre réalité. Limite de ma vision du monde qui devient dangereusement limite du monde.
Idolâtrie religieuse
Bien heureux celui qui peut se dire affranchi du joug de l’idolâtrie. Elle guette l’homme telle une bête immonde. L’idolâtrie c’est le crime de la pensée, la négation de notre humanité, le refus de l’ouverture à la question.
La croyance en un Dieu et en un texte sont certainement deux des plus grandes idolâtries qui sévissent étonnamment chez ceux qui s’en pensent les plus affranchis. Combien de fois me suis-je surpris à m’y adonner… Croire, c’est l’essence même de la pensée idolâtre.
La croyance en Dieu est un double paradoxe, voire un double crime à l’égard de la pensée. Croire, c’est cette limitation volontaire de l’esprit. C’est une parole scandée que l’on établit aussitôt comme vérité. On fige la pensée, on l’enferme et on scelle avec elle la paresse de penser. Croire, c’est refuser la quête, refuser de faire l’effort de comprendre l’une des idées les plus complexes qui tourmentent le génie humain. L’athée, comme le religieux, sont trop souvent des empressés qui sur un amas de doutes se hissent pour faire entendre ce qu’ils pensent… ou plutôt ce qu’ils croient penser.
Nulle place pour la certitude dans cette quête folle de ce que nous appelons couramment Dieu. Seule compagne véritable de cette quête, l’angoisse. Angoisse de ne pas savoir ce que nous faisons là, absence de sens à notre existence, situation que bon nombre de penseurs d’après- guerre ont qualifié d’absurde, et qui nous laisse tous orphelins, lâchés dans l’immensité de l’univers.
Affrontons la terrible vérité : la parole de Dieu ne s’est aujourd’hui manifestée à aucune oreille et croire ne saurait redonner la vue aux borgnes que nous sommes.
Le nom même de Dieu est une terrible trahison qui nous englue dans l’adoration et nous prive de la raison. Ce nom de Dieu nous berce depuis l’enfance d’images de vieux monsieur posé sur son nuage. L’hébreu utilise de nombreux noms pour qualifier Dieu. Jamais ces noms n’englobent Dieu et tous sont ineffables. Précaution particulière portée au langage. De manière courante, pour qualifier le créateur de l’univers et la source de toute vie, l’hébreu utilise « Hachem », c’est à dire « le Nom ». Il est cet insaisissable, il est une parole vivante qui fait apparaître le sens. Cette idole d’un Deus-Zeus (appréciez la similitude sémantique) est trompeuse mais pas mortelle.
Il existe une trahison bien plus grande et plus dangereuse. Idolâtrie qui, jusqu’à aujourd’hui, fait couler tant d’encre et de sang : idolâtrie du texte. La parole divine révélée et gravée dans le parchemin peut, si l’on n’y prend pas garde, très vite sécher, se figer, se scléroser. La parole vivante est traînée dans la boue dogmatique ; elle immobilise et entrave le mouvement de la pensée.
À ce titre, il existe un épisode de la Bible édifiant ; un geste, d’une rare violence, et dont on discute trop peu des conséquences. Moïse se laisse aller, pourrait-on penser, à la plus grande des infamies. Il brise les tables de la loi, ces mêmes tables que le texte nous dit avoir été écrites de la main même de Dieu. L’apogée de la sortie d’Égypte, c’est le don des tables fondatrices de ce peuple. Rencontre unique entre le peuple hébreu et l’Éternel qui inscrit son être dans la pierre. Expérience métaphysique inédite. Et ces pierres, dans lesquelles sont gravées « du doigt de Dieu » les 10 paroles, se retrouvent réduites en poussière par la main d’un homme. Alors que Moïse s’apprête à descendre de la montagne du Sinaï pour apporter la loi au peuple, Dieu lui annonce que le peuple s’est dévoyé en fondant l’or pris d’Égypte pour façonner un veau. Il m’est très difficile de ne pas m’attarder plus en détails sur cet épisode clé qui façonne à son tour la pensée juive du rapport à Dieu. Retenons seulement l’idée magistrale du Maharal de Prague : il ne s’agit pas d’une faute, mais d’une nécessité, nécessité pour la liberté humaine (voir les propos de Rabbi Ishmaël dans Taanit 4, Talmud Yerushalmi). Parce que Moïse brise les tables de la loi à la vue de ce spectacle infâme, il libère le peuple de la loi qu’il venait lui donner. Paradoxe ? Pas totalement. Car maintenant que la loi de Dieu figée dans la pierre n’est plus, il appartient à l’homme de la retrouver, de la rebâtir. Moïse vient de sauver ce peuple de l’idolâtrie d’un texte auquel Dieu lui avait demandé de se conformer. En brisant les tables, il fait une ouverture, ouverture à la question de comment les ressouder. L’homme devient alors partie prenante de la reconstruction. « La vérité n’est pas au ciel » (« lo bachamaïm hi », Baba Metsia 59b nous enseignent les maîtres du Talmud). La loi n’est plus l’expression unique de la volonté de Dieu. Elle est à redécouvrir par la pensée vivante et vivifiante de l’homme.
Idolâtrie humaine
Mais alors une nouvelle idolâtrie risquerait de surgir, celle d’un homme qui se serait fait Dieu… prenons garde ! Le Talmud ne vient pas ici faire advenir le règne de la pensée humaine, qui deviendrait la mesure de toute chose. Conclure ainsi sur la toute puissance de la pensée humaine m’a beaucoup tenté. Je me suis d’abord arrêté là. Et puis je me suis dit que terminer ainsi serait une terrible traîtrise : une tentation de plaire au détriment d’une exigence de penser. C’est en s’attaquant aux idées les plus consensuelles que l’on se met en danger, qu’on se risque aux critiques. Mais quel serait le sens de se pencher sur le thème de l’idolâtrie si ce n’était que pour caresser mon cher lecteur ?
La brisure n’est pas une séparation. La brisure d’une fenêtre par exemple est la charnière qui permet son articulation, tant son ouverture que sa fermeture. Briser, c’est étonnamment garder un lien. Distance avec le Créateur qui n’est pas rupture.
Vous me direz peut-être ici : encore cette vieille idole divine, qui lorsqu’on la chasse par la porte revient par la fenêtre ? C’est vrai, il est difficile de faire l’économie de Dieu et je vais tenter de l’expliquer.
Rappelons-nous la conclusion à laquelle nous étions arrivés : qu’est-ce qu’une idole ? Le refus de la question. En me pensant en tant qu’homme, mesure de toute chose, je fais de ma subjectivité la réalité. Je consomme le réel dans le sens où je fais mien ce qui m’est extérieur. Je refuse de penser ce qui peut m’échapper. Briser les idoles au contraire, c’est avant tout reconnaître notre fragilité humaine. C’est s’ouvrir au gouffre de la question, c’est reconnaître que je ne suis pas en possession de tout, qu’il y a quelque chose qui m’échappe radicalement : la raison de mon existence, le sens de la vie, l’avenir de mon être. Je ne peux me raccrocher à rien qui viendrait taire mon angoisse. La question reste toujours ouverte, je suis toujours en interrogation sur le monde. Cette interrogation sur le monde n’est pas réponse, mais déjà — et c’est énorme — ouverture à l’absence de réponse ; je viens alors de faire un pas de géant, j’abolis la limite du monde, je brise les idoles.
Lorsque précédemment je citais Lévinas, je le tronquais. Après avoir dit « Tout est ici, tout m’appartient ; tout à l’avance est pris avec la prise originelle du lieu, tout est com-pris » il poursuit : « la possibilité de posséder, c’est à dire de suspendre l’altérité… »
Pour Lévinas, ne plus penser l’homme comme l’alpha et l’oméga du monde est la première marche vers l’expérience éthique. Cette brisure originelle est nécessaire : JE dois me retirer pour faire apparaître l’Autre. L’idolâtrie est d’ailleurs appelée dans la Torah « Avoda Zara » (culte étranger) : culte qui me rend étranger à l’Autre puisque fixé selon le prisme de ma subjectivité. Briser les idoles, c’est accepter d’être bouleversé par ce qui peut surgir. Faire face au vide, à l’endroit où nous ne sommes pas. Lorsqu’on dit que Dieu est Nature, que la
Nature est tout, on abolit la limite avec le monde, on « com-prend » tout. Et l’on a beau penser le monde dans son immensité, on le pense toujours dans un infini dénombrable et non comme un in-fini, dont la fin n’est pas.
Ainsi, l’ordre éthique pour Lévinas ne peut pas résulter d’une loi que les hommes se seraient donnés (une autonomie comme la nomment les philosophes), produit de leur subjectivité. In fine, si tel était le cas, toute loi faite par les hommes pour les hommes ne pourrait être le produit que d’intérêts individuels, une incapacité à se donner à l’autre uniquement pour l’autre, la finalité soi-disant morale utilisée comme moyen au service d’intérêts particuliers. Ici et sans crier gare, on a peut-être touché à l’essence de l’idolâtrie : prendre le moyen pour une fin, pour sa propre fin.
Pour s’arracher au culte idolâtre et suivre une loi véritablement éthique, cette loi ne peut relever que de l’hétéronomie, c’est-à-dire d’une loi révélée et imposée à l’homme, dont cet homme ne retire pas d’intérêt direct. C’est par ce Quelque Chose que l’on appelle trompeusement Dieu et que je préfère nommer, comme l’hébreu le qualifie, le « Ein Sof », l’In- Fini, que la loi est révélée. Cet Ein-Sof échappe radicalement à la nature. Cet Ein Sof, lors de sa révélation au Mont Sinaï, a brusqué l’homme pour qu’il accepte la loi, acceptation nécessairement sous contrainte puisqu’elle ne peut relever d’un choix. Le choix donné à l’homme de la loi ne pourrait qu’induire une décision effectuée par l’homme à l’aune de ses intérêts personnels. (Pour aller plus loin, je vous recommande vivement la lecture talmudique de Lévinas sur le traité Chabbat, 88a et b, « ils arrivèrent au pied de la montagne… »).
Sartre, la fin d’une idole
C’est très certainement ce que Sartre, au crépuscule de sa vie, installé dans son gros fauteuil du boulevard Edgard Quinet, voulut signifier à Benny, son élève, dans les très sulfureux entretiens de 1980, « L’espoir maintenant ». Après les déboires et égarements de la révolution communiste, il s’emploie à repenser la fin. Cette nouvelle fin est indubitablement habitée de la conversion sur le chemin de Moscou de Benny Lévy :
« – Jean-Paul Sartre : je crois que l’essentiel chez le juif, c’est que depuis plusieurs milliers d’années, il a un rapport avec un seul Dieu, il est monothéiste, et c’est ce qui le distinguait de tous les anciens peuples qui avaient tous des pluralités de dieux, et c’est ce qui l’a rendu absolument essentiel et autonome. Ce rapport avec Dieu était, en plus très particulier. (…) Ce qui est neuf, c’est ce qui, en ce Dieu-là, se mettait en rapport avec les hommes. Le rapport qui caractérise les juifs, c’est un rapport immédiat avec ce qu’ils appelaient le Nom, c’est-à-dire Dieu. Dieu parle au juif, le juif entend sa parole, et à travers tout cela, ce qu’il y a de réel, c’est une première liaison métaphysique de l’homme juif avec l’infini. C’est ça, je crois, la première définition du juif ancien, l’homme qui a toute sa vie déterminée en quelque sorte, réglée par son rapport avec Dieu. Et toute l’histoire des juifs consiste justement en ce premier rapport.
– Benny Lévy : Dis-moi : en quoi ce rapport à un Dieu unique, ce destin d’Israël te concernent-ils ?
– JPS : Mais ce n’est pas non plus le Nom qui a du sens pour moi. L’essentiel, c’est que le juif a vécu et qu’il vit encore métaphysiquement. […] La religion juive implique une fin de ce monde-ci et l’apparition au même moment d’un autre monde, un autre monde qui sera fait de celui-ci mais les choses seront autrement disposées. […]
– BL : On voit bien comment tu as pu être sensible à l’idée de la fin de la préhistoire humaine que tu as trouvée chez Marx ; elle pouvait donner de la consistance à ta pensée du projet individuel. Mais en quoi cette fin messianique juive peut-elle t’intéresser aujourd’hui ?
– JPS : Précisément parce qu’elle n’a pas l’aspect marxiste, c’est-à-dire l’aspect d’une fin définie à partir de la situation présente et projetée dans l’avenir, avec des stades qui permettront de l’atteindre en développant certains faits d’aujourd’hui.
– BL : Tu peux préciser ce point ?
– JPS : Elle n’a rien de cela, la fin juive. Si tu veux, c’est le commencement de l’existence des hommes les uns pour les autres. C’est-à-dire une fin morale. Ou, plus exactement, c’est la moralité. Le juif pense que la fin du monde, de ce monde et le surgissement de l’autre, c’est l’apparition de l’existence éthique des hommes les uns pour les autres. […]
– JPS : Les révolutionnaires veulent réaliser une société qui serait humaine et satisfaisante pour les hommes ; mais ils oublient qu’une société de ce genre n’est pas une société de fait, c’est une société pourrait-on dire de droit. C’est-à-dire une société dans laquelle les rapports entre les hommes sont moraux. Eh bien, cette idée de l’éthique comme fin dernière de la révolution, c’est par une sorte de messianisme qu’on peut la penser vraiment. Bien sûr, il y aura des problèmes économiques immenses ; mais précisément, à l’opposé de Marx et des marxistes, ces problèmes ne représentent pas l’essentiel. Leur solution est un moyen, dans certains cas, d’obtenir un véritable rapport des hommes entre eux. »
Messianisme, fin du monde, les Sartriens s’étranglent : on crie à l’abus d’un Sartre malade. Au premier rang des révoltés de ces entretiens, Simone de Beauvoir, l’illustre compagne de Sartre, qui dans la Cérémonie des Adieux voit dans ces entretiens la manipulation du dernier secrétaire du maître. Mais il faut écouter précautionneusement ce que ce géant nous livre. En aucun cas Sartre ne vient ici remettre en cause son athéisme, et annoncer sa croyance en Dieu. Ce serait réduire à peu de choses la pensée d’un si grand homme. Il vient, dans un retour radical, repenser l’ordre du monde. La matière qui avait servi à bâtir tant d’idoles idéologiques ne peut plus constituer le ciment des révolutions. La dernière brisure doit être absolue, et l’espoir d’un monde nouveau son fondement.
[1] Pour en découvrir plus sur la vie de Benny Lévy, écoutez cette interview avec Thierry Ardisson en cliquant ici.