«L’alternative, c’est une prise de position radicale : le blanc ou le noir – s’y dérober serait consentir à l’abject. Voici les composantes de l’option sioniste authentique : une frontière incontestée au centimètre près, un plan social global pour guérir la société israélienne de son insensibilité et de son absence de solidarité – la mise au ban du personnel politique corrompu aujourd’hui au pouvoir».
Avraham Burg, «La révolution sioniste est morte» (septembre 2003)
En 2015 est paru à titre posthume un petit opuscule d’Emmanuel Levinas, Être juif, suivi d’une Lettre à Maurice Blanchot[1]. Le texte de Levinas est la reproduction d’un article initialement paru en 1947 dans une revue juive, Confluences. Sa lettre à Maurice Blanchot, inédite, datée du 21 mai 1948, est contemporaine de la création de l’Etat d’Israël et il semble que ce soit les premières pensées écrites du philosophe à ce sujet. «Et voici l’anachronisme d’un Etat juif», écrit-il à son ami. Faisant plus loin allusion à la déclaration d’Indépendance, il précise «l’anachronisme» en question :
Lorsqu’on nous dit que le régime d’Israël sera basé sur les prophètes, l’esprit colle si étroitement contre ces mots que le ton onctueux, par lequel dans le monde on bouche habituellement la fissure entre ces mots et la pensée, n’est plus tellement perceptible. La grande aliénation des Ecritures qu’a été la Septante – où nous-mêmes nous étudions la Bible – est finie[2].
Dans la préface qu’elle a rédigée pour l’opuscule, Danielle Cohen-Levinas conclut : «Entre le texte de 1947, “Etre juif”, et la lettre à Blanchot de 1948, ce n’est rien de moins qu’une nouvelle source de sens et de signification à donner à l’existence et au peuple juif qui a surgi[3]».
Il est en effet donné aux Juifs, à ceux de Palestine tout au moins, de concevoir et de réaliser un régime politique, économique et social «basé sur les prophètes». La Bible hébraïque serait de la sorte redevenue un texte contemporain, non seulement pour les Juifs religieux, ce qu’il a toujours été, mais également pour les Juifs laïcs. «C’est certes surnaturel ou, du moins – car il faut être lucide et ne pas s’emballer – cela apparaît ainsi pour le moment[4]», écrit Levinas à Blanchot. Pour combler la «fissure» entre les mots des prophètes d’Israël et la pensée (et l’action), ici et maintenant, c’est de lucidité dont il convient de s’armer, certes, plutôt que de «surnaturel» ; d’autant que dans le même temps, en mai 1948, l’expulsion de centaines de milliers de palestiniens est en cours qui, elle, n’a rien de «surnaturel». Soixante-dix ans plus tard, consacrant un article aux luttes des féministes israéliennes, la journaliste Laura Raïm écrit :
En 2003, le pays subit une recension sans précédent. Le ministre des finances Benyamin Netanyahou approfondit encore les réformes structurelles. Tandis que l’Etat dépense sans compter pour la défense, la colonisation et la construction du mur de séparation, le budget social est réduit de façon draconienne. Derrière la façade de la «nation start-up», Israël devient l’Etat du monde développé où les inégalités économiques sont les plus fortes, une famille sur cinq vivant aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. «Israël n’est pas un pays où il fait bon vivre, même pour les hommes juifs», résume Mme Revital Madar, militante féministe. «Si vous n’êtes pas rentier ou banquier, la vie est dure»[5].
Dans ces observations se niche le principe directeur d’une analyse progressiste de la situation israélienne : à mesure que l’antagonisme nationaliste – Juifs versus Arabes – détermine les termes du problème, les inégalités entre Juifs s’accroissent. Autrement dit, dès lors qu’on exalte le nationalisme, la vertu guerrière de la persévérance dans l’être, l’identité ethnico-religieuse, l’union sacrée et qu’en conséquence on se représente «autrui», en l’occurrence le palestinien, comme irréversiblement ennemi, le chemin est libre pour la bourgeoisie nationale, la classe possédante, si bien que «si vous n’êtes pas rentier ou banquier, la vie est dure».
C’est ainsi que l’impératif sécuritaire aveugle les classes laborieuses, dont le consentement est obtenu non seulement par la crainte du «terrorisme» mais aussi, et peut-être surtout par l’image soigneusement dosée, médiatisée du malheur palestinien. Car «être juif» en Israël, bien qu’on ne soit ni rentier ni banquier reste, malgré tout, un privilège en regard de la condition palestinienne. Regard nécessaire, car sans lui une autre vérité s’imposerait : «Israël devient l’Etat du monde développé où les inégalités économiques sont les plus fortes». Qu’est-ce donc, à cette lumière, qu’«être juif» ? Dans un recueil de textes, Au-delà du verset, paru en 1982, Emmanuel Levinas écrit :
Le traumatisme de l’«esclavage en pays d’Egypte» dont sont marqués la Bible et la liturgie du judaïsme appartiendrait à l’humanité même du juif et du juif en tout homme qui, esclavage affranchi, serait tout proche du prolétaire, de l’étranger et du persécuté. L’Ecriture qui rappelle, sans cesse, ce fait fondateur – ou ce mythe – ne va-t-elle pas jusqu’à faire de l’exigence inconvertible de la justice l’équivalent de la spiritualité de l’Esprit et de la proximité de Dieu ?[6]
Affirmer que la sortie d’Egypte est adressée à tous et qu’elle est normative, c’est-à-dire orientant une praxis, exégétique et sociale, c’est poser le principe d’une explicitation rationnelle, progressiste, émancipatrice de ce dont la Bible hébraïque est la vérité fabulée, c’est-à-dire mise en récit. Mais selon d’autres, cela revient à disqualifier la lettre pour l’esprit. C’est ce que soutient par exemple Benny Lévy, notamment dans son dernier ouvrage, Etre juif. Etude Lévinassienne[7]. L’analyse serrée de textes de Levinas le conduit à mettre au jour une dualité critique, et même une contradiction entre deux sortes d’énoncés : les énoncés dits «juifs» d’une part, les énoncés dits «grecs» d’autre part. Réitérant l’argument de Leo Strauss relatif aux «deux racines» de la pensée occidentale, «Athènes et Jérusalem», il explique que ces deux types d’énoncés, «grecs» et «juifs», sont inconciliables, sauf à recourir à une mise en forme dialectique, de sorte qu’il y ait dépassement de l’un par l’autre. Et une telle Aufhebung, lorsqu’il la repère sous la plume de Levinas est décrite en ces termes : «Levinas convertit une proposition de facticité juive en proposition dite universelle, en grec, en “langage universitaire”[8]». Levinas aurait-il été ainsi rattrapé par ce qu’il appelait lui-même, en mai 1948, «la grande aliénation qu’a été la Septante» ?
La conversion d’un énoncé «juif» en énoncé «grec», à suivre Benny Lévy, aurait pour marqueur, ou facture, l’universalisation de l’énoncé «juif», ou plus précisément l’universalisation d’une «proposition de facticité juive». Ce serait la marque, ou plus encore le stigmate d’une violence infligée à la lettre. Car traduire la lettre juive dans les termes du logos grec serait un projet qui ne relève pas du mosaïsme mais d’une contrainte extérieure, d’une loi imposée, d’une «aliénation». En affirmant que l’injonction de s’affranchir de «l’esclavage en pays d’Egypte» appartient à «l’humanité même du juif et du juif en tout homme», Levinas aurait-il converti un énoncé «juif» en énoncé «grec», c’est-à-dire, à terme, évangélique ? Mais en ce cas, que dit l’énoncé «juif» ?
***
Le point de départ du livre de Benny Lévy, Etre juif, est l’article d’Emmanuel Levinas lui-même intitulé «Etre juif», lequel avait été oublié jusqu’à ce qu’en 2002 il soit reproduit dans le premier numéro des Cahiers d’Etudes Lévinassiennes[9]. L’article y est suivi d’extraits d’un commentaire de Benny Lévy, qui présente le texte de Levinas :
En 1947, l’année même où sont prononcées les Conférences publiées dans Le temps et l’autre et où paraît De l’existence à l’existant, un article de Levinas intitulé «Etre juif» sort dans une petite revue juive, Confluences. Je ne saurais vous décrire mon saisissement ; cet article de 1947 semble déconstruire chaque proposition avancée la même année dans les textes philosophiques. Encore plus saisissant : Levinas a scrupuleusement surveillé la publication des recueils de ses textes dispersés dans les revues. Il a publié dans Difficile liberté «Etre occidental». «Etre juif», non. […]. Pourquoi cet article n’a-t-il pas été publié ? Comme s’il devait rester à l’arrière (secret) des textes publiés au grand jour[10].
«Etre juif» soulève donc deux questions : 1. Comment expliquer que Levinas puisse y «déconstruire chaque proposition avancée la même année dans les textes philosophiques» ? 2. «Pourquoi cet article n’a-t-il pas été publié» dans les recueils postérieurs, notamment dans Difficile liberté, compilation de textes sur le judaïsme ? À ces deux questions, Benny Lévy répond, au terme de son commentaire :
«Etre juif» fonctionne, disions-nous, comme un arrière (secret) des textes publiés au grand jour. Arrière, réserve séminale des possibilités à-venir du penser «philosophique». Texte-père. Dans la guerre métaphysique entre le Père vivant et le Père inconnu, guerre à l’arrière de tout texte lévinassien, ce texte-père devait rester secret[11].
Dans l’article «Etre juif», l’énoncé «juif » déconstruit l’énoncé «grec» et c’est pourquoi Levinas ne l’a pas réédité («ce texte-père devait rester secret»). Ceci posé, reste à interroger la «réserve séminale», soit l’inconvertible «proposition de facticité juive» que recèle l’article inédit de Levinas et qui, à suivre Lévy, résiderait tout entière dans la différence entre un «Père vivant» (du côté «juif») et un «Père inconnu» (du côté « grec »).
«Etre juif», paru en 1947, est à bien des égards une réponse au livre de Sartre, Réflexions sur la question juive, paru l’année précédente (1946). L’argument de Sartre est célèbre : «Le Juif est un homme que les autres tiennent pour juif. Voilà la vérité simple d’où il faut partir». Partant de cette «vérité simple», Sartre s’emploie à montrer que le «Juif» est une construction de l’antisémite. Le problème est qu’une fois anéantie la construction de l’antisémite, le «Juif» est lui-même anéanti en tant que juif, n’étant plus «un homme que les autres tiennent pour juif» mais un homme que les autres tiennent pour homme. Or, si cela n’est pas le problème aux yeux de Sartre en 1947, mais bien sa solution, ça l’est en revanche aux yeux de Levinas. Pourquoi ? Parce qu’il y a un sens, selon lui, à ce qu’il existe un homme que les autres tiennent pour juif, sans pourtant que l’humanité n’y perde rien, au contraire, et, corrélativement, sans que l’antisémitisme n’y gagne rien. Comment va-t-il s’y prendre pour expliquer à Sartre qu’être «juif» apporte une lumière que n’apporte pas, ou qu’obscurcit la substitution grecque, philosophique, évangélique de «homme» à «juif» ?
L’essentiel de la démonstration de Levinas consiste à équivaloir l’existentialisme de Sartre à une modernité d’essence chrétienne, puis à ressaisir la différence entre judaïsme et christianisme. Le biais choisi est la question du temps, l’existence grecque, évangélique ou moderne étant selon lui placée sous le signe du «présent» :
Etre dans le présent, c’est traiter le monde, c’est traiter nous-mêmes, comme on traite les gens qui nous entourent, dont on ignore la biographie, qui arrachés à leur famille, à leur milieu, à leur intérieur, sont tous de «père inconnu», abstraits en quelque manière, mais pour cela précisément, donnés immédiatement. Aussi le rapport avec l’être, dans la vie quotidienne, est-il action. Il est comme le glaive d’Alexandre qui ne dénoue pas les nœuds, qui ne refait pas à l’envers les mouvements qui nouent, mais qui tranche. [12]
Trancher les nœuds, «comme le glaive d’Alexandre», c’est commencer absolument, c’est couper le lien à un passé, une origine, et cela revient à s’émanciper d’un «père» dont le nom est dès lors frappé du prédicat «inconnu». Le présent du monde moderne est donc liberté absolue, mais bâtarde, et conquérante. Liberté des fils, exemplairement celle d’Alexandre, l’empereur, et aussi de la science qui, observe Levinas, exalte le présent en ne considérant que les lois, lesquelles sont «sans référence à l’origine qu’impliquait encore l’idée de cause[13]». Puis il en vient au christianisme :
Mais le christianisme aussi est une existence à partir du présent. Certes, dans une très large mesure, il est un judaïsme ; mais ce n’est pas au judaïsme qu’il doit son succès. Son originalité a consisté à reléguer au deuxième plan ce Père auquel le Juif est accroché comme à un passé, et à n’accéder au Père qu’à travers le Fils incarné, c’est-à-dire à travers une présence, à travers sa présence parmi nous. Ce n’est pas une question de dogme, mais d’émotion. Alors que l’existence juive se réfère à un instant privilégié du passé et que sa position absolue dans l’être lui est assurée par sa filialité, l’existence chrétienne possède dans son présent même ce point d’attache privilégié. Dieu lui est frère, c’est-à-dire contemporain. L’œuvre du salut est entièrement intérieure, ne s’accomplit pas avec l’entrée même dans l’être, avec la naissance ; elle est dans le pouvoir d’une nouvelle naissance à chaque naissance promise, dans la conversion, dans le contact de la grâce. Il y a là une atténuation de la notion d’origine dans ce qu’elle a de fort, au profit de la notion du présent.[14]
Chez le Juif, Dieu est «père» et l’origine prime sur le présent ; chez le chrétien, Il est «frère» et c’est le présent qui prime sur l’origine. Benny Lévy, dans son dernier livre, radicalisera autant que faire se peut «la proposition de facticité juive» : «Vous aurez beau devenir sociologue, révolutionnaire, Juif réformé, vous ne changerez rien à ce fait foncier, fondamental, initialement et destinalement : vous êtes nés, du début jusqu’à la fin[15]». Si le «présent» de Sartre, existentialiste, se laisse aisément ressaisir par l’aphorisme du poète – «Je parle, homme sans faute originelle sur une terre présente» (René Char) –, qu’en est-il, en revanche, de «l’origine» ou de la «naissance» dont parlent Levinas et Lévy ?
Soyons clairs : ce n’est pas une question de «race», c’est une question de «facticité» ; d’où le fourvoiement de Sartre qui, voulant désactiver la «race», aura désactivé du même coup une «facticité juive» dont l’enseignement, en dernière analyse, serait le suivant : vous ne vous faites pas homme, vous êtes fait ainsi. Ce serait l’énoncé «juif» inconvertible en «grec», celui qui permet de penser, ou plutôt d’éprouver l’humanité comme «créature», condition sine qua non de l’obéissance aux commandements. Benny Lévy, dans son Etude lévinassienne, reformule la leçon en ces termes :
Comment puis-je continuer à «être né» (impératif de la création) ? En obéissant à la loi du Père : l’impératif du commandement prolonge celui de la création. (…) Que Levinas ait articulé l’impératif du commandement avant l’être élu signifie qu’un être élu est un être qui entend le commandement. Ces quelques phrases contiennent tout le programme de pensée de Levinas[16].
Et ce «programme de pensée» formulé en 1947 devait donc rester «secret», précisément parce qu’il «semble déconstruire chaque proposition avancée la même année dans les textes philosophiques». La lecture de Benny Lévy se tient, d’où sa force. On peut toutefois se demander si elle n’est pas forcée, à défaut d’être incohérente, car à l’évidence une autre interprétation s’imposait : si Levinas ne réédite pas cet article dans ses recueils postérieurs, c’est parce que son argument lui paraît, rétrospectivement, s’écarter de ce qu’il s’évertuait à penser déjà, en 1947. Et cet écart ne serait pas un «secret», une «réserve séminale», ce serait plutôt un manquement, un écueil, un raté.
Pour preuve, en 1979, Levinas réunit sous la forme d’un livre des conférences prononcées en 1947 et parues en revue l’année suivante, Le temps et l’autre. Et d’emblée il prévient son lecteur :
«Ecrire une préface pour la réédition de pages qu’on avait publiées il y a trente ans, c’est presque préfacer le livre d’un autre. Sauf qu’on en voit plus vite et qu’on en ressent plus douloureusement les insuffisances[17]».
Quelles que soient les «insuffisances» de sa pensée dans les conférences de 1947, l’orientation est cependant déjà prise et la pensée en marche, raison pour laquelle leur publication se justifie trente ans après. Il n’en va pas de même pour l’article «Etre juif» dont la réédition ne s’est jamais imposée, pas même dans Difficile liberté, compilation d’articles sur le judaïsme où figure en revanche, comme l’observe Benny Lévy, Etre occidental». Pourquoi ? Nous répondons : parce que la pensée de Levinas s’est abîmée, défigurée dans «Etre juif». Et cet abîme, cette défiguration se signale par un mot – et un seul : «autrui».
S’il devait être question de résumer d’un mot la pensée de Levinas, depuis ses premiers pas jusqu’à ses ultimes formulations, nous dirions qu’elle tient tout entière dans l’idée, ou plus exactement dans la sensibilité à ce fait singulier : le visage d’autrui m’oblige. Or, c’est précisément de ce fait singulier dont il n’est nulle part question dans «Etre juif», où disparaît «autrui», littéralement, au profit de «l’origine» et de la «naissance». En regard, dans les conférences sur le temps, s’il n’est pas encore question du «visage», qui interviendra plus tard, il est en revanche question de la mort, de la femme, de la relation du fils au père, enfin d’ «autrui» – final qui est ce par quoi Levinas se sépare de Platon. Il conclut en effet que la différence entre Jérusalem et Athènes tient au fait que, à Jérusalem, «le moi se substitue au même et autrui à l’autre». Ainsi, «autrui», le dernier mot – souligné par Levinas – des conférences de 1947, est très précisément le mot absent de l’article «Etre juif» paru la même année. Et c’est pourquoi, selon nous, à l’inverse de dizaines d’autres articles, Levinas l’a mis au rencart. C’est un déchet dans son œuvre écrite, un avorton plutôt qu’un «texte-père».
***
De la disparition d’«autrui» dans l’article «Etre juif», et de la mise au rencart qui en découle jusqu’à ce que Benny Lévy en 2002, puis Danielle Cohen-Levinas en 2015, rééditent le texte selon nous renié par son auteur, voyons maintenant ce que dit l’article de Maurice Blanchot lui-même intitulé «Etre juif». En 1969 paraît L’entretien infini[18] ; dans la seconde partie du livre, «L’expérience-limite», un chapitre intitulé «L’indestructible» est composé de deux articles : le premier a pour titre «Etre juif», le second «L’espèce humaine». Il est d’abord question du Juif avec Levinas, puis de l’homme avec Robert Antelme. Et consacrant un texte à la philosophie de Levinas, Blanchot, le destinataire de la lettre de mai 1948, reprend le titre de l’article de Levinas paru dans une revue juive en 1947, sans pourtant y faire mention. Cohen-Levinas le relève lorsqu’elle évoque le texte de Blanchot :
Une remarque s’impose : dans son article, Blanchot ne fait aucunement état du texte de Levinas. Certes, le texte de Levinas n’avait fait l’objet que d’une seule et unique publication, mais bien que nous ne pouvions (sic) affirmer avec exactitude que Blanchot en avait eu connaissance, ce dernier ne pouvait selon nous l’ignorer totalement. Ce n’est pas le lieu d’interroger les rapports que Maurice Blanchot entretenait avec le judaïsme, ni les raisons pour lesquelles il inscrit sa réflexion dans le prolongement explicite au texte de Levinas sans pour autant s’y référer. L’inspiration lévinassienne ne fait aucun doute. Blanchot ne cède en rien à la logique hégélienne du concept qui voudrait que l’existence juive marquée du sceau du malheur, de l’oppression et de la persécution, s’accommode d’une condition historiquement négative[19].
Certes, «l’inspiration lévinassienne» de Blanchot «ne fait aucun doute», mais il est en revanche impossible de situer son article dans «le prolongement explicite» de celui de Levinas. Car s’il lui emprunte vraisemblablement son titre, il ne le cite pas. S’agirait-il en ce cas d’un prolongement implicite ? Il me semble qu’il s’agit plutôt d’une substitution : Blanchot, en ne mentionnant pas l’article paru confidentiellement en 1947, substitue en 1962 (date de la parution de son article dans La Nouvelle Revue Française), puis en 1969 (date de sa réédition dans L’entretien infini) son propre article «Etre juif» à celui de Levinas. Et selon nous, la raison de ce geste, apparemment inélégant, est une fidélité de Blanchot à l’authentique «inspiration lévinassienne», comme si l’auteur de L’entretien infini savait déjà (et peut-être le tenait-il de la bouche de son ami ?) que Levinas avait renié cet «Etre juif» parce qu’autrui l’avait défiguré par son absence. Pour s’en convaincre, il suffit de relire la conclusion de l’article de Blanchot, ses derniers mots :
Exclure les Juifs, non, vraiment, cela ne suffit pas ; les exterminer, cela n’est pas assez : il faudrait aussi les retrancher de l’histoire, les retirer des livres par où ils nous parlent, effacer enfin cette présence qu’est, avant et après tout livre, la parole inscrite et par laquelle l’homme, du plus loin, là où manque tout horizon, s’est déjà tourné vers l’homme : en un mot supprimer «autrui»[20].
Cette parole juive, cette existence juive «par laquelle l’homme, du plus loin, là où manque tout horizon, s’est déjà tourné vers l’homme», tel est ce que l’article de Levinas avait manqué en 1947 et que celui de Blanchot restitue en 1969, fidèle en cela à l’authentique «inspiration lévinassienne» depuis Le temps et l’autre (1947) jusqu’à Au-delà du verset (1982). Élégance infinie de Blanchot, donc, d’avoir ainsi ressuscité la présence supprimée d’«autrui» et, ce faisant, contribué à réparer la fissure entre les mots, l’action et la pensée.
Mais, demandera-t-on, comment expliquer ce raté, ce manquement de Levinas dans l’article de 1947 ? Il me semble qu’une explication s’impose : c’est dû au livre de Sartre. Dès lors que la «vérité simple» de Sartre met en scène «le juif» et «l’antisémite» et qu’il s’agit donc de raisonner dans ce seul horizon, «autrui» disparaît. Car entre «le juif» et «l’antisémite» il n’y a pas de relation, pas d’altérité, pas de rencontre ; il n’y a que le néant et c’est pourquoi, dans l’horizon donné de l’impossible relation du «juif» à «l’antisémite», nul visage n’interrompt le solipsisme de l’être.
Adoptant le paradigme des Réflexions sur la question juive, Levinas s’est ainsi trouvé prisonnier d’une relation sans altérité, celle de «l’antisémite» au «juif». Et à cette lumière, l’argument de son article s’entend mieux : «être juif», face à l’antisémite, est significatif en soi, comme si le simple fait d’être juif irradiait, sans qu’il soit nécessaire de lier l’existence juive à la parole prophétique ; mieux : face à l’antisémite, il est non seulement impossible mais nécessaire de ne pas invoquer «la parole inscrite et par laquelle l’homme, du plus loin, là où manque tout horizon, s’est déjà tourné vers l’homme». Autrement dit encore, face à l’antisémite, le pur fait d’être juif suffit. Cette vérité simple ne pouvait cependant sauver ce que l’article de 1947 avait littéralement supprimé : «autrui». Et c’est pourquoi Levinas se garda par la suite de l’intégrer à un livre. L’effacement d’autrui barrait le chemin que sa pensée traçait déjà : le primat de l’éthique sur l’ontologique.
***
Des prophètes d’Israël, dont l’actualisation de la parole est peut-être «tout le programme de pensée de Levinas», un article, parmi bien d’autres, tire les leçons : La laïcité et la pensée d’Israël. Le texte fut à l’origine une contribution à un recueil portant sur La laïcité (PUF, 1960), puis réédité dans Les imprévus de l’histoire (Fata Morgana, 1980). Levinas y expose les principes de ce qu’il appelle non pas la religion d’Israël, donc, mais sa «pensée», écrivant notamment que «le rapport avec Dieu ne se conçoit à aucun moment en dehors du rapport avec les hommes». Plus loin, il observe que le «ritualisme juif servira de méthode et de discipline à sa morale. Il ne prendra pas de signification sacramentelle[21]». C’est à ce propos que le philosophe souhaite souligner la singularité du monothéisme juif, singularité qu’il identifie dans la subordination de la vie religieuse à la relation éthique :
La relation éthique, impossible sans justice, ne prépare pas seulement à la vie religieuse, ne découle pas seulement de cette vie, mais est cette vie même. La connaissance de Dieu consiste selon le verset 16 du chapitre 22 de Jérémie «à faire droit au pauvre et au malheureux». Le Messie se définit, avant tout, par l’instauration de la paix et de la justice – c’est-à-dire par la consécration de la société. Aucun espoir de salut individuel – quels que soient les traits sous lesquels on le rêve – ne se peut, ne se pense en dehors de l’accomplissement social, dont les progrès résonnent, à l’oreille juive, comme les pas même du Messie. Dire de Dieu qu’il est le Dieu des pauvres ou le Dieu de la justice, c’est se prononcer non pas sur ses attributs, mais sur son essence. D’où l’idée que les rapports interhumains, indépendants de toute communion religieuse, au sens étroit du terme, constituent en quelque façon l’acte liturgique suprême, autonome par rapport à toutes les manifestations de la piété rituelle. Dans ce sens, sans doute, les prophètes préfèrent la justice aux sacrifices du temple.
Dans «Etre juif» de 1947, on lit : «Faire la volonté de Dieu est, dans ce sens, la condition de la facticité». Mais partout ailleurs dans l’œuvre de Levinas, c’est la relation à l’autre homme qui est la condition de la facticité. C’est pourquoi le ritualisme juif – c’est-à-dire l’ensemble des obligations du juif envers le Ciel – est conçu par Levinas comme ce qui doit servir «de méthode et de discipline à sa morale», le but étant de préparer à la rencontre de l’autre homme, c’est-à-dire à la révélation du visage d’autrui. Et l’article de Blanchot, à cet égard, paraît non seulement restituer l’authentique «inspiration lévinassienne» mais la radicaliser. À la question de Pasternak, «Que signifie être juif ? Pourquoi cela existe-t-il ?», il répond :
Cela existe pour qu’existe l’idée d’exode et l’idée d’exil comme mouvement juste ; cela existe, à travers l’exil et par cette initiative qu’est l’exode, pour que l’expérience de l’étrangeté s’affirme auprès de nous dans un rapport irréductible ; cela existe pour que, par l’autorité de cette expérience, nous apprenions à parler[22].
De cette analyse de la relation à autrui, s’ensuit une question : l’indépendance politique d’Israël sous la forme d’un Etat «juif» contredit-elle «l’idée d’exode et d’exil comme mouvement juste» ? Est-ce que Blanchot, en 1969, non seulement récuse tout «surnaturel» mais récuse en outre les termes de la lettre de Levinas de mai 1948 : «le régime d’Israël sera basé sur les prophètes» ? Cette question, dans l’article de Blanchot, est l’objet d’une note de bas de page apposée au dernier mot : «autrui». Evoquant d’abord la nécessité de prendre en considération la pesanteur historique de l’antisémitisme, puis citant Albert Memmi qui entrevoit «la liquidation progressive de l’oppression subie par le Juif», Blanchot se montre prudent, observant d’abord que la «renaissance de l’Etat d’Israël, ainsi que la conscience plus vive que nous avons de ce qu’est une condition d’oppression, peuvent nous faire avancer sur ce chemin» ; il ajoute : «Cependant il doit rester clair que la question exprimée par les mots “être-juif” et la question de l’Etat d’Israël ne sauraient s’identifier, même si elles se modifient l’une par l’autre». Puis, comme pour indiquer la différence entre ces deux existences que sont d’une part le Juif, de l’autre l’Etat d’Israël, il rapporte une pensée d’André Neher au sujet d’un sionisme compris comme une «solution purement occidentale, celle de l’Etat, comme si tout le mouvement porté par le judaïsme ne devait tendre à rien d’autre qu’à la fonction d’un Etat conçu sur le modèle de l’Etat du XIXe siècle». Et Blanchot de commenter – c’est sa conclusion :
Je serai tenté de conclure en disant que, dans la société qui s’essaie en Palestine, dans la lutte, sous la menace et sous cette menace non moins grave qu’est la nécessité d’une telle lutte pour la «sauvegarde», ainsi que dans les sociétés issues du marxisme ou libérées de la servitude coloniale, c’est la philosophie même qui se mesure dangereusement avec le pouvoir, pour autant que les unes et les autres ont à décider du sens et de l’avenir, face à l’Etat, de la «vérité nomade[23]».
Si la «renaissance de l’Etat d’Israël», selon Blanchot, ne saurait être remise en cause, il n’en demeure pas moins nécessaire de distinguer cette existence de celle du Juif, sans quoi la «vérité nomade» serait défaite, domestiquée, aliénée, voire anéantie. Or, nous a appris par ailleurs Levinas, une fois la «vérité nomade» évincée, l’existence juive risque de prendre une «signification sacramentelle».
À revenir maintenant aux principales scansions de l’article de Levinas, on mesure mieux encore l’écart avec celui de Blanchot. Levinas évoque rapidement la «question juive», puis se propose de «caractériser la signification ontologique de cette existence du monde non juif vers laquelle l’assimilation accédait[24]» ; il désigne ainsi l’existence occidentale, à laquelle les juifs allemands, français, anglais, accédaient avant le nazisme. Cette existence, nous l’avons vu, se situe résolument dans le «présent», c’est-à-dire «dans le pouvoir d’une nouvelle naissance à chaque naissance promise, dans la conversion, dans le contact de la grâce». Ceci posé, Levinas en vient à «l’existence juive» ; il évoque «la volonté d’être Juif qui à nouveau s’affirme[25]», allusion à la création de l’Etat d’Israël ; puis il est question, nous l’avons vu aussi, de «l’origine» et de la relation au père (ou Père) primant sur la relation à l’autre homme (ou Autrui) ; enfin Levinas conclut que «le Juif est l’entrée même de l’événement religieux dans le monde ; mieux encore, il est l’impossibilité d’un monde sans religion[26]». Et revenant ultimement à la haine antisémite, il clôt sa méditation par ces mots : «Il s’y mêle je ne sais quel goût d’obscénité, d’impudeur et d’infini. Un goût de sacré[27]».
En regard du mot «sacré» qui termine l’article de Levinas, Blanchot nous donne à lire le mot «autrui», auquel est apposée une note de bas de page qui, elle, se conclut par les mots : «vérité nomade». Et notre conviction raisonnée est que cet écart rend compte de la non réédition de l’article de 1947. Car le mouvement de pensée de Levinas, son «programme» de 1947 à sa mort, aura précisément consisté à concevoir le sacré non pas dans l’«être juif» mais, comme l’écrit superbement Blanchot, dans «la parole inscrite et par laquelle l’homme, du plus loin, là où manque tout horizon, s’est déjà tourné vers l’homme», autrement dit dans la relation éthique, «transcendance» qui garde l’existence juive de toute «signification sacramentelle».
Ce «goût de sacré» que Levinas identifie en dehors de la relation éthique caractérise en effet la haine antisémite et non l’existence juive, dont le «goût de sacré», s’il doit en être question, réside dans l’ordre des fins, non des faits ; et si dans l’ordre des faits la relation du fils au père prime sur la relation de l’homme à autrui, dans l’ordre des fins c’est la relation de l’homme à autrui qui prime sur la relation du fils au père, celle-ci ayant précisément pour fin l’humanisation heureuse du fils, de sorte qu’il soit en mesure, devenu grand, de se tourner vers l’autre homme et, ainsi, d’être homme.
***
Reste la question que pose l’article de Blanchot : comment articuler la «renaissance de l’Etat d’Israël» à la «vérité nomade» ? C’est peut-être l’enjeu d’un texte de Levinas paru en revue en 1951 et réédité dans le recueil Difficile liberté (Albin Michel, 1963) [28] : Etat d’Israël et Religion d’Israël. Levinas y affirme pour commencer, en philosophe hégélien, qu’une souveraineté nationale sanctionne l’acquisition d’une responsabilité, d’une possibilité d’exprimer intégralement son être spirituel, la volonté effective de chacun étant engagée dans celle de l’Etat :
Dans l’Etat souverain, le citoyen peut enfin vouloir. Il agit absolument (…). Voilà pourquoi, dans sa dignité de citoyen et, plus encore, au service de l’Etat, l’homme moderne reconnaît sa nature spirituelle. L’Etat représente dans le destin des peuples occidentaux leur accomplissement humain. La coïncidence du politique et du spirituelle marque la maturité de l’homme, car la vie spirituelle comme la vie publique s’épure de tout le clair-obscur sentimental, particulier, privé, dont se nourrissent encore les religions[29].
Toutefois, dans le cas du judaïsme, poursuit Levinas, l’Etat ne saurait être une pure et simple aufhebung, un dépassement de la spiritualité religieuse, la religion d’Israël étant ce qui doit éduquer, voire déterminer la volonté politique de l’Etat. Car c’est l’accomplissement du commandement religieux, c’est-à-dire éthique, qui concrétise l’esprit du peuple juif et avère sa souveraineté :
Ce droit singulier, révélé par une expérience juive incontestable, d’appeler sienne une doctrine pourtant offerte à tous, voilà la vraie souveraineté d’Israël. (…). Le peuple juif réalise donc un Etat dont le prestige tient cependant à cette religion que la vie politique moderne supplante. Le paradoxe serait insoluble si ce génie religieux ne consistait pas précisément à lutter contre l’ivresse des enthousiasmes individuels pour une œuvre difficile et savante de justice[30].
La religion d’Israël non seulement ne contredit pas la vocation de l’Etat moderne, ni n’est abolie par elle, mais l’instruit, car l’enjeu d’un Etat «juif» n’est pas de satisfaire un désir, certes légitime, d’indépendance nationale, il est de rendre possible l’effectivité des énoncés «juifs» :
L’important de l’Etat d’Israël ne consiste pas dans la réalisation d’une antique promesse, ni dans le début qu’il marquerait d’une ère de sécurité matérielle – problématique, hélas ! – mais dans l’occasion enfin offerte d’accomplir la loi sociale du judaïsme (…). C’était tout de même horrible d’être le seul peuple qui se définisse par une doctrine de justice et le seul qui ne puisse l’appliquer. Déchirement et sens de la Diaspora. La subordination de l’Etat à ses promesses sociales articule la signification religieuse de la résurrection d’Israël comme, aux temps anciens, la pratique de la justice justifiait la présence sur une terre. C’est par là que l’événement politique est déjà débordé. Et c’est par là enfin que l’on peut distinguer les juifs religieux de ceux qui ne le sont pas. L’opposition est entre ceux qui cherchent l’Etat pour la justice et ceux qui cherchent la justice pour assurer la subsistance de l’Etat[31].
L’existence d’un Etat «juif» impliquerait donc, à suivre Levinas, de redéfinir les formes de la subjectivité religieuse : elles ne consistent plus, ou plus seulement dans la pieuse observance des commandements de la loi religieuse codifiée, mais dans la mise en œuvre politique des idées fondamentales dont commandements et rites sont le véhicule. C’est pourquoi un Etat «juif» est un outil subordonné à sa fonction, qui est «d’accomplir la loi sociale du judaïsme», autrement dit de produire des énoncés politiques «juifs» et de les mettre en œuvre. Il n’est pas une fin en soi, il ne saurait l’être ; il trouve sa raison d’être et sa justification dans la réalisation des «promesses sociales» dont le judaïsme est la doctrine «offerte à tous» ; d’où la leçon que tire Levinas, où l’on reconnaît la «vérité nomade» de Blanchot, précisément située dans son antagonisme essentiel avec le «pouvoir» : «L’opposition est entre ceux qui cherchent l’Etat pour la justice et ceux qui cherchent la justice pour assurer la subsistance de l’Etat».
***
Revenons pour finir aux temps présents : «Israël devient l’Etat du monde développé où les inégalités économiques sont les plus fortes», observation en laquelle nous avons reconnu le corollaire de l’aliénation politique croissante entre Juifs et Palestiniens. Il faut donc sortir politiquement d’Egypte, injonction dont la réalisation a pour condition nécessaire (mais pas suffisante) une révolution formelle dont le cadre juridique nous paraît se résumer en l’alternative suivante : ou bien deux Etats confédérés mais séparés sur la base des frontières dites de 1967 (l’un israélien comportant une minorité arabe, l’autre palestinien comportant une minorité juive, l’un ayant pour capitale Jérusalem-ouest, l’autre Jérusalem-est, et une souveraineté partagée sur le mont du temple/esplanade des mosquées) ; ou bien un Etat commun israélo-palestinien, binational et bilinguistique, ouvert par principe à l’immigration des juifs et des palestiniens où qu’ils se trouvent dispersés dans le monde[32].
C’est ainsi que l’être-juif et l’être-palestinien, devenus indéfectiblement noués l’un à l’autre, ont rendez-vous, chacun, avec «autrui». Et en ce sens, par-delà l’inégalité criante du rapport de force et l’oppression des uns (palestiniens) par les autres (juifs), il n’en reste pas moins vrai que, de part et d’autre de la frontière identitaire, «l’opposition est entre ceux qui cherchent l’Etat pour la justice et ceux qui cherchent la justice pour assurer la subsistance de l’Etat».
Ou pour le dire avec Blanchot, «dans la société qui s’essaie en Palestine», exemplaire en cela, «c’est la philosophie même qui se mesure dangereusement avec le pouvoir», pour autant que les uns et les autres «ont à décider du sens et de l’avenir, face à l’Etat, de la “vérité nomade”». Vérité devenue juive pour une part, palestinienne pour une autre.
Quant à ceux qui haïssent le «mouvement juste» de la pensée, concluons qu’il se mêle à leur haine «je ne sais quel goût d’obscénité, d’impudeur et d’infini. Un goût de sacré».
[1] Ed. Payot et Rivage. Préface de Danielle Cohen-Levinas.
[2] Ibid., p. 77.
[3] Ibid., p. 40.
[4] Ibid., p. 77.
[5] Laura Raïm, «L’émancipation contrariée des femmes israéliennes», in Le Monde diplomatique, novembre 2017, p. 7.
[6] Ed. de Minuit, 1982, p. 18.
[7] Ed. Verdier, 2003.
[8] Etre juif. Etude lévinassienne, op. cit., p. 40.
[9] « Levinas et le temps », 2002, pp.99-106.
[10] Cahiers d’Etudes Lévinasssiennes, op. cit., p. 107.
[11] Ibid. p. 117.
[12] Etre juif, op. cit., p. 56.
[13] Ibid., p. 57.
[14] Ibid. p. 102-103.
[15] Etre juif. Etude lévinassienne, op. cit, page 34.
[16] Ibid, p. 34-35.
[17] Le temps et l’autre, PUF, coll. « Quadrige », 1979.
[18] Galimard, nrf. L’article «Etre juif» de Blanchot avait d’abord paru en 1962 dans La Nouvelle Revue Française, avant d’être repris dans ce recueil.
[19] Etre juif, préface, op. cit., p. 26-27.
[20] Op. cit., p. 190.
[21] Ed. Poche., p. 160.
[22] L’entretien infini, op. cit., p. 183.
[23] Ibid., p. 190-191.
[24] Op. cit., p. 53.
[25] Ibid., p. 59.
[26] Ibid., p. 63.
[27] Ibid., p. 67.
[28] Difficile liberté, éd. Livre de Poche, p. 302-308.
[29] Op. cit., p. 303.
[30] Ibid., p. 304.
[31] Ibid., p. 305-306.
[32] Ce second versant de l’alternative est exposé dans mon livre Les pingouins de l’universel, Lignes, 2017. Le premier versant est notamment exposé dans mon article «Israël : l’impossible boycott» (en ligne sur le site Lundimatin).


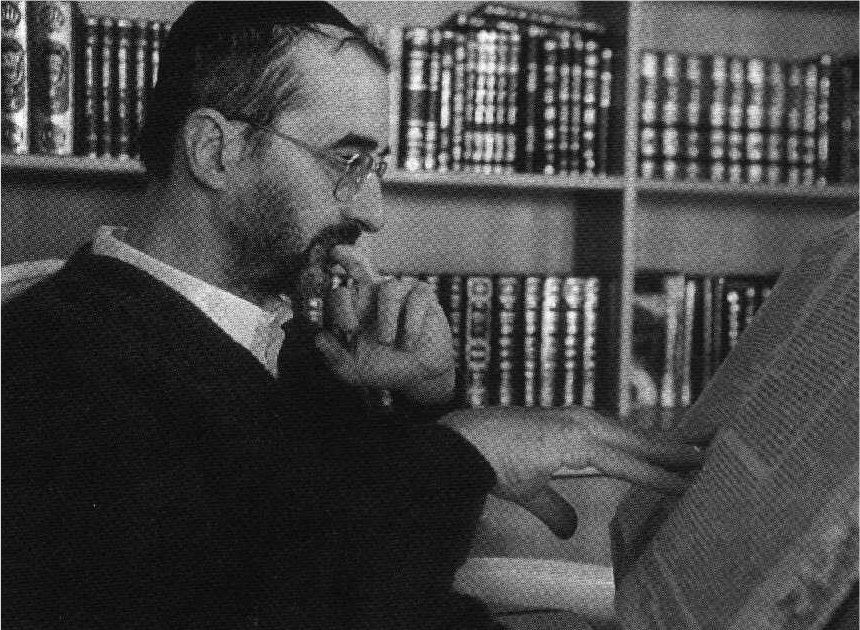





Une réflexion la vôtre qui mérite de rester affichée et méditée, car elle essentialise les fondements de notre être au monde.
Comment?
Par la praxis ou par le désir d’une liberté qui coupée du lien au père s’affranchit et se rend absolue ?
Une liberté absolue c’est la condition même du non-être, le fondement du vide.
Une liberté contrainte c’est l’affirmation de l’autrui, le choix entre vérités dogmatiques et la Loi universelle.
En modifiant la phrase de Levinas : « ce siècle aura donc été pour tous ceux de la fin de la philosophie », on y verra plutôt la fin des dogmes et de ses fausses idoles, qui ont précédé et suivi Auschwitz.
Le retour du peuple juif c’est celui qui signe la réconciliation avec la philosophie, manifestée dans la concrétude de l’Etat d’Israël, et qui peut-être aurait échappé à Benny Lévy.
C’est par la philosophie que l’écriture enfouie trouve sa liberté. Un aller-retour donc, plutôt qu’un simple retour, et qui donne entière signification à l’oeuvre d’Emmanuel Levinas comme le montre la source juive et celle grecque du titre même de son livre :
«De Dieu qui vient à l’idée ».
Qu’est-ce qui peut venir à l’idée qui n’y soit pas déjà en quelque sorte présent et enfoui ?
Philosophie et ontologie coexistent, une étant à l’origine de l’autre.
Le vrai dépassement opéré par Levinas c’est la libération du moi d’un soi, qui tuant l’altérité détruit toute trace de la transcendance.