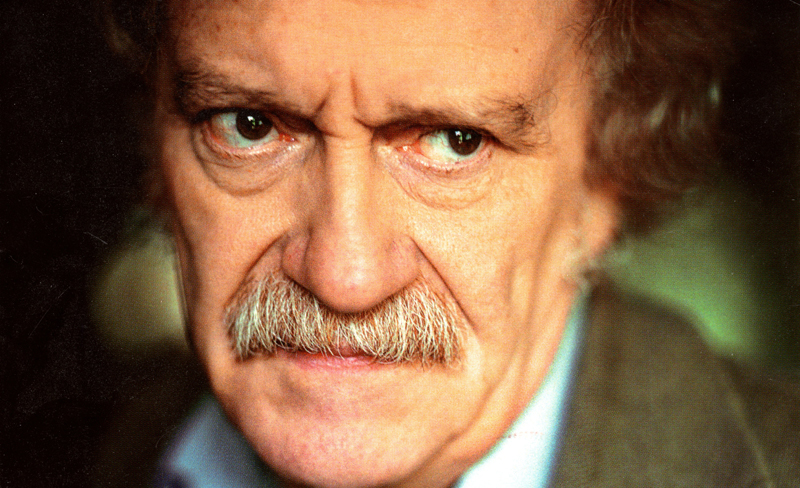Perdons notre Smartphone et nous perdons notre tête. Car beaucoup des opérations intellectuelles pilotées auparavant depuis la vigie, là-haut, nous les avons déléguées à notre secrétaire numérique, ici en bas, dans notre paume. Rechercher par mot-clé, moissonner des données, enregistrer des résultats – voilà les trois opérations majeures de notre cerveau délégué. Comme Saint-Denis, décapité, qui se promenait en tenant sa tête dans les mains, nous traversons la vie, cochers acéphales, agrippés ainsi à l’attelage du Smartphone et de Google, de l’outil et de la toile. Avons-nous perdu la tête ? Ou bien en avons-nous gagné une, aux performances de Mastermind ? Avec le silex taillé, notre ancêtre avait franchi une étape technico-intellectuelle déterminante. Notre petit biface qui vibre et brille, annonce peut-être une révolution anthropologique dans notre manière de mettre en culture notre existence. Faut-il alors que la terre entière soit prise d’un bonheur extravagant dans la conviction de disposer d’un outil miracle, obéissant au doigt et à l’œil – avec lequel il n’y aurait plus de problème sans solution ? Plus de questions sans réponses ? Plus d’oublis sans ressouvenirs ? Et puis, avec cette tête supplétive, n’avons-nous pas déposé notre boîte à soucis ? Celle qui servait à faire nos petits calculs, à garder en mémoire l’accessoire, à mettre en ordre l’ordinaire en bouffant sur nos heures et nos cheveux. Le progrès des performances de l’intelligence artificielle promet de surcroît de nous permettre d’occuper enfin nos têtes à des pensées dignes d’être pensées.
Déjà, il y a quatre siècles, dans le sillage de l’invention de l’imprimerie, Montaigne proclamait qu’il valait mieux «une tête bien faite qu’une tête bien pleine». Sa bibliothèque, ce «Smartplace» dans lequel il gambadait, le dispensait donc de l’obligation d’avoir tout en mémoire pour, disait-il, ne se consacrer qu’à «penser ailleurs». Encore que l’homme qui passe son temps à citer dans les Essais toute la littérature antique avait sans doute beaucoup en tête ! La culture de l’humaniste, aspirant à l’autonomie de la raison, tenait ainsi à bonne distance la mémoire, puissant cheval de trait d’un monde écrasant d’Autorités, qu’il s’agissait de contester. Avec le Smartphone, nous avons fini d’extérioriser la fonction mémoire mais nous l’avons aussi miniaturisée au point de voir le petit galet luminescent dans nos poches aspirer toute la mémoire du monde. Avons-nous du mal à rappeler ce nom propre qui nous échappe, avons-nous un doute sur une date, une question sur un évènement et nous voilà frottant du doigt notre lampe d’Aladin pour faire surgir le bon génie des listes qui déroule sans compter sa cascade de sites, de wiki, d’articles, de vidéos, de musiques, d’« amis » même. Notre tête n’a plus à se remplir. Nous disposons d’une tête bien plus grande que la nôtre, une immense tête universelle, qui constitue une nouvelle réalité culturelle – limitée ni par le lieu ni par le corps. Qu’importe d’habiter ici ou là, ou d’être physiquement présent, puisque, par mon Smartphone, j’ai le monde en poche et que je peux donner de la voix devant la terre entière. Cet activisme Gulliverien qui combine la réduction du monde en main et la projection du moi dans le monde, dessine peut-être l’idée de la culture de demain, utilitaire et narcissique…
Pourquoi alors ne pas considérer que l’homme connecté soit l’homme cultivé contemporain. Le rêve de démocratisation culturelle qui hante nos politiques depuis l’après-guerre se serait-il donc réalisé ? Avec une économie de moyens fantastique : car à quoi bon cultiver son (petit) jardin dans la durée, soumis aux saisons successives de l’existence quand il est possible de moissonner sans attendre les champs infinis du data universel. Nous entrons dans l’ère post-culturelle qui permet à tout un chacun de devenir monsieur réponse à tout. Comme ce fut le cas pour cet original, l’américain A.J Jacobs qui, dans les années d’avant internet (2004), avait ainsi passé dix-huit mois d’affilée, bouclé dans sa chambre, cloué sur son siège, à lire dans l’ordre alphabétique, les quelques trente volumes de l’Enclycopaedia Britannica ! Cet idéal de l’homme cultivé s’est donc imposé, dans son costume de l’homme informé, enfant de la culture du journal, apparue au XIXe siècle – et que Nietzsche abhorrait parce qu’elle ruinait la culture des Humanités – et de celle du «trivial pursuit», inventé au Québec dans les années 80, à l’origine de la culture du quizz.
Mais la culture, générale ou pas, est bien autre chose qu’un répertoire, immédiat, de bonnes réponses. Le croire serait confondre «information», «savoir» et «culture». L’information renseigne. Le savoir explique. La culture transforme. Par le pouvoir de la langue, des savoirs et des œuvres, nous habitons le monde. Nous sommes comme ces cellules qui, pour grandir, ont besoin de transformer, d’échanger en permanence de l’information avec l’extérieur. Si nous n’échangeons plus avec l’extérieur, nous ne changeons pas, et nous nous figeons sur notre stock (notre noyau), à la manière du personnage de Brichot, professeur à la Sorbonne, dans La recherche du temps perdu, mais éternellement prisonnier de sa passion pour les étymologies. Si nous échangeons mais sans transformer, nous nous diluons dans le flux de données, à l’image des deux personnages de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert, promis à la bêtise parce qu’incapables de rien faire des encyclopédies qu’ils dévorent. Mais est-ce l’homme qui échange et change lorsqu’il soliloque avec son Smartphone ? Ce n’est en effet pas lui qui est au centre du traffic. Les mises à jour, qui rafraichissent les données de son petit objet, ont remplacé les mises en question qui font mûrir les hommes. C’est la machine qui va s’améliorant. Et puis – déjà sans tête, l’homme connecté n’engage pas son corps.
Mais il y a plus. La culture – et pour ne pas la nommer, la culture générale – consiste non à se reposer sur un héritage, mais à le questionner et le mettre en mouvement pour le transformer en attitude – c’est-à-dire, quelque chose entre comportement social, position politique et conduite morale. Ainsi l’honnête homme du XVIIe se réalisait dans un idéal social de conversation où, avec l’apparence d’un dilettante, il métabolisait les savoirs en exercice de l’esprit. L’homme des Lumières, encyclopédiste, enfilait son costume de sceptique pour passer tout au filtre de la raison et défaire ainsi croyance et superstition. Le hussard noir des écoles de Jules Ferry, contretype du curé, luttait pour acclimater les jeunes intelligences à l’idée de Nation et les convertir à la science… Chaque moment culturel met ainsi en jeu une certaine idée de la culture. Quelle idée défend donc l’homme acéphale qui s’en remet à son Smartphone ? Celle d’une culture G(oogle) – faite de listes déroulantes, mirages des plébiscites instables poussés par les algorithmes – contre la culture G – corpus de textes et de savoirs, sédimentés dans un individu ? Qu’est-ce qui unifie donc ces milliers d’informations qu’il consulte et moissonne ? Peut-être représente-t-il le point extrême où la culture n’est plus un tout, mais un tas, une liste sans fin de fragments flottant sur l’immensité numérique, qui ne peuvent plus faire l’objet, comme le disait Hannah Arendt, d’une transmission – transformation et transport – mais seulement d’une «citabilité» – élargie pour le web aux images et aux sons… Pour autant, ne cultivons pas la nostalgie. Mais rappelons nous simplement que nous avons une tête, que nous pouvons la rebrancher sur notre corps, et nous débrancher de l’autre. Que la vie et l’histoire se font avec les corps, que le courage n’est pas une adresse IP, que face au risque (avéré chez Facebook) de voir notre substance aspirée, il est toujours possible, la tête sur les épaules, d’aller faire un tour, sans rien en main ni sur les oreilles, et de sentir de nouveau que rien de bon ne se pense qu’en marchant le nez en l’air.