Arnaud Viviant a décidé d’assumer. Dès qu’on assume, on est certain d’avancer. De tenir quelque chose. De quitter le cirque. D’entrer dans une autre époque de soi-même, et même dans un autre soi-même qui semble un monde neuf, inouï, vierge de toute exploration. Je n’ai pas dit : « abdiquer », je n’ai pas dit « renoncer ». Mais « assumer ». Assumer quoi ? D’être un critique, de n’être pas un rockeur, de n’avoir pas suffisamment voyagé, d’être la proie frénétique de pulsions sexuelles soignées par la fréquentation de sites spécialisés sur le Net. Arnaud Viviant a définitivement décidé d’être lui, pour le meilleur et pour le pire : et c’est en nous décrivant, et c’est en écrivant l’homme qu’il est, qu’il vient, en direct, de s’arracher à sa caricature. Plutôt que de concocter une œuvre romanesque qui viendrait, sinon contredire, mais contrecarrer, mais excuser, mais rédimer son travail critique, le coup de génie de Viviant (auquel aucun de ses collègues n’avait vraiment songé jusque-là) est d’intégrer cette condition, qui cesse aussitôt d’être une tare, dans la matière du livre : après la critique d’un roman, voici le roman d’un critique. Et il dit tout : les ébats solitaires avec doigt dans le cul en lisant Racine, le rêve déçu de n’avoir pas été un guitariste punk, son endémique paumitude, l’aléatoire mécanique de ses éreintements radiophoniques sur France Inter.
Viviant, je dois le confesser, m’a à la fois surpris et ému. Ce n’était pas gagné, même si j’ai toujours pensé que son heure finirait par venir. Ce n’était pas gagné, parce que les hasards de la vie (qui sont moins intelligents que nous) avaient décidé de nous opposer. Normal : il est de Tours, moi d’Orléans. Le vieil imbécile antagonisme entre les deux cités ligériennes. L’avancée dans les années corrige heureusement parfois les malentendus ; il rectifie les erreurs.
Sans égotisme, mais avec le zeste d’exhibitionnisme qui convient, Viviant se vautre ici devant son lecteur, non peigné, non lavé, mal léché. Il s’oublie face à nous, mais pour mieux se souvenir. C’est violent ; c’est fatal. On trouvera, en vrac (car La Vie critique est une caverne d’Ali Baba) des expériences SM avec une célèbre vieille veuve, des descriptions d’orgasmes douteux, des épisodes de nausées sociales : cela fait penser à une version trash de Philosophie de la vie quotidienne du marxiste Henri Lefebvre, qu’il s’agirait bien de relire. Arnaud aura passé sa vie dans les livres, enfant du Masque et la Plume comme d’autres le sont du rock. Petit, dans sa chambrette provinciale des bords de la Loire, il se rêvait à la tribune, démontant les grands auteurs, arrachant les inconnus à cet anonymat dont lui-même a décidé qu’il ne souffrirait plus.
Le lot du critique est de connaître une célébrité intermédiaire, une gloire en pointillés, mais surtout, de se refuser toute forme de destin au prétexte que ce serait tomber dans cet atroce abîme que dénonçait Debord. Le situationnisme fut, au vrai, le seul lycée qu’Arnaud fréquenta ; nous sommes loin des fanfares et des monuments. Mais le burlesque est là, présent à chaque page, qui nous rappelle que tout debordien qui se respecte goûte, en même temps que les alcools forts et la bière tiède, l’humour et la potacherie. C’est là le grand contresens des ennemis des « situs », que de reprocher à ceux-ci leur soi-disant esprit de sérieux. Un esprit critique, c’est d’abord un esprit qui se critique lui-même, avant que de se saborder.
La Vie critique est un roman à part, complexe et ciselé, improvisé mais tenu, une sorte de ballon lâché dans les airs, et qu’on regarde tourbillonner dans le ciel de la rentrée littéraire. Il est à part, il est parallèle, il est strapontin. Mais c’est là qu’il s’agit de s’asseoir : c’est le meilleur poste d’observation de tous les carnavals.
Il y a, parmi ces pages, de vrais grands moments de littérature, notamment une cavalcade hallucinée à scooter du 2ème arrondissement à la Porte de Versailles (Arnaud se rend, un peu bourré, au Salon du livre), qui force l’admiration et sait émouvoir. Une manière de faire coïncider les accélérations et les ralentis – passant devant les Galeries Lafayette à toute berzingue, Arnaud s’offre ce magnifique arrêt mental sur image : c’est là que François Bon, ancien ouvrier, décida en 1978 d’acheter sa première machine à écrire. Les rencontres avec un chanteur marginal sont également magnifiques, ainsi que les réflexions sur ce monde déjà mort, qui vit avec un cœur artificiel : le monde littéraire. Viviant y a atterri tandis qu’il agonisait ; telle est sa malédiction. Il aura espéré, souffert, aimé, haï une réalité qui n’existait plus vraiment. Il aura incarné, à perdre haleine, un univers qui n’était plus qu’une fumée. C’est cette illusion qui frappe et touche – cette façon de continuer quand même ce qui a cessé d’être ; cette manière de s’offrir comme futur la combinaison de tous les passés.
Viviant ne s’est jamais remis des sensations que lui procurait à l’adolescence, dans les années 70 et 80, la découverte de la dernière galette des Clash ou la parution du nouvel opus de Sollers, de Robbe-Grillet, de Baudrillard. Il habite toujours le pays de ses palpitations. Son obsession est de les ranimer, de les réactiver sans cesse ; l’âge adulte, le vrai, attendra. On verra bien après la mort. En attendant, il faut bien vivre – le temps qui passe n’est pas critique ; il aime tout et déteste tout pareillement. Il est aveugle et sourd. Le temps qui passe est impassible.


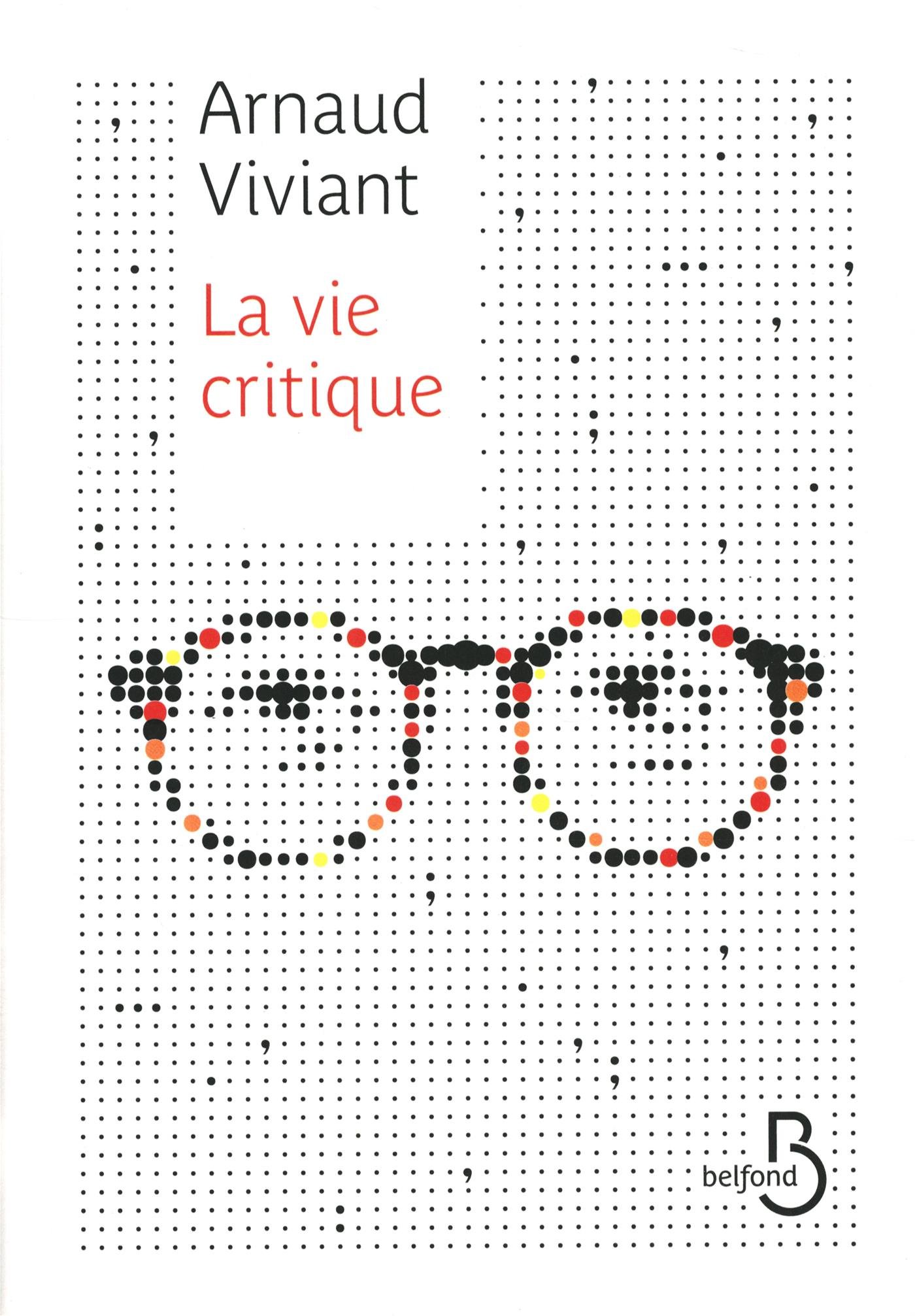

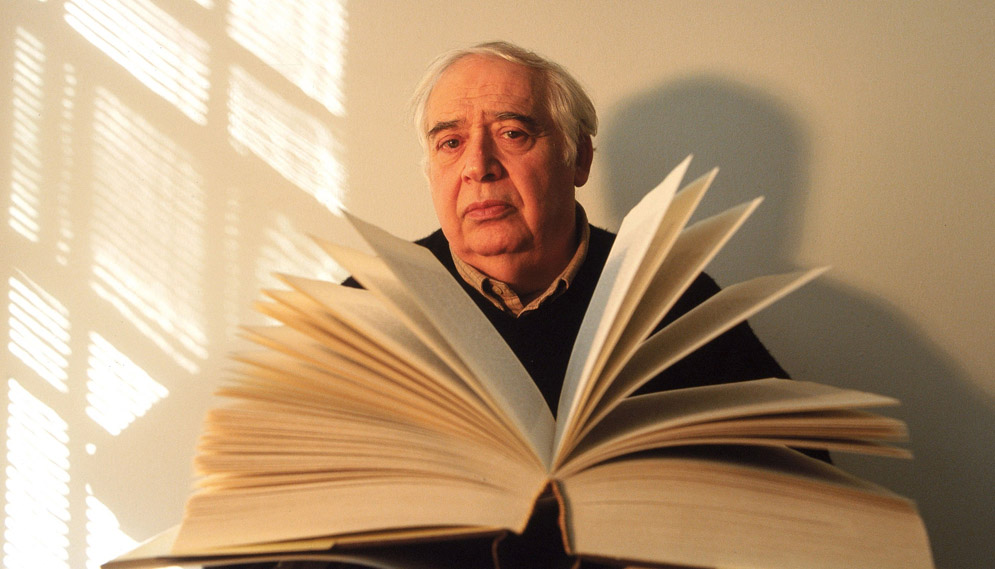




comme toujours, fluide et intelligemment ciselé. Quel sculpteur !
Comme ça doit être lourd à porter une telle justesse (acute/acurate) dans le choix des mots ! Très très lourd aussi tous ces adjectifs complimenteux sur vous, votre parcours, vos écrits, vos dires, vos positions (prises de). et bla bla et bla bla bla bla, accepter fièrement, yeux verts, sourire ravageur, l’usage intempestif des superlatifs qui résume notre époque, Toujours, tout le temps , et malgré tout ça, ne pas avoir le jabot qui gonfle (même si c’est l’image que vous voulez donner ou que les autres ont de vous).
Il n’y a qu’à regarder vos yeux et le menton qui tremble, et le front têtu et vos silences ô combien bavards et précieux sur tous ces plateaux télé tristes/pitoyables à mourir pour s’accorder (avec prétention) le droit de se dire avec jubilation que l’on a peut être, finalement, un bref instant (le temps qu’il faut à mon chat pour traverser le salon et piquer les croquettes du chien) décelé chez vous une pointe de quelque chose qui s’appelle « chais pas comment », qui n’a pas de nom, ou trop de mots, plusieurs syllabes, sans doute pas mal de synonymes : chais pas moi! suis pas écrivain ! grâce enfantine ? grâce tout court ?.
Belles journées/Bonnes soirées
Greta Garbo
PS : « Rimbaud le fils » c’est quand même très très beau. Vous êtes dur
Mr. Moix, Désolée d’utiliser cet espace pour vous faire arriver une observation. Je suis espagnole et j’ai accés a vos livres à travers Amazon sur Kindle. J’aimerai bien que vous regardiez comment son vos livres sur Kindle pour que vous puissiez vous faire une idée du désastre de maquetation qui ne rend pas plus facile la lecture de vos écrits. Concrétement, Mort et vie d’ Edith Stein. Il y a des « : » partout, et je n’arrive pas à comprendre… Pour ce qui en reste, mes félicitations.
Bravo werner vous vous défaite de l’essentielle pour aller à l’essence, la paix des ménages!
Quand un écrivain écrit sur un critique : renversement de rôles réussi qui donne vraiment envie de lire le livre en question.
La couverture du livre est réussi… Mais on dirait un livre sur AUdrey Pulvar.
Quoi qu’il en soit, ce qu’en dit Moix donne vraiment envie de le lire….
« les ébats solitaires avec doigt dans le cul en lisant Racine », c’est vraiment sérieux?!?!
Il lit vraiment Racine en ayant un doigt dans le cul?
Si c’est vrai, ça change un peu l’image que j’avais d’Arnaud Viviant.
Superbe critique du critique critique…
Si j’étais critique, j’aurais fait la critique de la critique du critique critique…
Mais comme je ne le suis pas, je me contente de vous féliciter…