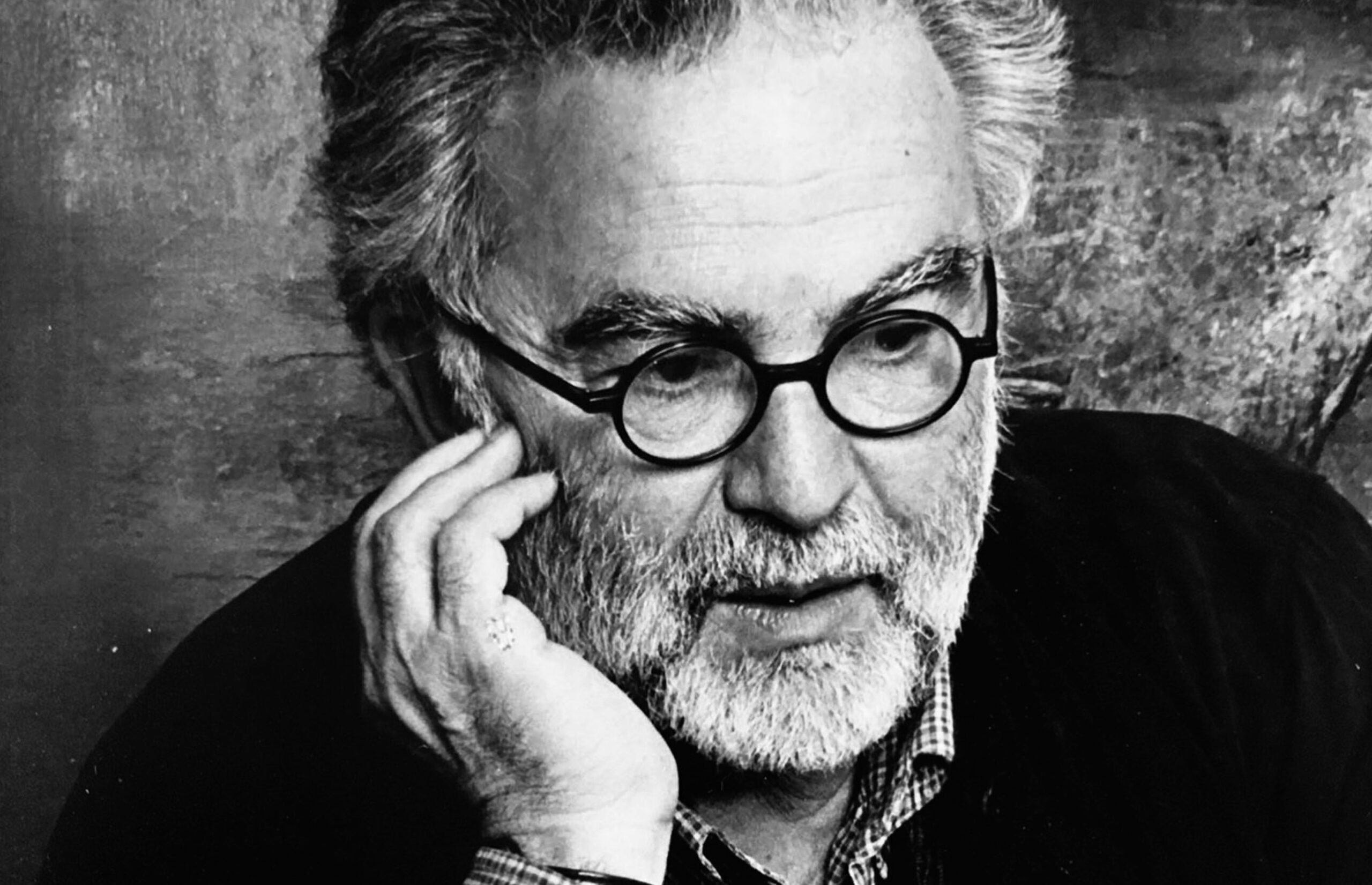De l’Iran je n’ai pas vu les lieux, mais j’ai rencontré les gens. De Téhéran j’ai vu le théâtre aussi bien celui de la scène que celui du monde. Le premier surtout dans les salles du théâtre de la Ville, l’autre dans la maison du consul. Là je me suis souvenu du célèbre quatrain d’Omar Khayyam, le poète persan qui avait trouvé dans la sagesse et dans l’ivresse un égal bonheur :
« Nous amusons le ciel, pauvres marionnettes !
Sans nulle métaphore, oh, les choses sont nettes !
Un à un nous rentrons au coffre du néant,
après avoir joué, sur terre, nos saynettes. »
*
Une nuit, tard, dans sa voiture, le consul cherchait avec entêtement un air des Noces de Figaro… Il nous exaspérait par son obstination. Sur les virages des routes qui nous menaient de la ville haute à la ville basse, la voix de Kiri Te Kanawa a fini par retentir : voique sapete… « Il faut entendre cela, pour comprendre l’Iran… » Il y eut un moment de silence. Nous écoutions Mozart dans la nuit persane tandis que la Peugeot soumise à la conduite fluide du « colonel », le maître de la maison du consul, nous entraînait vers le bas. Mozart devenait mystique et les Noces semblaient sceller une autre alliance que celle du mariage. La noce du consul avec l’Iran.
Pour le dernier whisky de la nuit je posai la question car, pour une fois, les sous-entendus inexplicites me semblaient trop commodes pour être acceptés.
« Pourquoi comprendre l’Iran à partir de cet air ?
– Voi que sapete… vous qui saviez ! murmura-t-il avec un geste évasif. »
La réponse du consul resta énigmatique. Et non pas au nom d’une quelconque propension pour l’indéchiffrable : lui-même ne pouvait pas dire plus. Mais un jour, j’ai fait le rapprochement qui me manquait : « À Téhéran, je n’aime que les Iraniens occidentalisés qui sont rentrés » avoue-t-il. Les Iraniens qui reviennent non pas pour expier, mais pour admettre qu’ils ont su… Et qui acceptent qu’aujourd’hui la vie se joue pour eux entre le savoir de jadis et l’isolement actuel. Voi que sapete… Pour eux résonne la voix de Kiri Te Kanawa : ni la fuite, ni la punition pour ceux qui ont su. L’attente ! L’attente infligée aux « négligents » de Dante, ceux qui restent devant la porte du Purgatoire. À Téhéran les « négligents » attendent sur les hautes collines de la vieille capitale perse.
*
Dans une salle minuscule du théâtre de la Ville quelques éléments disparates sur le plateau : une pierre, un peu de sable… c’est le premier spectacle iranien que je vois. Le consul à ma droite et à ma gauche « le colonel », ancien élève de Saint-Cyr et officier dans l’armée du chah, aujourd’hui plus que chauffeur, éminence grise du consul. Ils me traduisent à tour de rôle l’histoire essentielle de l’homme parti à la recherche du soleil. Les épreuves sont dures, la défaite imminente, mais à la fin, avant la disparition, le héros admet avoir trouvé sa vérité non pas dans le soleil inatteignable, mais dans l’expédition engagée vers l’astre brûlant. Tout cela évoque Le Voyage des oiseaux de Farid Uddin Attar dont Brook avait raconté les épisodes dans son célèbre spectacle.
Les mots et les gestes ont ici la simplicité du récit. Il n’y a de faux que le lieu… La même histoire donnée en plein air aurait eu la fraîcheur d’une prière. La prière de l’homme qui s’accorde à dire son besoin d’absolu, vécu non pas comme défi intellectuel, mais comme aventure formatrice. Sans intimidation, ni prétention aucune, ce spectacle modeste venu du sud apporte dans le festival la vérité absente ailleurs où, soit l’on aspire trop vers le Grand explicite soit l’on affiche une modernité d’emprunt. Dans cette goutte de rosée j’ai pu reconnaître l’appel mystique dont tout Iranien, par-delà les manipulations du pouvoir et les excès d’une révolution, semble habité.
*
Un metteur en scène iranien qui a vécu en France et dirigé un grand théâtre à Téhéran me montre des diapositives de ses anciens spectacles, surtout celles de Crime et Châtiment : c’est tout ce qui lui reste. Mais il continue à organiser chaque jeudi un cénacle pour des étudiants auxquels il fait découvrir l’existence d’un autre théâtre, d’ailleurs. Pour lui un vieux numéro de Théâtre public ou de Théâtre en Europe a la valeur d’un appel d’air frais… De loin, la scène française existe encore. Un autre metteur en scène, personnage du pouvoir actuel, évoque ses aventures à Paris où, proche de Bani Sadr, il éprouvait le sentiment que le pouvoir du chah était moins stable qu’il en avait l’air. Lui aussi se souvient : Jacques Lassalle, Armand Gatti… Un seul vœu, dit-il, resta inaccompli, celui de travailler avec Vitez ; je lui promets en guise de consolation tardive, le Théâtre des idées. Ainsi à Ispahan, j’ai parlé de Vitez et à Téhéran de Dostoïevski. Chacun de ces deux metteurs en scène, à tour de rôle opposants et officiels, me font penser à la roue de la fortune qui tourne sans cesse.
*
La salle où l’on projette pour la première fois depuis tant d’années des vidéos avec des spectacles français ne désemplit pas. C’est pareil pour la conférence que je donne où les questions se succèdent sans relâche ; je découvre le plaisir de répondre à une attente, de pallier un manque, bref d’éprouver le sentiment d’une utilité. Utilité nullement simulée. Le consul a su entrouvrir cette fenêtre avec l’accord des modérés qui règnent sur la culture. Le ministre que je rencontre n’a rien de ces apparatchiks auxquels le pouvoir soviétique nous avait habitués. Ne va-t-il pas jusqu’à émettre un doute : « si nous échouons… » dit-il. Qui l’eût entendu dans la bouche de la tristement célèbre Fourtseva, vingt ans durant maîtresse moscovite de la culture ? Mais aujourd’hui les bruits de l’écroulement soviétique sont parvenus jusqu’aux oreilles du ministre islamique. On n’est plus sûr de rien…
*
À une table ronde, consacrée au théâtre français, trois anciens étudiants de l’Institut de Théâtre où j’enseigne m’entourent. Ils incarnent trois positions politiques distinctes… Alors je réalise la portée de l’université pour la diffusion de la culture française, portée trop brocardée depuis un certain temps. À Téhéran nous parlions ensemble de Censier, de la bibliothèque, des cours… et une fois encore, je me suis laissé conquérir par le même sentiment d’une utilité. Cela réconforte. Parfois, dans la vie, on vous rend ce que vous avez donné.
*
Face à un pouvoir intransigeant, tout se pense en termes de stratégies et de distances qui réclament l’appréciation correcte du rapport que l’on entretient avec les forces en présence. Tout est donc relatif et s’explique en fonction du centre de décision. Mais parfois un regard étranger, comme le mien, apporte un détachement dont les indigènes ont perdu l’habitude. Je vois deux spectacles venus des anciennes républiques de l’URSS, spectacles qui font entendre les vers des grands mystiques et font revivre leur nom. J’écoute ébloui la splendeur de ces mots que l’interprète me murmure à l’oreille, mots aux couleurs profondes et aux échos prolongés, mots en quête d’être, de l’Être. Personne parmi les acteurs ne se distingue et le groupe l’emporte sur l’individu comme si, implicitement, on affirmait ainsi la nécessité de le surpasser. « Qu’est-ce qu’ils sont mystiques tous ces gens de l’Union soviétique » déplore à côté de moi quelqu’un las des prédications et des consignes de formation religieuse entendues à Téhéran à longueur de journée. Ce qu’il oublie, mon voisin, c’est l’origine de ces spectacles, dissidents chez eux en raison même de leur mysticisme. Ce qui en Tadjikistan signifiait, il n’y a pas longtemps, déviance, à Téhéran échoue en conformisme et le public n’y voit qu’un acte d’obédience. Et ainsi les contestataires des républiques de l’URSS, poursuivis jusqu’à hier chez eux, apparaissent en Iran comme des zélateurs suspects. De l’impact du contexte pour la réception du théâtre.
*
Déjà encadrée sur le mur, l’image canonique d’un spectacle de Ta’zieh rappelle son ampleur de jadis. Cet équivalent islamique du mystère occidental se donnait, comme sur ma reproduction, dans une immense salle de Téhéran. Des foules s’agglutinaient, acteurs et spectateurs confondus… et à force de regarder cette peinture comme par superposition, vient s’ajouter le croquis du célèbre Œdipe Roi mis en scène au début du siècle par Max Reinhardt au cirque Schumann. Lorsqu’en Europe le théâtre cherchait à redécouvrir l’esprit des masses, celui qui allait marquer notre époque, en Iran cet esprit restait encore vivant. Ce qui chez nous se rattachait à la réminiscence, là-bas tenait encore de la présence.
Mais les Pahlavi érigèrent le Ta’zieh en ennemi privilégié car réfractaire à leur effort d’occidentalisation à pas de charge. D’abord, la salle dont je possède encore la trace fut démolie, ensuite, des interdictions de toutes sortes tombèrent sur cet extraordinaire vestige, unique au monde, du théâtre sacré. Indissociable des pratiques chiites, il résista pourtant car ancré au plus profond de l’exercice religieux que même le chah n’osa censurer. Mais le Ta’zieh que nous avons pu voir, dans une version réduite l’année dernière à Avignon, ne procure pas un simple plaisir esthétique, il engendre et entretient une véritable participation mystique. Dans cette effervescence, le pouvoir laïc s’oublie et seul compte l’anéantissement de soi dans l’extase d’une identification généralisée. Le Taz’ieh, les rois de l’Iran l’ont justement compris, faisait taire un instant leur illimitée autorité.
Aujourd’hui les choses ont changé. J’apprends qu’un jour, un brillant et dévoué responsable de la révolution islamique faisait presque pour lui-même ce constat on ne peut plus significatif : « Quand je pense, disait-il, que tout est arrivé grâce au Ta’zieh ». Il a entretenu le climat favorable que, de Neauphle-le-Château, l’imam a su éveiller, exploiter, canaliser. Le pouvoir islamique reconnaît ses dettes envers le Ta’zieh. Hier en disgrâce, aujourd’hui officiel, hier poursuivi, aujourd’hui exalté. Comment un Occidental peut-il trouver la relation juste à cet art qui le fascine par tout ce qu’il sauvegarde, et le révulse par l’usage que l’on en fait ? Pour l’étranger que je suis, l’esthétique l’emporte sur l’éthique et je me reconnais séduit par le Taz’ieh. Cet art où il y a un maître de jeu qui contrôle les objets et les interprètes, pareil à ce maître des apparitions qu’était Kantor.
*
Un film vient d’être interdit : il porte mon nom, Banu, qui je l’apprends, veut dire en persan grand-dame, princesse. Le metteur en scène se trouve parmi nous dans les salons de cette belle ambassade de France, qui, il y a presque cent ans, se trouvait sur les marches de la ville ou elle est aujourd’hui engloutie. Je l’approche et je me renseigne sur le film. Dans l’interdiction qui vient de le frapper, il semble voir un repli stratégique des modérés réparable dans l’année. Scepticisme de censuré, ou ruse d’artiste oriental réfractaire aux conflits ? C’est l’histoire d’une femme, raconte-t-il, qui revient dans sa propriété en ruine… Je comprends vite qu’il s’agit d’une sorte d’adaptation de La Cerisaie. Le sait-il ? Ce n’est pas sûr. Au terme de son aventure, la dame, effondrée sur la valise, reste seule sur un quai de gare où le train vient de passer. Une Ranevskaïa surprise par la révolution ? Elle a raté son départ pour Paris. Que lui reste-t-il encore à faire ? Attendre… Comme les « négligents » de la ville haute.
Si Kurosawa, avec Le trône de sang, a réalisé la meilleure adaptation de Macbeth, j’ai le sentiment que ce film sur le destin d’une « Cerisaie persane » serait le meilleur équivalent de l’œuvre testamentaire de Tchekhov. « Le premier qui apprend sa sortie en Occident prévient l’autre ! », convient-on avec le consul.
*
Électre, de Vitez à Deborah Warner, s’installe au cœur du palais et s’érige en citadelle d’opposition sauvage, en meurtrissant son corps et se parant de haillons afin d’agresser sans répit Clytemnestre, toujours en robe rouge, femme qui s’aime et affirme son exubérance érotique. À Téhéran, où le noir règne et où les couleurs sont bannies, l’Électre que je rencontre dans la vie se met du rouge à lèvres, s’habille sans précaution aucune et, ainsi, incarne la résistance. Cette femme de théâtre procède à un retournement tout aussi radical que l’héroïne grecque car, elle l’a compris, ici la violence du refus se mesure à l’aune de la beauté d’une soie qui flotte, d’un bijou qui scintille, d’un foulard bigarré. Seul compromis, je l’aperçois dans la nuit lorsque sa main cherche un Kleenex dans la boîte à gants de la voiture pour inscrire sur le papier blanc comme une cicatrice la marque de ses lèvres rouges.
*
De l’Occident, la chahbanou aimait les arts et le chah, les blondes. Son goût fit fureur et la contagion emporta les hommes du pouvoir dans un désir mimétique, caricatural de l’Autre. « Chercher la blonde » prenait le sens d’un déni de beauté locale, beauté qui est brune. Ce déplacement artificiel eut vite des conséquences sur l’esthétique féminine surtout dans les hautes sphères où la mode des cheveux teints gagna. Dès lors, la blonde fit la loi…
Mais avec le départ du chah ces appétits ne disparurent pas pour autant ; le prestige des blondes persista au point qu’un jour, le chef de la police tomba brutalement sous le choc d’une blonde splendide qui opérait sur la scène. La visite précipitée dans les loges ne lui sembla que normale, de même que l’ordre donné à l’interprète de l’autre visite, dans ses appartements. Mais il s’est avéré qu’il y avait eu méprise car, en transgressant l’interdit du pouvoir islamique d’avoir recours à des perruques, un acteur célèbre s’était livré au jeu du travesti, lui aussi exclu. Sans le moindre doute, sûr de l’ordre régnant, le chef de la police se laissa donc séduire par un homme, de même que Sarrasine par un castrat dans la nouvelle de Balzac. Si chez Balzac, le cardinal Cicognara fait payer des tueurs à gages pour supprimer l’amant trop entreprenant ici le comédien se chargea lui-même de sa défense en plaçant un coup de poing dans la figure du policier amoureux. Depuis, le comédien interdit de séjour vit à Stockholm loin des passions chaudes d’une Perse faussement rigoriste.
*
Au théâtre de la Ville, dans le brouhaha des foyers, je remarque une petite assemblée réunie devant une toile amplement déployée sur le mur. Le conteur, à l’aide d’un bâton, pareil à un professeur de géographie, indique l’endroit où se place la personne dont il raconte l’histoire : cela fait l’économie de la description au profit de la narration. Le ton est épique, intensément soutenu, avec des moments rapides de dramatisation, comme des accents qui ponctuent une histoire dont l’intérêt ne fait pas de doute. Le public écoute avec cette attention flottante propre aux spectateurs de l’Orient où l’illusion et la distance ne se départagent pas tout à fait comme si chacune corrigeait l’autre. C’est le climat du spectacle naïf fondé toujours sur une confiance simulée.
Une fois le récit achevé, j’approche de la toile-cadre ; elle semble frappée par cette horreur du vide propre aux artistes du Moyen-Âge : pas un centimètre de libre, le règne du plein s’exerce sans faille. Elle trouble le regard par l’entassement des architectures, des paysages et des guerriers réfractaires à toute séparation de genres, car, selon la logique connue du naïf, la seule hiérarchie admise, lisible grâce aux dimensions adoptées, découle du rôle réservé à chaque élément dans la narration. La toile réunit un monde, un monde plein, un monde prêt à servir au conteur.
*
Les anciens abattoirs de Téhéran viennent d’être reconvertis en vaste centre culturel, une sorte de Cartoucherie de Vincennes plus diversifiée. Un grand cinéma se dresse dans une effrayante course contre la montre car on ne sait jamais ce que l’avenir peut apporter dans un pays où la culture reste assimilée à un divertissement proche de la corruption, tandis qu’un splendide centre pour enfants est soutenu par le même pouvoir qui entend façonner dès le plus jeune âge l’exemplaire humain qui s’identifiera à son programme. De Paris à Moscou et Téhéran, de la révolution de 1789 à celle de 1917 et enfin à celle de 1982, deux siècles durant, le projet pédagogique ne s’est jamais absenté : chaque révolution a rêvé d’accoucher de son modèle humain. On voit aussi du théâtre où l’on suit quelques séquences d’une vieille pièce persane de Furzi où l’on décèle le souvenir de Roméo et Juliette…. Saunas et espaces sportifs viennent compléter cet ensemble où toute une politique culturelle se cristallise. Au cœur des abattoirs on découvre le musée de Jacques Pimpaneau, le voyageur insaisissable, le rêveur imperturbable. À Paris je fais partie des amis de son musée, Kwok-On, musée secret de la rue des Franc-Bourgeois, mais qu’il soit à l’origine d’un musée pareil à Téhéran ne peut que surprendre. On y retrouve ses amours pour l’Orient qui occupait une place si importante sur la mappemonde imaginaire dressée par les surréalistes dans les années vingt. Dans une vitrine je reconnais les personnages du spectacle de marionnettes présenté l’année dernière à Avignon. Surtout Mobârak, cet équivalent d’Arlequin. Si le protagoniste de la commedia dell’ arte avait le visage noir parce qu’il descendait de la montagne, là où l’on avait amorcé l’exploitation du charbon, Mobârak, lui, véritablement noir, évoque l’arrivée des Portugais en Iran accompagnés par des esclaves africains. Pourquoi le héros le plus rusé dans une farce populaire doit-il toujours porter les signes de la différence ?
*
Sur ma demande insistante, nous voyons le lendemain une représentation de marionnettes, spectacle magique où le père, très vieux, joue derrière la toile tous les rôles, tandis que le fils, devant, incarne le conteur, tantôt exerçant sa maîtrise sur les êtres en bois, tantôt subissant leur revanche. Lui il les bat, et Mobârak peut à son tour pisser sur lui comme s’il y avait une constante redistribution des pouvoirs. Personne ne contrôle tout à fait les événements… Et si c’était justement cela la leçon subversive des marionnettes : le fait de nous rappeler qu’il n’y a jamais de maître définitif.
Après le spectacle nous rencontrons le fils, et ensuite le père qui nous révèle le sifflet placé entre les lèvres et la langue pour donner à Mobârak une voix artificielle, stridente, non naturelle qui fait de lui un personnage rattaché à la catégorie de l’étrange. Le conteur, de même que le marionnettiste, sait jouer toujours des ressources de l’artifice. Pour passer derrière la toile, pour devenir le protagoniste, le protagoniste absent comme Dieu, le fils conteur qui se trouve devant, doit attendre la mort du père octogénaire. Mais déjà depuis Avignon, le musicien qui les accompagnait avec un vieil instrument iranien a disparu et fut remplacé par un violoniste. Même en Iran la tradition décline.
*
Sur la scène des décors factices, des personnages falots et un seul acteur, le visage peint en noir, fait rire la salle. J’y reconnais le Mobârak vivant ; là, dans ce dernier théâtre qui survit sur la rue Lalehzar, équivalent persan de notre Boulevard du Crime également disparu.
Le petit comédien qui enivre de plaisir son public, public populaire pour lequel le théâtre reste une forme de divertissement vital, à tous les moments de la journée, est analphabète. Saadi Afshar nous parle un peu pour se retirer vite car il y a une autre représentation, qui recommence dix minutes plus tard. Le théâtre fonctionne ici selon le rythme des séances cinématographiques. Mais les comédiens sont vivants. Et ils se fatiguent. L’extraordinaire présence de cette salle qui s’esclaffe, interpelle, s’agite, atteste le pouvoir d’un théâtre de l’immédiateté, d’un théâtre fort, bien que, même à Téhéran, il soit menacé.
À Ispahan il y avait un comédien pareil à Saadi Afshar, comédien subversif interdit en raison des libertés qu’il osait prendre. Sa gloire avait atteint une telle renommée, que personne n’était dupe et savait que c’était lui la cause de toutes « les pannes » qui frappaient les camionneurs iraniens de passage. Les pneus crevaient, les moteurs calaient, l’essence manquait, tous les subterfuges étaient bons pour voir le comédien que l’on aimait.
*
Le théâtre est aussi un lieu du geste, surtout pas du « geste de bois », propre aux dictateurs et aux automates. C’est la raison qui explique pourquoi le regard d’un spectateur s’aiguise, et de la scène, ce regard-là se retourne vers la vie pour repérer le geste qui parle, le geste qui révèle. Cette lecture ne s’opère jamais mieux que dans les sociétés où règne un seul geste ritualisé. Le geste-loi. Mais, l’Orient nous l’a enseigné, la vraie subjectivité s’exprime à travers le maniement individuel des gestes hérités, imposés, des gestes séculaires. Sur la scène comme dans la ville. À Séoul, avant même de lui parler, j’ai eu l’intuition de la noblesse d’une femme lorsque, de loin, j’ai aperçu le dessin de son dos qui s’inclinait. À Téhéran, de même, l’ancien directeur des théâtres, Ali Montazeri Moghaddam lorsqu’il pose sa main sous le cœur, comme la loi islamique le demande, en souriant à peine, fait découvrir non pas une simple courtoisie, mais une identité qui appelle la confiance. De la force des aveux à travers le maniement des gestes anonymes.
*
Le bazar, le vrai lieu du pouvoir iranien, le bazar, où, comme dit Shakespeare, le sort des maîtres du monde se fait et se défait, à l’allure d’une ville fermée, secrète et oppressante. Sur les voûtes opaques des allées, les candélabres qui éclairent jour et nuit évoquent, pour le spectateur que je suis, la belle alliance du dehors et du dedans, de cet espace imaginaire que l’on découvrait à la fin des années soixante dans les célèbres mises en scène tchekhoviennes de Krejca. Dans le bazar, dans ce monde étranger, un souvenir familier resurgit.
*
Il y a une visite, une seule, que je voulais rendre. Et de cette visite je pressentais l’importance, car toujours, dans chaque ville une dame âgée se trouve à l’écart et en même temps existe comme référence précieuse pour quelques gens de théâtre. Lors d’un premier voyage à Moscou, Antoine Vitez m’a chargé de chercher une vieille amie, spécialiste de Dostoïevski. Rencontre avec un être qui avait su résister par la culture, chance offerte au jeune homme que j’étais d’approcher cette dame déclinante qui avait lié son destin au grand Fiodor dont désormais elle semblait descendre. La seconde fois, Antoine l’a vue seul – cette rencontre devait leur appartenir, entièrement – tandis que je faisais les cent pas dans la rue Arbat. Depuis, ni l’un ni l’autre ne sont plus. À Bucarest, une autre dame pareille survit dans une chambre et depuis quarante ans elle traduit, conseille, informe génération après génération. Là-bas, peut-être, se sont déroulés les plus vifs dialogues du théâtre roumain. À Téhéran, seul, dans un de ces rares moments où rien ne vous trouble, je suis arrivé dans l’appartement de Madame Tajadod. Elle ressemblait à la dame de Moscou et à celle de Bucarest : la même dignité austère. Une pureté obtenue par l’exercice d’une vie surveillée. Grâce à Arby Ovanessian, jeune metteur en scène iranien, Peter Brook a appris lorsqu’il préparait en Iran Orghast, en 1971, que quelqu’un connaissait une langue ignorée, langue secrète et sans héritier. Madame Tajadod avait retrouvé la langue rituelle avesta, à partir des dessins d’Avicenne, où l’on indique la position des lèvres, le circuit de l’air, la posture du buste. Avec ce repère seulement, elle engagea son expédition à la découverte de sons que nul être ne prononçait plus. À force de sculpter son corps, de localiser des résonateurs, la jeune femme avança pas à pas dans la conquête de la langue aux quatorze voyelles, langue rituelle et nullement langue quotidienne. Peter Brook l’invita à travailler avec lui et elle communiqua aux acteurs les secrets de l’avesta, mais au dernier moment, lors de la première d’Orghast, c’est à Madame Tajadod qu’il demanda de chanter du haut de la montagne. C’était sa victoire suprême sur l’ensablement des sons. Elle leur permettait de réverbérer encore une fois, des siècles après leur existence éteinte. Je la quitte avec le sentiment d’avoir rencontré un être qui a fait de sa vie une histoire borgésienne. Histoire d’une femme qui ressuscite une langue, langue qui avec elle disparaîtra. Une fois encore.
*
De l’Iran je n’ai pas vu les lieux mais j’ai rencontré les gens. Où ai-je entendu cette phrase ? Nulle part, mais, modifiée par le temps, elle a pour origine éloignée un roman d’Heinrich Böll, au terme duquel le héros sorti de la guerre ne regrettait pas les monuments écroulés, heureux d’être près des gens sauvés. À Téhéran, je les ai rencontrés dans la maison du consul.
Un soir, il me raconte l’histoire d’un grand metteur en scène à la vie disloquée en raison de son appartenance à une branche considérée comme hérétique par le chiisme officiel… « En Iran il n’y a que des branches, mais la sienne est pour les Mollahs la pire. » II venait de faire un film par lequel le consul s’avouait séduit, un film sur le voyage et la mort, sur le retour des spectres. Un de ces films qui vous fascine à force d’écouter son récit, mais aussi de rêver à partir de quelques images. Lorsque Beyzai arrive, il apporte la lumière des yeux et la sérénité du sourire : cet homme a-t-il souffert ? Comment a-t-il pu surmonter les épreuves ? L’ont-elles purifié ou aidé à mieux préserver ce qu’il possédait déjà ? Chacun lui raconte ses réactions au film et il se contente de répondre en disant qu’ici – propos subversifs à Téhéran, où le culte de la mort règne – la mort peut être surmontée et que les survivants parviennent à réapprendre l’art de vivre, libre du poids funeste. Mais dans le pays où le poids de la mort sert d’assise à la religion officielle, le propos de Beyzai n’a rien d’innocent. Par ailleurs un objet intrigue ses admirateurs : le miroir, que veut-il dire ce miroir qui traverse le film ? La réponse, bien qu’énigmatique, laisse deviner son horizon : « La mer n’est-elle pas le miroir du ciel ? » Cet homme est ouvert et secret. Paradoxe idéal. Noble et affectueux. Pendant le dîner son attention flotte et le regard se tourne parfois vers l’intérieur jusqu’au moment où, par un de ces hasards favorables aux plus subtils événements, la voix de Kathleen Ferrier remplit le salon. Il l’entend pour la première fois, il la découvre, je l’observe en train de subir son éblouissement, son visage s’éclaire, et tout en restant à table il nous quitte cette fois-ci pour de bon. L’artiste persan le plus accompli se laisse envahir par les appels d’Orphée…
Le lendemain, à la clôture du festival, sa très belle pièce recevait tous les prix. Il était absent. Je me le suis imaginé en train d’écouter la voix lointaine… qui reflétait quoi ?
*
Je ne supporte pas le cadeau ironique. À la limite, je peux l’accepter sans l’apprécier, mais jamais je ne prendrais la liberté de l’offrir à un ami. « Mais c’est une coutume de la société de consommation ou rien ne vous manque et où on ne peut plus rien offrir » me réplique une connaissance. Pensée vulgaire qui ne pense le cadeau qu’en terme d’utilité quotidienne ; le vrai cadeau a par contre une utilité symbolique, impossible à éliminer par nulle société, si avancée soit-elle.
Au Japon l’institutionnalisation de la pratique porte préjudice au cadeau. Car le plaisir échoue en impératif exigé par la conduite sociale. En revanche est préservée la coutume ancienne selon laquelle on peut offrir une phrase à quelqu’un : une phrase choisie pour lui et qui lui est destinée. C’est le cadeau que l’on porte avec soi. Les phrases offertes nous accompagnent partout.
En Iran j’ai vécu l’éblouissement du cadeau arraché, cadeau soudainement proposé. Un metteur en scène avec lequel j’ai passé une matinée à discuter de ses souvenirs parisiens – Mnouchkine, Chéreau – m’invite chez lui et dès que je rentre je remarque la présence d’un objet dont j’ignorais l’usage. Il le décroche du mur et me l’offre… « Cet objet vous accompagne et une dépossession si brusque peut vous blesser » essayai-je vainement de répondre. Peine perdue… Et aujourd’hui, je sais que j’aime le cadeau autant que le geste. Une autre fois, dans la maison du consul, les conversations se prolongèrent tard dans la nuit avec le grand maître de Zurkhaneh. Soigneusement je réponds à ses questions qui portent toutes sur Brook. Surtout à une : « Pourquoi aime-t-il tant l’Orient ? » Je décide de gagner ma chambre avant son départ en raison d’un long voyage prévu pour le lendemain. Lorsqu’on se sépare, le maître enlève la bague avec une améthyste qu’il portait et me l’offre spontanément. Le cadeau arraché sera à jamais plus fort que le cadeau choisi. Le cadeau arraché est un aveu non programmé.
« Vous leur avez donné aussi beaucoup, m’explique le consul en répondant à mes propos émerveillés.
– Peut-être, mais si je l’ai fait c’est uniquement pour le plaisir.
– C’est le plus important », conclut-il et alors je me suis rappelé le geste que j’ai fait moi aussi il y a vingt ans en arrachant l’icône la plus précieuse que je possédais pour l’offrir à une amie péruvienne. Dans la clôture de la Roumanie d’alors elle m’avait apporté ce que peut-être j’apportais dans la clôture de l’Iran. La chance d’un échange qui atteste votre existence synchrone avec le monde. Sans écart ni retard.
*
Les pièces, les grandes, gardent souvent de petits secrets essaimés à travers le texte et sans qu’ils entraînent par leur déchiffrement une véritable mutation de lecture, la satisfaction apportée par la réponse enfin trouvée n’est pas mince. L’ami qui m’accompagne à Ispahan me raconte que l’Iran reste le seul pays islamique où se trouve encore une importante colonie juive. « Nous avons eu de bons rapports. Grâce à eux, surtout au XIXe siècle, la musique persane a pu être préservée. Interdits dans les fêtes, les musiciens iraniens ont laissé la place aux musiciens juifs. » Cette historiette de voyage, une parmi d’autres, me renvoie spontanément à La Cerisaie où Ranevskaïa interroge la famille dès son arrivée à Paris sur le sort de l’orchestre juif qui ensuite va être invité à animer au troisième acte « la fête pendant la peste », la fête de la terrible attente. Cette précision aide à localiser la propriété vers le Sud, à cette frontière où, aux fameux orchestres tziganes du Nord, se sont substitués les orchestres juifs. Tchekhov a écrit à Yalta La Cerisaie et là-bas sans doute a-t-il entendu parler de cette survivance qui d’emblée préoccupe Lioubov. Par son inquiétude ne laisse-t-elle pas entendre que la précarité de l’orchestre juif n’était pas seulement d’ordre économique mais peut-être aussi ethnique. Ainsi l’on retrouve une fois encore, l’étonnant équilibre obtenu par Tchekhov entre la base historique et la construction symbolique de La Cerisaie. L’orchestre juif participe à la solidité de ses fondations.
*
Une amie du consul qui cherche depuis des années à regagner le droit de mettre en scène, prépare Oncle Vania. Quel sens peut avoir à Téhéran le monologue de Sonia, la désespérance de son cri final : « Nous allons travailler ! » Peut-être celui de l’indéfectible espoir, de l’inguérissable attente tandis que le consul, lui, se reconnait plutôt dans ceux qui, comme Sérébriakov, font leur valise quand les choses s’enveniment. C’est pourquoi il admire les opposants qui restent face au mal : quoi faire ? Attendre ou partir ?
*
Durant l’après-midi je voyais du théâtre dans des salles où le public, saisi d’en haut semblait expédier, à l’aide des turbans et des voiles noirs, une sorte de télégramme en vieil alphabet morse. Le télégramme chiite envoyé sous l’œil ténébreux de Khomeiny dont le portrait surplombe chaque cadre de scène ! L’imam a, à chaque fois, l’air de déplorer le spectacle, comme si ses sujets recommençaient à s’égarer. C’était l’expérience de la ville basse, expérience étouffante et excitante, expérience où la censure accroît le désir, expérience des yeux torrides qui viennent nier l’écran du tchador. C’était l’expérience de la ville basse à laquelle succédait un long voyage pour accéder à la ville haute, à la maison du consul. Un autre monde, un autre spectacle dont le scénario avait pour interprètes les acteurs de l’ancienne société renversée. Et ici chacun, je l’ai compris au bout de quelques jours, détenait son rôle : le photographe intouchable en raison de sa noblesse unanimement respectée et sa princesse géorgienne ; la femme qui a sauvé sa maison en effrayant les jeunes mollahs qui venaient l’occuper, un matin à l’aube, en se montrant toute nue ; les deux sœurs dont la beauté a troublé jadis le cœur du tout Téhéran ; l’artiste qui après avoir vécu à Paris a choisi l’exil intérieur… Ils se lançaient ensemble dans une véritable apocalypse joyeuse. Apocalypse où une passion les reliait, celle du jeu contre l’exclusion. Comme s’ils se retrouvaient tous sur une île de déportés à quelques kilomètres à peine du centre qu’ils détestaient. À l’écart, sur les hauteurs de la ville, ils jouaient à leur tour cette « fête pendant la peste » qu’organise Lioubov dans La Cerisaie. À force d’y participer, dans la maison du consul, brusquement, un souvenir émergea, celui du célèbre Quatuor d’Alexandrie. Alexandrie, pas très loin de Téhéran. Le Quatuor de Téhéran… effréné quatuor nocturne auquel succédait l’ordre islamique de la journée. La maison du consul et le théâtre de la Ville. Ce précipice vertigineux, seul un messager d’ailleurs, indistinctement acteur et spectateur, pouvait le franchir miraculeusement le temps d’un bref passage.