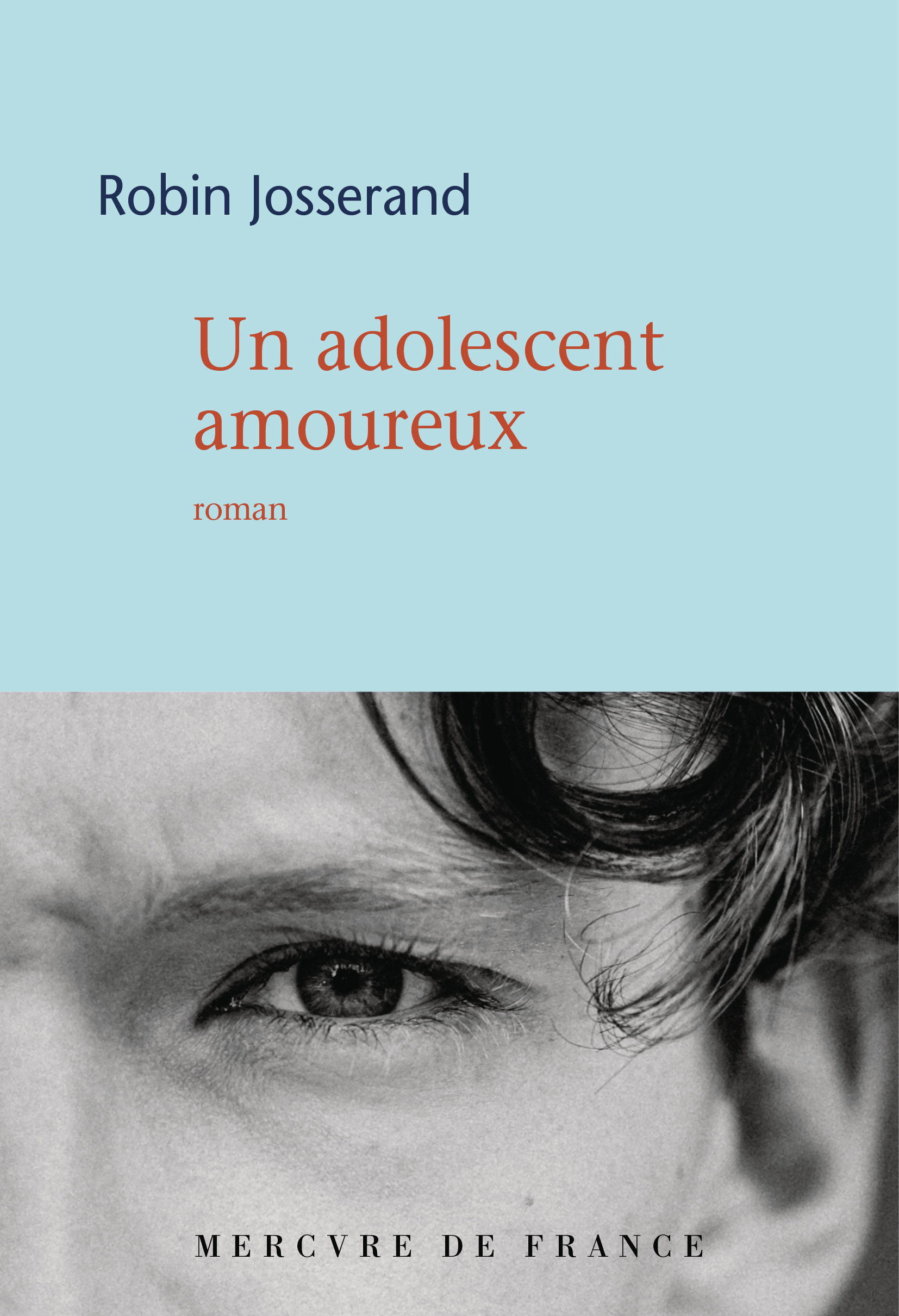Pour H. qui fut mon A. ?
« …et je me suis abîmé sous la tristesse amoureuse de la nuit. […] Je sortis dans la ville sans fin. Ô Fatigue ! Noyé dans la nuit sourde et dans la fuite du bonheur. C’était comme une nuit d’hiver, avec une neige pour étouffer le monde décidément. On m’a repoussé. Je pleurais énormément, à tout cela. Enfin je suis descendu dans un lieu plein de poussière, et assis sur des charpentes, j’ai laissé finir toutes les larmes de mon corps avec cette nuit. – Et mon épuisement me revenait pourtant toujours. »
Arthur Rimbaud, Les Déserts de l’amour (1871).
J’avais lu le premier roman de Robin Josserand, dès sa parution. Un carton manuscrit de la librairie, pincé sur la couverture, ne laissait aucun doute : j’allais aimer. J’ai aimé – le livre, et un homme, au même moment. Dans le roman, c’était Sven ; pour moi, Swan. Je les mêlais, leurs prénoms se répondaient. C’était comme un écho. Puis Swan est parti. J’ai interrompu ma lecture, longtemps. Le titre de ce premier roman était Prélude à son absence. Aujourd’hui il me semble prémonitoire de la catastrophe qui allait suivre. Je suis demeuré sans nouvelles… J’ai terminé le livre. Il y eu un deuxième roman. Je l’ai abordé avec méfiance – les livres de Robin Josserand allaient-ils tous accélérer ma détresse ? Était-il le nom de code secret de ma disgrâce ? Si une relation s’achève avant la fin d’une lecture en cours, me voilà dans l’impossibilité de terminer le livre en question. Tout est lié. Je ferais mieux de ne lire que des livres courts. Bien plus tard, quand H. est arrivé, tout le temps que ça a duré je n’ai plus rien lu. Lui aussi est parti. Alors j’ai pu lire Un adolescent amoureux (Mercure de France), de Robin Josserand. Roman d’un deuil impossible, le deuil de l’enfance c’est-à-dire des illusions, du désir et de ses mimétismes, de l’imaginaire romantique.
Écrire sur quelqu’un est une manière de le saisir, surtout lorsqu’il vous échappe. Vous en faites ce que vous voulez. Vous reprenez la main. L’autre devient vôtre. Faire récit est une manière de clarification par la neutralisation. Ça permet de se rassembler. Vous êtes dévoré. Vous dévorez à votre tour pour déposséder l’autre du rejet qu’il vous inflige. Il existe à travers vous, enfin. Parfois, il faut absorber ce qui vous anéanti pour le supporter d’abord, le dilapider ensuite. Chacun a son os à ronger, le monde se partageant entre ceux qui ne savent pas aimer et ceux qui ne savent pas l’être.
L’amour, l’écriture de cet amour, est une pathologie. Il est comme le trouble de Pica dont souffre ceux qui avaleraient du sable, des cendres, une aiguille, pour se l’approprier, et en jouir. En jouir, vraiment.
Ainsi Robin Josserand écrit « pour celui qui n’a jamais lu ». Il arrive qu’on écrive par ou pour des personnes dont on sait qu’elles ne nous liront jamais. Et pourtant, il faut le faire. C’est comme ça. L’auteur le fait dans un style d’une épure sensible et déchirante, pulsionnelle. Le dépouillement est sa manière, d’une subtile clairvoyance. Ses phrases ont l’allure de l’évidence. Cette simplicité dessine une ligne droite entre le lecteur et la fiction. Pour dire un monde où rien ne va de soi, où les êtres et leurs liens dissonent, il fallait cette écriture limpide.
Le décor d’Un adolescent amoureux est celui d’un lycée, dans une ville moyenne. Moyenne en tous points. C’est-à-dire hostile. Le narrateur s’appelle Robin. Bon élève traversé par un inconfort intime, toujours triste. Il se sait vouloir le corps des hommes, le préférer, mais ne sais que foutre de ce désir. Il se branle en silence, parce que le silence c’est la honte. Et puis… il y a « A. », le nouveau. Garçon en retard, du fond de la classe, le regard plus volontiers tourné vers la fenêtre que vers le tableau. Il est intouchable, personne ne lui demande rien, même les adultes. Il n’est là pour personne, sauf pour Robin. Sur lui, il se retournera souvent.
À la sortie d’un cours – peu importe lequel, tant une heure de classe au lycée ressemble à une autre – A. jette dans la poubelle un dessin griffonné. Robin le récupère. Tout ce qui touche de près ou de loin à A. sera fétichisé à l’excès par le narrateur (objets, habitudes, lieux). Il reste absorbé par ces « minutieux entrelacs progressivement recouverts de traits impétueux. Une figure sévère dont une partie est restée dans l’ombre. » Comme un autoportrait dans lequel Robin se reconnaît : tous deux portent leur zone d’ombre. Elles ne se répondent pas, ne peuvent se faire écho, mais elles existent – sans coexister. C’est cela, l’adolescence, être seul à plusieurs : le moment où les parts d’ombre se frôlent, s’accordent parfois, ou demeurent étrangères. L’adolescence existe, c’est un âge. L’adolescent, lui, n’existe pas, ne choisissant jamais où il est ni avec qui. Seules existent des groupes hétérogènes d’êtres en formation, rassemblés au hasard.
Le roman exprime cette fragilité des affinités par défaut. Comment composer avec les autres quand on s’ignore soi-même ? Le narrateur et l’objet de sa fascination ne se rencontrent jamais : le livre raconte le trajet pour tenter cette rencontre.
A., c’est Arture. Une réminiscence d’Arthur Rimbaud. L’adolescent éternel. L’image du poète irradie : ici une récitation des Déserts de l’amour, là une citation du Bateau ivre. Ils ont en partage cette manière de garder les poings serrés dans leurs poches. Peu à peu, Arture devient « une légende, une rumeur ». Il incarne l’irruption de l’extraordinaire dans l’ordinaire assommant d’un quotidien grisâtre ; il est aussi un homme-métonymie, une partie d’un grand tout. Aimer Arture, c’est aimer tous les hommes.
Robin Josserand écrit l’appréhension de ce désir. Si la trajectoire homosexuelle compte dans le roman, l’auteur esquisse surtout, avec une netteté éblouissante, l’œil du cyclone que traverse tout adolescent, quel que soit l’objet de son désir. Il chronique, avec précision, cette longue saison en enfer où l’on vous demande de tout projeter vers l’avenir alors que seul compte l’ici et maintenant, fixé sur un être auquel vous vous accrochez à votre propre détriment, et en secret. Le désir donc, comme une maladie qu’on contracte malgré soi, dans laquelle on voudrait pouvoir plonger sans peur.
Robin est comme « ce personnage rogné à droite, bras croisés, enveloppé dans un drap blanc, sage, fixant, comme happé, le plongeon du jeune homme » dans le Nageur de Caillebotte : « il n’existe pas non plus. Ce n’est pas lui qu’on voit. »

Un adolescent amoureux fait de l’amour une prise de risque – j’emploie indifféremment amour et désir, parce qu’à l’adolescence ils s’amalgament encore. Quand une infinité de distances vous sépare du garçon du dernier rang, il faut trouver un moyen de l’approcher. L’homosexuel aime le même. Robin doit devenir Arture, tel est le prix à payer : « c’est à cette condition, au prix de cette étrange union, que nous pourrons être ensemble. Il faut être très habile pour réussir à s’effacer. » Le discours amoureux va à rebours de celui, confortable et dénué d’absolu, qui domine aujourd’hui : celui de l’acceptation inconditionnelle, du « je suis comme je suis, à prendre ou à laisser ». Ici, il est question d’abandon, de sacrifice, du coût de l’autre. De cette part de soi qu’on métamorphose pour lui, à travers lui. L’auteur décrit un système entier d’imitation et montre, dans de courts chapitres aussi rapides qu’un geste, comment un être peut façonner sa manière, son goût, ses obsessions pour attirer un regard. L’adolescent amoureux est prêt à devenir son propre adversaire pour se fondre dans un autre que lui. Comment pourrait-il épouser la vulgarité, la masculinité étouffante d’Arture ? L’enjeu est de se conformer à ce qui est valorisé socialement. C’est, paradoxalement, par l’effacement de son moi profond qu’il se libèrera de sa négation. Il prendra forme, exercera son libre arbitre. Se fondre hors de soi peut devenir un moyen de tracer son propre contour.
L’auteur sonde un amour cristallisé par son impossibilité, traversé par la fascination pour un modèle d’émancipation… L’amour comme une prison, mais aussi comme levier d’indépendance ?
Pour l’instant, le narrateur est en colère, il « se fait la promesse de ne plus rien faire de [sa] propre initiative, de [se] fondre complètement dans son image et de [se] contenter pour toujours de la vie d’Arture ».
Cette approche du désir, fondée sur l’intériorisation de l’autre, va jusqu’à l’appropriation de ses haines – lesquelles participent d’une haine de soi. L’être aimé est parfois si idéal malgré son indifférence qu’il devient impossible de s’aimer à ses côtés. Dans un cahier où il consigne ses notes, le narrateur écrit : « Les propos méchants qu’il tient à tout bout de champ sur les pédales me captivent. Car il a bien raison : les pédés sont tous minables, ratés et pathétiques. » Peu de livres ont exprimé, avec une telle force dans la sobriété, ce passage de l’homophobie imposée de l’extérieur à l’homophobie intégrée, jusqu’à ce qu’elle façonne la définition de soi comme homosexuel. Celui qui ne peut se saisir de son propre désir n’existe pas ; à force de vouloir jouir sur des corps absents, on finit par ne jouir que sur soi.
Si Robin Josserand décrit avec acuité la manière singulière dont le temps s’écoule dans la vie d’un jeune homme écrasé par la médiocrité de son environnement (lycée, ruralité), il restitue avec la même exactitude les premiers soubresauts et les convulsions d’une sexualité empêchée. C’est l’effervescence des urinoirs d’un lycée ; les garçons éphémères des lieux de drague, inconnus indifférenciés que l’on chasse jusqu’à la folie pour n’en faire apparaître qu’un seul, rêvé, lorsqu’on veut démasquer et être démasqué pour accorder deux secrets, et de conclure : « Ces filles […] si j’étais elles, je ferais jouir les mecs à la chaîne dans la forêt. On me conduirait dans les caves du quartier. Ne pas en profiter me paraît criminel. Goûtez donc aux garçons. Vous qui avez tous les droits. »
Un adolescent amoureux explore les souffrances d’un garçon encombré par des désirs d’homme, impatient de sortir de l’enfance, avide d’être enfin pris au sérieux pour cesser de n’être qu’un mensonge mortifère. Pour qu’il existe vraiment, il aurait fallu qu’Arture n’existe pas, que les hommes n’existent pas, afin qu’il puisse demeurer étranger à son propre désir. C’est eux ou lui.
Finalement, Arture a tous les droits, et Robin aucun : « Lui, il paraît si tranquille, affranchi de toute autorité, alors je ne désire rien d’autre que cette liberté qu’on me refuse. » Arture est un être au présent. Il appartient à une aristocratie : celle de ceux qui baisent, de ceux qui n’ont pas la permission de minuit parce qu’ils les ont toutes – celles qu’ils s’octroient. À l’inverse, Robin est un prolétaire de l’irréprochable, de ceux qui ont du mal à vouloir parce qu’ils doivent.
Le narrateur n’a pas les moyens d’atteindre son fantasme : seule l’écriture lui a donné une réalité. L’auteur signe le roman de la naissance du désir, c’est-à-dire, aussi, de sa naissance en tant qu’écrivain. Ici, Robin rejoint Josserand. C’est un roman d’apprentissage d’une grande finesse où se mêlent hypothèses de désir et certitudes, toutes également douloureuses, qui enseignent à ne plus être un déserteur de soi-même. Au départ, il y a un homme ; à l’arrivée, il y a l’écriture, un livre. Entre les deux, le narrateur se déleste d’un poids : lui qui imitait, on voudrait qu’il apprenne à improviser. C’est tout l’enjeu du parcours raconté ici. Il fallait en passer par Arture, comme par une station de calvaire.
L’une des pages les plus bouleversantes, véritablement sublime, décrit Robin en train de reproduire la graphie d’Arture, de mimer le tracé de ses lettres au détriment de la sienne. Travail acharné, peuplé de résistances : « J’apprends de nouveau à écrire. J’apprends vraiment à devenir Arture. » Je n’avais jamais lu un tel acte de négation de soi. Rien n’est plus intime que la manière dont on forme les lettres de son propre langage. Comment faut-il aimer pour malmener sa singularité jusqu’à la conformer à ce point à celle d’un autre ? C’est un suicide par l’écriture. En prenant du recul, on comprend que tout le livre est contenu dans cette page. C’est un préambule à la fiction. Apprendre à écrire c’était se laisser traverser pour mieux s’élucider. Devenir Arture, c’était devenir soi-même. C’est aussi une façon de s’écarter des multiples formes de pression et d’autorité (familiales, sociales) pour tenter de sortir de l’enfance et, enfin, se dévêtir de la panoplie qu’on vous fait porter pour endosser un costume à sa taille.
Un adolescent amoureux est un roman du passage, de la mise à nu entre deux eaux pour tordre le cou de la clandestinité, un roman de la sublimation freudienne.
On ne sort jamais que d’un cadre, seules les limites peuvent se franchir. Mais comment cesser de gâcher sa vie délibérément, obstinément ? Comment briser la chaîne de sa propre lâcheté ? Peut-on ne pas devenir fou face à ce qui n’a pas été vécu ?
« La plus douloureuse des catastrophes, c’est de s’empêcher d’être heureux. »
Quand on ne parvient pas à vivre quelque chose, on l’écrit, ça double l’existence. Quand on la lit, on la démultiplie encore. J’ai lu, donc j’ai cheminé avec Robin, j’ai vu Arture. Bref, j’ai rencontré Robin Josserand.