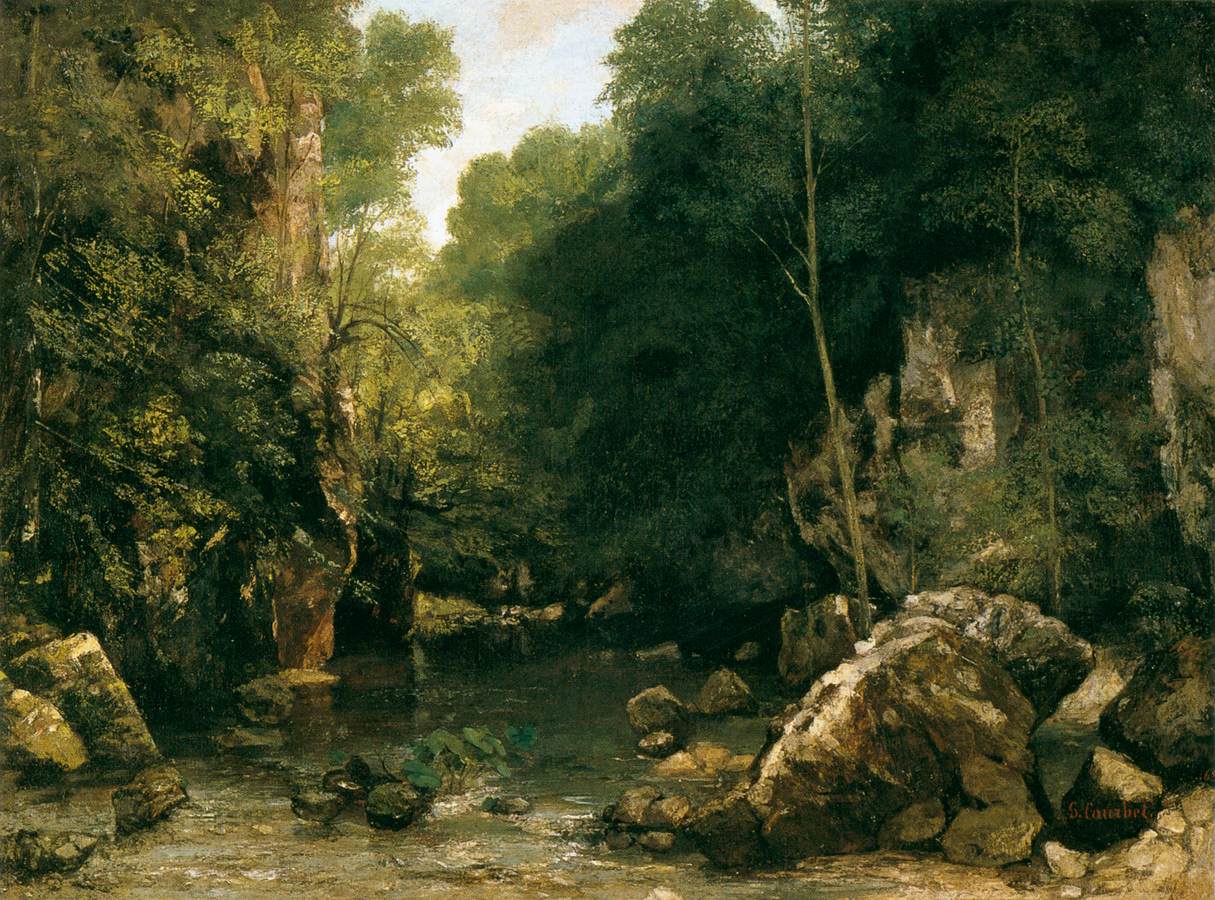La nouvelle de Danilo Kiš que nous publions ici est inédite. Composée pendant la période 1983-1984, elle appartient au même ensemble que les récits qui forment l’Encyclopédie des Morts – mais Danilo Kiš avait préféré l’écarter de ce recueil pour des raisons d’équilibre stylistique : il s’agit, en effet, d’un texte plus explicitement autobiographique, où la part de l’imaginaire est sensiblement plus réduite que dans les autres nouvelles de ce volume. On notera qu’il s’agit du seul texte de Danilo Kiš dont l’histoire se situe à Paris, de nos jours – soit dans l’univers concret où vivait l’écrivain yougoslave.
*
Je rentrais à Paris après les vacances de Pâques. J’habite dans le dixième arrondissement, et je n’ai pas le mal du pays. Les jours de soleil, ce sont les oiseaux qui me réveillent, comme à Voždovac ; par la porte ouverte de la terrasse, j’entends des Serbes qui s’interpellent en jurant comme des charretiers ; au petit matin, pendant qu’ils font tourner le moteur de leurs voitures, leurs autoradios crachent des airs d’accordéon. Par moments, je ne sais pas où je suis.
Je relevai le courrier qui s’était accumulé dans la boîte aux lettres et entrepris d’écouter mes messages téléphoniques : Anne-Marie m’informe qu’une nouvelle critique est sortie à propos de mon livre (soit dit en passant, je l’ai déjà lue). Puis de la musique et un ricanement ; je ne distingue aucune voix. B.P. me fait savoir de Londres qu’il n’a nullement l’intention de parler avec des fantômes et que, par conséquent, je n’ai qu’à jeter cet appareil aux ordures. Puis de nouveau un ricanement et de la musique. Une certaine Patricia Hamburger (« Oui, oui, comme les steaks hâchés ») me rappelle qu’après une exposition, si j’ai bien compris, je lui ai fait la cour et baisé les mains. (Possible.) Quelqu’un a ensuite raccroché deux ou trois fois. De nouveau B.P. : si jamais il tombe encore une fois sur cet engin… Puis, comprenant sans doute qu’il va être coupé : « J’ai quelque chose d’important à te dire. Mais pour ce qui est de ton maudit appareil, je te prie de le jeter à la poubelle. C’est à toi que je veux parler, et tout à fait sérieusement. Je ne peux pas, bon sang, dialoguer avec une machine ! J’aimerais bien savoir quel est l’imbécile qui t’a persuadé d’acheter cette horreur. Et pour quoi faire ? Tu n’es pas représentant de commerce ! Qu’est-ce que tu peux bien avoir comme affaires si importantes ! Pour ce qui est de tes nanas, elles n’ont qu’à patienter un peu… D’ailleurs, tu ferais mieux d’écrire plutôt que… Est-ce que tu as vraiment… » D’accord, je comprends bien, je comprends très bien, mais les trente secondes se sont écoulées, et je ne sais toujours pas de quelle chose importante il voulait me parler. Luba Jurgenson s’excuse : ils ont coupé la dernière phrase de son article ; le texte en est sérieusement tronqué. Puis une voix cassée : « Yourrri Goletz à l’appareil. Ma femme est morte. Les obsèques ont lieu mardi à quatre heures, au cimetière du Montparnasse. » Puis madame Ursula Randelis ; O.V. de Piran ; Christos Arvanitidis, mon ami de Salonique. Une certaine Nadja Moust de Belgique ; elle voudrait suivre mes cours de serbo-croate ; quelles sont les conditions d’inscription. De nouveau B.P., cette fois in media res : « Je voulais simplement te dire que nous nous connaissons depuis plus de trente ans et que nous n’avons jamais parlé sérieusement. Adieu. » Il coupe.
Il y avait au moins dix jours que Youri Goletz m’avait laissé son message ; je lui envoyai donc aussitôt un télégramme de condoléances. J’essayai ensuite plusieurs fois de le joindre, à des heures différentes, mais personne ne répondait. J’en déduisis qu’il était parti en voyage. J’appris peu après de madame Ursula Randelis, une de ses amies de longue date, qu’il s’était installé dans l’appartement de Noémie. (Ils vivaient séparés depuis plus de vingt ans ; elle près du Luxembourg, lui dans le quatorzième arrondissement.) Je téléphonai alors à plusieurs reprises à ce numéro et tombai chaque fois sur sa voix cassée : « Vous êtes bien au trois cent vingt-cinq – vingt-six – quatre-vingt, au domicile de Yourrri Goletz et de madame Goletz, alias Noémie Dastrrre. Veuillez laisser votre numéro de téléphone. »
Un matin, il me téléphona :
« – C’est Yourrri Goletz.
– Pauvre Noémie. Tu es reçu mon télégramme ?
– Oui, merci.
– Je pensais que tu étais en voyage, dis-je. C’est arrivé si brutalement.
– Laisse tomber. Je t’appelle pour quelque chose d’important.
– Je t’écoute.
– Tu es un homme sensible, David, tu me comprendras. (Une pause.)
– Je suis là. Je t’écoute.
– Tu n’es pas comme les Français. (Il passa tout à coup au russe) : Ty poet[1]. Je ne dis pas cela pour te flatter. D’ailleurs, je l’ai écrit dans la préface de ton livre. Toi seul peux m’aider. Le problème d’argent ne se pose plus. Quelle que soit la somme nécessaire. Noémie avait pas mal d’argent. Je ne sais pas si tu étais au courant. Elle s’occupait de films ethnographiques, cela lui rapportait de solides revenus. Et puis ses statues africaines… Tu m’écoutes ?
– Bien sûr que je t’écoute.
– Elle m’avait complètement déshérité, mais elle a modifié son testament au dernier moment. À l’hôpital. Elle estimait que j’avais finalement expié tous les péchés que j’avais commis envers elle. Elle a légué la plus grande partie à une fondation en Israël qui portera son nom.
– Quelle fondation est-ce ?
– Pour l’étude des traditions juives en Europe orientale. Qui sont apparemment en voie de disparition. Mais ce qu’elle m’a laissé est tout à fait suffisant.
– Pars en voyage.
– Il faut que je reste ici. À cause de toutes les formalités autour de l’héritage, l’inventaire officiel…
– En tout cas, ne reste pas dans cet appartement. Ce n’est pas bon pour toi.
– Il faut que tu m’aides. »
Je pensai qu’il voulait m’emprunter de l’argent, en attendant que la succession ne fût réglée ; ou que je l’aide à déménager. Il avait une énorme bibliothèque, avec des livres dans toutes les langues.
« – Je suis à ta disposition.
– Kupi mnje pistolet. Et, comme s’il craignait que je ne l’eusse pas compris, il répéta en français : Achète-moi un pistolet. Je ne peux plus continuer comme ça.
– J’arrive. Tu appelles de chez toi ?
– Oui, de l’appartement de Noémie. Tu sais où c’est. Quatrième étage. Gauche. »
Il m’ouvrit très vite, comme s’il était resté tout le temps derrière la porte. Il me parut avoir meilleure mine que jamais. Il n’avait pas de cernes sous les yeux, était rasé de près et son visage maigre était tout rose ; il avait l’air de quelqu’un qui sort du sauna. Il portait un costume neuf d’étoffe satinée taillé sur mesure, une chemise claire et une cravate de soie bariolée. C’était la première fois que je le voyais vêtu de la sorte. Le vernis des meubles étincelait, les fenêtres étaient grandes ouvertes, bien qu’il fît frais dehors. Les cendriers de porcelaine brillaient sur la table.
Je remarquai immédiatement que la collection de sculptures africaines avait disparu ; il ne restait qu’une statuette de femme avec de gros seins, sur une étagère entre les fenêtres et, à l’opposé deux dessins modernes dans un fin cadre noir.
« – J’ai un bon vin, dit Youri Goletz, et il partit à la cuisine ; je l’entendis déboucher la bouteille. Puis il revint.
– Je prendrai une gorgée avec toi. Autrement, je ne bois pas.
– Tu es sûrement sous tranquillisants. J’en ai pris moi aussi au moment de mon divorce…
– Oh, il fit un geste de la main, cela ne sert à rien.
– Un médecin m’a avoué qu’il prenait des sédatifs avec du whisky.
– Tout cela n’a plus aucun sens, dit-il. C’est un pistolet qu’il me faut, et non des pilules.
– Tu permets, j’ai moi aussi quelque expérience dans ce domaine. (À l’époque de mon divorce d’avec Ana, j’avais traversé une grave crise. Youri Goletz me consolait alors avec des paroles équivoques à la façon des préceptes talmudiques : “En dehors du mariage, il n’y a qu’une seule autre bêtise qu’un homme puisse faire : divorcer. Et la pire de toutes : s’en repentir.”). La nuit, je dormais avec des boules Quiès, dis-je, et un bandeau noir sur les yeux. Je prenais des somnifères tout en buvant. Je me réveillais dans mon lit comme dans une tombe. Et je pensais que je ne toucherais plus jamais à ma machine à écrire.
– Tu écriras encore beaucoup de choses, dit Youri Goletz. Quant à moi… Tu m’as dit un jour que tu voyais parfois des gangsters yougoslaves à Montparnasse. Tu pourrais me procurer un pistolet par leur intermédiaire. À l’hôpital, elle a modifié son testament. Elle estimait que par mon comportement, ces derniers temps… »
À ce moment-là, le téléphone sonna ; il se mit à parler avec quelqu’un en allemand.
Quelle idée ai-je eue, pensai-je, de lui parler de mes rencontres avec les « gangsters yougoslaves » à Montparnasse. Du reste, tout cela était bien exagéré. C’était pour la plupart des camarades de lycée, et ceux avec qui je buvais un verre de temps en temps n’étaient pas armés. En tous cas, je n’avais jamais vu d’armes sur eux. Ils se contentaient de me raconter toutes sortes d’histoires. À propos d’un individu qui sortait à ce moment-là du Select, ou d’un autre dont ils affirmaient que je le connaissais (« un grand avec des moustaches »), l’avant-veille encore nous étions assis à la même table. Eh bien, il avait été tué la veille d’un coup de couteau à Pigalle. L’autre avait descendu deux Corses quelques jours plus tôt. Ou c’est lui qui avait été abattu, je ne sais plus. Le troisième avait écopé de huit ans : trafic d’armes, vol à main armée, proxénétisme.
« – Un de mes amis, dit Youri Goletz en se rasseyant à la table, cela fait dix ans qu’il ne sort pas de chez lui. Il a tenté de se suicider ; le métro lui a coupé les deux jambes au-dessus du genou. Il habite au huitième étage, mais il n’a pas le courage de recommencer. Il boit. Il avale des cachets. Et il attend la mort. C’est ça que vous me souhaitez ?
– Je te procurerai un pistolet, dis-je, dans un an. Le huit mai mille neuf cent quatre-vingt-trois. J’ai moi aussi quelque expérience dans ce domaine.
– Dans un an !, dit-il. Je ne peux même pas tenir le coup un mois. Même pas une semaine.
– Si tu en as encore besoin à ce moment-là.
– Je pensais que tu n’étais pas comme ces Français. Finalement, tu es comme les autres. Toi non plus, tu ne me comprends pas. Et pourquoi devrais-je…
– Parce que tu as survécu aux camps. (Il avait le matricule tatoué sur l’avant-bras.) À cause de cela. Quelqu’un qui a survécu aux camps…
– Laisse tomber les camps, dit Youri Goletz. Le camp, à côté de ça, c’était presque une partie de plaisir. Raoul aussi, ce malheureux qui n’a plus de jambes, il a survécu aux camps. »
Nous en étions déjà à la deuxième bouteille de Sauvignon. Je lui dis alors que le vin commençait à me monter à la tête et que j’avais faim ; au petit déjeuner je n’avais pris qu’un café noir. Je lui proposai de sortir et d’aller grignoter quelque chose. Nous pourrions déjeuner ensemble. Lui non plus n’avait sûrement rien mangé.
« – Je t’invite, dit-il. On va manger dans le quartier. Il faut que je sois ici au plus tard à cinq heures. J’attends des visites. Et puis le notaire peut passer à tout moment. Vivement que j’en finisse avec ces formalités. »
Nous sortons du passage et débouchons sur le boulevard. C’est une journée fraîche, bien que le soleil apparaisse de temps en temps entre les nuages. On sent la lente victoire du printemps ; les terrasses de cafés sont déjà installées sur les trottoirs ; les femmes sont attablées, le visage tourné vers le soleil, les yeux fermés ; elles ont relevé leurs jupes jusqu’au milieu des cuisses. Un noir en short file à nos côtés en patins à roulettes, puis traverse la rue comme une flèche. Je le vois disparaître le long du Luxembourg ; sur les piques dorées de la grille, le soleil laisse des traces sanglantes, comme sur une toile pompier du Louvre.
Le restaurant vient d’être rénové, il sent encore le neuf. Dans les boxes sont suspendues des lanternes avec des abat-jour rouge et des franges dorées. Les tables, dont le dessus est en plastique, sont recouvertes de nappes en papier. Dans les vases il y a des fleurs artificielles et à côté, dans un support en métal, la sainte trinité de la cuisine française : sel-poivre-moutarde.
Dans un des boxes déjeunent les propriétaires du restaurant, une grosse femme blonde aux ongles vernis et un homme corpulent aux joues rouges, avec de petites moustaches. Ils coupent à l’aide d’un grand couteau leur beefsteak qui est très saignant. Devant eux, sur la table, il y a une bouteille de vin rouge sans étiquette ; la bouteille laisse sur la nappe de papier des traces en forme de demi-cercles rouges.
Ils nous serrent la main.
« – Ça va ?[2]
– Ça va[3], dit Youri Goletz.
– Comment va madame ? demande la patronne.
– Elle est morte », répond Youri Goletz.
Le propriétaire du restaurant avale une gorgée de vin.
– Mais madame était là il y a moins d’une semaine encore, dit-il.
– Mon Dieu, mon Dieu[4]. Un accident de voiture ?
– Leucémie, dit Youri Goletz. Nous voudrions manger quelque chose.
– Mettez-vous là-bas, dit le patron en désignant de son couteau une table. Ou là-bas. Gaston ! Apporte la carte à ces messieurs. C’est ça, la vie. J’ai l’impression que madame était là encore hier. Justement là où vous êtes assis. Je crains qu’il n’y ait plus de plat du jour. Il est trois heures. Je vous recommande le rosbif. Gaston !
– Pour moi, du poulet, dit Youri Goletz. Avec des frites. Et une salade verte. Cela fait plus d’un mois qu’elle est morte.
– Et votre ami, qu’est-ce qu’il prendra ?
– Une omelette, dis-je. Et un carafon de rouge.
– Et madame qui faisait tellement attention, dit la patronne. Elle ne mangeait que des produits naturels. Des œufs. Du poisson. Et des fruits. Et beaucoup de carottes. Gaston, apporte une fourchette à monsieur.
– Les dernières années, dit Youri Goletz en se penchant vers moi, elle ne mangeait que de l’herbe. Comme une vache. »
Nous retournâmes à l’appartement de Noémie. Youri Goletz acheta en chemin trois cartouches de Rothmans – réserve suffisante pour au moins dix jours. Il paya également mes cigarettes.
« Moi aussi j’ai fumé des Gauloises et des Gitanes pendant des années, dit-il. Jusqu’à ce que j’obtienne la nationalité française. Je fumais cette cochonnerie pour avoir le même goût qu’eux dans la bouche. »
Dès que nous fûmes arrivés, il commença :
« Donc, tu veux que je me jette sous le métro comme le pauvre Raoul. Ne m’interromps pas, s’il te plaît. C’est ce que vous me souhaitez ? Je suis incapable, vois-tu, de m’ouvrir les veines. J’ai horreur du sang, comme le héros de ton roman. Surtout maintenant. Je suis allé la voir tous les jours à l’hôpital pendant un mois. Je restais à son chevet jusqu’à l’aube. Sans tabac ni alcool. Inutile de te raconter. Le sang, les vomissures, les excréments, le pus. Nous étions mariés depuis quarante-trois ans. Nous nous sommes connus en Pologne, à notre sortie des camps. Elle du russe, moi de l’allemand. Les vingt dernières années, nous ne vivions pas sous le même toit. J’ai couché pendant ce temps-là avec beaucoup de femmes ; je suppose qu’elle aussi a eu des amants. Combien ? Je l’ignore. Mais, en dépit de cela, il y avait entre nous quelque chose qui nous unissait. Quelque chose d’essentiel ; quelque chose qui unit un homme et une femme pour toujours. »
Le téléphone sonna, et il parla de nouveau avec quelqu’un en allemand, à voix basse. À moins que ce fût du yiddish. Puis il se rassit en face de moi :
« Un mois avant qu’elle ne tombe malade, nous nous promenions sur le boulevard Saint-Michel. C’était une journée lumineuse, comme aujourd’hui. À un moment donné, elle s’est arrêtée et m’a pris le bras. « J’aimerais vivre cent ans », a-t-elle dit. « Avec toi. » Et nous nous sommes embrassés. Sur la bouche. »
Youri Goletz avala une gorgée de vin.
« – Excellent bilan pour un vieux couple juif, conclut-il. Après quarante-trois ans de vie commune.
– Tu devrais partir en voyage le plus vite possible, dis-je. Où tu en es avec le testament ?
– Il est possible qu’elle ne m’ait rien laissé. Et je m’en moque. Tout ce que je veux, c’est en finir avec ces formalités. Mais tout cela n’a plus aucune importance. Je suis au bout du rouleau. J’ai aidé quelques personnes. J’ai écrit quelques bricoles, comme du bout du doigt à la surface de l’eau. Je n’ai plus ni force ni curiosité.
– Je sais très bien ce que tu ressens. Moi aussi, je me suis penché au-dessus de ce gouffre, il n’y a pas si longtemps. Les autres, dans une telle situation, ne peuvent te donner aucun conseil ; quant à Dieu, si tu permets, il n’y connaît pas grand-chose. À l’époque, je me suis mis à la recherche de livres qui pourraient me donner la force de survivre. Et j’en suis arrivé à la conclusion tragique que tous ces livres dont je m’étais gavé pendant des décennies ne pouvaient m’être d’aucun secours dans un moment aussi décisif. Je te passe les livres saints ou les sages de l’Antiquité ; je n’étais pas prêt pour eux, faute de remplir la condition initiale : croire en Dieu. Contrairement à toi. Mais j’ai lu les auteurs et les ouvrages les plus divers : les gnostiques et les commentaires des gnostiques, Survivre de Bruno Bettelheim, le Training autogène de Lindemann, la Destinée du plaisir d’un certain Aulanier, les Affinités électives de Goethe, le Jour, la Nuit de Braunswig, les Etats psychotiques de Rozenfeld, les romans de Philip Roth, et même la Vie des marionnettes de Bergman, car j’avais l’impression d’être une marionnette dont le destin tirait les fils. Le seule conclusion que j’ai déduite de ces lectures, c’est que les livres n’offrent aucune réponse aux questions les plus brûlantes. Que nous sommes guidés par les gènes, par le diable ou par Dieu, et que notre volonté, aux instants fatidiques, ne joue pas le moindre rôle, que ce sont nos passions qui nous entraînent. Comme lorsqu’un homme nage de toutes ses forces et pourtant non seulement la rive ne s’éloigne guère, mais il est évident que le courant – qu’il essaie de remonter – l’entraîne dans la direction opposée. Mais, heureusement, les passions, tout comme les malheurs, ne sont pas éternelles, à l’instar des plantes et des animaux. »
Je sentais bien que ce que je disais sonnait creux et paraissait purement livresque. Il n’est pas facile de répondre à un homme qui vous demande : pourquoi devrais-je vivre ? Mes intentions étaient honnêtes : en me réclamant de mon expérience, je voulais lui faire entrevoir l’effet bénéfique du temps, lui représenter l’avenir, son avenir : quelque part sur les bords de la Méditerranée, il réchauffe ses os au soleil du printemps, avale un capuccino et donne une tape sur le derrière de la jeune serveuse.
« En fin de compte, il faut que tu vives parce que c’est la seule vie que nous ayons. »
Il fit un geste de la main.
« N’oublie pas que je crois en Dieu, dit-il, et Lui me pardonnera. »
La sonnerie de la porte interrompit cette pénible conversation, Youri Goletz me présenta ses invitées par leur prénom, en ajoutant : « Mes protégées. »
De moi, il leur dit que nous étions de vieux amis et que j’étais écrivain.
« Il a écrit la préface pour mon dernier livre », dis-je pour masquer mon trouble.
C’étaient deux jolies jeunes femmes, à la chevelure exubérante, aux pommettes saillantes, aux yeux un peu bridés à la mongole.
« – Oh, Youra, pourquoi ne nous l’as-tu pas dit ? s’exclama Natacha.
– Tu vois, continua Dola (on lui avait donné ce nom en l’honneur de Dolorès Ibarruri), tu dois vivre ne serait-ce que pour les autres. Qu’est-ce que c’est que ces horreurs dont tu parles. Quel pistolet, Bog s toboi[5]. Puis, s’adressant à moi : Si Youri a écrit la préface de votre livre, c’est que cela doit être quelque chose de bien. »
Je leur promis de leur envoyer des exemplaires de mes livres ; celui dont la préface était de Youri Goletz et, bien sûr, celui qui traite des camps. (Elles étaient les filles d’un général soviétique qui avait disparu dans les purges.)
« – Santé, dit Natacha qui nous avait tous servis.
– À votre santé, dit Youri Goletz d’un air absent.
– Il y a tant de belles choses dans la vie, dit Dola. L’amitié par exemple ; et tu vois bien que nous avons tous besoin de toi. Sans toi, où nous serions-nous réfugiées toutes les deux à notre arrivée à Paris ? Vous ne pouvez pas imaginer ce que Youra a fait pour nous. Son appartement est une véritable ambassade pour tous les réfugiés de l’Est. Russes, Polonais, Ukrainiens, Estoniens. Tous. Depuis quand connaissez-vous Youra ?
– Au moins dix ans, dis-je.
– Nous nous sommes connus, il y a longtemps, à une réception, dit Youri Goletz. Lorsque son premier livre est sorti en français. »
Note : C’était madame Ursula Randelis, mécène des écrivains sud-américains, qui avait organisé cette réception. En dehors de ses protégés, des écrivains d’autres pays entraient parfois par la petite porte. Ce cocktail avait lieu en l’honneur de la sortie du livre d’un Portugais, d’un Espagnol et du mien ; ils étaient tous les trois publiés dans une collection consacrée surtout aux Latino-Américains. Je ne connaissais personne, et je n’osais pas manger, car je ne savais pas comment décortiquer les crabes et autres crustacés ; c’est ainsi que je passai toute la soirée assis sur un canapé, à boire. Vers trois heures du matin, une jeune femme me proposa de me ramener en voiture, et je vomis dans sa salle de bains allongé sur le carrelage, à demi-mort. Par bonheur, on oublie en général ce qui est voué à l’oubli. Les années passant, ce malheureux cocktail était sorti de mon souvenir, et il aurait sombré dans une nuit éternelle si Youri Goletz ne me l’avait remis en mémoire deux ou trois mois plus tôt. Il m’avait demandé si Marie La Coste avait écrit sur mon dernier livre. Je lui répondis que je ne savais pas qui c’était.
« – La galanterie est une qualité appréciable, dit-il, mais, mon cher, tu as couché avec elle. Ce n’est un secret pour personne. Au cocktail chez Ursula Randelis, tu lui baisais les mains sous le nez de son mari. Et au petit matin, vous avez disparu ensemble.
– Je croyais que c’était la domestique de madame Ursula Randelis, dis-je. J’avais d’ailleurs été étonné qu’elle ait une salle de bains pareille. Avec du carrelage rose et un bidet. »
Pour changer de thème, donc, je dis :
« – Je pense que vous devriez le convaincre de ne plus habiter ici.
– Tu vois, Youra, tout le monde te dit qu’il vaudrait mieux que tu ne vives pas dans son appartement, dit Natacha. Nous te l’avons répété cent fois.
– Juste le temps de finir les formalités, dit Youri Goletz.
– En attendant, au travail, dit Dolorès-Dola et les deux jeunes femmes se levèrent en même temps. Les sculptures ont été enlevées, c’est bien. Laisse les cendriers, Youra, je vais les vider. Qu’est-ce qu’on fait de ça ? »
Nous étions dans l’autre pièce, où se trouvait la bibliothèque de Noémie. Les livres couvraient le mur sur toute sa longueur et jusqu’au plafond.
« Ce sont des livres de valeur », dit Youri Goletz, en prenant sur une étagère un tome de la Judaische Enciklopedie.
Elles jetèrent un coup d’œil aux rayonnages, puis chacune prit un livre, au hasard.
« Ce sont des livres récents, dit Dola. Ce qui t’intéresse, nous le transporterons demain en voiture dans ton appartement. Le reste – chez un bouquiniste. »
Youri Goletz restait planté au milieu de la pièce, le tome de la Judaische Enciklopedie dans les bras, sans savoir qu’en faire.
« – Certains sont dédicacés, dit-il.
– Elle n’avait quand même pas la signature de Victor Guiougo[6], dit Natacha.
Elle était accroupie par terre et palpait du bout des doigts, comme lorsqu’on examine une étoffe, le tapis usé dans la chambre de Noémie.
– Celui-là, c’est un persan, dit-elle en désignant le tapis devant la coiffeuse sur laquelle, comme dans un poème de Baudelaire, se trouvaient encore les flacons de parfum soigneusement alignés. Demain, nous viendrons en voiture chercher tout cela, dit-elle. Vladimir Edmundovitch, monsieur Baumann, et nous deux. Tu vois, Youra, tout va s’arranger.
– Et qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? demanda Dola en désignant les placards dans l’entrée.
– Ses fringues, dit Youri Goletz, en ouvrant les portes des placards, après avoir posé l’encyclopédie sur un radiateur. Les derniers temps, elle achetait des fourrures. Elle se plaignait tout le temps d’avoir froid. Elle les portait même à la maison. Elle prétendait que, maintenant seulement, elle se ressentait du froid qui lui avait pénétré les os quarante ans plus tôt, en Sibérie. Poustiaki[7], ajouta-t-il avec un geste de la main. Elle envisageait de s’installer définitivement en Afrique.
– Il y a là quelques bonnes fourrures, dit Dola. Cela aussi, il faut le vendre. Celle-là coûte au moins vingt mille francs.
– Cent vingt, répliqua Youri Goletz. Elle ne l’a portée qu’une seule fois. L’an dernier. Pour Yom Kippur.
– Pour quoi ? demanda Natacha.
– Pour une fête, dit Youri Goletz.
– Il y a au moins trente paires de chaussures, dit Dola.
– En Russie, dit Natacha (qui venait juste d’émigrer et se servait encore de la propagande anticommuniste) on pourrait vendre cela pour des devises, dans une Beriozka.
– Bog s toboi[8], dit Dolorès-Dola, quelle Beriozka ! C’est à La Croix-Rouge qu’il faut le donner.
– Peut-être qu’une partie de tout cela, via La Croix-Rouge, parviendra jusqu’en Afghanistan », dit Youri Goletz en jetant un coup d’œil à sa montre.
À ce moment-là, on sonna à la porte.
« Le docteur Wildgans », dit-il comme pour lui-même.
Le docteur Wildgans était un homme d’une trentaine d’années, grand, la chevelure abondante et bouclée où apparaissaient quelques cheveux blancs. Il y avait en lui quelque chose de sauvage, de bédouin, et pas seulement à cause de la couleur insolite de ses yeux, jaune-vert, et du grand châle qui lui couvrait les épaules. Il était rentré deux semaines plus tôt d’Afghanistan. Avec deux autres médecins, il avait franchi la frontière et, habillé en combattant, s’était aventuré dans les montagnes les plus inaccessibles. Il avait assisté, depuis son abri, à nombre d’embuscades et observé à la jumelle les chars d’assaut qu’abandonnaient leurs équipages ; il avait pratiqué quelques amputations, dans des conditions très précaires, quelque part à une centaine de kilomètres de Kaboul.
« – Tu as secouru tant de gens, dit tout à coup Youri Goletz, et moi, tu ne veux pas m’aider.
– Deux au coucher, dit le docteur Wildgans, en posant un flacon de cachets sur la table. Ceux-là sont plus efficaces. »
Après le départ des deux jeunes femmes, on avait l’impression qu’un brouillard pesant planait de nouveau sur la pièce. On entendait la rumeur étouffée de la ville ; une musique parvenait du voisinage : quelqu’un s’exerçait obstinément au saxophone et répétait la gamme chromatique ; les sons se fondaient de temps en temps dans les hurlements des sirènes des ambulances.
« – Tu peux parler devant lui, dit Youri Goletz en s’adressant au docteur Wildgans.
– Ne me demande pas ça. Je suis médecin.
– Justement, dit Youri Goletz. Tu es médecin, et moi, j’ai besoin d’un remède efficace. Du cyanure. Ou un pistolet.
– Ces cachets t’aideront.
– D’accord, dit Youri Goletz. Vous voulez donc que je me jette du quatrième étage. Que je reste estropié. Comme ce pauvre Raoul. Tu connais Raoul. Ou que je me tranche la gorge. « Mes amis, mes compagnons se tiennent à l’écart de ma plaie et mes proches se tiennent au loin ». »
Puis il se leva brusquement et emporta le cendrier pour le vider. Il ne ferma pas la porte de la salle de bain, comme s’il craignait que nous montions une intrigue contre lui. Je l’entendis uriner et tirer la chasse d’eau.
« Je suis incapable de m’ouvrir les veines, ou de me pendre, dit-il en revenant avec le cendrier qui brillait de nouveau. Je ne peux pas imaginer mon visage enflé et bleu avec la langue tirée. J’ai vu suffisamment de scènes de ce genre dans ma vie. Et je peux vous dire qu’un pendu, ce n’est vraiment pas beau. En plus, je ne suis nullement excité à l’idée que je pourrais encore une fois, une dernière fois, bander. S’il est vrai qu’un pendu bande. Est-ce que je peux prendre ça avec de l’alcool ? »
Il tenait à la main le flacon de cachets.
« Je ne te le recommande pas », dit le docteur Wildgans.
Le lendemain, je lui téléphonai de nouveau.
« Vous êtes bien au trois cent vingt-cinq – vingt-six – quatre-vingt, au domicile de madame Goletz, alias Noémie Dastre. Je vous prie de me laisser votre message et votre numéro de téléphone. Au revoir et merci. »
C’était la voix de Noémie. Elle venait du ciel, ou de l’enfer, peu importe.
Le vendredi, je partis à Lille faire mes cours. J’avais une dizaine d’étudiants ; je leur enseignais « un des idiomes de la grande famille des langues slaves, qui, à côté du russe et du polonais… » J’essayai de profiter de l’entrée fracassante de madame Yourcenar à l’Académie pour leur faire découvrir la poésie populaire serbe, que madame Yourcenar appréciait, comme en témoignent ses Nouvelles orientales. Ils n’avaient pas lu Marguerite Yourcenar. Je tentai ma chance avec des poèmes d’amour. Des sonnets. Ils ne savaient pas ce qu’est un sonnet. En alexandrins, comme chez Racine. Ils ignoraient ce qu’est un alexandrin. (Encore un truc bourgeois.) Je passai alors à la palatalisation et à la mouillure. Cela eut l’air de les intéresser. Ils prenaient tous des notes. C’est ainsi que, dans le train, je dus apprendre la palatalisation et la mouillure.
Le samedi, j’appelai madame Ursula Randelis.
« – C’est la voix de Noémie sur le répondeur, dis-je. J’ai eu l’impression que je parlais avec l’au-delà.
– Moi aussi j’ai eu un choc à cause de ce répondeur, dit-elle.
– Il m’a demandé de lui procurer un pistolet.
– À moi aussi, n’aie crainte. Tu n’es pas le seul. Il a toujours eu le sens du tragique. Je le connais bien. Depuis au moins trente ans. Dieu que le temps passe. La mort de Noémie l’a beaucoup secoué, je comprends. C’est arrivé si brutalement. Les médecins eux-mêmes n’étaient pas tout à fait sûrs. Elle avait tout le temps un peu de fièvre. Et tu vois. En moins d’un mois. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ils ne vivaient plus ensemble depuis vingt ans. Qu’elle repose en paix. Elle avait un caractère infernal. Elle ne le comprenait pas, tout simplement. Il n’allait tout de même pas coucher toute sa vie avec la même femme ! Il n’est pas rabbin ! Moi non plus, elle ne pouvait pas me supporter. Ce n’est plus un secret : j’ai été sa maîtresse. À l’époque où j’ai quitté le couvent. Il y a vingt ans. Vingt-cinq. Depuis, nous sommes seulement amis. Les meilleurs amis du monde. Je ne comprends pas ce qui lui a pris de mettre la voix de Noémie au répondeur. Excuse-moi, on sonne. »
Après une courte pause :
« C’est mon fils. Il s’est inscrit en espagnol. La voix du sang. Je ne veux pas me mêler de ses affaires. Je lui dis que l’essentiel c’est qu’il ne se drogue pas. Youri Goletz est comme un enfant. Il est incapable de payer sa facture de téléphone. Dieu sait combien de fois on le lui a coupé. Et Ursula accourt pour arranger les choses. Comme pour l’électricité, le loyer. Pour tout. Et tu crois que Noémie aurait levé le petit doigt ? Jamais ! Il a besoin d’une mère. Ou d’une sœur. Je lui demande : “Comment ça va, Youri ?” “Ça va”, dit-il. “Très bien.” “Allons, je vois bien que quelque chose ne tourne pas rond.” “Non adaptabilité de l’être humain à l’existence”, dit-il. “C’est tout.” Et maintenant cet héritage qui lui tombe sur le dos. Ça le tracasse. J’ignore où ils en sont. Apparemment, le testament n’a pas encore été ouvert officiellement. C’est pour cela qu’il ne bouge pas de l’appartement. Je lui ai dit de laisser la clé à la petite Japonaise. Ils ont une Japonaise, juste à côté. Une étudiante. Je me demande s’il n’a pas couché avec elle. Noémie, bien sûr, ne pouvait pas non plus la supporter. En tout cas, il faut qu’il quitte le plus vite possible cet appartement. Et qu’il arrête de faire des drames. Quel pistolet… Entre nous soit dit, il est bien possible qu’elle ne lui ait rien laissé. Pas un centime. Elle était capable de lui faire ça. Donc, il t’en a parlé. D’accord, c’est son argent, c’est elle qui l’a gagné. Qu’elle en fasse ce qu’elle veut. Le folklore juif ou la sculpture africaine, cela m’est égal. L’essentiel, c’est que tout soit réglé. En tout cas, maintenant il faut le laisser tranquille. Tu as bien fait de lui dire ça. Dans un an, tout ira bien. Comme si je n’avais pas eu, moi aussi, de ces crises. Trouve-moi quelqu’un de normal qui n’a pas traversé de crise grave. Quand Angel Asturias m’a quittée, tu crois que je n’ai pas eu de crise ? J’en ai eu, et comment. Je buvais, je me gavais de pilules, et tout le reste. Excuse-moi, ça sonne encore. C’est de la folie chez moi. J’arrive. Appelle-moi ces jours-ci. J’ai un travail fou. Je traduis Cortazar. Je ne sais pas ce que cela va donner. Quand tu veux. Un instant ! J’arrive ! Tu peux appeler tard. Jusqu’à une heure. Ou deux. Et même après. J’arrive, mierda ! »
Le dimanche, j’étais invité chez madame d’Orsetti. Après son divorce d’avec un marchand d’art, elle vivait seule et, dans son grand appartement, à proximité du parc Monceau, elle organisait des dîners intimes. Elle faisait diverses collections, s’occupait d’astrologie et de mode, ce qui, d’après Baudelaire, fait partie de l’art. Elle avalait en grande quantité romans gothiques, somnifères et vin blanc. Elle avait été une amie de Queneau et de Perec, connaissait Chirico, René Char et Dado. Chez elle, on buvait de la tequila, du whisky, de la vodka et du vin blanc qui venait de ses vignobles. Elle parlait d’elle-même à la troisième personne : « D’Orsetti a fait son jogging à six heures ce matin au parc Monceau ; d’Orsetti a trente-huit de fièvre ; d’Orsetti part demain à Londres ; d’Orsetti va inviter Armani à dîner. »
Je fus étonné de voir qu’elle m’avait réservé la place d’honneur à la table, étant donné qu’était présente ce soir-là la veuve du prince S., critique littéraire et traducteur, ainsi que le célèbre créateur de mode Armani. Considérant que c’était par mépris des conventions (« d’Orsetti déteste les conventions »), je m’assis à la place que l’on me désignait, pour ne pas paraître moi-même trop formaliste.
La conversation tournait autour de gens que je ne connaissais pas ou de thèmes qui ne m’intéressaient guère : la mode, le féminisme, l’homosexualité, l’art conceptuel, la bande dessinée. Mais le thème principal du dîner était un opéra que je n’avais pas vu, et en particulier le rôle d’une jeune cantatrice qui y faisait ses débuts. Madame d’Orsetti jugeait son style plébéien, sa voix vulgaire et ses interviews idiotes ; Armani, qui réussit à se rallier la majorité, affirmait au contraire qu’une nouvelle étoile était née et qu’elle allait bientôt briller au firmament de l’opéra européen ; une nouvelle Maria Callas.
Même ceux qui pensaient le plus grand mal de madame d’Orsetti, prétendant qu’elle était lesbienne et alcoolique, reconnaissaient ses talents culinaires et son imagination en matière de gastronomie. Ce soir-là, comme hors-d’œuvre, elle nous proposa du caviar, du thon au beurre noir et des carottes à la crème, et comme plat de résistance une « carpe dans le sable » ainsi que de l’agneau à la rhubarbe et aux noix ; puis du fromage et une glace à la pistache et à l’ananas, avec un coulis de cassis. On servait du vin blanc « d’Orsetti » de 1967, avec la devise « In vino veritas » imprimée sur l’étiquette jaune, ainsi que du bordeaux, pour ceux qui ne voulaient pas composer avec les goûts de la maîtresse de maison.
Après le dîner, madame d’Orsetti s’assit par terre, enveloppée d’un châle de pourpre, se balançant presque imperceptiblement au rythme de la musique que diffusait l’électrophone (Rameau, Brahms, Vivaldi). À un moment donné, elle posa son verre sur le tapis et me fit signe de la suivre. Lorsque nous fûmes dans sa chambre à coucher, elle me fit asseoir sur le bord de son lit à baldaquin violet, me mit un verre dans la main et le remplit à ras bord. Tout en versant la vodka, elle me dit :
« Ton ami Youri Goletz s’est suicidé. Je voulais que tu dînes en paix. Je te laisse seul. Si tu as besoin de parler avec quelqu’un, d’Orsetti est à ta disposition. »
Les obsèques étaient fixées au mardi, à quatre heures, mais la cérémonie commença avec presque une heure de retard. Visiblement, les gens d’ici y sont habitués, car à mon arrivée, exactement à l’heure dite, il n’y avait encore personne au cimetière. Je pensai que les amis de Youri Goletz s’étaient réunis près de la fosse ou devant la chapelle ; c’est alors que survint Luba Jurgenson, une de mes connaissances, et nous attendîmes ensemble devant l’entrée du cimetière. Vers cinq heures, des gens commencèrent à arriver. Venaient-ils à l’enterrement de Youri Goletz, nous demandions-nous, de même qu’ils se le demandaient probablement en nous voyant ainsi grelottant dans le vent froid. Luba Jurgenson, écrivaine, émigrée et protégée de Youri Goletz, aperçut enfin des amis communs ; elle se dirigea vers une femme en deuil qu’elle embrassa. « La sœur de Youri Goletz, me dit-elle. Elle arrive d’Amérique. » Dolorès-Dola et Natacha apparurent en compagnie d’un jeune homme avec un chapeau de cow-boy et des pantalons à passepoils, dont Luba Jurgenson me dit que c’était aussi un émigré russe, un peintre. Finalement, nous fûmes une trentaine : Emil Cioran, Adolf Rudnicky, Ana Novak, femme de lettres et ancienne déportée, les représentants de la maison d’édition Gallimard, l’attaché culturel de l’ambassade d’Israël, un délégué de la ligue juive, des amis et des admirateurs de Youri Goletz.
Madame Ursula Randelis avait tenu parole et, contrairement à ce que je prévoyais, elle ne vint pas aux obsèques. Ce matin-là, elle m’avait dit : « Je n’aime pas les morts, j’aime les vivants. La dernière fois que je suis allée à un enterrement, c’était celui de ma mère, il y a vingt ans. Et puis j’ai fait une exception, à cause de Youri, et je suis allée, il n’y a même pas un mois, je pense, aux obsèques de Noémie. C’est assez pour le restant de mes jours. Ah, qui est-ce qui me dira désormais : “Vieille jument estropiée ?” Qui me dira : “Vieille jument goy, ils m’ont encore coupé le téléphone ?” Qui me dira : “Allez, viens, vieille jument arabe, on va se rincer le gosier ?” La prochaine fois que j’irai au cimetière… Venez chez moi après l’enterrement, tous. Je ne sais pas quels sont les usages juifs, je m’en moque. Je préparerai quelque chose à manger. Et on boira un verre de vodka pour le salut de son âme. Mais je n’irai plus à aucun enterrement. Sauf, un jour, au mien. »
Le rabbin était un homme d’une cinquantaine d’années, svelte, rasé de près, vêtu d’un caftan noir, et il n’avait rien d’un prophète biblique barbu ; il ressemblait plutôt à un de ces magistrats français en robe que l’on voit dans les cafés autour du Palais de Justice. Les bras écartés, les paumes de main tournées vers le ciel, il remuait les doigts pour nous faire signe d’approcher :
« Venez plus près et entourez-le, comme vous l’avez entouré de son vivant. Plus près, encore plus près, messieurs-dames. »
Le cercueil était hissé sur un socle dans une des allées du cimetière, sous un grand platane. Dans la partie la plus large du couvercle il y avait une petite fenêtre carrée, comme dans une arche de Noé particulière qui va transporter le corps du voyageur sur la terre ferme de l’éternité. Sur le couvercle étaient fixées des lettres de métal brillant : « Youri Goletz, 1923-1982 », telle une notice idéalement condensée pour la Judaische Enciklopedie.
Au moment où le rabbin commença à parler, je remarquai le docteur Wildgans ; sa silhouette imposante apparut derrière un monument funéraire. Raison pour laquelle, probablement, j’eus l’impression qu’il n’arrivait pas par l’allée, mais directement des tombes.
Depuis que madame d’Orsetti m’avait annoncé que Youri Goletz avait mis fin à ses jours, mes soupçons s’étaient portés sur le docteur Wildgans. Le fait qu’il arrivât en retard et comme en cachette ne faisait que confirmer mes doutes. J’essayai de pénétrer ses pensées : éprouvait-il des remords ? Ou peut-être était-il fier, comme quelqu’un qui a rempli son devoir envers son prochain ? En fin de compte, pensai-je, en tant qu’ami et médecin, il était le mieux placé pour juger du bien-fondé de sa décision ; donner une ampoule de cyanure ou procurer un pistolet à un homme qui aspire à la mort comme au salut, cela peut paraître justifié du point de vue moral. Je soupçonnais d’autant plus le docteur Wildgans qu’il était la dernière personne que l’on eût vue avec Youri Goletz ; ce soir-là, je l’avais laissé seul avec lui. Peut-être Youri Goletz avait-il réussi à trouver des arguments pour le convaincre ?
À cause du bruit de la rue et de l’indifférence des gens dans les grandes villes, personne n’avait apparemment entendu de coup de feu. La voisine japonaise n’était pas chez elle. On ne savait donc pas exactement à quelle heure il avait mis fin à ses jours. La police était venue faire le constat, et elle ne tenait pas spécialement à donner des détails aux curieux.
Aurait-il fallu que je l’aide ? pensais-je. Je pouvais réellement, grâce à mes amis yougoslaves, acheter un pistolet sans grands risques. Je n’avais pas la conscience tranquille. Je l’imaginais gisant sur le carreau, dans une flaque de sang et le crâne fracassé, ou le sang coulant de ses veines, ou encore pendu dans le placard au milieu des fourrures de Noémie, bleu, la langue tirée, les yeux exorbités. Je me sentais comme quelqu’un qui n’a pas porté secours à un homme en danger de mort ; comme un lâche qui a laissé tomber un ami.
À ces remords se mêlait un sentiment de culpabilité de nature différente : comme tout le monde savait que j’étais un des derniers à l’avoir vu en vie, j’avais l’impression que l’on me soupçonnait. Madame Ursula Randelis m’avait répété deux ou trois fois au téléphone cette phrase menaçante : « Ah, si je tenais le salaud qui lui a procuré le pistolet », et il m’avait semblé qu’elle disait cela pour moi.
Le docteur Wildgans me libéra de ce cauchemar. Comme s’il avait deviné mes hésitations, il m’aborda et me serra longuement la main. Il me raconta la fin de Youri Goletz : il avait acheté un fusil de chasse et des cartouches pour gros gibier ; il avait appuyé le canon sur le cœur. Il avait laissé sur la table la facture du magasin d’armes, afin d’écarter tout malentendu ; et aussi pour nous prouver à tous que nous étions des empotés et qu’il n’était pas aussi incapable de régler les problèmes pratiques que nous le pensions. Au dos de la facture, il avait couché d’une écriture nerveuse son testament kafkaïen : « Brûlez mes papiers. »
Dans le texte que lut le rabbin, je reconnus une brève notice imprimée vingt ans plus tôt au dos du roman de Youri Goletz. « Né en Ukraine dans les années qui suivirent la guerre civile, Youri Goletz, ancien déporté d’Auschwitz, a vécu à Paris depuis quarante-six. Après des études de philologie arabe en Pologne, en Allemagne et à la Sorbonne, il a travaillé comme correspondant de journaux étrangers. Il a écrit son seul roman – il fut, comme on dit, l’auteur d’un seul livre – directement en français. » Puis il énuméra ses recueils de poèmes, ses textes et essais publiés dans diverses revues, et souligna le rôle important que Youri Goletz avait joué dans l’attribution du prix Nobel à Elias Canetti. « Il a aidé son prochain ; il a tourné sa prière vers Jérusalem ; il croyait en Dieu à sa façon. »
Lorsque le rabbin commença à lire les psaumes de David, en hébreu et en français en alternance, cinq ou six hommes mirent leur calotte qu’ils tirèrent de leur poche ; le docteur Wlidgans se couvrit la tête d’un mouchoir plié en quatre.
Le rabbin lisait, tenant la Bible sur le cercueil comme sur une chaire et s’appuyant de ses poings au couvercle :
« Alors que m’enveloppaient les lacets de la mort et que m’épouvantaient les torrents de Bélial, que les lacets du Shéol m’entouraient, que les pièges de la mort étaient tendus devant moi, dans ma détresse j’invoquai Iahvé. »
Puis il poursuivit en hébreu : « Adonaï, Adonaï ».
« Iahvé, ne me punis pas dans ton courroux, ne me châtie pas dans ta fureur. C’est que tes flèches s’enfoncent en moi et ta main s’abaisse sur moi… Je suis paralysé et moulu à l’excès, je hurle d’un rugissement de lionne. Adonaï, tout mon désir est sous tes yeux et mon gémissement ne t’est pas caché… Mes amis, mes compagnons se tiennent à l’écart de ma plaie et mes proches se tiennent au loin… Ne m’abandonne pas, Iahvé, ne reste pas loin de moi, mon Dieu, hâte-toi de me secourir, Adonaï, mon salut. »
C’était un écho lointain de la voix de David qui nous parvenait des ténèbres de l’histoire et du temps ; ce qu’un poète inspiré et malheureux a écrit il y a quelque trois mille ans arrive encore à nous toucher le cœur comme la lame et le baume.
« J’ai crié vers toi, Iahvé, j’ai dit : “C’est toi mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis bien misérable. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de prison, pour que je rende grâce à ton nom ; autour de moi les justes feront une ronde puisque tu m’auras fait du bien.” »
À proximité de la fosse, sur le bord de la dalle de marbre, j’aperçus un rat mort ; il gisait sur le ventre, comme s’il s’était arrêté un instant ; sa queue, droite et raide, pendait vers le sol comme l’étendard d’une armée défaite. Qu’est-ce qui l’avait amené ici ? De quoi était-il mort ? me demandais-je. Y avait-il là une part de la divine providence ? Youri Goletz, qui était un fin connaisseur du Talmud et des Upanisad, aurait sûrement trouvé une explication à cette présence et n’y aurait point vu de provocation. Je me souvins : « Quelques rats – tels de lourds chars d’assaut – regagnaient leurs garages. » C’était donc, pensai-je, ce rat de la comparaison ; un de ceux qui étaient venus directement de son roman au cimetière du Montparnasse. Car rien n’est permanent, hormis la grande illusion de la création ; nulle énergie ne s’y perd ; chaque mot écrit est comme la genèse.
Je me tenais tout près de la dalle et j’observais. Serrées contre la pierre, et comme tétanisées, des fourmis dirigeaient leurs fines antennes vers cet énorme corps gonflé, sans oser encore s’y attaquer. Et ce rat mort, ce rat vivant du roman, gisait là immobile, sans présenter encore le moindre signe de décomposition, tel un lourd char d’assaut dont une mine a anéanti les chenilles et qui a été abandonné par son équipage.
« L’Abîme appelle l’Abîme ; au bruit de tes cataractes, toutes tes lames et tes vagues ont passé sur moi… Que parvienne devant toi ma prière, tends ton oreille à ma clameur. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au Shéol… Tu m’as plongé au plus profond de la fosse, dans les ténèbres et dans les gouffres. »
Les fossoyeurs, à l’aide de cordes, descendirent le cercueil dans la fosse qui était creusée à proximité de l’allée. Les lettres sur la tombe de Noémie étaient déjà patinées ; la dalle de marbre ressemblait à une plaque de glace ayant survécu à l’hiver ; sur les fils de fer dénudés des couronnes subsistaient des bandes de papier crépon délavées par la pluie.
En passant à côté de la fosse, nous jetâmes une poignée de terre, de même que jadis, dans le désert, on jetait des pierres sur les morts pour empêcher que les bêtes emportent leurs os. Un des fossoyeurs tenait dans ses bras le coffret de bois contenant la terre apportée de Jérusalem ; elle était friable et claire, mêlée au sable du désert. Les couronnes étaient appuyées contre la tombe de Noémie. L’une d’elles portait l’inscription : « À Youri Goletz – Que Dieu te pardonne ». Je compris, bien qu’il n’y eût pas le nom de l’envoyeur : « J’aime les vivants ; je n’aime pas les morts. » Je savais qui pouvait avoir laissé ce message sévère, qui était un signe d’amour.
J’attendis que les fossoyeurs aient placé la dalle de marbre, la même que sur la tombe de Noémie. Puis je les aidai à disposer les couronnes, à part égale. Après tant d’années, tels des amants du temps jadis, ils reposaient sous le même toit ; pas dans la même tombe, mais l’un à côté de l’autre. Après quarante-trois ans de vie commune.
« Excellent bilan pour un vieux couple juif », me dis-je en moi-même.
Post scriptum : Je n’ai pas inventé le nom de Youri Goletz ; c’est tout simplement un des noms que mon malheureux ami Piotr Rawicz a donné au Narrateur dans son unique roman Le Sang du ciel. Son personnage est resté, dans cette nouvelle, à mi-chemin entre la réalité et le monde des concepts platoniciens.
Le prix de la fourrure m’a tout d’abord paru excessif, et j’étais prêt à le baisser de façon arbitraire, en enlevant un zéro. Heureusement, au moment où je terminais la nouvelle, je trouvai dans un journal (du 19 novembre 1982) une réclame d’un grand magasin spécialisé dans la vente des fourrures ; la zibeline, avec un rabais de 15 %, coûtait à cette époque-là 106 000 francs (prix antérieur : 125 000). C’est ainsi que, six mois après avoir jeté un coup d’œil dans la garde-robe de celle qui s’appelle ici Noémie, je découvris que sa fourrure la plus chère devait être la zibeline, que cette fourrure valait bien aussi cher que ce qui était écrit dans la nouvelle et que Y. G., donc, n’avait pas exagéré. En dehors de ces renseignements utilitaires, tel que le prix de la fourrure, je découvris alors toute une faune exotique et revis en mémoire la garde-robe de Noémie, où scintillaient des fourrures d’origine inconnue de moi : vison, renard argenté, renard bleu, lynx, loup américain, astrakan, castor, ondatra, marmotte, ragondin, coyote, qui sont ainsi entrées dans la nouvelle par la petite porte, ultérieurement, suscitant de nouvelles associations, révélant de nouveaux mondes – métiers, bourse, argent, aventure, chasse, armes, couteaux, pièges, sang, anatomie animale, zoologie, paysages exotiques lointains, cris nocturnes des bêtes, fables de La Fontaine ; la nouvelle vous soumet à de grandes tentations. On ne saurait, comme dans le roman, y ouvrir impunément les portes des placards et des armoires.
[1] « Tu es un poète » (en russe). (N.d.T.)
[2] En français dans le texte. (N.d.T.)
[3] En français dans le texte. (N.d.T.)
[4] En français dans le texte. (N.d.T.)
[5] Que Dieu te garde (en russe). (N.d.T.)
[6] Guiougo étant la prononciation russe de Hugo.
[7] Bêtises (en russe). (N.d.T.)
[8] Grand Dieu (en russe). (N.d.T.)