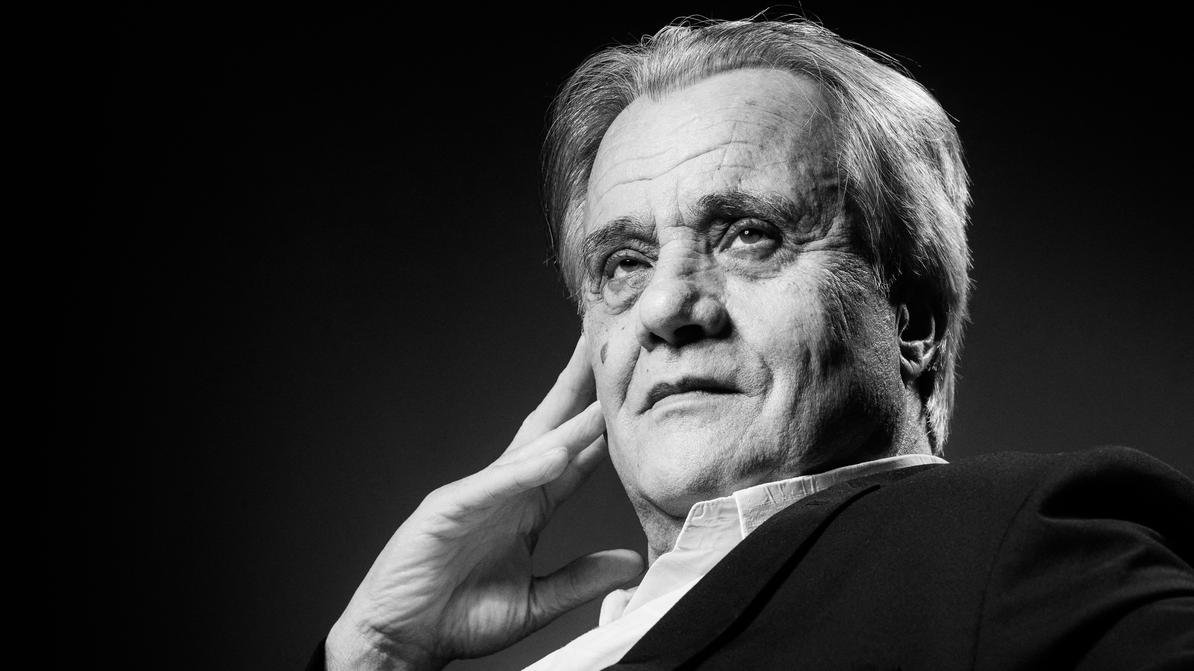Masud Khan reprochait aux psychanalystes de recourir avec suffisance à leur « vocabulaire », c’est-à-dire au vocabulaire de la métapsychologie freudienne, pour se garantir de ce qu’ils appelaient le malaise de penser dans le champ de la clinique psychanalytique. Pourquoi parler de malaise de pensée ? Je crois que Michel Schneider apportait en 1982, dans un article intitulé À quoi penses-tu ? publié dans le numéro 25 de la Nouvelle Revue de Psychanalyse une réponse intéressante. Il y soulignait la forte analogie entre la pensée et le symptôme, car de l’une comme de l’autre on ne sait d’où ils viennent. L’analysant et le penseur disent la même chose. Le premier dit : « Ne m’arrachez pas ce symptôme auquel je tiens plus qu’à ma vie » ; et le second : « Ne me prenez pas cette pensée par laquelle je me suis constitué une identité – fragile, criblé de dettes, mais une identité tout de même ». Pensée propre, symptôme vital, à situer dans le registre des illusions nécessaires.
*
Dans le même article, Michel Schneider souligne que si l’on n’est jamais seul dans sa pensée, on est en revanche toujours seul dans l’acte de penser. Cet acte, essentiel et fragile, est ce qui ne se partage pas. Penser s’adresse au lointain au sein duquel on peut toujours s’effondrer. C’est pourquoi pour représenter cet acte, ou cette activité, ce n’est pas à l’homme assis devant une pile de livres, dans la chaude lumière dorée des bibliothèques, qu’il retourne, mais à l’enfant creusant la terre de ses mains, faisant des trous, creusant inlassablement de grands trous dans la terre, pour savoir ce qu’il y a de l’autre côté. Savoir qu’il n’y a rien. Ensuite, dit-il, la terreur se mêle de raison et c’est de l’autre côté des mots, puis des livres, que l’on cherche.
*
Winnicott et les analystes du « Middle Group » ont fait du malaise de ce qui ne se partage pas l’un des axes de leur travail, à partir duquel ils se sont efforcés de penser comment, au juste, un lien peut se construire. Le lien dont il s’agit en analyse, nous l’appelons transfert. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un lien dans lequel l’analyste est mis en place et position de mère. Ce qui veut dire que l’analysant aura à apprendre à mettre entre lui et sa mère une autre langue que la dite maternelle, où il aura à apprendre à passer outre à la pensée de la mère, à la pensée comme mère, à sortir, comme le dit aussi Michel Schneider, de l’échange fou où la mère soutient son enfant de ses mots, où les mêmes mots le retiennent. C’est passer de la pensée, qui est toujours, comme le disait Lacan, du « ready-made », au penser. C’est sortir de l’assujettissement.
*
La psychanalyste suisse Alice Miller s’est beaucoup intéressée à la question du narcissisme. Elle introduit sa question par un proverbe : « Lorsqu’un sot jette une pierre dans l’eau, cent sages ne peuvent l’en ressortir. » De ce proverbe, de sa lecture plutôt, elle passe au mot, à la notion de narcissisme : le même sort lui serait advenu ; il a été jeté dans la langue commune, de telle sorte que les psychanalystes sont bien embarrassés, car il semble ne plus leur être possible de l’en faire revenir pour lui donner une rigueur conceptuelle semblable à celle qu’il aurait eu avant de se voir abandonné au discours courant. Son souci est donc d’essayer de retrouver cette notion, d’en raviver le sens, pour tâcher de voir quel usage on pourrait psychanalytiquement en faire. Elle va jusqu’à dire que la notion de narcissisme a été galvaudée à un point tel qu’il est devenu presque impossible de s’en servir pour l’élaboration d’un concept psychanalytique précis. Il y aurait même, selon elle, un paradoxe assez étrange : plus les psychanalystes déploient des efforts pour préciser cette notion, plus son installation dans la langue commune est assurée, et plus son sauvetage devient difficile. Essayons d’y voir un peu plus clair.
Elle pose le problème qui a fait dès le début la difficulté de la psychanalyse, à savoir : comment peut-il y avoir de l’autre ? Donc, comment se lier est-il possible ? Et puisque cela doit avoir lieu, il faut se demander comment cela peut avoir lieu. Et d’abord pour l’enfant. Car il n’y a pas lieu d’idéaliser l’amour parental, à commencer par l’amour maternel. Il n’y a pour Alice Miller aucune raison de penser, ou de croire, que ce corps étranger qui grandit dans le corps de la mère – et dont Freud faisait remarquer qu’il est le seul corps étranger, à l’exception de la cellule cancéreuse, que l’organisme ne rejette pas –, que ce corps étranger, donc, cette autre identité qui vient entamer celle de la femme qui le porte, l’entamer au point qu’elle ne sera plus jamais seulement femme, au point où elle sera désormais aux prises avec la question de savoir ce qui advient d’elle en tant que femme maintenant qu’elle devient mère – et cela même si c’est d’être mère qu’elle se sent enfin femme. Il n’y a donc aucune raison de croire que cette entame, cette limitation, cette altération d’elle-même, elle la supportera bien et qu’elle accueillera facilement l’enfant qu’elle a pourtant tellement voulu ou désiré. Par cet autre, son narcissisme sera tout à la fois accompli et entamé, menacé et renforcé, fragilisé et consolidé. On peut bien sûr faire de ces propositions une lecture simple, en restant au niveau de cette apparente naïveté. Mais on peut aussi les lire comme, en quelque sorte, une allégorie, car c’est toute la difficulté du rapport à l’autre telle qu’elle se pose pour Freud à propos du narcissisme qui s’y rassemble et qui y trouve une expression dramatique : toute relation à l’autre est toujours déjà menacée, à commencer par cette toute première relation. Aucune n’y échappe.