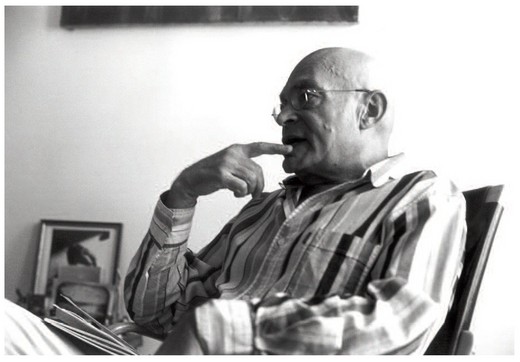5
Étrangement, moi qui m’étais toujours méfiée de l’enchantement du corps à corps, j’avais totalement confiance en ce qui nous arrivait. Je crois que c’est précisément ce qui trahit le vrai amour, qui peut-être toujours inquiète le désir, non parce qu’il l’obligerait ou viendrait le contrarier mais parce qu’il l’accorde autrement, bien plus loin, de manière vitale, le raccordant à des zones désertées, abandonnées de tous, très archaïques, hors-mémoire même, qui lorsqu’elles sont rejointes, réveillées, nous sont d’abord très douloureuses. C’est ce qui fait du désir un traumatisme, comme peut l’être la joie.
J’ai su, la première fois que nous avons fait l’amour, que je n’en reviendrais plus. Oui : j’ai été retournée, renversée. Oui : ma vie me fut révélée, et aurait continué de l’être. Par ce même acte, le même pourtant chaque fois nouveau, j’aurais été affectée entièrement, sans reste. Et je pense aujourd’hui que c’est justement de cela que tu n’aurais pas été capable et qui t’a fait fuir. Ta pratique du secret, de la dissimulation est très ancienne, tu as toujours vécu ainsi, loin de ta vérité en quelque sorte. Et ce qui t’arrivait avec nous te rendait cette dissimulation impossible. Tu aurais été contraint de porter la quittance de ce qui t’arrivait, tu n’aurais pu te dérober.
J’aurais voulu te dire qu’il ne fallait pas t’inquiéter, que ça n’était qu’un changement de ressort dramatique qui jouait sur la multiplicité des voix : voix du dedans, voix venues du dehors ; voix actuelles, voix anciennes ; voix familières, voix étrangères. Il s’agit toujours de la même chose : comment se faire sujet de sa voix ? Que dire ? Pourquoi le dire ? À qui le dire ? Comment dire ? Comment parler ? C’est l’une des questions de Beckett : parler avec sa tête ne va pas très loin ; parler avec son cœur donne des morceaux de bravoure ; parler à partir de sa propre chair mise à nu sous une peau déchirée peut toucher au vrai. C’est ce qu’il nous aurait fallu faire, et que nous avions commencé à faire, et qui t’a inquiété. Je t’aurais dit que le monde n’est pas hostile, re-serti dans le vitrail de cette sidérante histoire, dans la force de ce nouvel attachement, incomparable, inimaginable, inouï. Mais tu as fui.
Réduite à moi-même, il me fallut trouver des points d’appui pour me dégager de l’inconsistance intérieure à laquelle ton retrait m’a confrontée, pour parer au retour d’une menace d’effondrement psychique. Soudain, je ne savais plus où j’allais, les mots perdaient leur sens – et pour que la catastrophe soit complète, les sens perdaient leurs mots. C’est exactement ça : les couches emboîtées qui donnent son assise au sens se désagrégeaient successivement. L’idée même de sens perd tout sens dans l’angoisse. Tu n’étais plus là, je ne savais plus, tout se précipitait soudain, j’étais emportée je ne savais où, qu’allais-je faire ? Je connaissais jusque-là ma vie par cœur, mais voilà que quelque chose m’arrivait qui faisait que je ne pouvais ni rester où j’étais, ni partir. Je ne pouvais qu’attendre.
Tu t’en étais allé une fin d’après-midi, il y avait cette lumière étrange qui vient, souvent, après une journée de pluie, ininterrompue, lorsque le soleil réapparaît et que le ciel s’éclaircit trop tard pour être d’une quelconque utilité. Je me souviens être restée assise sur un banc à regarder ce ciel inutile. Je me sentais agitée, et très violente. Quelque chose devait changer, je ne savais quoi, quelque chose qui rendrait possible une naissance plus vive, ou une mort plus réelle, une sortie de ce murmure de souvenirs et de rêves. Je me rappelais nos nuits si réelles, si profondes, ces nuits que nous espérions sans matin, à nous demander comment nous ferions demain, comment nous endurerions demain, l’aube, puis le jour, jusqu’à la nuit suivante qui nous trahirait. Comment allais-je endurer ça ?
L’aube est presque là, ce qui n’est pas une heure, mais c’est tout ce qui me reste, ces heures improbables pour t’écrire, te faire vivre avant d’enfin te perdre. Je cherche ta voix, ton visage, ta peau…
Le temps avait d’emblée été la question majeure entre nous, il avait été posé comme ce qui toujours manquerait, puisque le mien était tout entier donné. Je donnais déjà tout mon temps : à mon travail, à mes enfants, à Pierre, à mes amis, à l’imprévu qui arrive toujours. Nous aurions ce qui resterait, mot à la fois inquiétant et magnifique puisqu’il dit ensemble la scorie et l’éternité, il retire et promet en même temps, justement, l’essentiel. Je te le disais d’ailleurs, comme Madame de Maintenon l’écrivait à Madame Brinon : ils prennent tout mon temps ; je te donne le reste, toi à qui je voudrais tout donner. Je te disais, en somme, qu’à eux, donc à tous sauf à moi-même, je donne tout. Car à donner tout son temps, on donne tout, on donne le tout, si tout ce qu’on donne est dans le temps et qu’on donne tout son temps. Je t’avais prévenu : je ne pourrais pas prendre mon temps, je n’en avais plus. Ce qui revenait, en bonne logique et en bonne économie freudienne new look, à te dire que déjà je t’aimais, puisque je te donnerais ce que je n’avais pas, ou plus. J’avais alors pensé qu’il te faudrait, toi, me le prendre, m’arracher ce dont je me disais dépourvue. Ce qui serait revenu, j’en suis aujourd’hui certaine, à me le rendre, c’est-à-dire à me rendre, moi, à ce qui était mien et que je ne savais pas avoir.
Qu’est-ce qu’avoir du temps ? Je t’avais si souvent dit combien j’aurais aimé en avoir davantage. Soupir infini du désir insatisfait : tout le temps que déjà je donnais me laissait à désirer. Il nous serait donc resté le tout de mon désir, et voilà ce que je nous aurais donné. Mais ce sera impossible, me disais-tu, tu n’auras pas le temps de nous donner le temps qu’il faudrait. Soit, t’avais-je rétorqué, nous commencerons donc par l’impossible, histoire de lui régler son compte. Je te proposais de nous laisser entraîner par l’impossible, il nous emporterait au-delà de nous-mêmes, de ce que nous savions faire, de ce que nous connaissions.
On ne parle pas clairement du temps, pas même de celui qu’on a, ou n’a pas, ou voudrait avoir. De quoi alors parlais-je en parlant du temps que je n’avais pas, et n’aurais pas ? Que te disais-je exactement ? Rien, justement,exactement : seulement ma confusion, ma peur.
Je t’ai tout de suite aimé, j’ai tout de suite su que la stupeur ne passerait pas, que la magie ne s’épuiserait pas. Que tu serais une fatalité à laquelle je reviendrais sans cesse. Et en effet : cette certitude s’est enfoncée en moi chaque fois que je t’ai vu, que je t’ai touché, que je me suis couchée sur toi, sous toi, pour tenter de m’anéantir. Et c’est là qu’a commencé la douleur. On n’apprivoise pas la magie, ni la terreur, ni le mystère. Ni même la joie.
6
La stupeur, oui. De toute façon, en pleine clarté ou dans l’ombre, je n’ai jamais cessé de rêver de l’obscur. Ou de la lumière de l’obscur. Et cela depuis les premières choses que j’ai dites de tout ce qui a toujours hanté mes veilles et mes nuits. Je suis depuis toujours exilée, et voilà que tu me cueillais où je me défaussais, où je me défaisais. Comment aurais-je pu ne pas céder à cette force et ne pas faire place à cette joie immédiatement habitable ? Aussi loin que je regarde en arrière, j’ai honte de ne pas avoir su échapper au devoir de prudence qui m’a toujours éloignée de cette joie sauvage.
Que m’as-tu fait, que t’ai-je laissé me faire, à quoi me suis-je soudain ouverte, comment fut-il possible que je me sente soudain capable d’accueillir ce qui m’avait toujours effrayée ? Que m’as-tu à ton insu donné, qui m’a arrachée à la haine, à l’inhibition, à la terreur dans lesquelles j’avais jusqu’à toi vécu ? Cela ne tenait qu’à toi mais tu n’y étais pour rien, tu ne l’avais pas voulu, c’était un don dont tu ne savais rien. Et pourtant, tu es toujours resté au fond de moi si inatteignable. Je ne crois pas que je comprendrai jamais ce vertige.
Souviens-toi, cela ne cessait d’arriver, de survenir, de bousculer, d’envahir, de surprendre. Je croyais connaître mes repères, mes limites, ma place. Je ne savais pas. Je ne m’en savais pas capable. Je ne savais pas ça de moi. Jamais je n’avais désiré qui que ce soit ainsi. Jamais je n’avais voulu, désiré, espéré, eu besoin de donner de moi ce que j’ai voulu te donner et qui m’effrayait. Nous partagions la même peur absurde. Je t’ai voulu au-delà de ce que tu donnais. Je t’ai voulu absolument. Ton histoire secrète, interdite. Ce que tu voyais comme abject en toi. Je voulais ces mots-là, qui te faisaient peur, qui te faisaient jouir. Nous parlions la même langue secrète. Nous aimions, souvent dans la terreur, les mêmes mots, les mêmes gestes qui nous enchantaient. Nous partagions cette peur d’aller vers ce que tu appelais la laideur, la vérité nue, crue, du sexe, du corps, du visage, sans image de soi à protéger, la crudité et la cruauté des mots, des gestes, pas nécessairement leur violence au sens strict, mais une violence quand même, la violence de l’érotisme.
J’avais confiance. Je nous croyais capables de trouver une issue, d’inventer. Tu avais toujours ce mot aux lèvres : inventer. Et j’ai mis longtemps à comprendre que tu parlais en fait d’autre chose : de la nécessité de l’utopie dans nos vies, nécessité que je n’avais pas su reconnaître. Ce site de l’idéal, cette figure d’horizon est en réalité non pas au-devant de nous, mais là, présente à chaque instant. Et faire droit à cette espérance, à ce rapport à l’absolu, c’est ne pas se refermer uniquement sur l’ici et maintenant, sur le quotidien, mais être débordé, déplacé par quelque chose qui nous précède et nous désarme. Peut-être est-ce notre rapport à ce lieu-dit spirituel qui déplace, de l’intérieur, tous les cadres. C’est peut-être ce qui permet de sortir de la peur…
***
Je n’ai presque pas dormi la nuit dernière, je flotte plus que jamais, dans une sorte de non-lieu – mais c’est plutôt agréable. Dans cette torpeur étrange de l’insomnie prolongée par le jour, certaines choses m’apparaissent autrement. Cette peur, par exemple, d’être abandonnée, qui se retourne en violence, et la sérénité (ou presque) dans cette violence. Parce que j’y suis seule et que j’y domine ma peur ? Je pense parfois que nous étions semblables à ces paysages fous, aux cieux renversés, aux montagnes déchaînées, avec lune de pierre, arbres spectraux, rivières gelées, et nous essayions de les recomposer, comme Alice à côté de son miroir. Ce paysage insensé, fracassé, n’offre pas de refuge. Il nous aurait pourtant fallu réussir à l’habiter, à nous y loger.
Je suis encore aujourd’hui émerveillée de constater combien de terres désertées notre relation nous avait fait regagner. Émerveillée aussi par la manière que nous avions d’être ensemble physiquement. Jamais je n’avais été si intensément, si entièrement présente avec quiconque. Comme si un temps à l’intérieur du temps, un espace à l’intérieur de l’espace, une nuit à l’intérieur de la nuit s’ouvraient. Je veux dire que ce qui s’ouvrait là, entre nous, c’était la possibilité d’un temps infini dans un temps fini, d’un espace infini dans un espace fini, d’un abandon à toi, à nous, que je ne connaissais pas. Il y avait dans cet érotisme qui nous liait quelque chose dont je ne suis pas revenue. Je trouve bouleversant de voir à quel point l’érotisme, le vrai, si j’ose dire, ouvre l’esprit, la marche intérieure, les champs de la créativité. Tout ça gît dans l’espace du désir ouvert par les amants. Et cela t’a fait peur.
***
J’ai rêvé de toi la nuit dernière. Je ne me souviens plus de quoi il s’agissait exactement ; tout ce dont je me rappelle est qu’il y était question de cordes. Et en me réveillant, j’ai tout de suite pensé que l’on parle de l’âme d’une corde pour designer son centre – mais je n’ai rien pu faire de cette idée. Je me suis levée malgré qu’il faisait encore nuit. Je me suis fait un café et suis allée dans mon bureau pour continuer à t’écrire. En t’écrivant, je levais de temps à autre la tête et regardais les livres autour de moi. Je les regardais avec tes yeux, repensant à ce que tu m’avais souvent dit à propos du poids des ans, de ces temps immenses passés à lire, de ces univers où nous nous étions l’un et l’autre si tôt engouffrés. J’ai le souvenir de moments quasi extatiques à la découverte de certains textes. J’ai tant aimé cette fulgurance. On n’oublie jamais, je crois, ce qui nous a ravi, au sens vrai du ravissement. C’est comme certaines rencontres amoureuses ou érotiques. Peut-être parce qu’on s’est alors accordé la possibilité d’élargir le champ de notre perception, de notre capacité d’aimer, de jouir, de penser, d’être retourné. Les livres ont toujours été pour moi le lieu d’une amitié et d’une fidélité indéfectibles. Je pouvais, et je peux toujours, m’appuyer sur eux, jamais ils ne me faisaient défaut. Et je me suis dit, pensant cela, qu’ils comptaient parmi les « cordes » entre toi et moi, qu’ils étaient comme le fil du funambule. Qu’ils avaient un vrai pouvoir de consolation, et d’affranchissement, comme nos lettres. L’écriture nous était une terre commune. C’est un acte. Un acte de délivrance et un acte par lequel on se livre à l’autre, un acte de foi dans le langage et dans l’autre, dans la possibilité de la vérité. Comme l’érotisme.
Nous n’aurions pas pu ne pas nous écrire. Je repense souvent à cette page du Journal de Clarice Lispector, où elle parle du courage de ne plus écrire, de ce qui pourrait être une « décision joyeuse » : ce serait la seule chance, la condition, ce qu’il faudrait se donner pour que quelque chose enfin se passe. C’est une réminiscence de Valéry, il me semble, tu reconnais ça ? Mais tu ne me répondras pas, je ne veux pas que tu me répondes, je ne veux plus que tu m’écrives, je ne veux pas de traces supplémentaires.
Nos lettres furent nos archives. Il n’est pas de relation sans archives. L’amour, la passion, le sexe, ne sauraient s’en passer. Mais se laissent-elles jamais consulter ? Et pourquoi d’ailleurs le ferait-on ? Que pourrait-on espérer délivrer en les consultant ? Est-ce pour cette raison que tu m’as renvoyé toutes mes lettres, pour te délivrer de notre passé ? C’est peut-être ce qu’on espère toujours à l’occasion d’une séparation. On convoque les archives pour expliquer, justifier, légitimer la nécessité de partir. L’histoire d’amour s’archive peut-être au fur et à mesure qu’elle se fait parce que la possibilité de la séparation s’inscrit dès le premier moment, dès l’avènement de l’événement.
7
Nous disons vouloir la vérité. Nous savons mais nous n’acceptons pas ne pouvoir la dire toute. Et la vérité n’est jamais sûre : ce qui aujourd’hui est, pourrait demain ne plus être tel. L’angoisse n’en finit pas. Sans relâche nous appelons la vérité, la convoquons, tâchons de l’arraisonner, de la capter. Nous voulons l’assurance, la certitude sans mélange de la vérité une fois pour toutes et irréversiblement donnée. Nous en concevons même un devoir. La vérité serait un dû. Il y aurait au principe de toute relation un « nous nous devons la vérité ». Nous voulons tout savoir, y compris l’envers des choses. La promesse de tout dire, de tout révéler, est implicite et attendue. Mais.
Il n’est pas vrai que l’on peut dévoiler l’envers des choses (Lautréamont parlait du « puéril revers des choses »). C’est pourquoi on passe sa vie à chercher des mots ajustés aux circonstances qui l’ornent. Il faut accepter l’errance, l’incertitude. On cherche un lieu d’équilibre, un repère dans la tempête, des augures, on espère que de nouvelles vues s’ouvriront tandis que d’autres se ferment. Que faire quand toujours en soi cet affrontement : se déplacer, se poser ? On cherche un lieu à l’écart des confusions et des douleurs héritées de qui nous a précédé. On rêve de jardins, de désir et de simplicité. Il s’agit de considérer l’histoire dont on est issu. Se soustraire au poids des générations mortes. Si possible lever la tête du « mol oreiller de l’ignorance » sur lequel nous dormons. Éviter les erreurs d’engouement. Et il faut une adresse, c’est-à-dire quelqu’un. Quelqu’un qui sache ce dont nous avons besoin quand nous-mêmes l’ignorons, qui nous donne ce dont nous avons besoin quand nous ne savons même comment demander. Ni même que demander est possible, et nécessaire. Quelqu’un qui nous rende à nous-mêmes. C’est l’amour. Tu aurais été cet amour. Je l’aurais cru.
Tout est allé si vite. Je t’ai tout de suite intériorisé, tout de suite laissé te loger dans mon orient secret. Tu as creusé un espace vertigineux en moi, je n’en reviens toujours pas. Mais les forces t’ont manqué pour te hisser constamment vers le lieu où la vie elle-même est un miracle. Je n’ai jamais conçu de vivre autrement. J’ai été tentée, très tôt, de rester « hors du monde », immergée dans les livres, dans l’entremêlement de mes personnages imaginaires. Cette intensité que je cherchais dans la littérature, que je trouvais parfois dans l’amitié, je ne savais pas comment la miser ailleurs. Je me suis jetée, littéralement, à corps perdu (longtemps perdu) dans la vie heureuse, et j’ai voulu cette vie-là, excitante, merveilleuse, drôle. J’ai voyagé, beaucoup, aimé parfois, espéré, me suis échappée aussi – trop souvent. Et tu m’as rattrapée. Tu es venu me chercher là où personne, jamais, ne m’avait trouvée. Mais ta présence ne fut qu’un sursis – et voilà la colère qui me submerge à nouveau.
Je suis assise au salon. Je vois à peine les vignes à travers les vitres embuées. Pas un bruit ne me parvient. Je suis en colère contre moi, contre toi, tes compromis, tes évitements, cette manière qui fut toujours la tienne de t’enferrer dans des emplois du temps de plus en plus serrés, absurdes, où tu n’avais plus de temps pour nous, ni même pour toi. En même temps, je comprenais : on accumule si facilement tant de choses à faire, de promesses à tenir, et personne ne connaît nos serments, parfois si anciens… Jamais tu ne t’es engagé vraiment, avec personne. Voici mon hypothèse : il y a une ambivalence, une difficulté à quitter la vie utérine, c’est-à-dire à quitter les rêves de notre mère et à consentir aux nôtres propres. Cela entraîne de la peur, de l’excitation, de la joie, de l’espoir et de l’illusion. Il faut du courage pour consentir, sans se cacher, à cette envie de liberté. D’où cet appel, en même temps que ce refus, à aimer et à s’abandonner. Cela me rappelle cet après-midi de mars où tu étais venu me rejoindre, et ce qui s’était passé pour moi après. En te quittant, j’étais comme dans un autre corps, exposée, vulnérable. J’avais envie d’être cachée, ou transparente, comme si la jouissance qui m’avait traversée était visible, obscène. En même temps, j’étais heureuse, je ressentais une gratitude infinie pour ce qui m’arrivait, nous arrivait, voulais-je croire. Pour cette intensité, ce risque de vivre que j’ai depuis toujours envie de courir, que j’ai en effet couru à quelques reprises, mais toujours seule, et que nous aurions rendu possible. C’était cette fois si totalement inattendue que j’étais restée stupéfaite par la rapidité avec laquelle le feu s’était propagé. Je te l’avais dit – et tu as fui. Et je t’en veux pour ce vide terrible que tu as laissé, cette solitude effrayante, après s’être tant donné, dans laquelle tu m’as laissée. Je voudrais être une autre, dans une autre vie. Je te hais, je hais ta lâcheté. C’est d’ailleurs pourquoi j’avais brusquement cessé de t’écrire. Je n’avais plus la force de soutenir, j’allais dire d’affronter, la chance qui nous était donnée et que tu ne cessais de nous retirer. Ce feu, si je l’avais entretenu, aurait détruit tout ce que j’avais construit. Tu me laissais trop seule. On ne guérit pas d’une telle métamorphose. On ne revient pas indemne d’un tel voyage. Alors je me suis mise à chercher une issue, j’ai cherché à m’enfuir, à nous perdre, je ne voulais pas de ces « frissons froids que donnent les immenses bonheurs », de ce bonheur sur fond noir, du désert crayeux dans lequel je m’éveillais tous les matins. Ce bonheur était au-delà de mes forces, il me fallait trouver un chemin de traverse. Je me faisais l’impression, certains jours, d’être un clown dans une comédie des erreurs. Je cherchais la bifurcation, il devait bien y en avoir une. J’essayais de calculer une dissolution. J’étais, depuis ta rencontre, éveillée comme jamais je ne l’avais été et c’était insupportable parce que tu ne m’y rejoignais pas. C’est Kafka, que je t’avais si souvent cité : « Je t’aime, comme la mer aime le gravier de ses profondeurs. » Par toi, j’aurais voulu, j’aurais cru m’absoudre. C’était absurde. Je n’étais plus moi que quand tu étais avec moi, je ne supportais pas que le soir tombe et que tu ne fusses pas là. Le jour, passait encore, mais le soir, mais la nuit, non, tu me manquais trop. Je ne savais plus ce que je faisais de ma vie et la vie est si courte. Comme dit l’autre, entre dépenser du temps et le vivre, il y a un abîme.
Alors, la première idée qui me venait en me levant, tous les jours (ou presque), c’était que le mieux serait de tout lâcher, tout, famille, amis, carrière, nous (surtout nous), et partir. J’étais débordée, et pourtant très calme. L’évidence était là, tu me l’avais révélée : ma pensée habitait le même espace impossible que mon désir. Je passais mes journées à essayer de transférer ce que je vivais dans un monde de mots médités, pesés. C’était malgré moi, c’était plus fort que moi, et c’était usant.
Il fallait donc rompre, et tu le savais. Il fallait rompre – et c’était impossible. C’était impossible absolument, tu le savais aussi, comme moi. Il serait impossible, désormais, de vivre absous, détachés ou délivrés de ce lien ; ce que nous avions été, ce que nous étions, continuerait d’exister même si nous nous séparions. Et pourtant, jusqu’à la fin nous serons demeurés étrangers. Nous étions l’un et l’autre trop sauvages, trop étrangers même à nous-mêmes pour qu’il pût en être autrement. Tu m’avais un jour dit : « je suis celui envers qui tu n’auras aucune obligation, à qui tu n’auras aucune excuse à présenter, avec qui il n’y aura pas de malentendus : il suffira de la vérité. Je veux tout de toi mais je ne te demande rien. Je te veux telle que tu es, telle que tu dois être, telle que tu ne peux qu’être. Désespérément entière, absolument seule. » Tu mentais.
***
Il est tard.
J’ai envie de hurler.
Je repense à la dernière fois où nous nous sommes vus.
Nous ne nous étions pas touchés. Ou à peine. Je t’avais cherché, un peu, au début, et puis j’ai abandonné la partie quand j’ai compris que le temps était compté.
Pas de baiser, sinon celui que des amis proches se font quand ils se disent adieu avec un peu d’émotion. Il nous a toujours fallu du temps pour nous aimer physiquement, nous mélanger. Mais jamais comme cette fois-là. Je savais que nous ne ferions pas l’amour, je n’imaginais pas la hâte et le désordre des corps, pas là, pas comme ça – mais je n’imaginais pas ce désert. Oh, léger, délicieux, avec conversation enjouée, sollicitude et bienveillance. Tout cela, oui – et l’enchantement perdu, cette chose qui serre le cœur et qui ne se commande pas.
Tu étais parfait pourtant. Magnifique, élégant, drôle, le meilleur des amis. Mais nous n’étions plus amants.
***
Il fait nuit. C’est comme si ton parfum, ta présence (mais à peine) flottaient dans la pièce. Va-t’en.
8
Je lis les lettres de Clarice Lispector. Je pense, comme elle, qu’il ne sert à rien de désespérer, que désespérer est encore plus facile que travailler ; qu’il est possible d’avoir la nostalgie de soi-même ; qu’il faut s’habituer à être seul, même quand on est avec d’autres ; qu’il est possible d’aimer les choses écrasantes – et je suis en effet écrasée, et le désespoir me tente, et j’ai la nostalgie de ce que j’étais, et je ne m’habitue pas à cette solitude. C’est pourquoi je t’écris une dernière fois. Je me sens rivée à un désastre.
Je me suis très vite sentie entièrement abandonnée. Tu ne comprenais pas ma résignation, pourquoi je ne réagissais pas à tes provocations. Alors tu en rajoutais, tu m’agressais, tu étais injuste. Tu aurais voulu que je sorte de l’échiquier, que je t’arrête, que je te dise que je te voulais, que j’en avais marre de tes voltes soudaines, que je cesse de te comprendre, de te respecter, de te trouver des excuses, de t’attendre. Tu aurais voulu que je te viole. Mais tu n’avais rien compris ! C’est comme si ma vie avait été sans événement, sauf un seul, quelque chose de monumental et d’abject et de merveilleux, voluptueux et inquiétant, qui m’avait poussée où j’étais : ta rencontre. J’étais emplie d’une douleur inconnue, plus claire que le jour le plus clair, plus terrible que celle d’un enfant. Je te demandais secours sans réussir à t’indiquer où j’étais, je m’en rendais bien compte, c’était absurde.
J’étais dépassée. Ce qui me dépassait portait le nom de ce qui m’arrivait depuis toi, avec toi.
***
J’ai relu tes lettres. J’y avais cru, j’ai eu tort. Voici la première, que tu as probablement oubliée :
« Je pensais avoir cette fois réussi à te perdre, te quitter. Mais il a suffi que tu me laisses dire, sans me répondre, pour que je m’affole. J’ai essayé de tenir, de ne pas te rappeler. Mais trop de souvenirs m’ont envahi. Je t’ai retrouvée, vraiment. Je n’avais pu le faire jusqu’à présent parce que je me mettais en quelque sorte moi-même en travers du chemin, m’étant perdu et ayant besoin, moi aussi, d’être trouvé. Alors nous étions comme deux enfants perdus en forêt, comme ces enfants des contes cruels qu’on nous lisait. Mais peut-être n’y a-t-il plus aujourd’hui qu’un seul enfant perdu, toi, qu’il me faut venir chercher, arracher à la forêt pour l’emmener vers des terres plus hospitalières. Et s’il refuse de se laisser emmener, alors je lui rendrai visite, là-bas, dans sa tanière.
Tu vois, lorsque tu m’as écrit il y a quelques semaines que jamais les mots de qui que ce soit ne t’avaient touchée comme te touchent les miens, j’ai bien réfléchi à ce que tu essayais de me faire entendre. Je ne suis pas certain d’avoir compris ce que tu voulais dire exactement, mais je veux que tu saches que je t’ai prise très au sérieux, que je t’ai crue. Et puis une autre image m’est venue. Je te voyais prisonnière d’un immeuble en feu, prisonnière d’une agonie qui dure depuis toujours. J’ai aussi été prisonnier de ce lieu, de cette même agonie. Et nous l’avons également, un temps, été ensemble. Mais j’en suis sorti. Et je t’entends m’appeler, de ce long cri qui dure depuis des années. Tu me dis que je suis le seul à t’entendre, ou que mes réponses sont les seules qui te parviennent. Je ne sais pas – mais, oui, je t’entends, ce que j’essaye aujourd’hui de te dire est que cela, en tout cas, est certain. Et que je ne disparaîtrai plus. Peut-être pourras-tu sortir de cet incendie, peut-être pas. Mais, au moins, tu sauras que je sais que tu y es prise, et tu pourras dire comment c’est d’être ainsi prisonnière.
Tu me disais encore que la seule chose que tu puisses concevoir est de créer des histoires dans lesquelles tu puisses trouver place, que ton seul espoir est de devenir un personnage de quelque histoire. Alors, écoute : dans mon histoire, il y a une place pour toi. Dans mon histoire, je suis quelqu’un qui t’aide à trouver la tienne, d’histoire. Dans mon histoire, tu es quelqu’un dans l’histoire de qui ma propre histoire peut s’inscrire. »
Tu t’es bien relu ? Ne trouves-tu pas ça fou ?
Relis maintenant celle-ci, reçue le même jour :
« Je viens de nager. Je vais maintenant dîner d’artichauts à la romaine et d’un verre de vin, puis j’irai me coucher. Et je lirai avant de dormir quelques pages de Light in August. Je sais, tu n’aimes pas Faulkner.
Mais je voulais encore te dire deux choses avant d’aller au lit. D’abord, que j’ai bien compris que tu es fatiguée. Que tu es épuisée et que quelque chose est en train de t’arriver, que tu ne reconnais pas, quelque chose de nouveau, qui te donne l’impression que tu es en train de te défaire, de te désintégrer, que c’est la fin. Et tu ne comprends pas comment il se fait que tu n’arrives pas à vivre au présent, que tu ne puisses toujours que te rappeler l’avenir (si tu vois ce que je veux dire). Tu ne peux dans ce cas que t’épuiser à essayer d’empêcher que n’advienne l’avenir dont tu te rappelles – et ainsi constamment le recréer (sans jouir un seul instant de ce qui a lieu). Mais peut-être cette énigme est-elle aussi une ouverture, un commencement (oui, même à ton âge), une entrée dans un à-venir réellement nouveau (et par conséquent inimaginable).
Et l’autre chose que je voulais te dire est que j’espère que tu n’abandonneras pas cette part de toi qui est depuis toujours scellée et qui désespère de se faire entendre, que tu ne céderas pas à l’envie de faire mourir cette part de toi, que tu n’achèveras pas le travail commencé par ceux qui t’avaient fait naître.
C’est à tout cela que je réponds. J’espère que tu n’apprendras jamais à faire taire l’enfant que tu as été et que tu es toujours. »
***
Ces lettres m’avaient évidemment touchée, elles m’avaient presque convaincue. J’avais longuement hésité avant de te répondre, car il y avait ceci que je ne comprenais pas : pourquoi a-t-il fallu que je me retire pour que tu puisses enfin te décider à t’engager ? Lis plutôt :
« J’avais cru ne pouvoir te répondre ce soir mais j’ai finalement pu me libérer plus tôt que prévu. Alors je m’empresse de te dire ceci, que tu pourras lire après-demain j’espère : j’avais oublié à quel point tu es sans défense, plus encore que je ne l’avais d’abord cru.
Je crois que ce que tu me dis depuis longtemps, c’est quelque chose comme ceci : “viens, approche – de toute façon tu partiras, tu disparaîtras.” Et tu dis en même temps : “si tu ne disparais pas, tu me tueras.”
Je suis si touché par l’espoir indomptable que tu portes, que tu incarnes, que tu es. En dépit (en dépit ?) de toi-même, de ta certitude tout aussi indomptable que tu seras abandonnée, ou tuée, de n’avoir jamais vraiment vécu, qu’on te détruira, qu’on ne t’accueillera jamais que pour très vite te rejeter à la rue. Je veux que tu saches que je sais le risque que tu ne cesses de courir. Mais il t’est si difficile de savoir ce que tu ressens, et tu caches tellement bien cette incertitude, qu’on te croit souvent insensible. Ce qu’on ne comprend pas, c’est que tu es paralysée, sidérée. Alors les voix s’élèvent, on hurle, on t’agresse – et tu te retires de plus en plus en toi-même, de manière à ne plus les entendre. Et tu te tais. Et tu ne comprends pas. Et tu voudrais appeler à l’aide mais tu ne peux pas, tu ne sais comment faire, tu n’as pas les mots. Il n’y a pas de mots. Même simplement “aidez-moi” n’est pas possible. Alors celui qui se dit blessé – moi, par exemple – hurle de plus en plus fort. Il hurle que tu lui as fait mal, que c’est de ta faute, que c’est toi qui lui as fait ça. Quoi, ça ? Rien, justement. Tu lui as fait ça : rien. Tu ne peux que ça : rien. Tu es verrouillée dans une horreur qui est aussi vieille que toi et dont tu n’as pu t’échapper que très rarement, dans un érotisme risqué. Un érotisme dans lequel tu essayes de te noyer, où tu cesserais d’avoir mal, où tout deviendrait désirable, agréable, nécessaire, vivant. Où tu serais prise, déchirée, envahie, forcée, oblitérée. Et où tu prendrais, déchirerais, envahirais, forcerais, oblitérerais. Où enfin un autre te rejoindrait, te toucherait, que tu rejoindrais, que tu toucherais. Un bref instant.
Écoute-moi : tu vis ta vie en vacillant entre la Scylla du meurtre et la Charybde du suicide. Entre la Scylla du gel et de la solitude et le Charybde de l’immolation dans le feu de passions dans lesquelles, inévitablement, toi et tes partenaires êtes blessés. Tu es blessée d’avoir fait mal, blessée de n’avoir pas trouvé ce que tu cherchais. Blessée de n’avoir pu donner ce que l’autre attendait. Et une fois de plus tu es seule. Sidérée. Abandonnée. Encore. Et encore. Et encore. Tu redeviens cet enfant que l’on avait dit toxique. Fatale, comme on le dit de certaines femmes. Convaincue de ne pouvoir que blesser ceux qu’elle aime. Qui crève de solitude. Alors tu recommences. Tu t’exposes à nouveau – et on dit que tu cherches à séduire. »