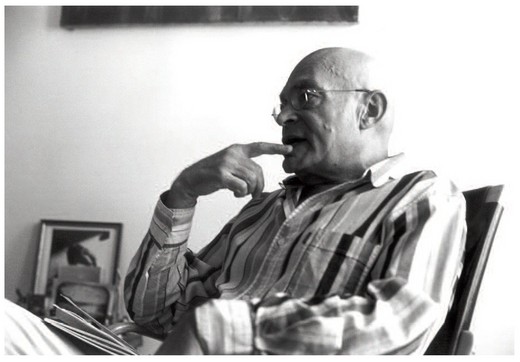Anne Dufourmantelle me proposa en 2010 de recevoir en consultation quelques-uns de ses analysants, avec lesquels elle se sentait être dans une impasse. J’acceptai, à condition que ces personnes sachent que Anne et moi nous entretiendrions régulièrement à leur sujet. L’expérience dura environ deux ans, au cours desquels, en raison de ce qui émergeait dans le travail de plusieurs de ces personnes, Anne me demanda d’écrire quelque chose à partir de la définition de l’amour énoncée par Lacan : donner ce que l’on n’a pas, à quelqu’un qui n’en veut pas. Plutôt qu’un énième essai théorique sur la question, j’ai écrit le texte que voici.
« Le mouton qui se raconte au
loup est fou. »
Dicton attribué aux bergers espagnols
1
Voilà, je t’écris une dernière fois. Tu ne comprendras pas – tu n’as jamais compris – mais tant pis, je t’écris quand même. C’est pour moi, je me dois bien ça, il faut que je reprenne mes esprits. Je me dis qu’en reprenant notre histoire, peut-être ; alors je nous relis, j’ai tout gardé.
Tu te souviens de nos tout premiers échanges ? C’était il y a si longtemps. Tu voulais me lire, tu m’avais demandé de t’envoyer quelque chose, même un texte ancien, n’importe quoi ; je t’avais répondu ceci :
« Te donner à lire quelque chose de moi ? Oh, simplement rien (rien qui me présente)… ou ma thèse peut-être, qui est la chose que j’ai pu écrire avec le plus grand enthousiasme et la moindre malhonnêteté ; c’est ancien déjà, et pas d’urgence. Ou simplement mes réponses, pour commencer ?
Bien sûr, tu as raison, depuis longtemps nous empruntons des chemins similaires. Je crois aux Lettres. Pas par élitisme : de manière privée. Pour la subtilité et la distance, et l’humour, et la gratitude pour les figures tutélaires, dont elles vous équipent. Pour l’alibi imparable à la solitude et à la rêverie. Mais je ne lis pas du tout assez. Il y a que la vie est bourrée de choses à faire. Et puis, Paris est un piège. Pas d’espace, donc pas de vraie solitude ; le ciel, avec parcimonie ; peu d’arbres, peu d’oiseaux, trop de monde ; une rumeur urbaine et des sirènes permanentes. Tout cela me rend triste (mais sur un fond de joie inaltérable), car je ne trouve pas d’issue.
Tu dois avoir raison, il y a dans un parcours similaire des retrouvailles ou des reconnaissances plus faciles – et bien agréables. Ceci une fois dit, c’est la suite qui compte. Donc oui, je t’écrirai, quand je t’aurai lu – je veux dire, tes livres. »
Sans doute as-tu oublié.
***
Je t’aurais aimé, et puis j’aurais su. Enfin, c’est ce que je crois.
Je n’aurais pas pu ne pas te dire la vérité, je n’aurais pas pu. Je ne t’aurais rien demandé, je n’aurais rien attendu, mais la vérité, je te l’aurais dite, autant que faire se peut. Car ça ne dépend pas de nous : c’est nous qui dépendons d’elle, la vérité, toute la vérité dont nous sommes capables. Il faut s’y abandonner. C’est le plus difficile de tout, cet abandon. C’est le pire, cette perdition de soi, cette dépendance. C’est merveilleux. C’est le bonheur. Le plus difficile, le pire des bonheurs, le plus terrifiant. On a peur de l’amour comme d’un piège. C’est quelquefois intenable. Oppressant. On est embarqué dans la chose la plus difficile et la plus exaltante d’une vie. Là est le risque, là est la vérité. C’est libre de nous, l’amour, c’est la seule chose qui nous sauve. Et j’aurais eu peur de trop t’aimer. Je veux dire : j’aurais été gagnée par la peur que tu ne puisses me rejoindre là où je me serais perdue, où je me serais abandonnée. Car c’est moi que j’aurais abandonnée dans cet amour, je me serais confiée à toi, je t’aurais confié tout ce que je sais, jusqu’à ce que j’ignore de moi, je t’aurais confié l’à-venir de ma vie. Et j’aurais eu peur que tu ne puisses répondre avec le même abandon. Dans ces moments de peur surgit en moi quelque chose qui n’est pas très loin de la haine. Aussi me serais-je vue comme pure obscénité, dont j’aurais craint qu’elle ne te répugne. Alors je me serais tue. J’aurais attendu. J’aurais attendu sans pouvoir rien faire que, finalement, me porter malheur dans l’espoir de dérouter le destin. J’aurais tenté de sortir du langage. C’est ce que font tous les amants. C’est cette sortie qui fait le fond de leur beauté. C’est leur adieu, qui est un défi à la collectivité tout entière.
Je t’aurais attendu. J’aurais enduré ton silence. Je me serais adressée à toi intérieurement, comme si tu avais pu m’entendre, me rejoindre dans ce labyrinthe où les perceptions font écho aux pensées. J’aurais essayé d’apprendre le détachement sans rien céder à la fulgurance du désir. J’aurais espéré devenir capable d’offrir l’accueil qui convient à ce qui fracture la vie. Mais je n’y serais pas arrivée. J’aurais aimé que tout fût simple et facile mais j’aurais su que c’est impossible. Choisirait-on toujours même cela, surtout cela qui n’est fait que pour nous refuser les satisfactions auxquelles nous prétendons aspirer profondément, avec pour conséquence les deux vies qu’il faut mener, l’une étroite, resserrée, souvent décevante, l’autre inventive vraiment, le tout contradictoire, difficile, fatigant ? Je ne sais pas. La seule chose dont je sois certaine, c’est qu’on ne vit vraiment qu’adossé à l’énigme du désir. La vie sinon n’est qu’un froid marécage. J’ai besoin de la ferveur puissante, de la brûlure de la passion. De la faim. J’aurais eu faim de toi. Je me serais enfermée dans mon amour. Cet enfermement m’aurait ravie. Je suis depuis si longtemps vouée au silence, au repli, je vis depuis si longtemps avec le sentiment que tout est perdu, que tout ce qui importe s’anéantit. Tu vois, je suis toujours menacée par la mélancolie. Je ne crois guère aux raisons qui peu à peu se révèlent, pour peu qu’on les reconnaisse. Seules m’emportent les passions. Ainsi, tout entre nous aurait été connaissance du plaisir, celui sans doute qu’on connaît le plus souvent, mais celui aussi que nous n’avions jamais ailleurs partagé, vif comme une plaie. Ce plaisir est une arme, à ce qu’on dit, il saute hors des labours appris par cœur. J’imagine l’enjouement dont nous aurions été capables. J’aurais craint ta cruelle élégance, ton orgueil d’être qui tu es, pourtant j’aurais affronté le risque de ta beauté. J’imagine le don secret que tu m’aurais fait et qui t’aurait laissé seul comme l’hiver, où tu m’aurais appelée, où je t’aurais atteint, où j’aurais voulu te retenir. Soudain tout aurait été permis. Nous aurions crié en prenant le ciel à témoin de l’injustice de nos vies. Cet aveu nous aurait coûté. Nous nous fions depuis trop longtemps à une route dont un long détour dénature le trajet, incertains de notre propre volonté. Ce qui te contenait et dansait dans ton œil soudain n’aurait plus été hors de portée. Ta bouche aurait été avide, heureuse ; tes mains, désormais déliées, auraient su ce qu’elles n’avaient jamais su.
2
Se pourrait-il que l’on craigne le bonheur plus que le malheur, parce qu’il force à inventer, contraint à choisir, exige davantage de courage que le malheur ordinaire dans lequel on s’installe si facilement ?
J’aurais eu peur de cette dépendance envers toi, d’une attente qui aurait fait de nos vies un espace mortifère. J’aurais été submergée par un bonheur douloureux. Peur, ravissement, rêve, abandon. J’aurais voulu, encore et encore, tes mains sur moi, tes lèvres sur mes yeux, j’aurais voulu te boire, ton goût dans ma bouche. Il y a quelque chose de presque tragique dans l’événement d’un tel amour, presque un effroi sacré devant l’infini de ce qui s’y ouvre. Faut-il alors penser que le secret aurait été notre seule chance ? Chacun aurait-il gardé le secret de l’autre ? Le secret aurait-il seul pu rapiécer notre appartenance au monde ?
Mais tu serais parti. Tu m’aurais abandonnée. Tu m’aurais laissée avec ce bonheur perdu qui est, je ne sais comment le dire autrement, une force de métamorphose. Tu serais resté étranger à mes tourments. Je me serais invariablement trompée, ce que j’aurais senti aurait été dépourvu de fondement, ce qui se serait passé sans rapport avec ce que j’en aurais pensé. J’aurais été à côté de ma vie, j’aurais suivi des chemins parallèles. Il se serait agi de préserver quelque chose qui n’aurait pas eu de nom, trop profondément enfoui dans cette ombre où ce que nous sommes vraiment repose et nous échappe. La peur et la honte, mais l’une et l’autre sans objet que j’eusse connu, m’auraient rongée comme une lèpre. J’aurais été tentée de te dire, si tu me l’avais demandé, mais tu ne l’aurais pas fait, l’ancienne folie qui m’avait fait naître, la sauvagerie dans laquelle j’avais grandi. Tu sais comme moi que, enfant, on sent, on sait tout, tout de suite. Mais on l’ignore. On se borne à se ralentir, à se taire, à inventer des artifices pour apaiser l’inquiétude chronique où nous tiennent la haine, la faiblesse, la couardise de ceux qui sont sensés nous aimer et nous soutenir. Il me fut très vite évident qu’à m’attarder si peu que ce fût en ces lieux et compagnies adverses, j’allais être broyée. Je ne sais comment, mais il m’est venue une gravité aussi soudaine que précoce, qui fit que s’ouvrit une porte sur une liberté vertigineuse, un temps nouveau. J’ai su que si je franchissais ce seuil, rien ni personne ne pourrait plus me contrarier, ni infliger à mon corps défendant la tristesse, l’accablement où ils auraient voulu avec eux m’enfermer. Je devinais que l’ouvert et le vaste auxquels j’aspirais me coûteraient. Je n’étais pas sûre d’être ni de taille, ni de force : jamais tant d’étendue n’entrerait dans l’étroit périmètre où on me voulait maintenue. Il me faudrait rompre. La question, sous sa forme explicite, n’a percé qu’après. Dans les faits, j’avais avant de le savoir commencé d’y répondre. J’accusais le coup des vieilles faims dont j’avais hérité, qui avaient laissé tel ou telle de mes aïeux ou aïeules sur le bord du chemin. Ma vie avec mes proches avait à peine commencé que je la savais finie. Les livres furent mon refuge, me sauvèrent. La joie sourde, profuse qu’ils me procuraient desserrait l’étreinte de l’angoisse. Et cela se voyait. On me questionnait. Je me répandais sur le malheur que c’est de devoir affronter sans cesse la contrariété inépuisable que nous oppose le monde. Ce n’est pas simple. Qu’avez-vous fait, votre vie durant, aurais-je voulu leur demander, sinon accepter les privations inhérentes au réel, bâtir des murs qui contrariaient tout désir ? Mais je n’en eus jamais ni le courage, ni la cruauté. J’aurais dû. Cela m’aurait épargné de vivre tant d’années dans une obscure et oppressante confusion.
Je t’aurais aussi parlé de la cruauté de mon père, que je n’ai comprise que tardivement. Longtemps, je n’ai vu que sa lâcheté, qui l’avait fait se ranger à la loi du monde. Je voyais bien sûr qu’il en pâtissait amèrement, mais qu’il pût ainsi se soumettre me dépassait et m’exaspérait. Que cette couardise s’assortît d’asthénie morale me semblait autorisation railleuse du ciel à donner libre cours à ma violence. Je me souviens avec tristesse de conversations à table le soir où, incapable de se défendre, il se réfugiait dans une rage qu’il eût voulue secrète mais qui n’était que pathétique, comme l’était la risible illusion qu’il se donnait de composer un masque d’autorité résignée. Je l’aimais et je devais le fuir parce qu’il me craignait. J’eus très tôt horreur de l’intelligence qu’on me prêtait ou me reconnaissait. Et, tour d’écrou redoublant la panique, on ne se privait pas de me menacer de la sentence : si l’intelligence m’avait été donnée, celle-ci, en revanche, ne me donnerait rien. J’ai ainsi passé toutes ces années effarée, hors de moi. On me trouvait absente et énigmatique ; midi était loin. J’étais délestée de toute identité en laquelle je pus croire. J’ai longtemps vécu dans l’ignorance de qui j’étais. Les livres m’ont aidée à m’inventer. Reste que je verrais battus en brèche mes désirs, que je m’abîmerais avec délice dans la complaisance.
***
Vois où même absent tu m’entraînes. Je me plais à t’imaginer voulant savoir tout ça de moi, mais rien n’est moins sûr – et il n’est pas sûr non plus qu’il m’eût été possible de te le dire si tu avais été là. J’avais enfoui tout ça sous son fumier. Sans doute aurais-je eu peur qu’à te dire mon histoire tu ne fusses ou terrifié, ou séduit. S’il n’est rien que je n’eusse voulu te confier, je me serais en revanche interdite d’interpréter exécrablement devant toi les rôles qui depuis toujours me tiennent lieu de vie. Mais assez parlé de ça, changeons de registre : je m’imagine en talons hauts et linge délicat, tenant des postures insensées, mon sexe à vif et ma jouissance exquise comme on le dit de certaines douleurs, voilà ce que tout de suite je voudrais.
3
Je ne sais pas de quoi au juste j’aurais été capable, mais il est certain que je n’aurais pu m’empêcher d’espérer arriver à me défaire d’habitudes trop étroites, peu profondes, de pouvoir prêter foi à une vie nouvelle. C’est assez terrifiant. Je cherche un repli secret à l’intérieur de la vie même. Voilà ce que tu aurais été, si tu avais pu l’être : un repli secret. Les enfants cherchent des replis secrets. Mais aurais-je su m’abandonner à cet enfant-là dans l’amour, le sexe et le vertige du plaisir et du partage, accueillir cette spontanéité de l’enfance, son audace, sa vulnérabilité, son émerveillement ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. J’aurais tellement aimé que notre rencontre pût inventer sa propre voie, qu’elle nous emmenât ailleurs, non pas hors du monde mais hors de nos mondes, qu’elle nous aidât à dissiper les grandes ombres dont nous sommes cernés, qu’elle nous poussât vers une clarté soudaine, qu’elle nous permît de rompre enfin avec les lois sourdes, inéluctables, du passé auquel nous avons, en dépit de nous-mêmes, appartenu.
***
J’écoute Leonard Cohen : You want it darker. Je vais bientôt sortir, marcher un peu, flâner dans la ville avant de dormir. J’aime, en ville, plus que tout, la promenade, la visite, l’égarement, le cruising, la dérive : toutes ces manières de laisser à la ville ce que Jean-Luc Nancy a appelé la chance et le risque de l’insignifiance. Puis je vais encore écrire, penser à toi, je me perdrai dans l’écriture, dans la part la plus cachée, la plus sombre, où l’on ne sait plus ce qu’on écrit, où la main trace en avant de soi un territoire dont on entrevoit seulement le contour mais dont la lumière et la traversée nous sont inconnues, où l’on chemine dans l’ouvert de la dis-position. Et lorsque emmené là, presque malgré soi, on se découvre, comme parfois en faisant l’amour, pensant/écrivant ce qu’on ne savait pas abriter, des idées étranges nous convoquent et exigent de n’être pas laissées orphelines. Ça n’a l’air de rien mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît : il s’agit de laisser partir sa pensée, comme on laisse venir la jouissance. Aurions-nous su accepter l’invitation ? Ou aurions-nous été frigides ?
***
La nuit tombe, l’obscurité m’enveloppe. Je suis exténuée mais tout à fait éveillée. Tout est si calme soudain, apaisé.
Jusqu’où t’aurais-je suivi, jusqu’où t’aurais-je demandé de m’accompagner ? C’est sans limites, tu le sais. Ce que je découvrais m’était inconnu, je commençais à sentir ce qu’aurait pu être un lien qui n’aurait pas été meurtrier. Que serait-il advenu de nous dans cette vie secrète que je nous imaginais ? Il nous aurait fallu inventer quelque chose qui aurait exigé générosité, humour, patience (beaucoup), impatience (davantage encore), et joie. Je me sens aujourd’hui comme si j’habitais une maison inconnue mais dont je saurais pourtant que c’est bien la mienne. Ou comme si j’habitais un autre corps.
***
Je me souviens de cette première nuit à Florence. Nous n’avions pas fermé l’œil. Tu m’avais au matin parlé de ta tristesse, en riant, d’une voix gaie. Ne crois-tu pas que ce mal est un héritage très ancien que tu déposes dans tout ce que tu fais, tout, et dont tu te trouves du coup brusquement délesté ? Ce serait vertigineux d’être délivré, soudain, de ces violences aussi vieilles que soi. Ce vertige nous fait peur car il trahit, dans la réalité, une naissance. Une sortie vers une terre inconnue. Je veux dire que la tristesse nous apparaît, nous atteint lorsque nous sommes sur le seuil. Peut-être est-elle elle-même un seuil. Et c’est ce que nous quittons qui nous envahit alors à travers elle. Un monde ancien, outre-mémoire. Ou alors une mémoire enkystée, encryptée, dont l’effet de fragmentation n’est pas létal.
***
Il avait plu sans discontinuer durant ces quatre jours. Je me souviens du parfum suave de verdure, de terre émue qu’exhalaient les jardins des Boboli. Tu m’avais dit ta peur que cela ne te fasse de trop beaux souvenirs, que nous n’aurions pas dû venir. Et j’ai découvert, béant, l’océan d’angoisse qui bat en permanence ton cœur. Ces quelques mots dits tout bas ont longtemps roulé leur écho de tonnerre en moi. J’ai rapporté de ce séjour une fatigue et une inquiétude dont je ne me suis jamais lavée.
Je me sens agitée, désemparée, j’ai besoin de toi, je voudrais te toucher, être avec toi, dans tes bras. Que suis-je sensée faire de ce manque de toi ? C’est trop difficile. J’essaye de te mettre à distance, de t’oublier même, de me dire que ça n’a finalement pas tellement d’importance, de prendre les choses comme elles sont. Il y a une violence en moi que je ne comprends pas. Il me semble parfois que la seule chose à faire serait de retourner à cet exil intérieur que je connais si bien, ne pas te chercher ainsi. Je t’en veux de m’être à la fois si essentiel et si étranger, de partager les mêmes langues, d’habiter les mêmes territoires de l’esprit, et d’être hors d’atteinte. Je m’en veux d’avoir cru, vraiment cru en ton besoin de réparer ce qu’il y a d’abîmé en moi, en ton espoir de partager les joies simples, les gestes faciles du quotidien, la lenteur, le temps pour rien, le temps perdu, en flânant, en nous perdant, toutes ces choses qui rendent le monde habitable. Mais il me faut être vigilante : la tristesse peut être capiteuse, son ombre brûlante.
4
J’ai vu que tu avais tenté de me joindre hier. Pourquoi n’as-tu pas laissé de message ? L’inquiétude ne m’a pas quittée de la soirée – et je n’avais pas besoin de ça. Pierre allait si mal que je ne savais plus que faire, ni comment être. Face à trop de détresse, je suis sans moyens. L’effroi, la solitude, l’angoisse inapaisable de Pierre me sont à peine tolérables. Nous avons fait l’amour cette nuit, très tard, assez violemment. Comme pour conjurer toute cette angoisse, ses idées suicidaires, et aussi peut-être pour tenter de revenir de ma propre absence, ces derniers temps, avec lui. Mais cela m’a laissée profondément triste. J’aimerais tant parfois ne plus rien porter. Le plus étrange est que je sens toute sorte de choses s’ouvrir dans ma vie, une nouvelle manière de me relier au temps, à l’écriture. Et ton souvenir est là, et je vis avec la pensée de toi en moi, mais tu n’es pas là, tu es si loin, et je te cherche. Je cherche une voie et ce n’est pas facile, je veux dire cette manière d’être à la fois ensemble et séparés. Dans ton souvenir, le souvenir de toi plutôt, je reprends vie. Les quelques mois passés avec toi furent un ravissement. Je pense à la très élégante, très délicate obscénité avec laquelle tu te défais dans le plaisir. Ta sauvagerie et ta douceur. Mais comment rester debout face à ce qui m’est arrivé avec toi, face à la rupture à laquelle il me faut depuis nous consentir ? Tu as fracturé ma vie, je suis depuis toi inconsolable, notre histoire est sans retour.
Nous nous étions rejoints sur des rives inconnues, quelque chose de brutalement désolé commençait d’apparaître, comme un paysage dévasté. Nous étions l’un et l’autre aimantés par un commun besoin d’exil. Je me souviens de cette nuit où tu m’as avoué, c’était ton mot, être un enfant « naturel ». Je ne comprenais pas ton inquiétude, je ne comprenais pas que tu puisses même à moi avoir peur d’avouer les circonstances de ta naissance. Après tout, je ne suis pas issue de la France profonde, exténuée, des tranchées, repliée sur ses villages, ses clochers, ses dames aux cheveux gris observant derrière leurs fenêtres le maire et l’adjoint au maire recevant le Conseiller général, le Défilé, et pourquoi pas, une fois, le Président lui-même. Tu me disais craindre l’hypocrisie assumée, cette vertu. Mais il te fallait bien te présenter, avouer tes origines. Tu ne pouvais pas toujours faire semblant. Ton aveu m’a rappelé la méditation de Kafka : est-il possible de penser quelque chose d’inconsolable ? Ou plutôt : de penser quelque chose d’inconsolable sans le souffle de la consolation ? J’y repense aujourd’hui autrement : je serai depuis toi inconsolable. Pourtant, je veux croire, il m’arrive de croire que tu m’as en quelque sorte gardée. Et à propos de garde, tiens, voici quelque chose que je ne t’avais pas dit : je n’ai gardé qu’un seul des messages que tu as laissés sur mon répondeur, deux mots : « C’est moi », où se mêlaient, m’avait-il semblé, l’angoisse de l’abandon et l’espoir de l’accueil, de la promesse réitérée, de l’amour intact. Je voulais croire en cet amour, j’arrivais parfois à y croire, à croire que tu disais vrai, mais la tentation de l’abandon, de nous abandonner, de m’abandonner, ne cessait de revenir. C’était trop difficile, cette impossible consolation, cette nécessité de sans cesse ré-apprivoiser cette distance entre nous, entre nos vies, distance géographique aussi, et c’est sans doute pourquoi nous ne sommes jamais vraiment entrés dans le risque de cet amour. Et nous l’avons su tous les deux, d’emblée.
Pourquoi t’écrire tout ça maintenant ? Peut-être à cause de rêves étranges, violents, la nuit dernière, dont il ne me reste rien. Je me sens anormalement fatiguée et je flotte un peu, comme toujours dans ces cas-là, entre déconnexion et présence (à toi, à moi-même, au réel – si une telle chose existe). J’ai tout à la fois envie de rentrer dans ma tanière et de m’enfuir. Nous avons l’un et l’autre tout de suite su qu’il y aurait toujours quelque chose d’inconsolable entre nous. Cette séparation, cette distance, cette part d’inconsolable est peut-être l’une des conditions de possibilité non seulement de l’amour mais du risque sans lequel l’amour n’est plus la passion qu’il doit être pour que l’événement de la rencontre se répète chaque fois que nous nous retrouverions ?
Où nous sommes-nous trompés ? Ma question n’est ni déploration, ni colère. Comment aurions-nous pu ne pas nous installer dans cette alternance de distance et de présence si particulière dans laquelle nous nous mouvions ? Comment aurions-nous pu faire pour sans cesse réinventer ce qui nous arrivait ? Où trouver la force d’inventer une langue contre le monde donné ? Le travail de traduction constante entre deux langages, celui du monde connu et le nôtre, adossé à une terreur primitive, intraduisible justement celle-là, est une source de résistance, c’est-à-dire d’invention. Car résister, c’est déjà trouver un passage. Sortir de l’impasse ou éclairer les ténèbres suppose de se déplacer plus vite que l’oppression (ou que l’oppresseur, quel qu’il soit), et avec plus de grâce, d’intelligence.
Ce qui me ramène à ce que tu m’avais dit cette nuit-là à Florence à propos de ce que tu appelais la chance, terrible, cruelle, qu’était aussi la distance qui nous était imposée et dans laquelle nous vivions et que nous devions accepter. Nous sommes l’un et l’autre des enfants de parents vaincus, je veux dire de parents qui n’ont jamais su nous donner tout à la fois la liberté – d’aimer, de grandir, de penser – et le soutien dont nous avions besoin. Enfants, nous leur avons sans doute rappelé l’enfant qu’ils avaient eux-mêmes été et qu’ils avaient perdu. Il leur a fallu, et nous l’avions très tôt compris, que nous soyons de petits adultes – et nous l’avons été. Nous les avons compris, aimés, soutenus. C’est peut-être ce qui explique que nous soyons aujourd’hui si enveloppants, si protecteurs avec ceux que nous aimons, que l’idée de les abandonner nous soit à ce point intolérable.
C’est encore l’énigme absolue, ce jeu de ma mère s’allongeant près de moi dans mon lit et faisant semblant d’être morte, refusant de répondre à mes appels d’abord, puis à mes cris, puis se relevant brusquement, comme un diable en boîte, un Jack in the Box, hilare devant mes sanglots. Cette mère adorante, suppliante, étouffante, jalousant mes amies et même mes chiens, était un fardeau insupportable, car j’étais le seul sens de sa vie. Et du coup, c’est mon amour de petite fille que j’ai avili en le refoulant au point de le nier, de le remplacer par une haine qui, seule, traduisait mon attachement. J’ai eu une mère-bébé, qui demandait constamment à son enfant : et si je disparaissais, est-ce que tu serais bouleversée, est-ce que tu survivrais ? C’est le fort-da à l’envers, puisqu’elle se mettait à la place de la bobine qui disparaissait, la faisant apparaître et disparaître, elle, plutôt que moi. C’est une scène d’amour tout à fait folle. Mais je savais bien sûr qu’elle n’était pas morte, et elle m’a peut-être ainsi à son insu (et au mien) convaincu que jamais elle ne m’abandonnerait, qu’elle souhaiterait rester à mes côtés dans un attachement presque fou, démesuré.
***
Si longtemps je t’ai gardé en moi, si longtemps je t’ai attendu. Tu étais ma question, tu étais ma nuit, tu étais mon enchantement, ma jouissance. Tu étais l’oubli de qui j’avais peur d’être. Tu étais l’évidence. Tu étais le risque qu’il me fallait courir. La blessure qui ne devait pas guérir. Tu aurais été ma chance.
Je voudrais ce soir te sentir jouir, je voudrais te parler, t’écouter, t’entendre rire, te regarder marcher. Te nourrir, te laver, te regarder dormir. Je voudrais t’aimer.