Entre monologue intérieur et errance hypnotique, Yannick Haenel propose une traversée nocturne de Paris. L’auteur de Cercle et de Tiens ferme ta couronne dérive entre griserie et angoisse, ivresse et désolation. La musique scande le texte – plus que des citations, les titres de The Cramps, Suicide, ou Schönberg sont de véritables balises sonores.
« Es-tu en vie ? » La phrase m’a transpercé. J’attendais le bus de nuit, derrière la Tour Saint-Jacques. Il était quatre heures du matin, il pleuvait. « Es-tu en vie ? » : une voix répétait cette phrase, sur un ton ironique.
La nuit, le quartier du Chatelet est sinistre. L’univers m’apparut noyé dans une flaque d’eau. Je glissais dans une humidité sale ; mes os étaient glacés : je pensais à Gérard de Nerval qui s’était pendu sur le trottoir en face.
Cette nuit-là, je n’avais plus envie de continuer, pourtant je sentais bien qu’il y avait de la comédie dans cette fatigue. La nuit se casse en deux, mais ça ne va pas si mal : j’entends encore mes bonnes clartés, celles qui à chaque fois me repêchent. Le bus arriva, il était bondé, rempli de têtes bleues qui grimaçaient. Il y en avait qui tenaient des faux et tiraient la langue. Est-il possible d’être à la fois dans le bus et dehors ? Je connais un sentier qui traverse l’enfer, il donne à-pic sur les supplices, mais on y garde son âme. À travers la vitre, les têtes me faisaient signe de monter : masques bleu-noir, figés dans un hurlement de carnaval. J’ai pensé : on ramasse les morts, on va nous foutre à la décharge, broyer nos os, faire de la poudre. J’étais ivre, les gueules bleues riaient, je suis monté.
On a pris le boulevard Sébastopol, puis j’ai perdu le fil. On fonçait dans la nuit, le bus tanguait sous le rire des morts qui sautaient sur place, serrés les uns contre les autres. Dans ma tête, « Zombie Dance », une chanson des Cramps, rythmait la cadence comme un fou-rire.

[The Cramps, “Zombie Dance”, 2:03, Songs the Lord taught us]
Sans doute faudrait-il débarrasser la mort du sinistre cortège qu’ouvre la souffrance et que ferme la puanteur : la nuit des masques conjure la peur d’en finir. Pourtant, aucune éternité ne rayonne, et cette nuit-là je ne voyais rien non plus derrière les grimaces.
Le monde où nous sommes morts s’agite derrière une vitre. Il est loin, là-bas – de l’autre côté. En même temps, j’y ai ma place, debout entre les masques. Le chauffeur conduit avec la brusquerie d’un fossoyeur ; je vois mon reflet qui bouge à chaque coup de frein.
J’avais dansé cette nuit dans un club, seul, jusqu’à l’ivresse. Je dis « seul » alors qu’on ne l’est jamais lorsqu’on danse. Mes amis étaient partis tôt, j’avais hurlé de joie avec des inconnues légères, bu du champagne, de la vodka, et voici que je tanguais avec les morts dans un bus qui nous menait au bout de Paris.
[Sonic Youth, “Satan is boring”, 5:13, Bad Moon Rising]
En arrivant chez moi, porte de Bagnolet, il était cinq heures du matin. J’oublie toujours de remplacer les ampoules : depuis plusieurs semaines, je circule dans ma chambre comme dans une grotte. Rien ne divise l’ombre, la solitude embrase les coins ; il est possible qu’un appartement sans lumière épouse mieux l’esprit : la nuit y habite comme chez elle – et moi je vis là, allongé sous une baie vitrée où quelques étoiles percent le ciel pollué de Paris.
J’ai allumé deux bougies, mais déjà le ciel s’éclairait, avec une lenteur rouge, orange, jaune. Je me suis fait des pâtes, puis j’ai continué à boire, allongé sur le divan, en tapotant sur mon ordinateur. Voir le ciel s’éclaircir lorsqu’on a festoyé appelle la disparition : on pourrait s’évanouir comme une buée. L’oubli du soir vous grise, mais celui du matin espère une délivrance.
[Anthony Braxton & Max Roach, “Spirit Possession”, 6:40, Birth and Rebirth]
Je ne sais plus comment, sur YouTube, je suis tombé sur cet extrait de L’Âge d’or de Buñuel : le personnage de l’amoureux fou dévaste une chambre, il éventre un oreiller dont les plumes se dispersent dans l’air, puis jette par la fenêtre un arbre en feu, une girafe, un évêque.
On entend des roulements de tambour, le commentaire dit : « À l’instant où ces plumes arrachées par ces mains furieuses couvraient le sol remonté au pied de la fenêtre, à cet instant, mais très loin de là, sortaient les survivants du château de Selling. »
Voici qu’apparaît le château, menaçant, irréel, perché sur un pic de neige. Le texte continue : « Pour célébrer la plus bestiale des orgies, s’étaient enfermés dans ce château inexpugnable, 120 jours auparavant, quatre scélérats profonds et reconnus qui n’ont de loi que leur dépravation, des roués sans Dieu, sans principes, sans religion. » On nous rappelle que ces quatre obsédés avaient enfermé avec eux des jeunes filles et des jeunes garçons, dont l’unique fonction était la satisfaction sexuelle de ces messieurs. Puis on annonce la sortie du premier d’entre eux, le duc de Blangis ; la porte du château s’ouvre sur un pont-levis, et voici qu’en surgit, au comble de l’hébétude extatique (celle qui vient de l’extrême débauche) – resplendissant et glorieux : Jésus. J’ai éclaté de rire. Tandis que les scélérats sortaient l’un après l’autre du château, exsangues à force d’être allés jusqu’au bout de leurs fantasmes, Jésus marchait le long du château,
On sentait qu’il avait joui au-delà de tout ; et que personne, peut-être, n’avait jamais autant joui. « Dieu, dit Georges Bataille, est un porc. » Sur le visage épuisé de bonheur de Jésus-Christ, auréolé de satisfaction repue, dans ses yeux vidés, s’écrit furtivement l’horreur qui est l’horizon de la jouissance infinie, celle qui passionne les libertins, eux qui s’imaginent défier avec elle le Ciel.
Mon rire ne s’arrêtait plus. J’ai toujours ri en lisant le Marquis de Sade, d’un rire d’autant plus libre qu’il n’est pas justifiable. Les crimes, chez Sade, sont hilarants ; n’exigez pas que j’en aie honte.
J’avais chaud, je me suis déshabillé. Je pensais à Jésus, pieds nus, sortant du boxon, repu comme un vicelard. Voilà, je me répétais cette phrase : « Jésus sortant du boxon, repu comme un vicelard », et je riais, nu, à six heures du matin, dans mon salon.
La transgression, ce vieux joujou des petits humains, voilà que Jésus en personne la renvoyait au néant. Ils courent tous après l’absence de limite depuis qu’ils ont étranglé́ leur doudou. Je me disais : dans un monde qui se fait exploser à chaque instant, quel sens pourrait encore avoir la négation ? Les nigauds de la transgression forment un club halluciné, ils croient l’enfer profond – mais l’enfer est plat, il est creux, il ne vous donnera jamais rien.
Observez bien la mine de ceux qui se croient tellement transgressifs (surtout les artistes) ; ils ne voient pas qu’à leur coté le bon Jésus se paie leur tête : « C’est déjà fait », dit-il en souriant.
(Vision soudaine, risible : le diable au chômage. Quand il n’y a plus partout que du démoniaque, le démon n’a plus besoin de travailler.)
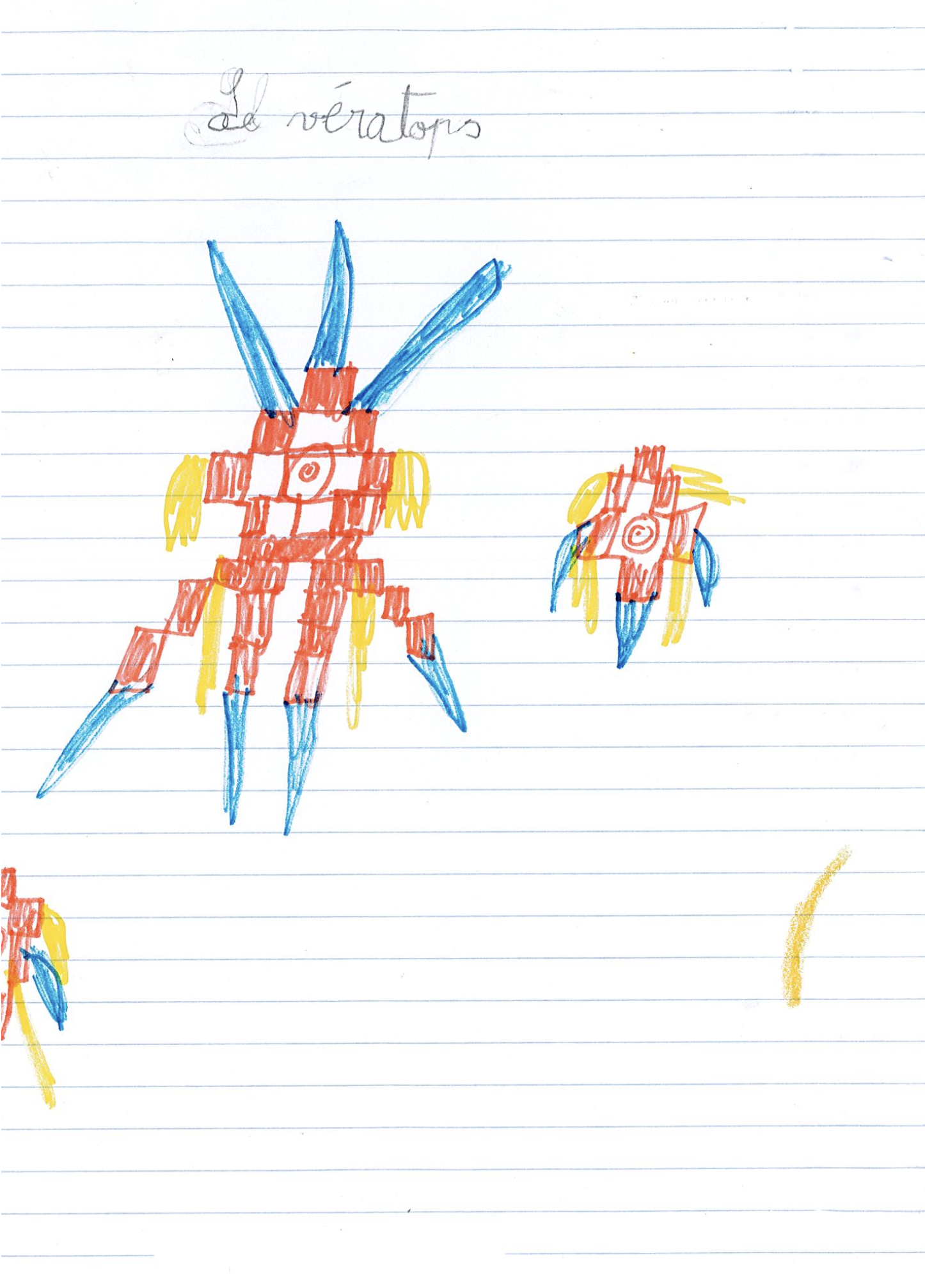
[Winter Family, “So soon (2)”, 3:57, Winter Family]
Un homme angoissé pense qu’il va mordre. L’horizon s’absente ainsi, dès que s’ouvre la bouche. L’invivable crispe nos mâchoires. Je désire embrasser (la nuit rit en moi comme un baiser de feu, elle me file entre les doigts).
La voix revenait : « Es-tu en vie ? » À partir d’une certaine heure de la nuit, il faut être capable de trouver un passage. Les tourments doivent s’écarter par le milieu, comme la Mer Rouge pour les Hébreux. J’ai longé à pas de loup la fenêtre, puis je l’ai ouverte. Je dis « fenêtre », mais c’est une baie vitrée : pas besoin de grimper sur une chaise. Tout de suite, avec la fraîcheur du dehors, mon état d’esprit s’est modifié – j’ai pensé : je suis déjà passé par la fenêtre, je n’ai pas vu venir la bascule, c’est fait, je cours dans la forêt, les corbeaux me bouffent les yeux.
[Arnold Schönberg, “String Trio, Op. 45”, 18:53, Robert Craft Conductor]
Il est maintenant sept heures. Je ne dormirai pas. J’ai souvent écrit des notes allongé sur un lit, fiévreux, à demi-ivre ; j’ai même accueilli, dans cet état, des clartés qui ont décidé de ma vie. La solitude la plus étoilée procure une joie lente : dans ces cas-là, je fais durer la nuit. À Berlin, sur un grabat, dans une chambre de la Kantstrasse ; dans des hôtels de banlieue, sous la neige, pendant une grève des transports ; et ici, à Paris, porte de Bagnolet : royauté soudaine, sans rien.
Il n’est pas facile de savoir si votre vie s’en va en morceaux, ou si vous allez vers ce qu’il y a de plus vivant. Parfois, les deux chemins coïncident : l’égarement vous conduit à l’énigme, tandis que la sagesse vous apparaît tortueuse.
L’excès ne conduit pas qu’au dérèglement. J’aime en lui ce qui dédaigne le malheur. Une vitesse traverse les formes tourmentées ; j’y reconnais mon exigence : celle de brûler sans me consumer.
J’avais rencontré quelques semaines plus tôt une jeune femme dans un bar de Belleville – le Cannibale café –, et mes pensées allaient vers elle. J’avais le souvenir d’une fée souffrante, tendue merveilleusement vers ses incertitudes, et animée d’un désir qui veut tout.
Moi aussi je veux tout. Je poursuis une aventure, et peu importe qu’elle croise des chemins désolés ou sordides : sa lumière me guide.
Je passe mes journées, mes nuits, à me consacrer à des phrases. En elles s’allume une vérité que rien n’apaise. Ma soif, à la fin, rugit. La solitude appelle des fêtes absurdes, où se conjurent des gestes excessifs ; elle ne se satisfait d’aucune mesure.
Nous nous étions embrassés, la jeune fée et moi, au cœur de la nuit, sur une banquette rouge. En m’avançant vers les lèvres d’une femme, je cherche un passage qui tranche l’enfer. Le vivable et l’invivable se mélangent à chaque instant, mais il existe un point qui brise leur connivence.
La littérature et le baiser sont une même chose. Les phrases sont rouges comme le velours. J’écris ce récit la nuit, sur la banquette du Cannibale. Le roman qu’est devenu ma vie depuis une dizaine d’années me transmet une joie qui pulvérise l’angoisse. En écrivant, je vois la fontaine. La soif est la seule vérité. Tout m’est donné dans une nuit qui flambe. Un destin de phrases implique de ne jamais dormir.
[Arvo Pärt, “Cantus to the memory of Benjamin Britten”, 8:53, Tabula Rasa.]
Plus tard, je me mis à errer vers Belleville. J’entrai dans un kebab et me nourris à la hâte. Il devait être dix, onze heures du matin. J’avais envie d’aller au Cannibale café, mais le poids de la nuit blanche m’abrutissait : je me noyais. On voit une ligne, puis des feux qui clignotent. Un ruisseau d’encre coule dans le ciel. La nuque, les bras, les hanches : tout grince. Je vais tomber, là, dans le caniveau. Quel triomphe, quelle gloire : le héros des phrases s’écroulant dans une flaque, rue de Ménilmontant, comme un ivrogne…
Derrière l’église, il y a une librairie qui s’appelle « Le Monte en l’air ». J’étais là, titubant, je regardais la vitrine : le Cahier de l’Herne consacré à Maurice Blanchot me dévisageait sévèrement. Est-ce que Blanchot avait lui aussi roulé dans des ténèbres foireuses ? Avait-il dévalé dans l’extravagance, le déboire, la simagrée folle ? Je me suis souvenu en riant que Georges Bataille disait de lui, avec une douce ironie (celle de Jésus sortant du boxon) : « Il est vrai que personne n’est allé aussi loin dans la sagesse que Maurice Blanchot. »

J’ai pensé́ : si je lis le Cahier de l’Herne Blanchot, je ne sombrerai pas. Alors je me suis accroché à cette absurdité, et suis entré au « Monte en l’air ». J’ai poussé la porte, sans doute y avait-il une marche, je me suis étalé, face contre terre. Un type et une fille, les libraires je crois, se sont précipités pour me relever. Je me sentais mal, j’ai tendu l’index vers la vitrine : – Blanchot… Je voudrais le Cahier Blanchot ! La tête me tournait, je saignais du nez. La fille a remarqué mon haleine, elle a eu un mouvement de recul, un peu dégoutée, puis m’a aidé à m’asseoir sur une chaise. Le bonheur s’affirme contre toute raison. Je souriais. Je me sentais léger, maintenant. J’étais bien ici, sur la chaise du « Monte en l’air ». En chutant, j’étais passé d’un seul coup dans le monde facile, celui où plus rien ne vous retient.
[Suicide, “Diamonds, Fur Coat, Champagne”, 3:22, The Second album]
Est-ce que le ridicule tue ? Même vautré, je me crois un personnage, je me vois comme Lancelot ou Gauvain, destiné à des épreuves mystiques : le sens est masqué volontairement par des mésaventures (après tout, Jésus a connu les 120 journées ; en lui s’illumine la pudeur des nuits qui se vautrent). Je perdis conscience. Les deux libraires appelèrent les pompiers. Les chevaliers de la Table ronde sont parfois frappés brusquement d’inertie sur leur cheval, ils restent alors immobiles, pensifs, en pleine forêt. Pensif : ce mot me plaît. La pensivité est l’autre nom de la nuit blanche. Selon Johan Huizinga, la chevalerie – cette haute espérance fondée sur la noblesse –, est une imitation du chœur des anges autour du trône céleste. Ainsi les moments d’absence d’un chevalier relèvent-ils de la prière, de ce recueillement extatique où l’esprit se refait. Je serrais contre moi le Cahier de l’Herne Blanchot, que j’avais réussi à acheter. Les pompiers ne vinrent pas. Un type encore ivre à onze heures du matin qui s’effondre dans une librairie, franchement, quelle importance ? Je pensais à la jeune fée : trouverait-elle tout cela drôle ou pathétique ? Il me semble que c’est pour elle que je vivais ces péripéties : ne pas dormir était un rite – une expérience pour me rapprocher d’elle. Ce que j’aimais chez elle, c’était cette manière qu’elle avait de vivre absolument : les déchirures aussi bien que les engouements avaient chez elle l’intensité d’un poème. Et puis, elle savait faire face : là où tous choisissent la facilité (et s’en plaignent), elle voyait les difficultés comme une épreuve noble. Le courage est ce qu’il y a de plus désirable.
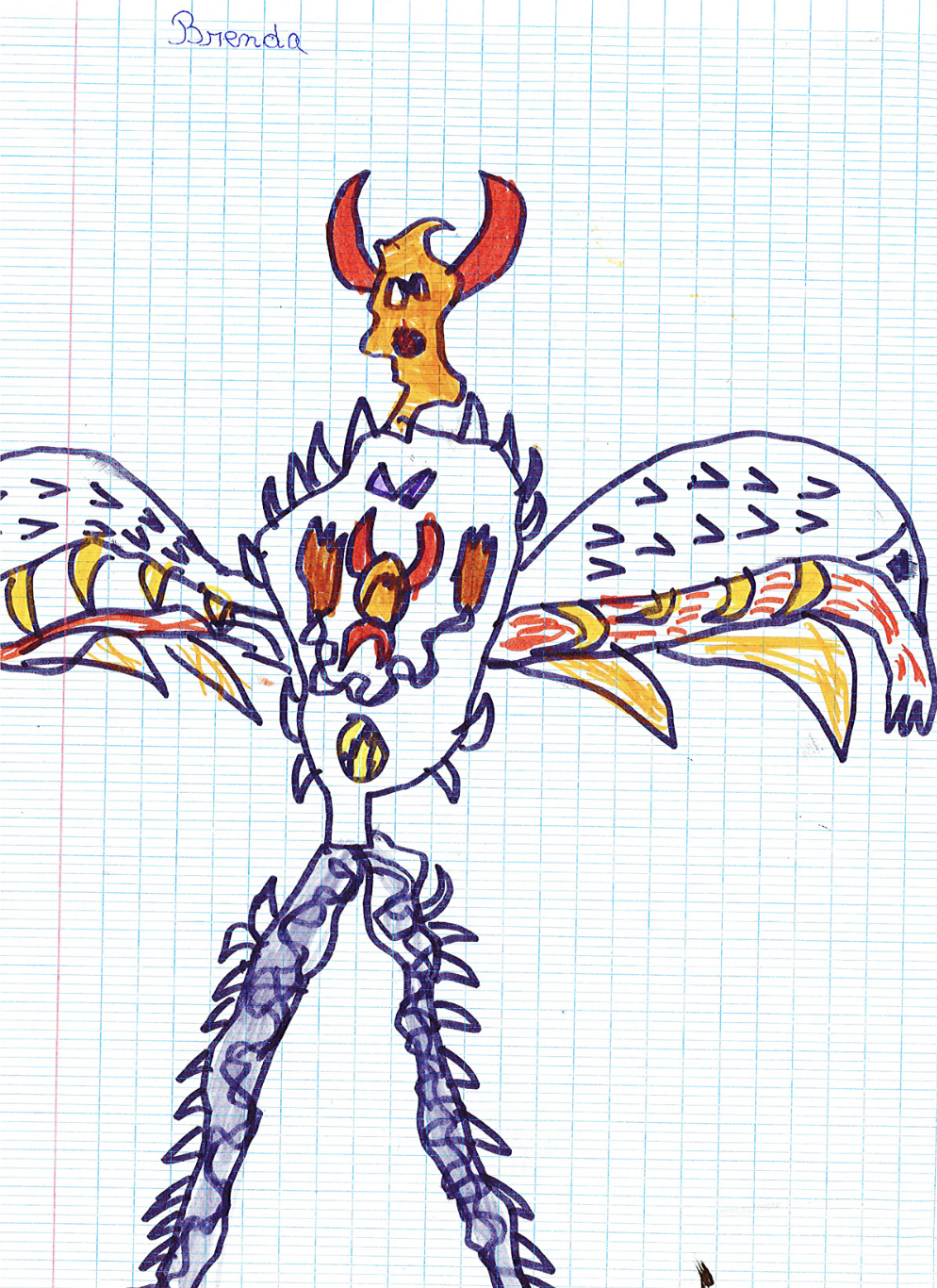
[A Silver Mount Zion, “13 Angels standing guard ‘round the side of your bed”, 4:32, He has left us alone but shafts of light sometimes grace the corner of your rooms…]
J’ai pris le boulevard de Belleville et j’ai continué à marcher jusqu’au Cannibale café. On se lance parfois vers un visage parce que le trouble qu’on y devine éclaire le nôtre. Il semble alors que les pensées, les phrases se destinent ; elles surgissent pour quelqu’un qui les reçoit en silence, loin là-bas, de l’autre coté du sommeil. Ce quelqu’un va naître, ou alors il existe et vous le rencontrez : la chance est une déesse.
Je pousse la porte du Cannibale, commande un double-expresso, et rejoins la banquette rouge. J’ouvre mon cahier, j’écris en majuscules trois mots :
L’IVRESSE LES PHRASES LA NOBLESSE
Je tourne autour de ces grands mots. Je les ajuste dans ma tête, ils dialoguent, changent de place, débordent l’un sur l’autre. La nuit avec eux est sans fin : je ne peux pas me reposer, sinon ils se figent sur la page. Seul le mouvement – la brûlure d’une gorge – leur donne une vie qui les rénove.
Oui : l’ivresse, les phrases, la noblesse. C’est mon programme. Que l’une vienne sans l’autre, ça tombe : l’ivresse toute seule conduit au siphon ; les phrases toutes seules, à la branlette ; et la noblesse, à la prétention vide.
Que les trois viennent ensemble, on marche enfin avec le feu : de nouveau la littérature est en vie.







