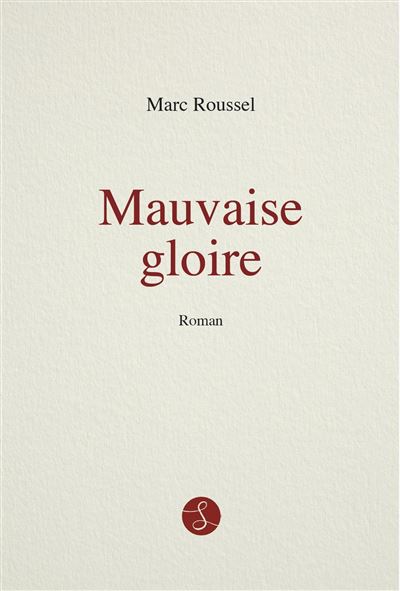Avec leurs anges gardiens, Sergueï et Bogdan, ils sont partis très tôt, samedi matin, pour Soumy dans l’est de l’Ukraine, où la bataille fait rage depuis un mois, au détriment des forces du général Syrski qui ont dû rétrocéder aux Russes la poche de Koursk conquise il y a un an, et se replier sur la frontière derrière leurs lignes de défense.
Ils, ce sont Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel, son photographe et caméraman attitré depuis la chute des Talibans à Kaboul, il y a un quart de siècle.
Engagement sartrien, antitotalitarisme, souvenirs d’un père qui rallia les Brigades Internationales en Espagne, s’illustra comme ambulancier à Monte Cassino durant la campagne d’Italie, aînés légendaires, Byron, Lawrence, Malraux, beau désir de gloire : on sait ce qui mobilise BHL sur les théâtres du monde où il s‘est aventuré sans relâche, bannière au vent, depuis un demi-siècle, Bangladesh, Éthiopie, Bosnie, Kurdistan, Libye, Darfour, Israël, et, ces dernières années, l’Ukraine.
L’homme d’idées et l’homme d’images, témoins inlassables de la résistance de tout un peuple, achèvent d’y tourner un quatrième film, Notre guerre. Tandis que le sort de l’Ukraine, invaincue mais trahie par l’Amérique, est en jeu, et, avec elle, le destin de l’Europe tout entière.
Qu’est-ce qui fait, à l’instar de Lévy, courir Marc Roussel ? Au-delà du métier et des contingences matérielles, quelle boussole, quels combats, quel idéal, quelle vision des hommes et des choses animent le faiseur d’images et reporter de guerre à l’ancienne que cet aristocrate du terrain demeure contre vents et marées ? A l’heure des portables dans les moindres mains, de l’événement instantané, du direct, du mitraillage visuel à tous propos fait par le premier venu, témoin improvisé de lui-même, pur soutier de la société du spectacle, que deviennent les émules de Capa, Gerda Taro, Lee Miller, Gilles Caron, Françoise Demulder, Don McCullin ?
La réponse est dans un roman épatant, Mauvaise gloire, que vient d’écrire Marc Roussel, dans lequel on peut lire, mise en fiction, sa propre généalogie, revue et corrigée par la littérature, où l’art de l’écrit et des mots rivalise avec succès avec son art de l’image. Rendre signifiante une situation en la figeant par un cliché qui résume tout – le fameux instant décisif cher à Cartier-Bresson –, ou, à l’inverse, animer une scène par l’image en mouvement, n’est plus ici le sujet.
Le sujet est ce siècle bientôt centenaire, fleuve de boue et de larmes depuis la guerre d’Espagne, dans lequel nous baignons à chaque fois contre le même éternel ennemi, revisité ici par trois hommes d’une même famille, acteurs solitaires d’une Histoire qui les requiert génération après génération, sous le flambeau de la guerre.
Roman des origines doublé d’un roman d’éducation, presque tout, dans Mauvaise gloire est inventé, et tout, pourtant, y est vrai. Si l’origine prolétarienne de cette tribu communiste de verriers en banlieue parisienne qu’évoque Roussel a bercé son enfance, s’il a, d’évidence, hérité des siens le souci du monde, si le patriarche savoureux qu’il décrit est bien son aïeul et fit la guerre d’Espagne dans les Brigades internationales, si sa geste a poussé son petit-fils à troquer très tôt sa carrière de Centralien pour le photojournalisme, tout le reste, sa vie dans les Brigades internationales à Albacete, la défense de Madrid à la Cité universitaire, les batailles de Teruel et de l’Ebre, l’assassinat de son supérieur lors de la Retirada des Républicains espagnols à l’hiver 39, sont une recréation de l’auteur. Mutique, l’aïeul ne pipa mot aux siens de l’Espagne, pas plus que de son passage à la Résistance. Mais la plausibilité que son épopée espagnole fut telle que Roussel l’a peinte, est grande, tant l’illusion historique – la guerre d’Espagne vue par un homme qui l’a faite –, est bluffante. Bel exemple de mentir-vrai cher à Aragon, le livre de Roussel cousine avec les meilleurs récits de la tragédie espagnole.
Tel grand-père, tel père ? La cause de l’Espagne républicaine fut pour le premier son graal ; le cauchemar colonial que fut la guerre d’Algérie sera une damnation pour le second. Roussel, là, n’y va pas de main morte, qui lui prête crument le recours forcé à la torture, dans une scène quasi-insoutenable. Inventé de part en part, même si son père fit partie du contingent en Algérie, le personnage y perd son âme.
Troisième génération, contemporaine. Manuel, le narrateur, alias Marc Roussel, prend la suite de ses deux prédécesseurs familiaux, et, expiant la figure du père, réinvente à son propre usage le photojournalisme à vocation humanitaire. Ce sera chose faite au Rojava kurde, en lutte à la fois contre les Turcs et les islamistes de Daech, où notre héros photographie un chirurgien lumineux et bougon, opérant les blessés à la chaîne, qui ressemble à s’y méprendre à feu le docteur Jacques Bérès. Cofondateur de MSF. Bérès reste d’illustre mémoire dans le milieu des internationalistes dont nous sommes encore quelques-uns, blanchis sous le harnais, à perpétrer l’engeance. Roussel lui-même y figure en bonne place. Ne parlons pas de Lévy.
A ce propos, pourquoi ce titre, Mauvaise gloire ? Serait-ce un auto-procès ?
La notoriété qui s’attache – en vérité, de moins en moins aujourd’hui – aux acteurs de l’internationalisme en lutte par l’image, la médecine ou l’écrit aux côtés des peuples sous la botte, serait, selon Roussel, entachée par le souci de reconnaissance, la recherche d’une posture héroïque. « Les vrais héros sont ceux qui ne reviennent pas » écrit-il, comme si seule la mort authentifiait la grandeur de l’action. On reste quelque peu interdit devant pareil purisme. Le militant qu’il est des causes que nous sommes encore quelques-uns à partager ignore moins que personne que le tam-tam médiatique pour réveiller les consciences des nantis Occidentaux est la seule arme entre nos peu puissantes mains.
En foi de quoi, que lui et Lévy rentrent de Soumy riches en images, y compris d’eux-mêmes, et surtout qu’ils reviennent sans entrave, est mon vœu le plus cher.