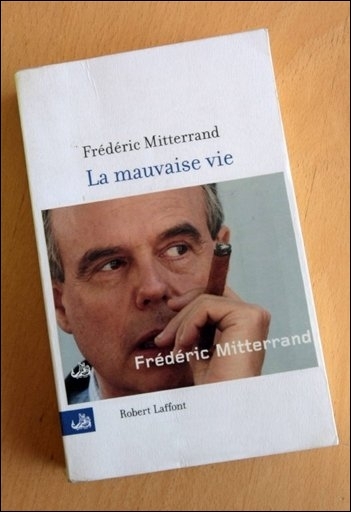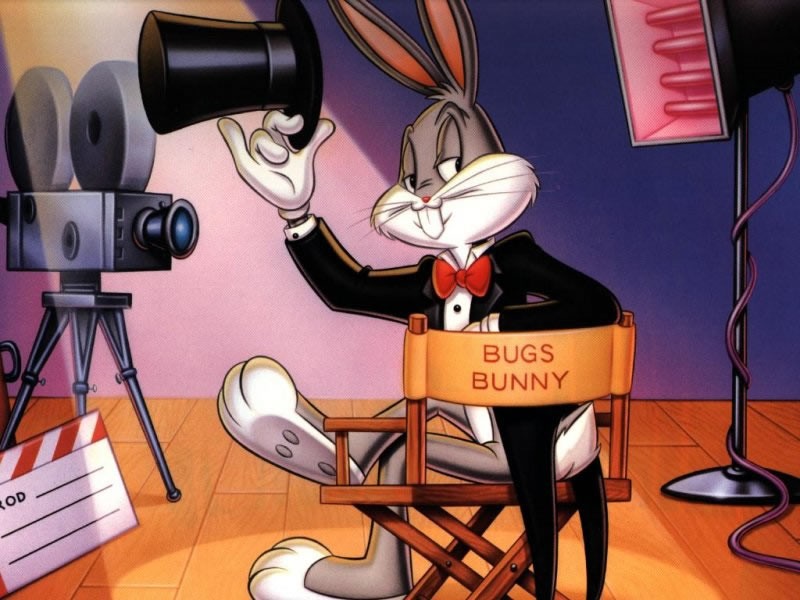Anne Claire Onillon : Dans votre livre, on apprend que les humiliations en public ont été abolies en France en 1848. Elles ont alors été décrites comme « une peine qui dégrade la dignité humaine, qui flétrit à jamais le condamné et lui ôte […] la possibilité de réhabilitation ». Internet et les avancées technologique nous feraient-ils paradoxalement basculer dans une régression moyenâgeuse ?
David Doucet : Je ne pense pas que c’était l’objectif ! Internet a permis de formidables progrès à tous points de vue : en termes de connaissance, en termes d’élévation du niveau de l’éducation… Mais effectivement, il a aussi entraîné des effets pervers dont on ne se rend pas forcément compte, comme les lynchages qui sont désormais mis à la portée de n’importe quel clavier. Les bornes qui, traditionnellement, limitaient les humiliations ou les infamies ont explosé : alors qu’avant, c’était circonscrit à la fois dans le temps et à un quartier ou à une ville, aujourd’hui – comme je le raconte dans mon livre –, dans une situation de ce type, déménager pour fuir l’humiliation ne sert plus à rien, et il n’y a plus non plus de limite temporelle, puisque les « informations » sont sans cesse ressassées par Google.
Malheureusement, et malgré les tentatives de résoudre ce problème, ce sont presque toujours les polémiques et les accusations que Google, qui est le plus gros moteur de recherche du monde, met en avant. Par une sorte de curiosité malsaine, on est incité à aller voir ce qu’il y a de pire sur Internet, et du coup ce sont toujours les pires résultats qui sont mis en avant – et même si Google ne le fait pas, des suggestions vous proposent les pires polémiques sur chaque personnalité publique. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’au bout d’un moment, « juif » est apparu à côté de mots-clés ou de noms de personnalités – ou des théories complotistes qui étaient régulièrement cliquées. Il est très difficile de contourner cet écueil, car aujourd’hui, tout le monde a le réflexe, avant de rencontrer quelqu’un, de « googliser » son nom. Ainsi, on débute d’emblée avec des a priori ; et si vous avez été « éclaboussé », chaque relation se contracte avec un boulet au pied, parce que la personne en face de vous aura tout de suite Google et ces résultats-là en tête. Dans mon livre, je rapporte les propos d’Éric Schmidt, le PDG de Google, qui, en 2010, prodiguait ce conseil : « Si vous faites quelque chose que vous voulez cacher à tout le monde, vous feriez sûrement mieux de commencer par vous en abstenir. » Il est donc très difficile de dépasser cela, même si, à travers la Cnil en France et la Commission européenne, s’exprime une volonté de réguler ce domaine, en revendiquant un droit à l’oubli ; pour l’instant, cela ne reste qu’une douce utopie. Les pouvoirs publics sont impuissants face aux Gafam. Milan Kundera a écrit que « vivre dans un monde où nul n’est pardonné, où la rédemption est refusée, c’est comme vivre en enfer ». C’est ce que vivent ceux qui sont traînés dans la boue sur Internet. Seuls les plus fortunés parviennent à nettoyer leur réputation numérique. Éric Schmidt prophétisait d’ailleurs qu’à l’avenir, chaque jeune aura un jour le droit de changer son nom à l’âge adulte, pour pouvoir tirer un trait sur ses frasques passées.
A.-C.O. : Et cela coûtera sans doute très cher, et sera vendu par Google…
D.D. : Il est vrai que c’est un abîme sans fin. À l’heure où, aujourd’hui, on dénonce toutes sortes de discriminations, il y a malheureusement là, dans des cas très concrets, une discrimination perpétuelle qui n’est pas prise en compte. Que vous ayez fait quelque chose de répréhensible ou non, entre un profil qui paraît sans problèmes et un entaché par une polémique fondée ou non, n’importe quel recruteur va tout de suite écarter le dossier ou le profil éclaboussé, sans prendre le temps de savoir si cela est justifié ou non. Il y a donc une discrimination à l’emploi et une discrimination sociale, parce que toutes les interactions sociales sont biaisées. C’est une macule. Dans la Rome antique, on tatouait les esclaves ; et même s’ils étaient ensuite affranchis, ils conservaient cette macule servile, qui montrait qu’ils avaient un jour été esclaves. Aujourd’hui, avec Internet, c’est comme si l’on avait ressuscité cette entache au fer rouge.
Je pense cependant que ce ne sont là que les débuts balbutiants de la civilisation numérique – et que nous subissons les travers qui marquent toute invention ou toute naissance de civilisation. C’est comme une jungle ; et je crois que dans vingt ou trente ans, ce que nous décrivons là aura été légiféré, que nous aurons des moyens pour nous défendre et que des associations lutteront pour le droit à l’oubli mais aussi au secours des victimes des lynchages en ligne. Mais pour le moment, il n’y en a quasiment pas ; et c’est pourquoi, dans mon livre, j’essaie de mettre le doigt sur un phénomène qui est passé sous silence. Beaucoup de personnes tombent en dépression et se suicident à cause de cela, et l’on n’en parle pas dans les médias, parce que parfois il ne s’agit de rien de plus que d’une vidéo qui a tourné dans un village. Mais la personne touchée, elle, le vit comme une honte, et tout le monde se détourne d’elle. Je mentionne par exemple le cas d’une institutrice de vingt-cinq ans qui habitait dans un petit village de La Réunion et dont l’ancien petit copain a publié sur Internet une vidéo de leurs ébats en précisant son nom et son prénom, ce que l’on appelle du revenge porn. D’un seul coup, tout le village s’est détourné d’elle. Elle a été suspendue et l’inspection académique a mené une enquête pour vérifier le contenu de ces cours, et elle les a approuvés. Mais les parents d’élèves, eux, ont décidé de retirer leurs enfants, et l’enseignante s’est retrouvée doublement ostracisée et a fait deux tentatives de suicide.Ce genre de choses arrive très couramment. Dans les collèges, lorsqu’une petite vidéo tourne sur Snapchat, TikTok, etc., le jeune qui est « éclaboussé » a l’impression de voir sa vie sociale exploser – et cela passe sous le radar des médias. Je travaille actuellement pour So Foot. J’ai mené une enquête sur la haine en ligne dans le milieu du football suite à la décision de Thierry Henry, qui est une sorte d’icône nationale – puisqu’il a été champion du monde en 1998 et champion d’Europe 2000 –, de se retirer des réseaux sociaux en mars 2021, où il était régulièrement victime de violentes attaques racistes. Dans le cadre de cette enquête, j’ai interrogé quelqu’un qui jouait en Ligue 2 à Auxerre – un défenseur dans un club moyen pas très exposé. Il m’a raconté qu’il a fini par faire une dépression et qu’il a lui aussi décidé de se retirer de tous les réseaux sociaux car depuis un an, il recevait des messages d’insultes à chaque mauvaise prestation. En fait, c’est un cercle vicieux, parce que de telles attaques exercent une forme de pression qui vous atteint psychologiquement, et alors vous devenez de moins en moins performant. Je pourrais citer un autre exemple, encore plus parlant : celui d’un joueur australien prometteur, mais qui, lui, a carrément décidé d’arrêter le football. C’était sa passion, il a consacré vingt ans de sa vie à devenir un sportif accompli, et pourtant il a arrêté parce qu’il n’en pouvait plus : il est tombé en dépression.
On voit donc bien que cela ne touche pas forcément des personnalités publiques, des hommes politiques ou des stars, mais même l’inconnu qui, soudain, va avoir son quart d’heure de célébrité – malheureuse – et servir d’exutoire pour des foules en colère qui vont se déchaîner contre lui. Ensuite, tout le monde passe à autre chose, mais la victime, elle, reste avec cette souffrance : celui qui vit cela a le sentiment d’être touché dans sa chair, comme lacéré par une série de coups de couteaux ; et il a l’impression que tous les yeux sont braqués sur lui. C’est une sensation extrêmement pénible, et les dégâts psychologiques que cela entraîne sont largement sous-estimés.
A.-C.O. : Vous abordez la théorie du bouc émissaire, selon laquelle toute communauté se constitue par le rejet et le sacrifice d’un élément tiers. Les réseaux sociaux seraient-ils donc intrinsèquement voués à être un espace de lynchage ?
D.D. : Non, je ne pense pas qu’ils soient forcément voués à cela, mais je crois que les plateformes qui ont créé ces réseaux sociaux ont une grande responsabilité par rapport à leur contenu. C’est comme les chaînes d’information en continu, sur lesquelles, pour pousser à la confrontation, le débat est mis en scène, spectacularisé. Un débat nuancé entre deux journalistes, cela n’intéresse plus personne – non, il faut qu’on s’apostrophe, que cela fasse des éclairs ! Donc on va prendre des représentants de tendances totalement opposées, sur un sujet épidermique : ainsi, on est assuré d’avoir son quart d’heure d’audience… Il en va un peu de même sur les réseaux sociaux : l’ergonomie de ces plateformes est conçue pour mettre en avant la polarisation et les conflits. Donc, pour être remarqué, il faut s’indigner, il faut lancer des attaques, il faut être plus fort que l’autre. Si vous faites un commentaire nuancé : « J’ai trouvé ce film bien, mais il y a cette chose que je trouve particulièrement critiquable… » – cela ne marche pas ! Par contre : « Ce film est une daube absolue » – là, oui, vous êtes sûr de faire grimper l’audimat ! En fait, nous sommes tous devenus des petits agents médiatiques avides d’une petite audience, avides de reconnaissance sociale, et nous sommes donc tous entraînés, sur ces autoroutes de l’information – comme on les appelait avant –, à se taper les uns sur les autres, à crier plus fort que les autres, à pointer untel du doigt… Ces plateformes poussent à de mauvais comportements, des comportements moutonniers, panurgiques, à une quête toujours un peu sanguinaire. Sur les réseaux sociaux, tout est fait pour encourager ces comportements – et c’est en cela que les plateformes ont une immense responsabilité en la matière.
La montée des colères profite aux géants du web qui ne cachent plus que la polarisation et la conflictualité font partie de leur business model, tout en refusant de mettre en œuvre les moyens de modération qui seraient nécessaires pour l’endiguer. Il faut aussi le dire. Il faut qu’elles s’améliorent. Récemment, Twitter permet notamment de limiter les discussions à des personnes que vous connaissez. Instagram permet aussi de filtrer les messages privés qui contiennent des mots insultants.Mais vous pouvez encore citer un tweet en y rajoutant une blague pour vous moquer de la personne qui l’a posté. Tout est fait pour pousser à une surenchère rhétorique et à une escalade verbale. Des études ont prouvé que les conflits permettent de démultiplier le temps passé sur une plateforme – et c’est le but recherché, car plus vous passez de temps sur la plateforme, plus vous allez cliquer sur des publicités.
En mai 2020, les dirigeants de Facebook ont mené des recherches internes concluant que leurs algorithmes exploitent « l’attrait du cerveau humain pour la division » dans le but d’attirer l’attention des utilisateurs et d’augmenter le temps sur la plateforme. Après avoir tenté de remédier à la situation, les résultats de ses recherches ont été discrètement enterrés par son PDG Mark Zuckerberg, parce qu’il s’est dit qu’il allait perdre de l’argent. De manière assez naturelle, ce terreau favorise les comportements justiciers.
A.-C.O. : C’est la même logique que la télévision.
D.D. : Tout à fait. C’est triste, mais le format de la spectacularisation des débats a été adapté à toutes les plateformes. En fait, cela devrait nous inciter à nous interroger sur ce que nous regardons, puisqu’il relève de notre responsabilité individuelle d’essayer de pousser ces systèmes, ces plateformes, à changer leur manière de fonctionner – ou bien de boycotter ces chaînes de télévision et ces plateformes qui ne font que brasser du vide.
A.-C.O. : Vous dites qu’individuellement, chaque commentaire paraît assez inoffensif, mais que leur accumulation collective terrorise et assomme la victime. Cela me fait penser à la fin du film M le maudit, où cette masse terrifiante et vengeresse le juge et le condamne. Sur le Web, cette masse potentielle est encore bien plus terrifiante, parce que, comme vous l’avez dit, elle est sans limite.
D.D. : C’est un bon exemple – je n’y avais pas pensé. Mais dans M le Maudit, on a l’impression que les visages sont tout de même identifiables ; à la limite, M le Maudit peut interpeller quelques personnes dans la foule, tandis que sur Internet – c’est ce que j’explique –, vous ne le pouvez pas. Certes, vous pouvez bien sûr répondre à une personne : « Attendez, vous mésinterprétez mon propos, ce n’est pas du tout ce que j’ai voulu dire, je vais vous expliquer. » Ce faisant, vous réussirez peut-être à calmer cette personne, mais derrière, il y en a des milliers d’autres qui ne verront pas forcément votre réponse. Donc, en fait, cela ne sert à rien, il n’est pas possible de faire cesser le feu parce qu’il n’y a pas de porte-drapeau ou de représentant avec qui vous pourriez parlementer pour stopper les hostilités ; il n’y a pas de possibilité de conciliation, parce que c’est une meute. Sur Internet, la distance atténue la culpabilité́ et renforce le sentiment d’impunité. Caché derrière votre écran d’ordinateur, vous pouvez détruire des gens et piétiner leur réputation sans même les connaître. Aucun échange qui permettrait des excuses ou des explications ne viendra entraver votre colère. Cela me fait penser à un autre film : Battle royale. Ce n’est sans doute pas un grand film, mais c’est une histoire où les personnages sont tous des cibles potentielles et où ils doivent tous s’entretuer – à la fin, il n’y en a plus qu’un. Et quand je scrute Twitter, j’ai l’impression que chaque jour c’est Battle Royale ! À droite de l’écran, vous avez la colonne des « trending topics » : ce sont les sujets les plus discutés du moment – et souvent, ce sont des individus qui sont les sujets les plus discutés du moment : des personnes qui ont commis une bévue, une maladresse, etc. Alors même si vous n’êtes pas au courant, simplement en lisant les gens que vous aimez bien et que vous suivez, comme si vous lisiez votre journal, vous tombez donc là-dessus : « Édouard Philippe a dit une énorme connerie ! » Vous regardez cela et vous allez peut-être ajouter un commentaire, pour vous faire entendre et participer vous aussi au sujet du jour – et ainsi, chacun y va de sa petite pique… Mais le problème, c’est que le sujet du jour, c’est le plus souvent une personne qui est traînée dans la boue ! C’est comme si, chaque jour, on désignait une liste de personnes clouées au pilori.
A.-C.O. : Alors que faire ? Y a-t-il, selon vous, des solutions envisageables pour réguler le pouvoir des réseaux sociaux ?
D.D. : Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Tout d’abord, comme je l’ai dit, les plateformes doivent revoir leur modèle de fonctionnement, afin que leurs contenus ne soient pas uniquement basés sur la conflictualité et la polarisation. Il faut aussi qu’elles mettent au point des outils pour préserver la santé psychologique des personnes qui sont lynchées – par exemple, que l’on puisse mettre son compte sous protection lorsqu’on est victime de harcèlement. Elles doivent également trouver une manière d’intégrer à leurs outils la présomption d’innocence : c’est un pilier de notre État de droit et pourtant elle est complètement absente des réseaux sociaux où, à partir du moment où vous êtes accusé, vous êtes condamné par le tribunal des réseaux sociaux.Ensuite, un deuxième niveau de responsabilité échoit à la justice, qui a un rôle à jouer. La justice ne peut pas dépendre d’entreprises privées relevant du droit américain surtout qu’elles se contentent souvent de censurer arbitrairement les propos qui s’y tiennent via des algorithmes. Il faut accorder plus de moyens humains, financiers et procéduraux à la justice pour qu’elle puisse traiter les plaintes, sans la lenteur qui la caractérise aujourd’hui, qui fait que cette meute croit qu’elle peut jouir de l’impunité. La justice doit avoir les moyens d’être plus réactive pour répondre à l’instantanéité des réseaux sociaux. Je pense que si les citoyens se disaient que la justice va prendre le relais, cela ferait un peu baisser la pression. Car aujourd’hui, on a au contraire le sentiment de ne pas être écouté par la justice, même dans les cas de harcèlement, d’agressions sexuelles, etc. – en France, seulement 10 % des femmes victimes de viol portent plainte et environ 3 % des viols débouchent sur un procès en cour d’assises. C’est devenu un tel parcours du combattant, pour les victimes ! Il y a tellement de progrès à faire ! Je pense que si tout ce processus s’améliorait et devenait plus réactif, les gens ne seraient pas amenés à se faire justice eux-mêmes ; souvent, on se fait justice parce qu’on a l’impression de ne pas avoir d’autre solution. Un des lyncheurs que j’ai interrogé dans mon livre me l’a d’ailleurs confié : « Si l’État faisait ce qu’il faut, on n’aurait pas à faire justice nous-mêmes. » Il se vit comme un justicier.
Le dernier niveau de responsabilité, enfin – après celle des plateformes et celle de l’institution judiciaire et de la police –, c’est notre responsabilité individuelle. Et mon livre est une tentative de nous mettre face à cette responsabilité individuelle, qui est celle de chacun d’entre nous, mais dont nous ne sommes pas toujours conscients. Nous sommes tous indignés par certaines choses – c’est humain. Et au moment où nous sommes indignés, nous avons tous envie de rajouter notre commentaire sur les réseaux sociaux. Mais il faut essayer de se dire qu’on n’est pas seul, que des milliers de personnes ont fait la même chose et qu’il vaut mieux s’abstenir de jeter la seconde – et a fortiori la énième – pierre. La confrontation à l’altérité et à la différence est vécue de plus en plus difficilement sur les réseaux sociaux mais j’espère que cette situation évoluera et que l’on pourra à nouveau débattre sur Twitter sans s’insulter au bout de deux échanges. On peut tous participer à ce changement de paradigme.
A.-C.O. : Quels sont aujourd’hui vos rapports à cette toile hypermnésique ?
D.D. : C’est particulier, parce que je suis un enfant des réseaux sociaux. Très tôt, j’étais sur Facebook, Instagram, Twitter. Aujourd’hui, j’en suis un peu revenu. J’y reste malgré tout – mais à contrecœur –, parce que c’est un outil de travail pour contacter des sources, pour voir des sujets montés, pour prendre le pouls de l’opinion – même si ce n’est pas du tout un bon thermomètre. Prenons un exemple récent : la vidéo de Macron avec McFly et Carlito. C’est un objet de communication qui est critiquable – pour moi, c’est évidemment un objet politique. Mais cela mérite-t-il de susciter une telle flambée de colère des deux côtés ? En fait, le moindre sujet crée une vague de haine, et je suis écœuré de voir que même sur le sport, même sur la culture, il ne peut pas y avoir de discussions apaisées. C’est un miroir déformant, et c’est devenu très anxiogène. Le web a longtemps été un refuge pour se confier et s’épancher mais c’est désormais hors ligne qu’on se met à couvert pour échapper aux sirènes anxiogènes de notre temps.
A.-C.O. : Dans votre livre, vous abordez également l’enseignement du marketing de soi-même dispensé dans les écoles de commerce – comme si nous étions devenus des marques, des produits. Pourrait-on dire que d’une certaine manière, l’impact grandissant des réseaux sociaux est une sorte de Bourse de l’humain ?
D.D. : Absolument. Cela me rappelle un épisode de la série Black Mirror baptisé « Chute libre », où tous les humains, à chaque fois qu’ils ont une interaction avec quelqu’un, sont notés. Dans cet épisode la chose est poussée à son paroxysme avec l’histoire d’une fille à qui il arrive toute une succession d’événements qui font que sa note arrive presque à zéro. Elle vit une lente dégradation sociale et finit par être quasiment SDF : elle ne vaut plus rien aux yeux des gens et, au contraire, lui parler fait baisser la note des autres. Aujourd’hui, on n’a plus de recul et cela ne choque plus personne : vous sortez d’un Uber, on vous demande de noter le chauffeur. Vous descendez d’un avion, on vous demande de noter le personnel. Vous commandez un plat, on vous demande de noter. On note tout, on évalue tout. C’est comme si l’on voulait gommer toutes les aspérités de l’être humain : il faut toujours être en forme, toujours souriant. Nous vivons dans une société de l’évaluation permanente de tout et de chacun, une société à la fois très hypocrite et très dangereuse.
A.-C.O. : Vous citez Deleuze, qui se réfère lui-même à Foucault, pour aborder le passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle, qui fonctionnent non plus par l’enfermement, mais par un contrôle continu et une communication instantanée. À votre avis, comment un Deleuze ou un Foucault réagiraient-ils aujourd’hui face à cette emprise de plus en plus forte des réseaux sociaux ?
D.D. : Je pense qu’ils la critiqueraient très fermement. Mais quelles solutions auraient-ils pour lutter contre ces phénomènes ? On a l’impression qu’il n’y a pas vraiment d’alternative à cela. Certes, de plus en plus de gens désertent les réseaux sociaux parce qu’ils en sont dégoûtés. Mais le problème, c’est qu’une grande partie du système commercial a été absorbée par cela et qu’en fait il est très difficile de s’en passer – ce serait comme renoncer au capitalisme.Michel Foucault ou Gilles Deleuze – s’ils étaient encore parmi nous – ne voudraient pas vendre leurs livres sur Amazon car le géant fait partie des GAFAM. Je pense qu’ils essaieraient de réformer cette économie numérique qui a tout absorbé – mais ce serait compliqué et qu’il serait très inquiet de vivre dans une société où chacun de nos pas est géolocalisé, nos clics monétisés et où l’administration fiscale pratique une surveillance de masse pour traquer la fraude. À l’époque déjà, Foucault a voulu critiquer la télévision à la télévision, et il a dû en venir au constat que ce n’était pas possible, que les conditions pour cela n’étaient pas réunies.
Mais des penseurs comme Deleuze ou Foucault permettraient peut-être au moins d’amener à une prise de conscience de la toxicité des réseaux sociaux – mais quelle audience auraient-ils ? Je ne sais pas. Cela dit, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l’eau du bain : Internet a quand même permis la naissance de nombreux médias et une libération de la parole.
Le droit de faire connaître son point de vue s’est libéré et élargi à l’ensemble de la société alors qu’il était jusqu’alors relégué aux radios libres et au courrier des lecteurs. Il appartient à chacun de faire des vidéos et de produire des contenus intelligents.
A.-C.O. : Ne pensez-vous pas que, tout comme la télévision, le contenu sur Internet aura tendance à devenir de moins en moins qualitatif avec le temps ?
D.D. : Il demeure pourtant un grand nombre de très bonnes émissions à télévision, sur Arte, sur France 5… Nous pouvons exercer notre responsabilité individuelle à bon escient en encourageant les émissions (à la télévision) et les contenus (sur Internet) qui prennent les téléspectateurs et les internautes au sérieux, et qui s’adressent à leur intelligence. Je crois qu’il y a un modèle alternatif – ce n’est pas celui qui est le plus mis en avant, mais il existe cependant. Et je pense qu’à l’avenir, il y aura des réseaux sociaux sur lesquels on pourra discuter de manière apaisée, où l’on rencontrera davantage de modération, de réflexion collective, où les règles du jeu seront différentes. Il est également possible qu’il émerge des modèles nationaux, ou un modèle européen, de nouveaux géants qui proposeront d’autres alternatives, une fois que les gens seront lassés des GAFAM.
A.-C.O. : Vous croyez qu’il y aura, à un moment donné, une lassitude qui permettra de tout repenser ?
D.D. : C’est certain. Mais en attendant, cela cause beaucoup de dégâts et cela participe à la fracture de la société, qui n’a jamais été aussi clivée – en grande partie à cause des réseaux sociaux.
A.-C.O. : Vous écrivez d’ailleurs que « les masses populaires réduites au silence peuvent enfin titiller les puissants » : quelle est la part de la lutte des classes dans ce phénomène de bashing ?
D.D. : Elle est importante. Au moment des gilets jaunes, par exemple, on a vu qu’une partie de la population ne se sentait pas représentée. Je crois qu’on ne peut pas balayer cette colère d’un revers de main. Nombreux sont celles et ceux qui ne se sentent pas représentés légitimement, car les grandes institutions et le pouvoir politique ne sont en effet pas représentatifs de la mixité de la population, de sa diversité sociologique, etc. Au moment de cette révolte sociale, toute une partie de la France périphérique et populaire, dont les attentes et les revendications n’étaient pas relayées, a décidé de se réunir et de se faire entendre. Il y a une colère, bien réelle ; il faut l’écouter. À partir du moment où les gens se sentiront représentés, incarnés par d’autres personnes, j’ai l’espoir que le niveau de tension baissera et qu’ils auront moins envie de se faire justice par eux-mêmes. Au nombre des professions les plus détestées aujourd’hui figurent les journalistes, les hommes politiques, toutes les fonctions d’incarnation : il faut s’interroger sur les ressorts de cette haine, sans doute due au fait que beaucoup d’erreurs ont été commises, et qu’il y a très peu de reconnaissance et d’humilité par rapport à ces échecs (ce qui constituerait déjà un premier pas vers une réparation). Il y a également une forme de cooptation, de réseaux endogames. Je pense que si tous ceux qui, justement, sont censés parler des sujets qui agitent la société étaient davantage à l’écoute de la société dans sa pluralité, cela ferait déjà baisser le niveau de tension. Je ne crois pas que les débats de CNews ou de BFM, tous les soirs, répondent aux attentes de 90% de la population. Je pense que les gens se fichent de savoir si Édouard Philippe va être candidat, ou bien Éric Zemmour. La vidéo de McFly et Carlito ou les débats sur l’islamo-gauchisme les indiffèrent. À côté de cela, dont on nous rebat les oreilles, il y a un mal-être étudiant, un monde agricole qui est en train de mourir et des délocalisations qui s’opérent à bas bruit…
A.-C.O. : Il y a un décalage.
D.D. : Oui, il y a un décalage ; et du coup, ce fossé se creuse encore davantage. Lorsqu’on ne se sent pas représenté, on en vient à vouloir se faire justice ; et cela passe d’abord par les réseaux sociaux qui, pour beaucoup, sont devenus une forme de soupape de compensation.
A.-C.O. : C’est très vrai. Est-ce que l’écriture de ce livre vous a aidé à mieux appréhender ce que vous avez vécu personnellement ?
D.D. : Disons que cela m’a permis de donner du sens à ce que j’ai vécu.