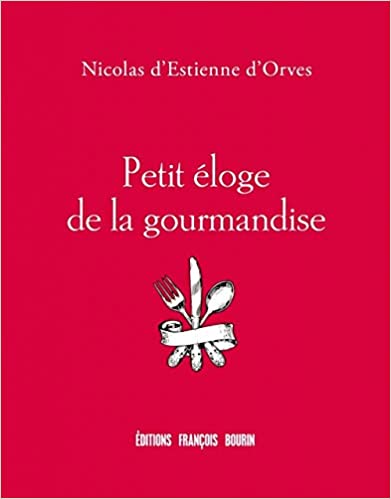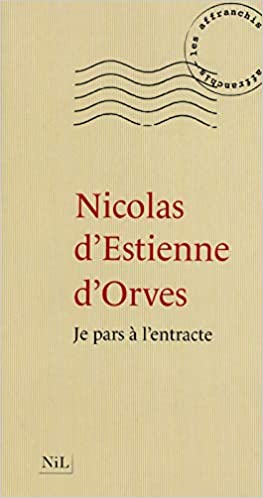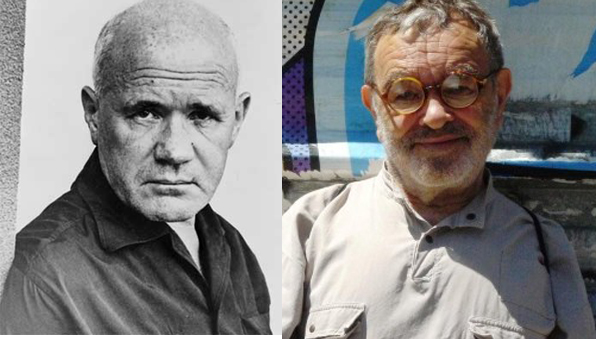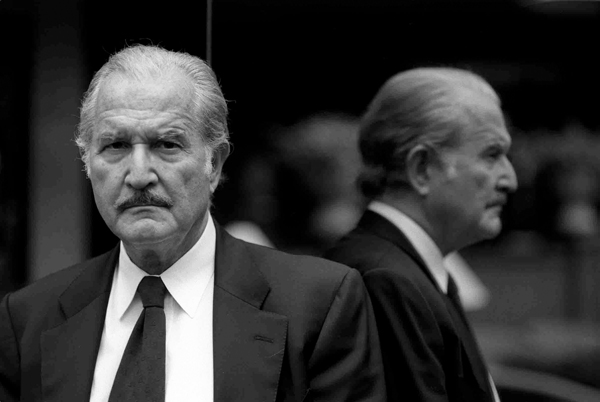Anne-Claire Onillon : Le plaisir de la lecture est-il comparable au plaisir que peut procurer la nourriture ? L’écriture comme préparation en cuisine et la lecture comme une façon de se mettre à table ?
Nicolas d’Estienne d’Orves : L’écriture, certainement. J’ai un rapport très organique, très physique, très artisanal à l’acte d’écrire. Je rédige mes romans en suivant des recettes précises, comme en cuisine, avec un gros travail en amont : je prépare des ingrédients, je les rassemble, je fais un plan détaillé, un peu comme on prépare un scénario. Je suis une ligne directrice extrêmement minutieuse, qui peut parfois être un peu sclérosante, auquel cas je dois en sortir. Ce travail en amont est comparable à ce qu’on fait avant de mettre un plat au four : je place tout dans un moule, j’enfourne, et ce qui en sort, je le donne aux gens, comme si je les invitais à dîner chez moi – alors qu’en fait (d’ailleurs je le dis dans mon livre), je cuisine peu, pas très bien, même plutôt mal, et essentiellement pour mes enfants. Mais j’ai un rapport assez culinaire à la chose littéraire – je n’y avais jamais pensé.
Pour ce qui est de la lecture, c’est autre chose. Je comparerais davantage le plaisir gastronomique à la musique, car le plaisir gustatif est plus évanescent, il se passe de mots. Dans un second temps, on plaque des mots dessus ; mais c’est d’abord quelque chose de très impalpable qui ignore la barrière de la langue, quelque chose d’absolument universel. Autour d’un bon vin, d’un plat, il peut y avoir une communauté spirituelle et presque intellectuelle avec quelqu’un dont on ne parle pas la langue, dont on ne partage pas la culture ; la gourmandise est incroyablement fédératrice. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de grandes résolutions diplomatiques se sont conclues à table. Le fameux congrès de Vienne, juste après la chute de l’empire napoléonien, a abouti grâce à Talleyrand et à son fameux chef, Antonin Carême, qui a transfiguré ce moment vraiment délicat, entre d’anciens ennemis qui devaient trouver un terrain d’entente. Rien n’apaise davantage l’animosité que de partager les plaisirs de la table, les plaisirs du goût : lorsqu’on a un peu bu et qu’on mange de bonnes choses, la tension s’apaise et l’on se rend compte qu’en fait, on aime les mêmes aliments, on est habité par les mêmes désirs, les mêmes plaisirs ; les différences culturelles, intellectuelles, politiques, s’effacent devant la simple communauté de joie de goûter des choses universelles.
A.-C.O. : La grande différence, c’est que la lecture est aussi un acte solitaire, tandis que pour vous, l’appétit, cela se partage.
N.E.O. : En effet, pour moi, la gastronomie n’est pas un plaisir solitaire. Cela peut être un dialogue à deux – j’adore les repas en tête-à-tête –, à quatre, à six… Mais attention, il ne faut non plus être en trop grand nombre, car lorsqu’on est trop nombreux à une même table, on oublie un peu ce qu’on est en train de manger, et c’est moins amusant. C’est pour cela que j’aime bien les clubs gastronomiques où l’on reste entre nous, en petit comité, à disséquer ce qu’on mange. La gourmandise, c’est vraiment le partage, le plaisir partagé. Pour le coup – sans tomber dans l’orgie –, cela s’apparente à l’amour physique, c’est un échange de fluides.
A.-C.O. : Entrons un peu plus dans votre livre. J’ai retenu la figue qui, pour vous, est « notre mère à tous, l’ancêtre de nos joies gustatives, l’Éden de la gourmandise ». Quel est votre auteur figue ?
N.E.O. : Mon auteur figue ! Ce n’est pas mal, ça ! Ce qui me fascine avec la figue, c’est que c’est un fruit qui, je pense, provoque le même plaisir depuis toujours. Il n’a jamais été modifié, il n’a pas non plus, comme la tomate, l’avocat ou le chocolat, été découvert à la Renaissance, au moment des grandes expéditions maritimes où, soudain, on a découvert tout un pan de l’alimentation arrivé d’outre-Atlantique. À l’époque d’Homère, quand on mordait dans une figue, le goût était le même qu’aujourd’hui. En littérature, c’est plus compliqué, parce qu’une fois de plus il y a cette barrière de la langue, de l’évolution du rapport au monde – c’est-à-dire qu’il y a forcément des traductions. C’est en cela que la gastronomie transcende, si je puis dire, la littérature : on n’a pas besoin de filtre. Mais alors, un auteur figue, laissez-moi réfléchir… Ce n’est pas simple, de nos jours, de faire lire à quelqu’un un auteur comme Rabelais ou Montaigne, par exemple. Le plaisir immédiat que pouvait prendre un lecteur du XVIe n’était pas le même que celui d’aujourd’hui. Qui lit Homère dans le texte de nos jours ; surtout : qui le lit avec la même spontanéité que dans l’Antiquité ? Je ne crois pas qu’un auteur figue soit possible.
A.-C.O. : L’auteur figue n’existe donc pas… Alors, lequel de vos livres pourrait être votre sablé, sachant que le sablé, lui, est, selon vous : « l’école d’équilibre, de subtilité, un mets qui ne triche pas car il est sans filtre, ni filet » ?
N.E.O. : C’est un petit livre qui s’intitule Je pars à l’entracte et qui est mon livre le plus intime, le plus personnel. C’est une lettre que j’ai écrite à mon meilleur ami, qui s’est suicidé il y a déjà pas mal d’années ; il était comme mon frère, nous avons grandi ensemble, nous avions comme une gémellité assez étrange, nous étions passionnés par les mêmes choses, nous vivions totalement en symbiose. Puis un jour il a décidé de se donner la mort. C’est mon livre le plus bref, le plus équilibré, le plus ramassé, le plus synthétique, le plus sincère et, pour le coup, un texte dans lequel je n’ai mis absolument aucun filtre. Je me suis déboutonné, si je puis dire, ce que je fais assez rarement en littérature. J’ai plutôt tendance à écrire des romans avec de nombreux personnages, beaucoup de décors et pas mal de numéros de claquettes – j’adore ça, et puis j’aime raconter des histoires. Mais dans ce livre, je ne raconte pas d’histoires ; c’est une lettre à un absent, sur le modèle de la Lettre au père de Kafka. Il a paru aux éditions Nil, dans la collection « Les affranchis », dont le principe est d’écrire une lettre à quelqu’un à qui l’on n’a jamais pu parler. Et justement, avec cet ami, qui s’appelait comme moi Nicolas, nous n’avons jamais eu une grande conversation sur notre amitié, sur la complexité de notre relation, de notre complicité. Il est parti trop tôt. Je me suis donc permis de faire une sorte d’appel, pas du tout un appel au secours, mais un coup de chapeau et un coup de griffe post mortem, pour dire tout ce que j’avais à lui dire.
A.-C.O. : Et pourquoi ce titre : Je pars à l’entracte ?
N.E.O. : Parce qu’il est parti à mi-parcours : il avait 32 ans.
A.-C.O. : Parlons andouillette, à présent ! Vous dites : « Peu de mets provoquent une réaction si viscérale. On l’adore ou la déteste. Jamais dans la zone grise, elle est ombre ou lumière. » Quel livre andouillette auriez-vous à nous conseiller ?
N.E.O. : Un livre andouillette est un livre clivant, qui peut horripiler. L’un de mes auteurs favoris est Paul Morand, un écrivain que l’on aime beaucoup ou pas du tout, pour des raisons aussi bien littéraires que morales, politiques et intellectuelles. Et l’un de mes textes favoris de Morand, que j’offre régulièrement, est un petit livre qui s’intitule Hécate et ses chiens, publié chez Flammarion dans les années 1950. C’est un texte très ambigu, extrêmement obscène ; parmi ceux auxquels je l’ai offert, certains l’ont détesté, trouvant que c’était un livre malsain et complaisant, alors que d’autres ont été absolument fascinés.
Dans un tout autre genre, j’aime également beaucoup un petit livre de Roland Topor qui s’intitule La Vérité sur Max Lampin. Là encore, c’est un livre qu’on adore ou qu’on déteste, qu’on trouve drôle ou pas du tout. C’est un livre sur l’ordure, un livre de haine ; il me fait penser à ces objets en caoutchouc qu’on met sur les bureaux pour les écraser lorsqu’on a envie de passer son agressivité. Topor a inventé Max Lampin, qui est un personnage qu’il insulte. C’est un texte à lire quand on est très en colère contre quelqu’un. C’est un vrai livre andouillette ; je l’ai fait lire à toutes sortes de personnes : certains l’ont trouvé génial, tandis que d’autres n’ont pas compris et l’ont trouvé obscène, laid, vulgaire.
A.-C.O. : Je vais m’empresser de le lire !
N.E.O. : Lorsque je le laisse traîner, mes enfants se plongent dedans… Ils adorent et ne se tiennent plus de rire. La laideur volontaire du trait et autant de gros mots, c’est vraiment génial. Un vrai livre andouillette !
A.-C.O. : Vous avez un avis assez étonnant sur McDonald’s, pour un gourmet.
N.E.O. : Oui, et revendiqué.
A.-C.O. : « J’ai toujours défendu McDonald’s. En un sens, c’est de la merde qui s’assume, qui ne pète pas plus haut que son cul. » Avez-vous une lecture McDo ?
N.E.O. : J’ai toujours aimé – et j’en ai d’ailleurs pratiqué – ce qu’on appelle les « mauvais genres », c’est-à-dire le polar ou la science-fiction. Je suis tombé dans la lecture avec les romans de Stephen King, quand j’avais 12-13 ans. C’est lui qui m’a, pour la première fois, aspiré dans un livre, happé dans un univers romanesque au point de me faire oublier le monde extérieur. C’est avec Stephen King que j’ai senti à quel point le pouvoir évocateur des mots transcendait beaucoup de choses et permettait de projeter le lecteur dans une fiction hypnotique. À l’époque, c’était considéré comme de la sous-sous-sous-littérature, mais on s’est maintenant rendu compte que malgré le côté très pataud de l’écriture de Stephen King, qui souffre énormément de mauvaises traductions (car c’est de l’anglais parlé et que la langue anglaise parlée est à peu près intraduisible), il y a une force et un univers extraordinaires. Depuis les années 1970 et jusqu’à aujourd’hui, c’est un des grands écrivains naturalistes américains, et l’auteur d’une régénérescence de l’imaginaire assez sidérante.
A.-C.O. : Et que dire des tripes ? Je vous cite toujours : « Dans un menu de restaurant, je vérifie toujours la présence tripière. Elle est pour moi gage de qualité et d’ouverture. Un rognon ou un foie de veau peuvent à eux seuls sauver une carte. » Si vous appliquiez votre grille d’analyse d’un menu de restaurant à une librairie, quels seraient vos auteurs abats ?
N.E.O. : J’aime bien qu’une librairie soit éclectique. J’avais fait un article assez méchant sur une librairie très intello du Marais, qui ne vendait que des livres de sciences humaines. Je suis agacé par ces librairies qui, par principe, refusent de vendre un Marc Lévy ou un Guillaume Musso sous prétexte que ce ne serait pas assez littéraire. Pour moi, une librairie doit se généraliser ; il faut qu’on puisse y trouver aussi bien les œuvres complètes de Roland Barthes que le dernier livre de Virginie Grimaldi. Je n’aime pas qu’on ait à subir le terrorisme intellectuel d’une librairie qui fait sa classification du public. C’est un problème très français de dire qu’il y a du bon et du mauvais genre, du premier et du second rayon. À mon avis, on doit trouver de tout dans une librairie : il faut qu’il y ait un bon rayon polars, un bon rayon BD, un bon rayon mangas – je n’aime pas cela du tout, mais mes enfants sont des passionnés –, un bon choix de chaque chose, un mélange de curiosité et d’ouverture d’esprit, des livres de droite et de gauche… Les librairies trop terroristes, trop vindicatives, cela m’irrite.
A.C.O. : Vous entretenez une relation particulière avec Kinder. Je vous cite encore : « L’écœurement qu’il me procure ensuite, et même une satisfaction masochiste, comme si je bichais d’en souffrir, comme si je l’avais mérité. » Avez-vous un livre Kinder, de plaisir coupable ?
N.E.O. : En fait, je n’ai pas vraiment de livre Kinder ; car manger un Kinder, c’est une minute, alors que lire un livre, cela prend plus de temps. Et il faut que j’aie du plaisir à la lecture – et pas un plaisir masochiste. Je peux avoir un plaisir masochiste au goût, au palais, manger quelque chose en sachant qu’à la fin je vais être malade ; mais le livre, il y a un moment où je le ferme. Je suis jusqu’au-boutiste dans mon masochisme gastronomique, pas dans mon masochisme littéraire.
A.-C.O. : À propos des vins des Corbières, vous écrivez : « Buvant ces vins, il me semble avaler ces rocailles qui défient le ciel, il me semble déguster une ambiance médiévale. » Quel auteur vous fait autant voyager dans le temps et dans l’espace ?
N.E.O. : J’ai tendance à placer Alexandre Dumas très haut dans mon panthéon, parce qu’il possède une énergie, une vivacité, une efficacité dans le romanesque qui me fascinent. J’ai l’impression que ses personnages existent, qu’ils se baladent ici, dans cette pièce, même si Dumas – et c’était déjà le cas à son époque – pratique un passé recréé de façon assez maladroite. Il venait du théâtre, donc il a un sens du dialogue et une efficacité narrative qui créent un incroyable effet de réel – peut-être parce qu’il a un tel souci de capter son lecteur. Il peut me faire voyager, me faire croire que je vis les guerres de religion, que je suis à la cour de Marie-Antoinette ou dans le Paris de Monte-Cristo. Avec lui, le voyage dans le temps est immédiat, alors que ses romans datent déjà d’un siècle et demi.
A.-C.O. : Vous écrivez : « Le goût est une création de l’âme, la rencontre de la surprise et de la mémoire. » Est-ce que, pour vous, cela pourrait être une définition de l’écriture ?
N.E.O. : C’est une définition de l’écriture et de la lecture, parce que nous ne sommes que la somme des livres que nous avons lus, et non pas des livres que nous avons écrits. Et puis, à chaque fois, on essaie malgré tout de ne pas trop se répéter ; en même temps, on n’écrit jamais que le même livre, on a toujours les mêmes obsessions – surtout dans mon cas, moi qui suis très polygraphe : j’ai publié beaucoup de livres qui n’ont rien à voir les uns avec les autres, chez différents éditeurs, mais mes obsessions restent les mêmes. Chaque nouvelle lecture et chaque nouveau livre dont on est l’auteur, c’est une pierre de plus à un édifice qui peut être une cathédrale ou bien juste un petit phare branlant qui va s’écrouler à un moment ou à un autre. Tout auteur et tout lecteur – si tant est qu’il y ait encore des gens qui lisent – est la somme des livres qu’il a engrangés, qu’il a avalés ou qu’il a rejetés. Les gens qui ne lisent pas – et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas lire du tout – sont un mystère pour moi ; je me demande toujours comment ils se construisent intellectuellement.
A.-C.O. : Ont-ils une âme ? Y a-t-il la possibilité d’une âme en dehors de la lecture et de l’écriture ?
N.E.O. : Je pense que oui, tout de même, car il existe de grands esprits qui ne sont pas des esprits littéraires. Il y a d’autres formes d’art : la musique, qui pour moi est l’art suprême et qui me fascine, peut-être parce que je ne la pratique pas. Je vis par la musique. Si je devais faire un choix, si l’on me disait : « On t’enlève les livres ou l’on t’enlève la musique ? », je dirais : « Laissez-moi la musique. » Et la bouffe !
A.-C.O. : Et les deux en même temps, si possible.
N.E.O. : Tout à fait. La mémoire est essentielle pour évoluer dans la lecture et dans l’écriture ; mais en même temps, il faut que la mémoire soit sélective et séquencée, sinon, on se retrouve comme Ireneo Funes, le personnage de Borges, qui est hypermnésique et qui devient fou parce qu’il est étouffé par sa propre mémoire. Moi, je souffre de l’excès inverse : je commence à perdre la mémoire, j’ai parfois du mal à me souvenir de certaines choses – peut-être est-ce dû au portable. Les gens qui ont 60 ou 70 ans aujourd’hui ont grandi à une époque où l’on apprenait tout par cœur : les départements, les préfectures, des tirades de Corneille, de Racine – mais c’est une autre génération. Aujourd’hui, on est connecté en permanence à des mémoires externes ; dès qu’on a un problème, dès qu’on cherche à se souvenir de quelque chose, on sort son téléphone portable. Donc la mémoire disparaît, alors que sont essentielles la mémoire des lectures comme celle du goût. En ce moment, je fais justement l’expérience de l’absence du goût, et il s’avère que c’est très compliqué de se souvenir in abstracto d’une saveur – un livre, c’est peut-être plus facile, car certaines phrases nous reviennent. Je dois tout réapprivoiser, c’est une expérience intéressante, mais très perturbante.
A.-C.O. : Je vous cite : « Sans lui, ma plume s’égare, l’inspiration est à la peine, les mots ne viennent pas », dites-vous en parlant du capuccino Nescafé que vous buvez tous les matins.
N.E.O. : À 5 heures.
A.-C.O. : Et vous ajoutez : « Il n’est pas question de plaisir, encore moins de qualité. C’est une névrose, voilà tout. » Vos névroses seraient-elles le moteur de votre écriture ?
N.E.O. : Nous sommes tous des névrosés. C’est d’ailleurs aussi ce qui permet de structurer une journée d’écrivain, parce que sinon on est devant du vide ; il faut des névroses. Mon camarade Yann Moix est, par exemple, lui aussi quelqu’un d’extrêmement organisé : il fait des plans, il dresse des listes. Parfois, à cinq heures du matin – parce que nous nous levons à la même heure –, il m’envoie une photo de ce qu’il a déjà coché. Si les écrivains n’étaient pas de grands névrosés, je crois qu’ils n’arriveraient pas à mettre des mots les uns à la suite des autres. Qui dit névrose dit une forme de psychorigidité, une autodiscipline qui fait que l’on arrive à structurer ce qui est impalpable – car lorsqu’on est écrivain, on fait du plein avec du vide, aussi il faut arriver à le capter, ce vide. Si l’on n’a pas une rigueur d’organisation, une forme de rigueur morale et de rigueur d’emploi du temps, on se laisse dépasser. L’écriture, ce n’est pas quelque chose qui s’improvise, qui se butine ; on ne peut pas être un écrivain du dimanche. C’est du plein temps, et c’est même une attitude générale face au monde, face à la vie, face au temps, face aux gens… Pour moi, tout commence donc le matin par ces deux tasses de capuccino, qui sont le début de mes rituels d’auteur. Je suis du matin : le plus important, c’est la tranche 5 h-10 h, parce qu’après, il y a déjà du bruit et la conscience n’est plus dans le même état. Si je n’ai pas ces quelques heures de solitude créatrice et d’efficacité intellectuelle, j’ai l’impression que j’ai perdu ma journée, cela me met le moral à zéro et je n’ai plus qu’à attendre le lendemain matin. C’est donc l’acte de naissance du jour et de ma journée d’écriture : tout commence par le capuccino.