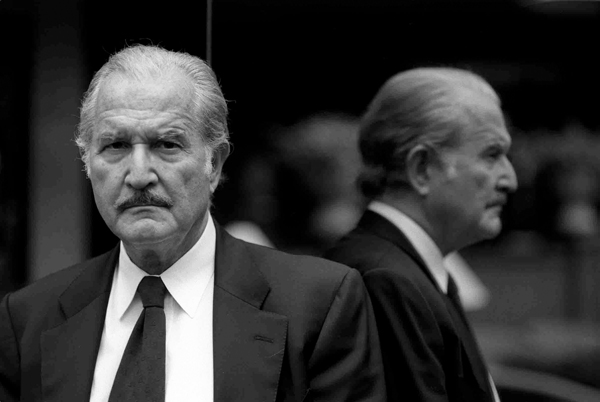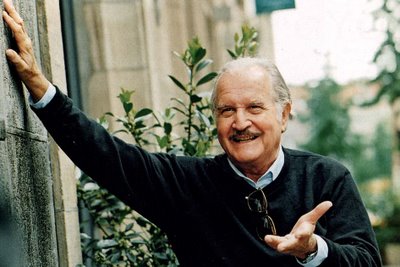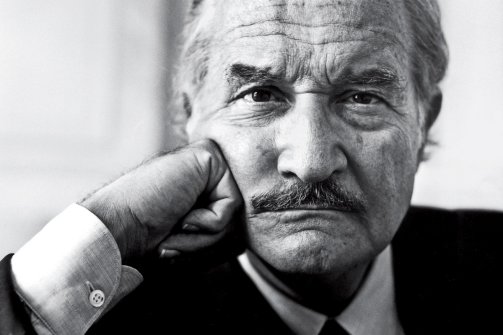Fragments du journal d’un marin génois – par Carlos Fuentes
(Extrait, RDJ, n°12, janvier 1994)
Sur le vol Iberia, on me traite pour ce que je suis : une relique. Vénérable relique : Christophe Colomb rentre en Espagne après cinq cents ans d’absence. J’avais perdu toute notion du temps et de l’espace. Maintenant, tandis que je plane dans les airs, elle me revient. Ah, quelle joie de suivre de là-haut le tracé de mon premier voyage, en sens contraire : les montagnes couvertes de chênes et d’arbousiers, la terre fertile, toute cultivée, les barques qui sillonnent le golfe dans lequel se jettent sept fleuves dont l’un en douce cascade laiteuse ; je vois la mer et les sirènes, les léviathans et les amazones qui tirent leur flèches contre le soleil. Et je devine déjà, tandis que je survole mon verger calciné, les plages avec leurs tas de merde, les chiffons, ensanglantés, les mouches et les rats, le ciel âcre et l’eau empoisonnée. Vont-ils encore uns fois accuser les Juifs et les Arabes d’être responsables de tout cela avant de les expulser et les exterminer ?
J’observe le vol de craves et de canards sauvages, et je sens que notre nef est poussée par de doux alizés sur une mer changeante, ici placide comme du verre, là clouée dans les sargasses, parfois démontée comme aux pires moments du premier voyage. Je vole près des étoiles et pourtant je ne vois qu’une seule constellation à la tombée de la nuit. Ce sont les superbes seins d’Ute Pinkernail qu’il ne m’a pas été donné de toucher…
On dépose devant moi du pseudo-champagne espagnol et la revue Hola. Je ne comprends pas le contenu du journal. Je rentre en Espagne. Je rentre chez moi. Je tiens serrées dans mes deux mains les preuves de mes origines. Dans l’une, les graines d’oranger. Je veux que ce fruit survive à l’implacable exploitation de l’île. Dans l’autre, la clef glacée de la maison de mes ancêtres à Tolède. C’est là que je retournerai pour mourir : maison de pierre au toit effondré, porte grinçante jamais ouverte depuis le départ de ma famille, Juifs expulsés par les pogromes, chassés par la peste, la peur, la mort, le mensonge, la haine…
Je récite en silence la prière que je porte sur la poitrine comme un scapulaire. Je la récite dans la langue que les Juifs d’Espagne ont préservée durant toute cette éternité, signe que nous ne voulions pas renoncer à notre foyer, à notre maison : «O toi, Espagne bien-aimée, nous te nommons Mère et jamais nous n’avons abandonné ta douce langue. Bien que tu nous aies arrachés de ton sein comme une marâtre, nous ne cessons de laisser les cendres de leurs ancêtres et de milliers de ses amants. Nous t’avons gardé tout notre amour familial, glorieux pays, et t’adressons notre salut glorieux ».
Je répète la prière, je serre la clef dans ma main, je caresse les graines, puis je me laisse aller à un vaste songe sur la mer, dans lequel le temps circule comme les courants marins, où tout converge et se rejoint, conquérants d’hier et d’aujourd’hui, reconquêtes et contre-conquêtes, paradis et envahissement, apogées et décadences, départs et arrivées, apparitions et disparitions, utopies du souvenir et utopies du désir… La constante de cette mouvance est le déplacement douloureux des peuples, l’émigration, la fuite, l’espoir, hier comme aujourd’hui.
Que vais-je trouver à mon retour en Europe ?
Je rouvrirai la porte de ma maison.
Je replanterai la graine d’oranger.