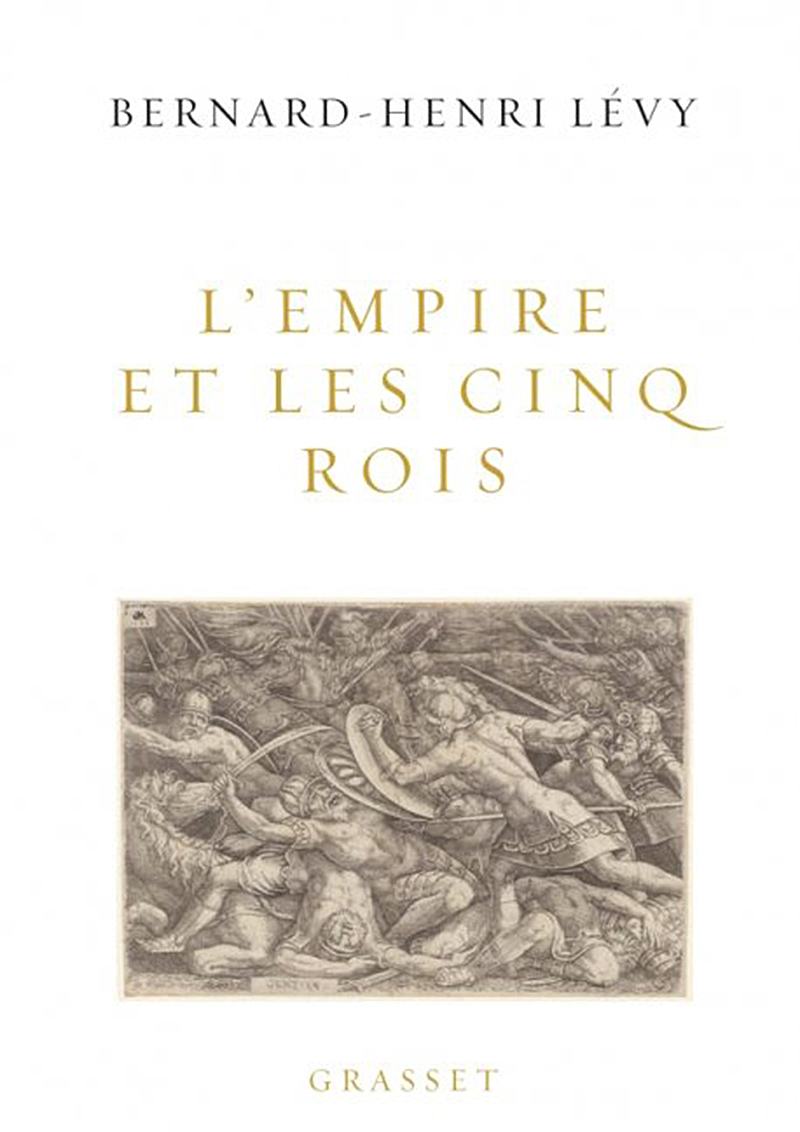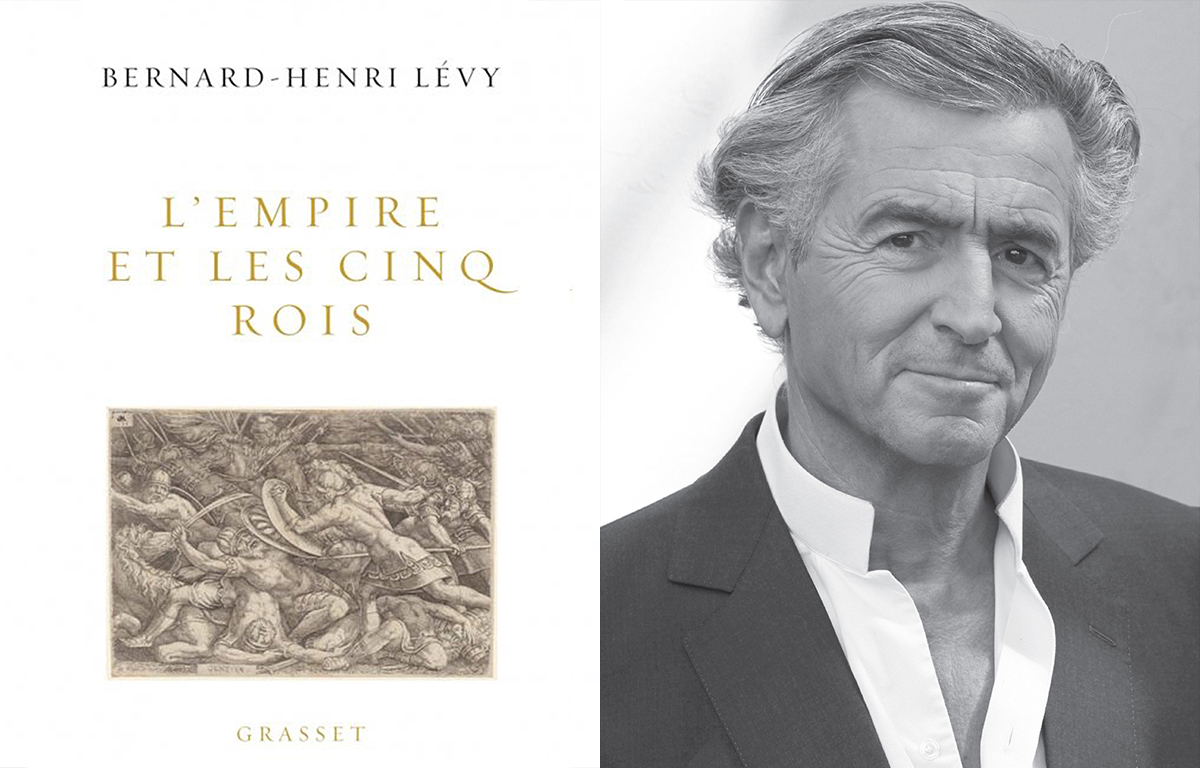C’est évidemment un grand honneur que d’avoir ce parterre qui est le vôtre. […] Et c’est un grand plaisir d’accueillir pour l’éternité vos écrits, vos films, vos documentaires.» Ce 13 mars, à la bibliothèque de l’Arsenal, Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, ne ménage pas ses effets pour accueillir son hôte, Bernard-Henri Lévy. L’écrivain-philosophe fait, ce soir-là, d’une pierre deux coups. Il lit des passages de son nouveau livre, L’Empire et les cinq rois (Grasset), tout en annonçant, l’air de rien, qu’il a désormais sa place réservée «pour l’éternité». Ou du moins son œuvre, mais est-ce si différent?
Pour l’occasion «son parterre» est en tout cas à la hauteur. Un ancien président de la République, François Hollande, un ancien ministre, Bernard Kouchner, Milan Kundera, mais aussi Michel Bouquet, Xavier Niel, Claire Chazal, Alain Minc, Claude Perdriel, sans compter la famille – sa fille, Justine, sa femme, Arielle Dombasle –, Olivier Nora, le président de Grasset, Olivier et Christine Orban, Jean-Paul Enthoven et Gilles Hertzog, les compagnons de toujours, ou encore Betty Catroux. Un auditoire très chic, parisien en diable – même si un peu «ancien monde», dirait Emmanuel Macron –, venu écouter pendant une heure trente le philosophe pousser son nouveau cri d’alarme en réaction à «l’abandon du peuple kurde par ses alliés traditionnels». Les Kurdes aujourd’hui, après tant d’autres peuples oubliés.
À commencer par celui du Bangladesh, au début des années 1970. Bernard-Henri Lévy, jeune étudiant, ému par l’appel d’André Malraux, décide d’y partir. Une manière pour le diplômé de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm de se frotter à l’histoire avec un grand H. Une manière aussi de se mettre dans les pas de Malraux, dont il s’inspire dans le verbe et la geste, lui qui a pourtant écrit dans son livre Comédie qu’il fallait garder en mémoire son histoire: «Parti pour réincarner D’Annunzio, Byron et Lawrence réunis, et finissant dans la peau d’un clown lyrique, dévoré de tics et de poncifs.»
Des causes nobles mais lointaines
À l’époque, «BHL» n’est pas encore né. Il verra le jour quelques années plus tard, en 1977, sur un plateau d’«Apostrophes», où il est venu présenter son livre, La Barbarie à visage humain . Il est beau, intelligent, beau parleur aussi. Il se pose en porte-drapeau d’une génération d’intellectuels – les nouveaux philosophes – en révolte contre un certain dogmatisme marxiste et est cornaqué par l’éditrice Françoise Verny, qui le «croquera» dans Libération : «(Il) possède l’intelligence des idées, goûte l’art de la stratégie. Lui manque l’intuition des êtres, hommes et femmes. D’ailleurs, s’intéresse-t-il vraiment à eux?» Déjà, il mélange allègrement les genres. En même temps que paraît La Barbarie à visage humain, il joue dans un film, Aurélien. On le voit ainsi la même semaine s’époumoner contre le Goulag et s’afficher sur grand écran en petite tenue. D’où ce titre du Figaro à l’époque: «Un philosophe en caleçons» !
C’était il y a plus de quarante ans. Le temps a passé, les présidents se sont succédé. De nouveaux fronts ont émergé, de nouvelles guerres ont éclaté, mais Bernard-Henri Lévy est toujours là. Et aime bien toujours s’exposer. Dans tous les sens du terme. Il est passé de la philosophie au roman, du roman au théâtre, puis du long-métrage au reportage. Il a connu des heures de gloire et des «échecs sanglants». Il a enchaîné les polémiques et les querelles, a frôlé les abîmes en prenant longtemps des amphétamines à haute dose, s’est fait reprocher pêle-mêle son inconscience, son narcissisme, son égocentrisme, lui le directeur de cette revue au nom prédestiné: La Règle du jeu, rebaptisée «La Règle du je» par les mauvaises langues. Il a épousé une actrice, une femme exposée, elle aussi, Arielle Dombasle, et des grandes causes. À la pelle. De la Bosnie à la Russie, de l’Algérie au Kurdistan, en passant par la Libye ou Salman Rushdie. Des causes nobles mais lointaines toujours, comme si la misère au coin de la rue ne l’intéressait pas. «Je lui ai souvent dit: on va encore te reprocher de négliger le social, d’aller défendre des causes aux antipodes», sourit Jean-Paul Enthoven. «Bernard, son sujet, c’est le monde. Il a le regard large comme son père. Pas un regard obtus, étroit», renchérit François Pinault, qui, après avoir été un ami d’André Lévy, entretient une relation quasi filiale avec le fils. Quant à Gilles Hertzog, qui l’accompagne depuis toujours dans ses périples divers et variés, il avance un début d’explication: «Pour notre génération, tout se passait au Vietnam, à Cuba. La France, c’était étriqué. Comme les maoïstes, on passait par Pékin pour changer Pantin.»
Entre les champs de bataille et les palais, les siens et ceux des princes – «le terrain et les palais», résume Hertzog –, BHL se débrouille toujours pour trouver sa place sur la photo, malgré les critiques qu’il a essuyées pour avoir poussé à une intervention occidentale en Libye. Il se défend: «L’Occident, avant cela, a toujours été du côté des dictateurs.» Quant aux conséquences sur l’équilibre de la région, il élude: «Je vous citerai la phrase qu’a prononcée Zhou Enlai à Malraux qui lui demandait ce qu’il pensait de la Révolution française, deux siècles plus tard : “Il est encore un peu tôt pour se prononcer.”»
Avec Emmanuel Macron, cependant, les relations semblent moins cordiales qu’avec ses deux prédécesseurs. Et même si une projection de son dernier film, La Bataille de Mossoul, a été organisée à l’Élysée, en juillet dernier, en présence du général Barzany, même si les deux hommes échangent par SMS, le nouveau président – qui a reçu jeudi dernier une délégation arabo-kurde – semble vouloir tenir un peu à distance le philosophe. BHL feint de ne pas s’en offusquer, même si cela contredit son désir d’être dans la lumière, mais aussi celui d’avoir du pouvoir sur le pouvoir. Quelles que soient les critiques récurrentes à son égard, cette «haine chimiquement pure» ou ce mépris goguenard qu’il suscite chez certains, BHL est encore là.
Dans le paysage. Il n’a cessé toutes ces années durant de continuer à écrire son propre roman. De se faire son film en cinémascope, lui qui est, selon son ami Gilles Hertzog, «obsédé par la postérité». Quitte à «prendre des poses gréco-romaines, en travaillant le marbre et à laisser sa marionnette médiatique», et à être qualifié de «plus beau décolleté de Paris». Il assume: «C’est assez commode pour un écrivain d’avoir une marionnette médiatique, les gens s’énervent dessus et vous laissent en paix pour le reste. L’essentiel, c’est l’œuvre et l’action.» Alors, oui, la fameuse chemise blanche, il ne compte pas en changer: «Je suis comme ça, je ne me déguise pas. Je ne porte pas de gilet multipoches ou de pantalon kaki. Cela fait vingt ans que c’est ainsi. C’est un signe de courtoisie élémentaire.»
Tout tendu vers ce but, ce souhait de laisser sa trace dans la postérité, et évoquant au passage presque furtivement «les plaisirs de la vie», il reconnaît sans peine: «La vie d’un écrivain s’inscrit dans deux temps distincts. Il y a ce que l’on écrit. Et il y a ce qu’il en restera. Je suis de peu de foi, mais j’ai foi en ça: il faut que l’ensemble soit présentable, cohérent pour “après”. Je ne connais pas un écrivain qui n’y pense pas.» Pour que «l’ensemble soit présentable», BHL est donc toujours dans le contrôle. Contrôle des autres qu’il protège parfois de manière doucement tyrannique, mais aussi de lui, bien sûr. De sa posture, de son image, mais aussi de sa parole. Lors de notre entretien, il dresse des herses dès qu’il prend conscience que les propos qu’il vient de prononcer pourraient lui porter tort: «Ça, c’est off», «Ça, c’est super off». Rien de terrible, pourtant, si ce n’est parfois une part d’intime ou le désir de souligner ses actes de bravoure, de se pousser du col. Étonnant mélange de rouerie, de cynisme et de naïveté presque enfantine.
Le mouvement comme son salut
Ce besoin de contrôler son image et de penser à sa postérité a commencé tôt. «Quand j’étais gamin, quand j’avais 7 ou 8 ans, raconte-t-il, j’avais une cabane dans le jardin de mes parents. J’écrivais ma propre oraison funèbre et je me la récitais tout seul comme si j’étais un champion sportif, un aventurier, un grand écrivain, un capitaine d’industrie.» Le petit garçon qui imaginait les discours que l’on prononcerait à sa mort est toujours là. Son enfance, son adolescence, sa vie privée, il n’aime pourtant guère en parler. Sa naissance, à Béni Saf, en Algérie, le 5 novembre 1948. Une Algérie dont sont originaires ses deux parents. Sa mère, «extrêmement jolie» et qui, très tôt, lui a fait lire des livres. Son père, «un homme d’exception, avec des allures de héros romantique, selon François Pinault, un bagarreur, ancien héros de la Résistance, un antibourgeois, en rébellion permanente contre les gens installés». Un homme qui, d’après l’avocat de BHL, Olivier Cousi, «était tout aussi brillant, intelligent et charmeur que lui. Le même en plus discret.»
Très disert sur le reste, Bernard-Henri Lévy parle peu, en revanche, de ces années où il a grandi dans le confort doré de belles demeures et d’écoles des beaux quartiers. Il n’aime pas évoquer son frère, grièvement malade depuis qu’il s’est fait renverser par une voiture quand il avait 15 ans, ou sa sœur, convertie au catholicisme et devenue quasiment mystique. «Bernard a dû rembourser trois vies à ses parents. Il a été d’emblée le non-problématique, le petit prince chéri», dit un ami. Et il a voulu être à la hauteur. En se démultipliant. En vivant l’arrêt comme une petite mort, le mouvement comme son salut. «Très secret, cloisonnant ses vies comme des piscines à débordement qui ne s’arrêtent jamais», BHL a donc multiplié les vies dans la vie, cherchant toujours, quête éternelle, la reconnaissance, la lumière. Jean-Paul Enthoven encore: «Il est joyeux. Il faut, pense-t-il, que notre vie soit une succession ininterrompue de moments agréables. Quand on prend le sillage de Bernard, tout ce qui se passe est mouvement.»
Mais la lumière n’empêche pas le temps de s’écouler. L’écrivain a longtemps tout fait pour ne pas vieillir, mais il a aujourd’hui des cheveux blancs et des rides. Il va avoir 70 ans en novembre. Il ne célébrera pas l’événement. Non pas parce qu’il pense, comme Oscar Wilde, que «le problème de la vieillesse n’est pas qu’on devient vieux mais qu’on reste jeune», mais parce qu’il ne fête plus son anniversaire depuis la mort de son père, le 5 novembre 1995, le jour de son anniversaire, justement. Quant au temps qui passe, il feint de ne pas s’en apercevoir. Ou à peine. Repoussant la mort comme un sujet tabou, assurant crânement qu’il est en pleine forme. «À un moment de la vie, on commence à se demander ce que signifie tout ce que l’on a fait, quelle place cela tient dans la grande sentence humaine», lâche-t-il tout de même. Et d’ajouter, sans l’ombre d’un doute: «Il n’y a rien, dans ce que j’ai vécu, dont je rougisse ; rien que je regrette. Pas une initiative. Rien dont je me dise que j’aurais dû le faire autrement.» Le petit garçon qui se récitait son oraison funèbre peut être rassuré: tout est en ordre…