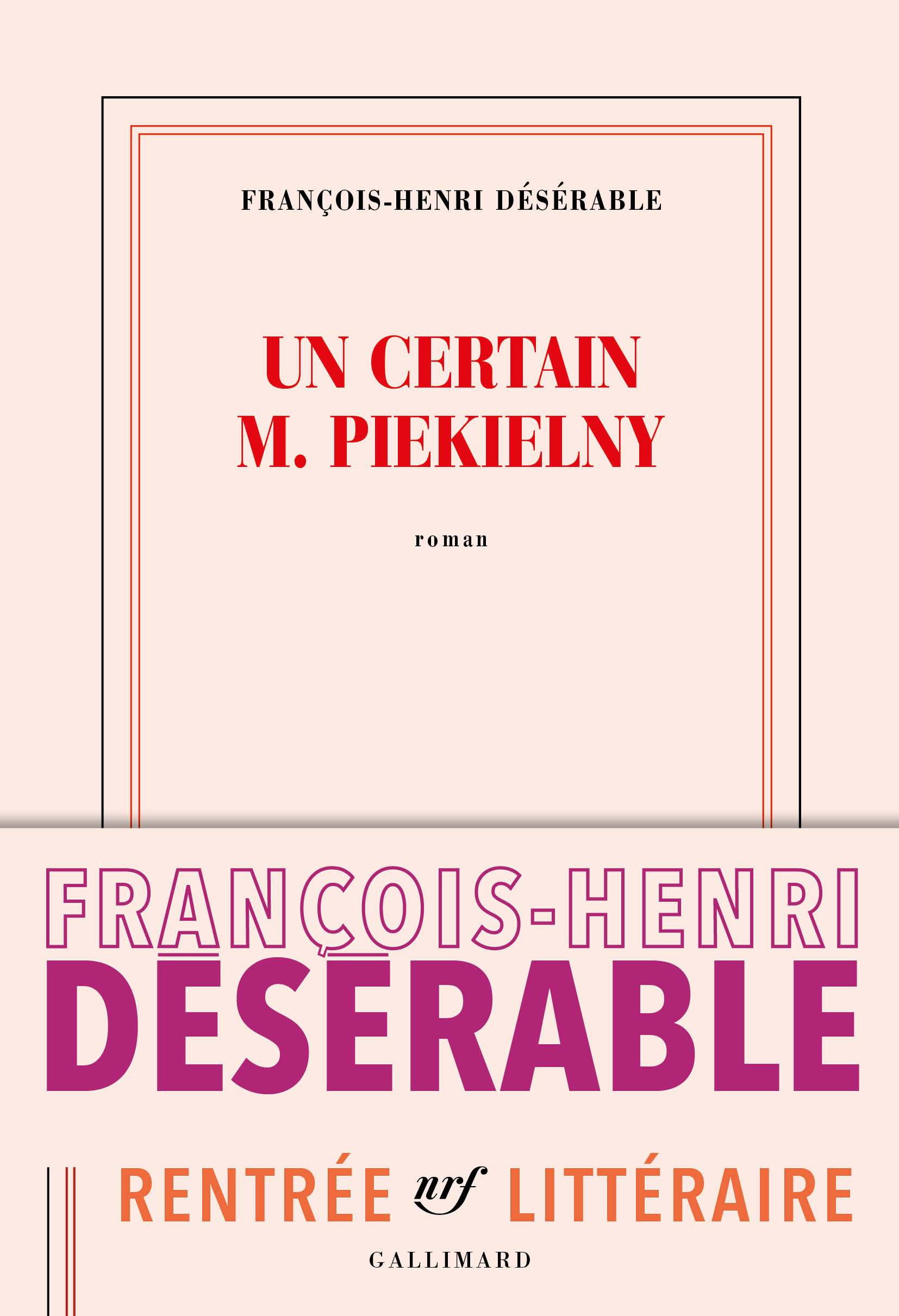Tout amoureux de la littérature du deuxième pan du XXe siècle porte en lui son propre Romain Gary : une figure forgée par les lectures et relectures de l’œuvre – comme pour Proust, et il faudrait écrire là-dessus, la relecture des Gary est un accompagnement difracté, qui s’inscrit dans l’expérience accumulée – ; les inédits enfin publiés et dévorés tout crus puis remis dans leur contexte ; les photos et les emblèmes, ponchos, chapeaux, chiens, taille de la moustache, de la barbiche ; Emile Ajar et ses anticipations, Tulipe, par exemple. Et la limite de validité de ce foutu ticket, titre ramassant dans un même mouvement le pessimisme de l’homme et l’optimisme de quelques personnages, comme le Roi Salomon se faisant tailler de nouveaux costumes au bord de la tombe. Un exemplaire Clair de femme et un « je me suis bien amusé, au revoir et merci ». Gary le magnifique, falsificateur et orfèvre, à l’étroit dans une vie si vaste, et si accomplie. Tout amoureux de la littérature porte en lui son propre Romain Gary. Le mien est niçois avant tout, il vit son enfance rue de la Buffa, dans la pension que tient sa mère, pension à l’enseigne «Mermont», anticipation de Seberg (sea/berg), comme Jean.
Le Romain Gary de François-Henri Désérable naît l’année de son bac de français. Désérable n’a pas révisé, n’a lu qu’un seul des bouquins au programme, La Promesse de l’aube, et voilà que c’est là-dessus qu’on l’interroge. La Promesse, il l’a dévorée, le futur bachelier. Ce portrait de mère… cette mère si sûre du destin exceptionnel de son fils… et ce petit homme, au détour d’un chapitre, impressionné par les prédictions de la mère-poule un peu folle, qui se dit pourquoi pas, et si jamais… et si cet enfant de Vilnius devenait D’Annunzio et ambassadeur de France… et s’il parlait de moi… moi qui ne suis rien… rien qu’une petite souris vivant au n°16 de la rue Grande-Pohulanka ? Un hasard heureux, incompréhensible comme tous les coups du sort, transporte François-Henri Désérable à Vilnius. Ses pas de touriste égaré l’emmènent dans la rue Grande-Pohulanka, où il tombe sur une plaque indiquant que Roman Kacew et sa mère Mina vécurent ici, dans les années 20. Et voilà que remonte le souvenir du baccalauréat, et de l’examinateur qui demande à l’élève «Que pouvez-vous me dire sur le chapitre VII de La Promesse de l’aube ?», le chapitre où il est question de M. Piekielny, ce petit homme comparé à une petite souris, à la barbe roussie par le tabac. Voilà un signe. Le signe qu’il faut partir sur les traces de ce M. Piekielny.
La traque de Désérable est physique et mentale. Physique au sens tangible du terme : faire plusieurs fois le voyage à Vilnius, enfiler des gants et manipuler les registres du début du siècle dernier, où l’on consignait les noms et généalogies des habitants de la ville, y retrouver les noms de Mina et de Roman, mais pas celui de M. Piekielny. Parcourir la ville que l’on appelait « la Jérusalem de Lituanie » et constater que toute trace juive a disparu, ou presque, à part ces palimpsestes inespérés, révélant sous d’anciennes peintures des raisons sociales rédigées en yiddish ou en hébreu. Mentale au sens presque égocentré du terme : F.-H. Désérable met en parallèle, ou plutôt en balance, son propre parcours d’écrivain et l’amour inconditionnel de sa mère, avec la vie de Romain Gary. Une scène délicieuse, lors de la remise d’un prix à François-Henri sous la Coupole, met en scène Mme Désérable et Jean-Christophe Ruffin : le fils est écrivain, certes, mais il faut lui dire de terminer ses études de droit, n’est-ce pas ? Les temps sont différents, Amiens n’est pas Vilnius, mais les mères restent les mères. Cette scène est peut-être aussi romancée que la fin de La Promesse de l’aube – on s’en souvient : Romain Gary revient à Nice après la guerre, paré de médailles et auréolé du succès de son premier roman, Education européenne. La mère est morte depuis longtemps, les lettres que Gary continuait de recevoir avaient été écrites bien en amont, envoyées au fils pour qu’il ne perde pas pied. L’histoire est fausse mais admirable, si juste du point de vue de la psyché et de l’amour maternel que toute contestation historique, et vérifiée, tombe à plat. Désérable s’inscrit sans doute dans ces vérités romanesques parfaites, plus belles que la vie elle-même.
Qu’en est-il de ce M. Piekielny ? Il est là, bien vivant et insaisissable, disparu à jamais et figé, «fixé», dans l’histoire littéraire. Il est devenu un personnage et un symbole, il incarne les Juifs de Vilnius. Il ne s’appelle peut-être pas Piekienly. Désérable ira débusquer sa première apparition chez Gogol.
Un certain M. Piekielny est un exercice d’admiration. Un roman vrai et falsifié, une fausse autofiction, une enquête au-dehors et en-dedans, qui prend le lecteur par la main, l’entraîne vers Gogol et Albert Cohen, par la bande. L’entraîne sur le terrain des âmes mortes et de tous les livres aux mères. Entre enquête méticuleuse et rencontres imaginaires, le roman de François-Henri Désérable est aussi une confession littéraire.