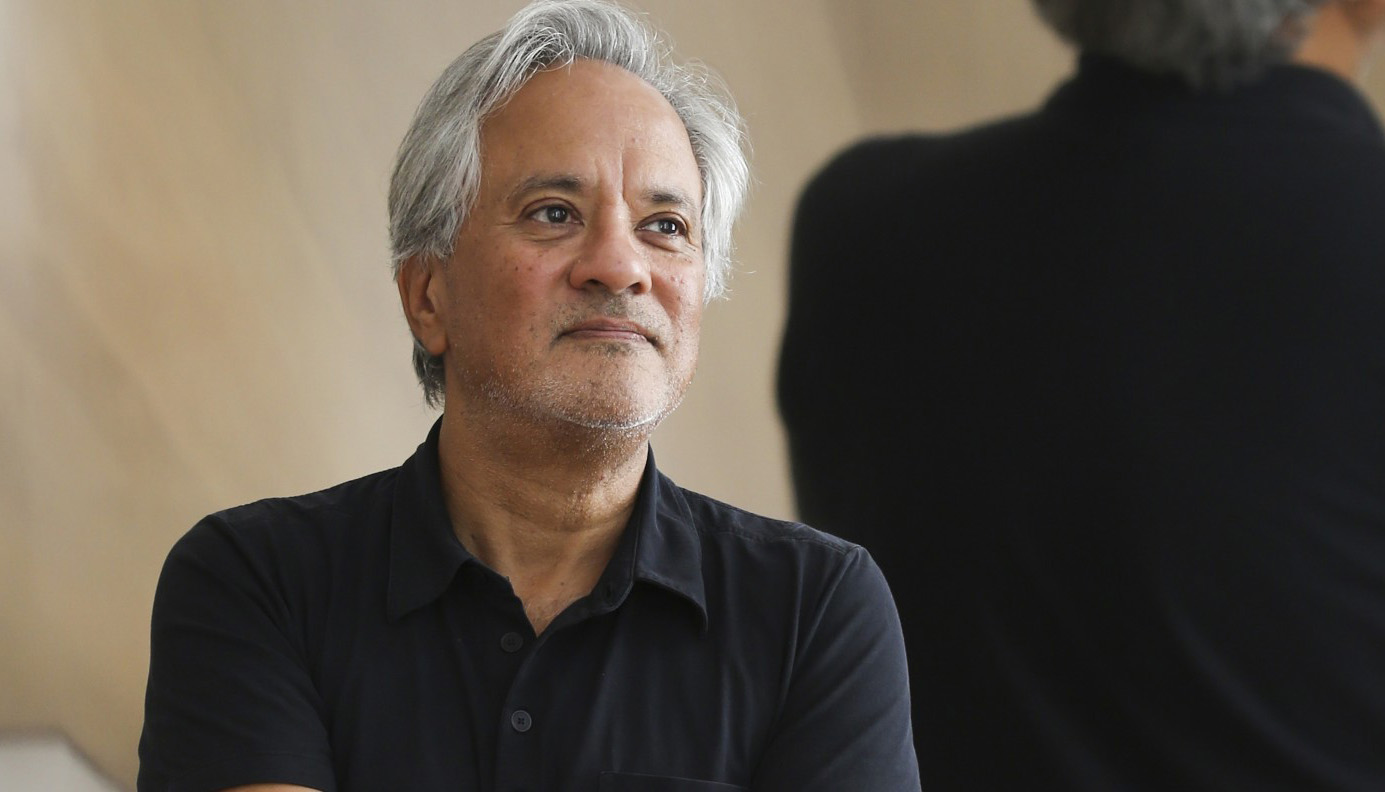La jeune comédienne et réalisatrice française Zoé Le Ber est l’auteure de « Transit », un documentaire poignant sur ces migrants qui ont tout quitté, au péril de leur vie, pour rejoindre les côtes européennes. De Syrie, d’Irak, ou encore du Congo, ils confient à sa caméra complice leurs rêves et leurs désillusions, la vie qu’ils menaient avant le départ et le lent processus d’oppression qui ne leur a laissé d’autre choix que de fuir leurs pays : « En 2015, on m’a forcé à m’engager dans l’armée pour tuer des gens et détruire leurs maisons, raconte un Syrien. Donc j’ai tout laissé derrière moi, mon travail, ma maison… Si quelqu’un vous dit qu’il y avait la paix en Syrie, il ment. Même avant la révolution, je voulais partir pour l’Europe. »
Pour recueillir leur parole, Zoé Le Ber s’est notamment rendue à Kos, cette île grecque touristique située à quelques kilomètres de la Turquie et devenue l’une des principales portes d’entrée des migrants en Europe.
Les camps de réfugiés de la région sont la cible d’attaques de sympathisants du parti néonazi grec Aube Dorée. Plus de 16 000 migrants s’entassent sur les îles de la mer Egée, pour une capacité d’hébergement ne dépassant pas les 7 450 places. En novembre dernier, le camp de Souda, qui accueille des familles syriennes et irakiennes sur l’île de Chios, a été attaqué par des cocktails Molotov et des jets de pierres. Une centaine de femmes et d’enfants ont dû dormir sur le port.
Haine et xénophobie croissent également sur le sol de Kos, parangon aussi bien de la générosité que du repli européen, comme en témoigne dans le documentaire un commerçant grec : « Au début, on a essayé de les aider, mais les gens sont fatigués de cette situation. C’est un problème pour le tourisme. Ils perturbent la vie économique et la vie quotidienne. Ce n’est pas agréable d’ouvrir son magasin et de voir des gens qui dorment devant, dans des sacs de couchage, des tentes… »
Sans avoir recours à la voix off, Zoé Le Ber laisse libre court à ces paroles fortes, aux points de vue parfois antagonistes. Un choix formel qui met le spectateur face à face avec les migrants, leur déracinement, leurs espoirs souvent déchus et une promesse de vie meilleure sans cesse repoussée. « Transit » est une plongée dans ces vies en suspens.
Comment est née l’idée de faire ce film ?
Zoé Le Ber : Je rentrais d’un voyage à Venise en juin 2015. A l’aéroport, j’ai acheté ce magazine, Society, que je ne connaissais pas. Je l’ai acheté pour la couverture où l’on voyait une photo de la mer Méditerranée, d’un bleu limpide, accompagnée de ce titre : « Ici un être humain meurt toutes les deux heures ». Et c’était en Grèce. L’article expliquait que les migrants traversaient tous les jours la mer, de la Turquie vers la Grèce, pour venir en Europe. J’avais entendu parler des tragédies arrivées à Lampedusa, bien sûr, mais pas de ces îles en Grèce que j’avais tant explorées plus jeune. Je trouvais cela incroyable qu’on n’en parle pas plus. Il a fallu la publication de la photo de ce petit garçon, Aylan, échoué sur la plage, pour que les gens se réveillent et en parlent enfin. J’ai fait des recherches : des centaines de personnes arrivaient tous les jours. Il y avait très peu d’informations en ligne, mais j’ai trouvé un article sur un ancien hôtel de vacances type Club Med, sur l’île de Kos, une des îles les plus proches des côtes turques. Les touristes s’y rendaient pour faire la fête. Le contraste devait être saisissant. Cet hôtel, qui était laissé à l’abandon, est devenu un camp de migrants. Il fallait absolument que j’aille là-bas, et vite. Ma priorité était de trouver un interprète qui m’aide à communiquer avec ceux que je savais être majoritaires dans l’île : les Syriens et les Irakiens qui fuyaient les conflits. J’ai rencontré Mohamed Al Halabi, un jeune syrien qui venait d’obtenir son droit d’asile en France et pouvait circuler librement dans l’Union Européenne. En s’engageant dans ce projet, il a, à nouveau, témoigné les conséquences de la persécution de son propre peuple – ce que je sais avoir été vécu par lui comme un difficile retour en Syrie. Nous sommes partis ensemble, avec ma caméra, mon système son et très peu de choses.
C’est donc vous qui avez filmé ?
Oui, j’ai tout fait moi-même avec l’aide de l’interprète. Puis, j’ai rencontré un autre jeune irakien, Wessam Al Yassin, qui est devenu le protagoniste du documentaire. Il m’a dit : « Je suis en transit sur cette île pendant deux ou trois semaines, et je n’ai rien à faire ». Il a demandé à m’assister sur le tournage et, tous les matins, on se retrouvait pour faire ce film.
Les migrants se confient à votre caméra de manière assez intime. Comment avez-vous obtenu leur confiance ?
Je n’ai pas cherché à les mettre dans des dispositions particulières, à part avoir été, bien sûr, attentionnée. Je leur parlais une première fois, puis je leur donnais rendez-vous le lendemain. Mais j’ai eu aussi quelques refus. Ils sont choqués par ce qui leur est arrivé. Je crois qu’ils ne s’attendaient pas à ce que ça soit si difficile. Ils avaient tous des maisons, des emplois, des liens affectifs, des habitudes, comme nous en avons tous et ils se sont, tout d’un coup, retrouvés sur cette île après avoir risqué leurs vies en traversant la mer… Ce sont souvent des personnes d’une grande humanité et intelligence qui ont tout simplement sauté sur l’occasion pour exprimer l’horreur de l’expérience qu’ils vivaient. Si j’avais vécu la même chose, et qu’on me tendait un micro et une caméra, j’aurais sûrement, comme eux, un besoin urgent de témoigner.
Vous donnez également la parole aux commerçants et aux habitants de l’île, qui ont parfois un regard négatif sur les migrants. Qu’avez-vous pensé de la façon dont le secteur touristique gère la situation ?
Je n’avais pas envie de montrer un seul pendant de l’histoire. J’ai rencontré un grand panel d’attitudes et les ai montrées. Malheureusement, la Grèce est dans une situation difficile. Le tourisme est le gagne-pain de beaucoup de personnes sur l’île. Les touristes voient des réfugiés arriver quasiment quotidiennement, et ils ont évidement du mal à être confrontés à la misère. Cela choque certains. C’est une réaction finalement humaine, peut-être égoïste, mais compréhensible. Et les acteurs du secteur touristique pensent à leur métier, à leur famille. Ils ont peur de perdre leur travail. L’île est en plein marasme économique…
Qu’est-ce qui vous a le plus frappée sur place ?
J’ai beaucoup appris en faisant ce film mais ce qui m’a le plus surprise, c’est leur vision de l’Union européenne. Ils imaginaient être accueillis, nourris, logés. Ils voyaient l’UE comme le lieu des droits de l’Homme. Une sorte de conte de fée, en somme. Il n’y a rien de pire que le déracinement, quitter sa famille et son foyer. Peut-être se rattachent-ils à cette image édulcorée d’une Union européenne accueillante, chaleureuse pour avoir la force de tout laisser derrière soi. Lorsqu’ils arrivent, c’est un précipice de désillusions. Un déchirement qui m’a profondément touchée. J’aurais aimé voir l’Union Européenne et mon pays correspondre à leurs attentes.
Qu’est-ce qui pourrait être fait pour que les choses soient moins difficiles pour les migrants ?
Il n’y a pas d’accueil, tout simplement. Quand j’y étais, il y avait uniquement un hôtel, sans eau courante, où les migrants dormaient à même le sol, sur des matelas dégueulasses. Les conditions étaient tellement atroces que la plupart refusait de dormir à l’intérieur, ils dormaient dehors, là où ils pouvaient. J’ai été très choquée. Mais il ne faut pas pour autant pointer les Grecs du doigt. Ils n’ont eu ni les moyens ni le temps de se préparer à un tel afflux de personnes… D’ailleurs ce qui est fait pour les migrants, comme la distribution de nourriture, ne repose que sur du bénévolat. Ce sont les citoyens qui leur viennent majoritairement en aide. Et peut être faudrait-il d’avantage compter sur l’entraide citoyenne, la compassion, que d’attendre en vain que des décisions politiques soient prises.
« Transit » a notamment suivi la trajectoire d’un jeune irakien particulièrement charismatique de l’île de Kos jusqu’en Belgique – où il était en attente de son visa. Comment va-t-il ?
Nous sommes devenus très amis. Wessam Al Yassin, c’est son nom, a attendu son droit d’asile dans un camp de la Croix Rouge en Wallonie pendant dix mois. Il voulait aller à Bruxelles, mais les écoles y étaient pleines. Il a donc décidé d’apprendre le flamand parce qu’il y a plus de débouchés professionnels du côté flamand. Il est maintenant à Ostende, une station balnéaire belge, pour reprendre ses études de droit commencées et presque finies à Mossoul. Wessam va consacrer un ou deux ans à l’apprentissage du flamand pour ensuite reprendre ses études de droit, du tout début, de la première à la dernière année. Comme tant d’autres migrants dans sa situation, il doit recommencer à zéro, tout reconstruire. Il essaie de s’adapter comme il peut à cette nouvelle vie alors qu’il n’a pas vu les siens depuis un an et demi. Sa famille était très soudée avant la guerre mais ils sont aujourd’hui dispersés aux quatre coins du Moyen Orient et de l’Europe et tentent par tous les moyens de préserver, à distance, leur lien familial. C’est le sujet de mon premier long métrage.