V.S. Naipaul, l’auteur de ces chefs-d’œuvre que sont Miguel Street et Une maison pour monsieur Biswas, est aussi, et ses récits de voyage en témoignent, un observateur lucide et impliqué des convulsions de notre époque[1]. Un écrivain dont l’origine (il est né dans la communauté indienne de Trinidad, aux Antilles anglaises) n’a pas empêché de déboucher sur un cosmopolitisme effectif, à repérer et à dénoncer les dangers que les courants (religieux ou territoriaux) font peser sur la civilisation mondiale. Le sort de la civilisation mondiale, tel est précisément le sujet de la conférence qui a été publiée dans le N°5 de notre revue, et que Naipaul a prononcée en 1991 au Manhattan Institute de New-York. Un texte d’une actualité frappante.
Le conflit est-il insurmontable entre les «différences» des cultures périphériques et la vocation universaliste de l’Occident ? À quelles conditions est-il possible de devenir écrivain lorsqu’on est issu d’une culture où ce terme n’a pratiquement aucun sens ? L’Islam, avant d’être une religion de colonisés, n’a-t-il pas été une religion de colonisateur ? C’est avec le regard spécifique d’un écrivain, bien entendu, que Naipaul aborde ces questions. Mais aussi avec la ferveur d’un intellectuel qui entend bien ne pas renoncer.
J’ai donné à cette conférence le titre de «Notre civilisation universelle». Son côté un peu ronflant m’embarrasse légèrement et me pousse à m’expliquer sur ce choix. Pour moi, il n’existe pas de théorie permettant d’uniformiser les choses : toute situation, toute personne est particulière, spécifique. Voilà pourquoi on voyage et on écrit : pour découvrir. Travailler autrement serait donner les réponses avant même d’étudier les problèmes. C’est une méthode de travail admise par certains, je le sais, surtout par ceux qui sont chargés de mission dans les domaines religieux, politique ou racial. Personnellement, il me serait très difficile de l’adopter.
Voilà pourquoi, lorsque vous m’avez invité à faire cette conférence, il m’a semblé nécessaire de rechercher le genre de sujet susceptible d’intéresser les membres de votre Institut. Myron Magnet, élève de terminale dans cet établissement, était en Angleterre lorsqu’il m’a téléphoné ; quelques jours plus tard, il me faisait parvenir une liste manuscrite de questions très sérieuses et très importantes : sommes-nous – ou plutôt nos communautés sont-elles aussi fortes que le sont nos croyances ? Pouvons-nous nous contenter de défendre avec passion nos croyances ou nos opinions sur la morale ? La passion leur donne-t-elle une validité ? Nos croyances et nos idées sur la morale sont-elles arbitraires ou représentent-elles quelque chose d’essentiel dans les cultures où elles se développent ?
Il était facile de découvrir les angoisses cachées derrière ces questions. On y sentait une réelle inquiétude devant certains fanatismes existant «là-bas» et une certaine défiance philosophique sur la manière d’exprimer ces anxiétés, personne ne voulant utiliser des mots ou des idées susceptibles de produire un effet de boomerang. Nul n’ignore combien il est facile de faire dire aux mots ce qu’ils ne veulent pas dire : je suis civilisé et loyal, donc vous êtes barbare et fanatique, primitif donc aveugle. C’est évident ! J’ai cependant pris le parti du questionneur et compris le courant qui l’entraînait. Mais, au bout de quelques jours, à cause sans doute du recul que me donnait ma situation, j’ai ressenti une impossibilité à partager son pessimisme. J’avais l’impression que celui-ci, joint à la défiance philosophique qu’il impliquait, révélait la force de la civilisation dont il était issu. Voilà d’où m’est venue l’idée de donner à ma conférence le titre de : «Notre civilisation universelle».
Devenir écrivain
Je ne vais pas tenter ici de la définir et n’en parlerai que de façon toute personnelle. Avant tout, je dois dire qu’elle est à l’origine de ma vocation d’écrivain ; c’est grâce à elle que j’ai pu la réaliser. Pour être écrivain, on a avant tout besoin d’une sensibilité à fleur de peau qu’une certaine atmosphère intellectuelle favorise et dirige.
Celle-ci se révèle parfois trop raffinée et la civilisation, trop parfaite, trop dépendante de ses rites. Il y a onze ans, alors que je voyageais à Java, j’ai rencontré un jeune homme dont le souhait le plus ardent était de devenir poète et de ne vivre que par l’esprit. Cette ambition lui venait de son éducation moderne ; mais il lui était impossible de se faire comprendre de sa mère, une femme pourtant très cultivée qui avait reçu en partage la beauté du visage, l’élégance, l’aisance de la parole et une façon de se comporter – selon les règles de la cour des princes de Java – qui était tout un art.
Je demandai donc au jeune homme – sans perdre de vue que nous étions à Java où de vieux poèmes épiques revivent à travers les spectacles de marionnettes : «Votre mère n’est-elle pas secrètement très fière d’avoir un fils poète ?» Il me répondit en anglais (je mentionne ce détail pour donner la mesure de son éducation reçue dans une petite ville lointaine de Java) : «Elle n’a pas la moindre idée de ce qu’est un poète».
L’ami et le mentor de ce jeune homme, un professeur de l’université de l’endroit, développa ce propos et ajouta : «Le seul moyen qu’aurait sa mère de comprendre ce qu’il essaie de réaliser serait de lui faire croire qu’il est un poète selon la tradition classique ; mais elle trouverait cela absurde et irréaliste». En effet, pour elle, les poèmes épiques de son pays – autrement dit, les textes sacrés – existaient déjà ; tous avaient déjà été écrits ; il suffisait donc de les apprendre ou de les consulter.
Bref, pour cette mère, le chapitre était clos avant même d’être ouvert ; toute poésie était déjà écrite et appartenait à la perfection de sa culture. S’entendre dire par son fils, âgé de vingt-huit ans (ce qui n’était plus tout jeune) qu’il espérait devenir poète lui paraissait aussi absurde que si une mère dévote, issue d’une autre culture, demandait à son fils écrivain ce qu’il avait l’intention d’écrire et s’entendait répondre : «Je pense sérieusement à ajouter un livre à la Bible.» Ou encore, on pourrait comparer ce jeune homme au personnage de Borges qui avait entrepris la lourde tâche de réécrire l’histoire de Don Quichotte – non pas de la raconter à nouveau ou de copier l’original de Cervantès, mais bien de chercher, par un extraordinaire processus d’épuration de l’esprit et de re-création, à parvenir – sans falsifier quoi que ce soit, mais uniquement au moyen d’une pensée originale – à retrouver une coïncidence narrative mot pour mot avec le livre de Cervantès.
Trinidad
Je compris la situation difficile dans laquelle se trouvait ce jeune Javanais. Ses antécédents n’étaient, après tout, pas si différents de mon propre milieu socio-culturel hindou, établi autrefois à Trinidad. Nous étions une communauté agricole d’immigrants venus de l’Inde. L’envie de devenir écrivain, l’initiation à l’écriture et aux idées qui s’y rapportent m’avaient été données par mon père, né en 1906 et petit-fils d’un homme venu à Trinidad alors qu’il était encore enfant. Dieu sait pourquoi, malgré la désapprobation des membres de cette petite colonie agricole, mon père avait éprouvé le désir de devenir écrivain et s’était lancé d’abord dans le journalisme en dépit des maigres chances d’avenir que lui réservait notre petite colonie.
Notre peuple était attaché à ses rites, à ses textes sacrés. Nous avions aussi nos poèmes épiques : ceux de Java ; nous les entendions constamment chanter et célébrer. Mais nous n’étions pas pour autant des littéraires. Notre littérature, nos textes ne nous incitaient pas à explorer notre monde ; ils étaient plutôt les balises de notre culture et nous donnaient le sens de l’intégralité de notre monde face à la singularité du monde extérieur. Je ne crois pas qu’avant mon père, personne ait jamais songé à composer une littérature originale. L’idée lui en vint à Trinidad, quand il sut se servir de la langue anglaise. En dépit des rebuffades de notre petite colonie, il conçut l’idée d’une civilisation liée au langage ; et il apprit à connaître certaines formes littéraires. Car la sensibilité seule ne suffit pas à celui qui veut devenir écrivain ; il doit connaître les formes littéraires qui porteront cette sensibilité ; or celles-ci, qu’elles soient poétiques, dramatiques ou romanesques, sont artificielles et en perpétuelle mutation.
Je reçus une partie de ce trésor dès mon plus jeune âge. Tout petit, là-bas, très loin au milieu du désert intellectuel et de la misère de Trinidad et de son demi-million d’âmes, je fus empli du désir d’écrire des livres et surtout des romans que mon père m’avait appris à considérer comme la forme la plus haute de la littérature. Mais ce n’est pas uniquement en esprit que les livres prennent forme. Ce sont des objets physiques. Pour les écrire, il faut avoir de la sensibilité, bien connaître une langue et avoir reçu le don de s’exprimer dans cette langue. De plus, il faut bien posséder la technique d’une certaine forme littéraire. Et pour voir enfin son nom figurer au dos de cet objet physique, il faut mettre en branle tout un dispositif extérieur composé d’éditeurs, d’imprimeurs, de critiques, de journaux, de magazines, de libraires et d’émissions de télévision où les critiques viennent dire ce qu’ils pensent de votre œuvre. Sans parler, bien entendu, des acheteurs et des lecteurs.
Je tiens à souligner l’importance de l’aspect terre à terre de l’entreprise car il est trop facile de dire qu’il va de soi, trop facile aussi de ne penser à l’écriture que sous son aspect romantique et personnel. Écrire est un acte privé. Mais une fois publié, un livre commence à vivre et implique la coopération de tout un groupe très spécialisé, doté d’une puissante organisation commerciale et de certains impératifs culturels et d’imagination, dont les stimuli se renouvellent sans cesse et qui possède les moyens de juger les apports inédits qui lui sont offerts.
De la périphérie vers le centre
Ce genre de société n’existait évidemment pas à Trinidad. Si je voulais devenir écrivain et vivre de ma plume, il me fallait donc voyager et entrer en contact avec le type de société où vivre de sa plume était possible. À l’époque, cela signifiait pour moi, aller m’établir en Angleterre. Je partis donc de la lointaine «périphérie» pour gagner ce qui me paraissait être le «centre», en espérant qu’on m’y ferait une petite place. C’était beaucoup demander ; en fait, je réclamais à ce centre plus que je n’avais jamais demandé à ma propre société. Ce centre, après tout, avait ses propres intérêts, ses propres opinions sur le monde, ses idées sur ce qu’il voulait trouver dans les romans. Il en va de même aujourd’hui encore. Mes préoccupations étaient très éloignées des siennes. Pourtant on me fit une petite place dans l’Angleterre des années cinquante. Je pus devenir écrivain et évoluer dans cette profession. Cela prit du temps ; j’avais quarante ans et publiais des livres depuis onze ans en Angleterre quand pour la première fois un de mes ouvrages fut édité aux États-Unis !
J’ai toujours reconnu, dès les années cinquante, que, pour moi qui avais cette vocation d’écrivain, il n’y avait pas d’autre endroit où aller que l’Angleterre. Et s’il me fallait décrire aujourd’hui ce qu’est la «civilisation universelle», je dirais que c’est celle qui fait naître à la fois le désir et l’idée de la vocation littéraire et donne les moyens de la réaliser ; celle qui m’a permis d’effectuer ce voyage de la «périphérie» vers le «centre», qui m’unit non seulement au public anglais mais aussi à cet homme de Java, plus si jeune aujourd’hui, dont les ancêtres étaient aussi respectueux des rites que les miens, sur lequel le monde extérieur a, comme sur moi, exercé une influence prépondérante et à qui il a donné l’ambition d’écrire.
De nos jours, les choses sont plus faciles pour un natif de Java ou de Trinidad qui souhaite devenir écrivain. Rien n’est loin aujourd’hui. Pourtant, je n’ai jamais pu considérer ma carrière d’écrivain comme une chose acquise. Je sais qu’il existe encore de vastes régions du monde où les conditions culturelles et économiques décrites précédemment ne sont pas les mêmes et où une personne ayant les mêmes ambitions que moi ne peut devenir écrivain. Si j’avais vécu dans le monde musulman, je n’aurais pas réalisé ce rêve, pas plus qu’en Chine ou au Japon où l’on n’accorde de place à la culture littéraire que si elle vient d’un pays avec lequel on est en compétition. Jamais non plus je n’aurais pu être l’écrivain que je suis devenu en Europe occidentale, si j’avais vécu en Union soviétique ou en Afrique, ni même aux Indes sans doute.
Vous comprenez donc combien il m’a semblé important de savoir dès mon plus jeune âge que je pouvais faire ce voyage de la «périphérie» vers le «centre», de Trinidad à Londres. Seule l’ambition de devenir écrivain m’a poussé à admettre que c’était possible. De sorte qu’en dépit de mes origines et du milieu socio-culturel de Trinidad où j’ai grandi, une bonne partie de moi-même considérait comme acquis le fait que j’appartenais à une civilisation plus vaste. Je suppose qu’on pouvait en dire autant de mon père bien qu’il fût plus proche de moi des traditions et des rites de notre passé hindou et indien.
Fondamentalisme
Mais c’est seulement récemment que j’ai formulé l’idée d’une civilisation universelle, à la suite d’un voyage accompli il y a onze ans dans des pays musulmans non arabes, pour essayer de comprendre ce qui les avait menés à la violence. Cette violence du monde musulman ne faisait que commencer. On n’utilisait pas souvent le mot «fondamentalisme», lié aujourd’hui au monde musulman, dans les journaux de 1979 ; ce concept n’avait pas encore fait son chemin. On parlait surtout du «renouveau de l’Islam». Et pour celui qui voyait les choses de loin, c’était une énigme. L’Islam qui apparemment avait si peu à offrir à ses adeptes du siècle dernier et de la première moitié du nôtre, qu’aurait-il à proposer dans la seconde, à un monde infiniment plus éduqué, infiniment plus développé et tellement plus rapide ?
L’adaptation de ma propre famille et à la colonie indigène de Trinidad et, à travers celle-ci, au monde du XX e siècle ne s’était pas effectuée sans mal. Il nous avait été pénible, nous qui étions un peuple asiatique menant une vie instinctive, marquée par les rites ancestraux, de prendre conscience de notre histoire et d’apprendre à vivre avec l’idée de notre impuissance politique. Des mises au point très délicates s’étaient imposées sur le plan social. Ainsi par exemple, dans notre culture, les mariages avaient toujours été «arrangés» ; il nous fallut un certain temps – et beaucoup de vies gâchées – pour nous adapter à une autre façon de voir les choses. Et tout ceci s’accompagnait évidemment du développement intellectuel individuel dont j’ai parlé plus haut.
Quand j’ai commencé à voyager dans le monde musulman, je pensais retrouver des gens semblables à ceux de ma propre communauté. Une grande partie des Indiens était en effet musulmane. Nous avions en commun, en ce XX e siècle, une histoire coloniale et impériale. Pour moi, la religion n’était qu’une différence accidentelle. Je pensais alors que «la foi c’est la foi», comme on dit, et que tous les êtres vivant à une même époque avaient les mêmes points de vue. Mais ce n’était pas vrai. Les musulmans affirmaient que leur religion était fondamentale ; et pour eux, elle l’était. De là venait toute la différence. Je souligne encore une fois que je voyageais dans des pays non arabes mais de religion musulmane. La notion de l’Islam a d’abord été perçue comme une religion arabe qui s’est étendue, comme l’empire arabe, en Iran, au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie – ces pays que je parcourais – et par conséquent à des peuples qui avaient été convertis à une foi étrangère. Je circulais parmi des gens qu’on avait obligés à faire une double mise au point : la première devant les empires des XIX e et XX e siècles ; la seconde devant la foi arabe. On pourrait presque dire que ces gens avaient été colonisés deux fois et deux fois arrachés à eux-mêmes.
L’Islam colonisateur
Je découvris bientôt qu’aucune colonisation n’avait été aussi profonde que celle opérée par la foi arabe et que les peuples ainsi colonisés ou vaincus en venaient parfois à perdre confiance en eux-mêmes. Dans les pays musulmans dont je parle, cette perte de confiance avait la force d’une religion. Un des articles de foi de la religion musulmane stipule que tout ce qui existait avant qu’on ait la foi, doit être considéré comme mauvais, erroné, hérétique. Il ne doit y avoir, dans le cœur et l’esprit de ces nouveaux croyants, aucune place pour leur passé pré-musulman. En conséquence, les idées qu’on avait maintenant dans ces pays sur l’histoire des peuples étaient complètement différentes de celles qu’on avait ailleurs. Personne ne souhaitait ici remonter le plus loin possible dans son passé ni chercher à en tirer le maximum d’enseignement.
La Perse avait un grand passé. Dans l’Antiquité, elle avait été la rivale de la Grèce et de Rome, chose inimaginable dans l’Iran de 1979 ; pour les Iraniens, gloire et vérité étaient venues avec l’avènement de l’Islam. Le Pakistan était un État musulman tout neuf bien que la terre fut très ancienne. On y trouvait les ruines des très antiques cités de Mohenjo-Daro et de Harappa : ruines fabuleuses dont la découverte au début de notre siècle avait donné une idée nouvelle de l’histoire du sous-continent indien ; ruines non seulement pré-islamiques mais éventuellement aussi, pré-hindoues. Un département archéologique hérité de l’occupation anglaise en prenait soin. Mais au-delà de tout ceci on décelait, au fur et à mesure du développement du fondamentalisme, un contre-courant que le correspondant d’un journal exprima dans une lettre, pendant que j’étais là ; il y disait qu’il fallait suspendre sur les vestiges des vieilles cités de grands écriteaux portant des citations du Coran prouvant qu’elles n’étaient que tromperie pour les croyants.
Ainsi, la foi faisait table rase du passé. Et une fois le passé ainsi aboli, plus d’une idée sur l’Histoire s’en trouvait ébranlée. Le comportement humain, l’idéal de bonne conduite en souffraient aussi. Pendant que j’étais au Pakistan, les journaux regorgeaient d’articles célébrant l’anniversaire de la conquête arabe du Sind, première partie du sous-continent indien à avoir été conquise par les Arabes au début du VIII e siècle. Le royaume de Sind était immense et englobait la moitié de l’Afghanistan, la moitié de la partie méridionale du Pakistan ; c’était un royaume hindo-bouddhiste. Les brahmanes ne comprenaient pas le monde extérieur ; les bouddhistes étaient contre l’idée de donner la mort ; le royaume attendait pour ainsi dire d’être conquis. Mais il fallut beaucoup de temps pour venir à bout du Sind, situé très loin de la patrie des Arabes, perdu dans d’immenses déserts. Six ou sept expéditions arabes échouèrent.
Vint un temps où le troisième calife, troisième successeur du Prophète, appela l’un de ses lieutenants et dit : «Ô Hakim, as-tu vu l’Hindoustan et appris tout ce qu’il faut savoir à ce sujet ?» – «Oui, ô chef des croyants», répondit Hakim. Et le calife reprit: «Décris-le nous.» Alors toutes les frustrations, toute l’amertume de Hakim se déversèrent dans sa réponse : «Son eau est noire et sale.» Et Hakim dit encore : «Ses fruits sont amers et empoisonnés. Son sol est pierreux et sa terre n’est que sel. Une petite armée y serait rapidement anéantie et une grande y mourrait bientôt de faim.»
Cela aurait dû suffire au calife. Mais, cherchant encore à être encouragé, il demanda à Hakim : «Et les gens ? Peut-on avoir confiance en eux ou bien ne tiennent-ils pas leur parole ?» Il était clair que dans son esprit, une population loyale serait plus facile à soumettre et à soulager de son argent. Mais Hakim cracha encore une fois son venin dans sa réponse : «Ce sont tous des traîtres et des fourbes.» Alors le calife prit peur ; les gens du Sind étaient vraiment des ennemis ; et il décommanda la tentative de conquête du Sind. Mais le Sind n’en demeurait pas moins une contrée très tentante. Alors les Arabes reprirent leurs assauts. L’organisation, le dynamisme et l’attitude des Arabes, fortifiés par leur nouvelle foi dans un monde encore tribal, désorganisé et donc facile à conquérir, ressemblaient beaucoup à ceux qu’afficheraient huit cents ans plus tard, les Espagnols dans le Nouveau Monde. Ce n’était pas surprenant, étant donné que les Espagnols eux–mêmes avaient été conquis et dominés par les Arabes pendant quelques siècles. En fait, l’Espagne tomba aux mains des Arabes à peu près en même temps que le Sind.
La conquête finale du Sind fut mise sur pied en Irak et dirigée par Hajjaj, gouverneur du pays, depuis la ville de Kufa. C’est d’une actualité fortuite, je vous l’assure. Le but de la conquête du Sind par les Arabes – ils l’avaient envisagée dès que leur foi avait été solidement établie – était de se procurer des esclaves et du butin et non de faire du prosélytisme religieux. Quand enfin le gouverneur d’Irak, Hajjaj, reçut la tête du roi de Sind en même temps que soixante mille esclaves et la part royale du butin s’élevant au cinquième du total, comme le décrétait la loi religieuse, il posa la tête sur le sol et offrit à Dieu des prières et des remerciements en faisant deux génuflexions ; il Le loua et dit : «Maintenant j’ai tous les trésors, ceux que l’on voit à l’air libre et ceux qu’on ne voit pas parce qu’ils sont enterrés, et je règne sur le monde».
Il y avait à Kufa une célèbre mosquée. Hajjaj y rassembla les gens et, du haut de la chaire, leur dit :
«Bonnes nouvelles ! Bonne chance aux peuples de Syrie et d’Arabie que je félicite d’avoir conquis le Sind et acquis les immenses richesses… que le Seigneur tout-puissant a bien voulu répandre sur eux.»
La foi et la vérité
Ces lignes sont tirées d’une traduction d’un texte persan datant du XIII e siècle, principale source des récits relatant la conquête du Sind. Le texte est étonnamment moderne, écrit d’une plume rapide et précise, avec des dialogues et des détails saisissants. Il raconte de terribles histoires de pillages et de massacres – car l’armée arabe avait le droit de tuer pendant des jours et des jours après la chute de chacune des villes du Sind. Ensuite le butin était évalué et distribué aux soldats après qu’on en ait mis un cinquième de côté pour le calife. Pour l’auteur persan, ce récit écrit cinq cents ans après l’écrasement du Sind n’est qu’une «amusante histoire de conquête». Le style est de type arabe ou musulman impérial. Après cinq cents ans – et malgré le fait que les Mongols aient failli faire une percée importante – la foi restait toujours solide : aucune morale nouvelle n’était venue permettre d’envisager la destruction du royaume de Sind sous un autre angle.
Tel était donc l’événement solennellement commémoré par les articles de journaux lorsque je parcourais le Pakistan en 1979. Un article signé d’un militaire parlait des succès du général arabe et tentait de célébrer avec équité les mérites des deux armées. Il reçut un blâme du président de la Commission nationale de recherche historique et culturelle. Voici ce que déclara ce président :
«Il est absolument nécessaire d’utiliser la phraséologie appropriée quand on évoque l’image d’un héros. Des mots tels que “envahisseur” et “défenseur” ou des phrases comme “l’armée indienne se battait bravement mais ne fut pas assez rapide pour tomber sur l’armée en déroute” sont beaucoup trop fréquents dans cet article. De plus, on y trouve des déclarations sans fondement telles que : “Si le Raja Dahar avait héroïquement défendu l’Indus et empêché Qasim de traverser ce fleuve, l’histoire du sous-continent aurait été complètement différente”. On n’arrive pas à savoir – ajoute le président de la Commission – si l’auteur applaudit à la défaite du héros ou pleure la défaite de son ennemi». Ainsi, après mille deux cents ans, la guerre sainte se poursuit. Le héros est évidemment l’envahisseur arabe qui apporte la vraie foi. L’ennemi dont il faut applaudir la défaite est l’homme de Sind. Et quand j’ai lu cet article, j’étais au Sind.
Avoir la foi c’était posséder la seule vérité et la posséder poussait à juger d’une certaine manière ce qui s’était passé avant qu’on l’ait et d’une autre ce qui était arrivé après. La foi altérait les valeurs, les concepts de bonne conduite, les jugements humains.
Une tyrannie auto-infligée
Je commençais à comprendre ce que voulaient dire les Pakistanais quand ils définissaient l’Islam comme un mode de vie affectant toute chose, et aussi à réaliser que j’avais parcouru un chemin tout à fait différent, malgré nos origines subcontinentales communes. L’idée d’une civilisation universelle commençait à germer dans mon esprit, cette civilisation dans laquelle j’avais grandi à Trinidad et dont je faisais partie sans le savoir.
Né dans un environnement hindou où la vie était instinctive et rituelle ; grandi dans les conditions peu prometteuses de la communauté de Trinidad, j’avais – à travers le processus que je viens de décrire – franchi plusieurs étapes dans la connaissance générale et la connaissance de soi. J’avais une plus haute idée de l’histoire et de l’art indiens que mes grands-parents. Eux se contentaient des poèmes épiques rituels, des mythes ; leur identité se définissait sous cette lumière au-delà de laquelle tout n’était que ténèbres dans la profondeur desquels ils étaient bien incapables de pénétrer. Moi, je n’avais besoin ni de rites ni de mythes ; je les voyais de loin. Mais, en échange, j’avais le don de faire des recherches et les moyens de mener cette tâche à bien par l’étude. Pour moi, l’identité était quelque chose de beaucoup plus compliqué. J’étais un mélange de plusieurs cultures, ce qui ne me posait aucun problème, d’ailleurs. Je pouvais développer mon savoir de façon continue parce que j’avais accès à la connaissance et étais capable d’accumuler dans ma tête cinq, six ou sept concepts culturels différents. Je connaissais mes antécédents et ma culture ancestrale ainsi que l’histoire de l’Inde et sa situation politique ; je savais où j’étais né et avais appris l’histoire de mon pays ; j’avais la prescience d’un monde nouveau. Je savais quelles formes littéraires m’intéressaient et je n’ignorais rien du voyage qu’il me faudrait entreprendre vers «le centre» afin de réaliser la vocation que je m’étais fixé.
Voyageant maintenant parmi des musulmans non arabes, je me retrouvais au milieu d’un peuple colonisé qui avait été dépouillé, à cause de sa foi, de tout essor intellectuel et de toutes les multiples formes de vie que font naître l’esprit, les sens, et la connaissance historique du monde. Je me trouvais au milieu de gens dont l’identité était plus ou moins contenue dans leur seule foi et qui n’avaient qu’une seule idée en tête : rester purs.
En Malaisie, chacun essayait désespérément de se débarrasser de son passé, de ses habitudes tribales, de ses pratiques animistes, de toute vie subconsciente chargée de souvenirs liés à la terre que l’on foule de ses pieds et même de ce riche folklore qui, ailleurs, stimule les peuples et enchante par sa poésie. Les plus fervents de ces Malaisiens n’avaient d’autre ambition que de s’abandonner entièrement à cette foi nouvelle importée d’Arabie. J’ai eu l’impression que, dans l’idéal, ils auraient aimé faire de leurs âmes et de leurs esprits un gouffre béant et vide que seule leur foi comblerait. Quelle tyrannie auto-infligée ! Jamais aucune colonisation n’a été plus profonde que celle opérée par la foi religieuse.
Pendant le temps où cette foi triomphait et semblait incontestée, le monde restait uni. Mais quand surgit de l’extérieur une civilisation puissante, captivante, les hommes ne surent plus à quel saint se vouer. Une seule arme leur restait : redoubler de zèle dans la pratique de leur foi et se détourner de ce qu’ils se sentaient incapables de maîtriser.
Une «philosophie hystérique»
Le fondamentalisme musulman dans des pays comme la Malaisie et l’Indonésie paraît tout nouveau. Voilà pourtant longtemps que l’Europe est présente en Orient et qu’un malaise existe dans le monde musulman. Cette anxiété, cette rencontre de deux mondes opposés, celui de l’Europe, ouvert à tous les courants d’idées et l’autre, replié sur sa foi, ont été merveilleusement perçues, il y a cent ans, par l’écrivain Joseph Conrad. Avec son passé polonais et son désir de transcrire exactement ce qu’il voyait au cours de ses voyages, il a réussi à décrire l’Orient et ses populations indigènes de façon bien moins superficielle qu’on ne le faisait à l’époque impérialiste.
Pour Conrad, ce monde où il voyageait était tout neuf : il l’observait avec attention. J’aimerais vous lire un passage tiré de son second ouvrage, publié en 1896 – il y a donc presque cent ans – dans lequel il a saisi quelque chose de l’hystérie musulmane de l’époque, cette hystérie qui, cent ans plus tard, devait se transformer en ce fondamentalisme dont nous parlons, alors que les populations autochtones étaient mieux éduquées, plus riches et que les empires disparaissaient :
«Un homme à demi-nu, mâchant du bétel avec pessimisme, se tenait au bord du fleuve à l’orée de l’immense et paisible forêt ; un homme en colère, impuissant, les mains vides, un cri d’amère révolte au bord des lèvres ; un cri qui, s’il avait fusé, aurait résonné à travers les solitudes vierges des bois, aussi vrai, aussi profond que n’importe quel cri philosophique jamais sorti des profondeurs d’un fauteuil confortable pour semer la panique à travers le désert impur des cheminées et des toits.»
«Philosophie hystérique», voilà les mots lâchés ; et je crois qu’ils sont toujours valables. Ils me ramènent à la liste de questions que votre condisciple, Myron Magnet, m’a envoyée pendant son séjour en Angleterre l’année dernière. Pourquoi, demandait-il, certaines sociétés sont-elles satisfaites de profiter des fruits du progrès tout en affectant de mépriser les conditions qui engendrent ce progrès ? Quel système de croyance lui opposent-elles ? Et plus précisément : pourquoi l’Islam reste-t-il inébranlable dans son refus des valeurs occidentales ? Je crois que la réponse se trouve justement dans cette hystérie philosophique. Ce n’est pas un phénomène facile à cerner ni à comprendre et les porte-parole des musulmans ne sont d’aucun secours en l’occurrence. Ils se gargarisent de clichés, peut-être parce qu’ils n’ont pas les moyens d’exprimer ce qu’ils ressentent. Et certains d’entre eux se consacrent à d’importantes causes politiques tandis que d’autres sont des missionnaires religieux plutôt que des érudits.
Un combat intérieur
Il y a bien des années, à l’époque où le shah était encore au pouvoir, on publia aux États-Unis un petit roman écrit par une jeune Iranienne qui, de façon discrète et sans faire de politique, annonçait l’avènement de cette hystérie. Le titre de ce roman est l’Étrangère et le nom de l’auteur : Nahid Rachlin. Peut-être valait-il mieux que ce roman soit publié sous le règne du shah ; de ce fait, l’auteur s’était vue contrainte à éviter d’aborder les problèmes politiques ; s’il en avait été autrement, l’œuvre aurait peut-être pris la forme d’un pamphlet politique, diminuant ainsi sa portée et la rendant dérisoire.
Le personnage central du livre est une jeune biologiste iranienne chargée de recherches à Boston. Mariée à un Américain, elle paraît bien adaptée à la vie américaine. Mais à l’occasion de vacances passées à Téhéran, son équilibre est sérieusement ébranlé. Confrontée à des problèmes de bureaucratie, elle ne peut obtenir de visa de sortie et se sent perdue tout à coup. Troublée par les souvenirs de son enfance opprimée, au sein d’une nombreuse famille où l’intimité sexuelle, souvent lascive, n’était pas respectée ; perturbée par ce qui reste de son ancienne vie familiale et par le développement monstrueux de sa ville natale qu’elle voit aujourd’hui saturée de «buildings à la mode occidentale», (expression intéressante puisque le mot «gigantesques» a été remplacé par «à la mode occidentale»), elle perd pied tout à coup comme si toute l’étrangeté du monde extérieur était venue s’agglutiner à Téhéran.
Ainsi déphasée la jeune femme se penche sur son passé américain. Rien n’y est aussi simple qu’elle le croyait. Tout à coup ce passé lui paraît vide ; elle ne comprend plus pourquoi elle a mené cette existence. En dépit de sa réussite apparente, elle ne contrôle ni sa vie sexuelle ni sa vie sociale. Pourquoi a-t-elle fait des travaux de recherche ? À quoi sert de les mener à bien ? Ce combat intérieur est décrit avec subtilité et efficacité ; nous comprenons que cette jeune femme n’est pas préparée à vivre l’affrontement des civilisations qui s’infiltrent dans le monde fermé de l’Iran où la foi, seule voie de salut, envahit tout : l’esprit, l’âme et la volonté. En face il y a cet autre monde où l’individualité, la responsabilité de chacun sont de règle, où l’on peut réaliser sa vocation, où l’on est stimulé par l’ambition et le désir de réussir et où l’on croit à la perfectibilité. Percevant cela à travers l’héroïne du roman, nous saisissons mieux le tourment, le vide de sa vie à Boston.
Dans sa détresse, elle tombe malade et se rend à l’hôpital. Le médecin chargé de la soigner comprend son désarroi. Lui aussi a passé quelque temps aux États-Unis et raconte qu’à son retour, il a chassé son vague à l’âme en visitant des mosquées et des lieux saints pendant des mois. Pour lui, la douleur de la jeune femme est une sorte de vieil ulcère : «Vous souffrez, dit-il avec douceur et mélancolie, du mal occidental». Et la biologiste en vient peu à peu à prendre une décision : elle abandonnera cette vie intellectuelle et ce travail inutile qu’on lui impose à Boston, tournera le dos au vide américain, restera en Iran et portera le voile ; comme le docteur, elle ira dans les mosquées et les lieux saints. Une fois cette décision prise, elle se sent libérée et plus heureuse que jamais.
Cette renonciation la satisfait pleinement. Pourtant, sur le plan intellectuel, elle est loin d’être parfaite : car elle sous-entend que là-bas, dans ce monde stressé, des gens continueront à fabriquer des médicaments et des équipements médicaux pour permettre aux hôpitaux iraniens de fonctionner.
Un récit de Conrad
Sans arrêt, durant mon voyage en Islam en 1979, j’ai retrouvé la même contradiction dans l’attitude des gens. Je me souviens en particulier du rédacteur d’un journal de Téhéran. Son quotidien avait tenu une place importante dans la presse révolutionnaire. Au milieu de 1979, il était en pleine gloire. Sept mois plus tard, quand je suis retourné à Téhéran, l’enthousiasme était tombé : dans les locaux de la rédaction, la pièce principale était vide : il ne restait de la nombreuse équipe d’employés et de journalistes que deux personnes. L’ambassade américaine avait été investie ; une crise financière s’en était suivie et beaucoup de firmes étrangères avaient fermé leurs portes : la publicité avait fait long feu et le rédacteur du journal pouvait à peine joindre les deux bouts ; chaque parution lui faisait perdre de l’argent. Attendant patiemment la fin de la crise, on peut dire que ce malheureux homme était devenu un otage au même titre que les diplomates américains. J’appris qu’il avait deux fils en âge d’aller à l’université ; l’un d’eux étudiait aux États-Unis et l’autre avait demandé un visa au moment où éclatait l’affaire des otages. Je fus surpris de constater que les États-Unis avaient une telle importance aux yeux des fils de l’un des plus grands porte-parole de la révolution islamique et j’en fis part à ce dernier. Il me répondit simplement : «Leur avenir en dépend».
D’un côté donc, une satisfaction émotionnelle ; de l’autre, le souci de l’avenir. Ce rédacteur était aussi déchiré que la plupart de ses concitoyens. Dans l’une des toutes premières nouvelles écrites par Joseph Conrad en 1890, on peut lire l’histoire d’un certain raja assassin et musulman (bien que cette dernière précision ne soit jamais réellement donnée) qui, ayant perdu son conseiller-magicien, se jette à l’eau une nuit, gagne à la nage les navires marchands anglais ancrés dans le port et demande aux marins – représentants à ses yeux de l’immense pouvoir venu de l’autre bout du monde – s’ils ne pourraient lui donner une amulette, un talisman. Les marins restent perplexes. L’un d’eux cependant tend au raja une pièce de monnaie britannique de six pences frappée à l’époque du jubilé de la reine Victoria. Le raja s’en retourne, enchanté. Conrad n’a pas traité cette histoire à la légère : il l’a chargée d’une signification philosophique profonde, valable pour les deux mondes ; et j’ai l’impression que sa vision des choses était juste.
Au cours du siècle qui a suivi cette aventure, la richesse du monde s’est développée en même temps que le pouvoir et l’éducation. Les troubles, les clameurs philosophiques se sont amplifiés également. Le déchirement que ressentait le rédacteur révolutionnaire et la renonciation que décidait la biologiste héroïne du roman de Nahid Rachlin sont tous deux un hommage – non reconnu mais non moins profond pour autant – à la civilisation universelle dont on ne tire ni talismans, ni sortilèges mais bien d’autres choses, difficiles à définir et à utiliser : l’ambition, l’effort, l’individualité.
La civilisation universelle a mis longtemps à se forger. Elle n’a pas toujours été universelle ni aussi attirante qu’aujourd’hui. L’expansion de l’Europe lui a donné, pendant au moins trois siècles, une connotation raciale qui fait encore bien des dégâts à notre époque. J’ai grandi à Trinidad où j’ai connu les derniers jours de ce genre de racisme. C’est peut-être ce qui m’a permis d’apprécier à leur juste valeur les énormes changements survenus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les immenses efforts accomplis par cette civilisation pour permettre aux nations de s’adapter à ce monde et à ses nouveaux courants de pensée.
Faire échouer le fanatisme
Mais revenons aux questions que m’a posées Myron Magnet : sommes-nous aussi forts que nos croyances ? Peut-on se contenter de considérer le monde du seul point de vue moral ? Il est facile de comprendre les angoisses cachées derrière ces questions dont le pessimisme même est une réponse. Mais c’est une arme à double tranchant. On peut y voir soit un moyen d’atteindre un système de croyance fixe et parfois hostile ; soit un des aspects de l’universalité de notre civilisation. La défiance philosophique rejoint l’hystérie philosophique et, en fin de compte, c’est l’homme qui manque de confiance en lui-même qui contrôle le mieux la situation.
Parce que le mouvement que j’ai opéré vers la civilisation s’est effectué de la «périphérie» vers le «centre», j’ai pu considérer d’un œil neuf certaines choses qui pour d’autres sont quotidiennes. Tout jeune encore, perturbé par les problèmes de la souffrance et de la cruauté, j’avais découvert avec émerveillement ce précepte chrétien : «Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît». Rien d’aussi consolant n’existe dans l’hindouisme, religion dans laquelle j’ai été élevé. Malgré l’absence chez moi de toute foi religieuse, j’ai toujours trouvé et trouve encore aujourd’hui que ce précepte est le plus admirable qui soit ; il définit parfaitement les règles idéales de bonnes relations humaines. Par la suite, j’ai compris combien la recherche du bonheur était essentielle à l’homme. Merveilleuse quête ! Sans doute en avais-je éprouvé l’attrait toute mon existence mais je n’en ai compris la portée philosophique qu’au cours de la préparation de cette conférence. Cette poursuite du bonheur est à la base de la fascination qu’exerce la civilisation sur la plupart de ceux qui en sont loin. Je trouve merveilleux de voir combien cette idée a mûri au cours des deux derniers siècles et surtout après les terribles événements de la première partie du nôtre. Elle s’adapte à tous les hommes, exige une grande ouverture d’esprit. Je ne pense pas que mes grands-parents paternels l’auraient comprise tant elle implique de concepts divers : le sens de la responsabilité individuelle, du choix, de la vie spirituelle, de la vocation, de la perfectibilité, de la réussite. L’envergure en est infinie et on ne peut la réduire à un système fixe ; jamais elle n’engendrera de fanatisme. On sait qu’elle existe et, de ce fait, les autres systèmes trop rigides sont voués à l’échec.
(Traduit par de l’anglais par Dominique Rueff)
[1] L’Énigme de l’arrivée de Naipaul (éditions Christian Bourgois), est de ce point de vue parfaitement exemplaire.



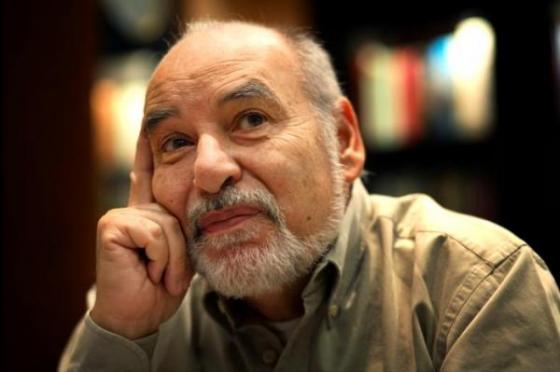
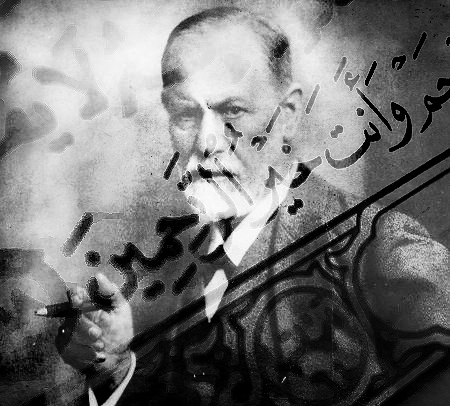




Que faire
Sinon s’incliner
En signe de respect
Face à ce regard de Sage
Qui scrute et interroge le monde
Puissiez vous avoir raison
Quant à la conclusion