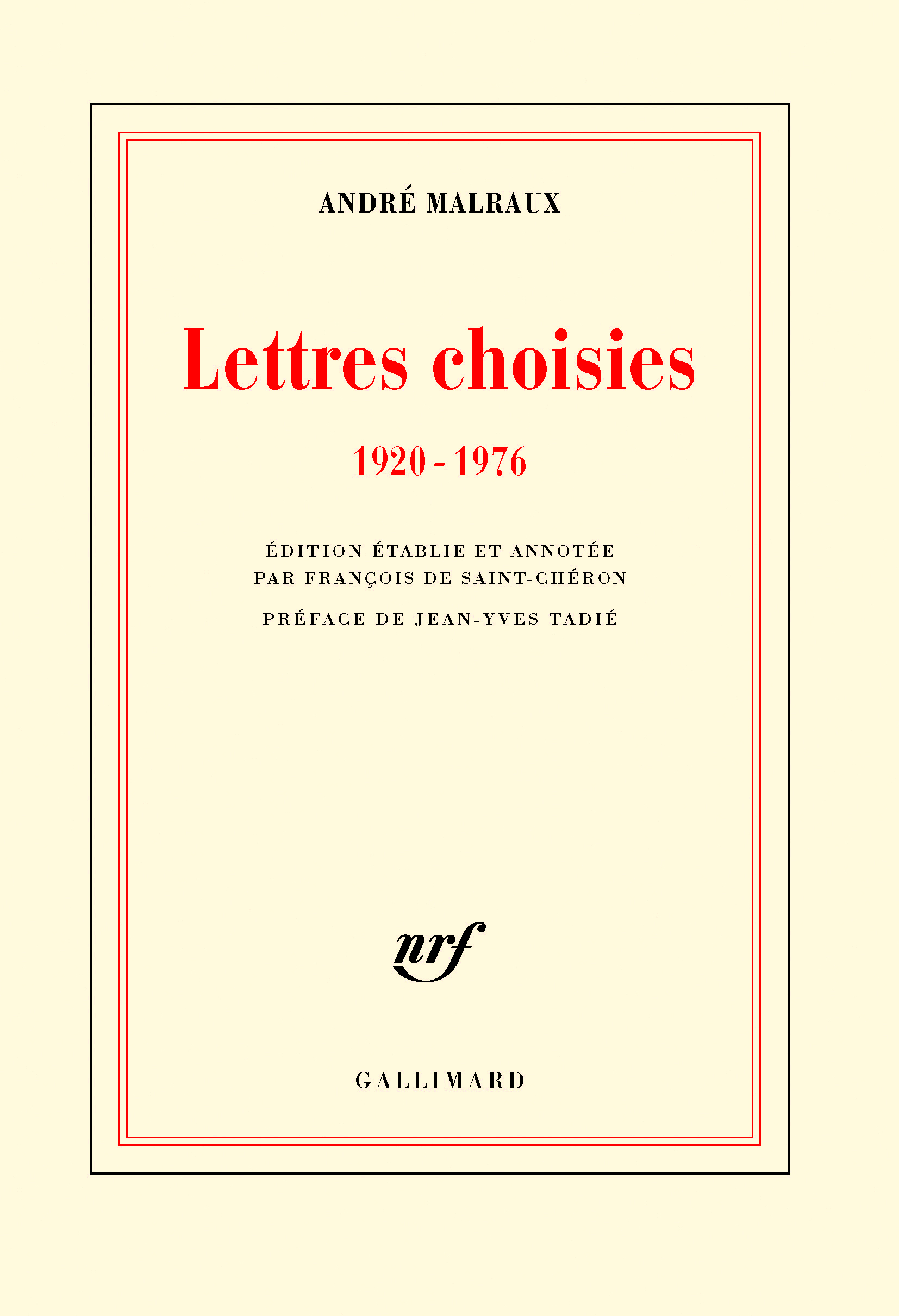Voici l’un des ultimes livres d’inédits d’André Malraux (1901-1976), ses Lettres choisies 1920-1976 dans l’édition que François de Saint-Cheron a réalisée grâce à Florence Malraux et à Jean-Yves Tadié qui l’a préfacée. Il ne reste plus d’inédits désormais que les quelques fragments du roman inachevé, Non, que Malraux avait entrepris puis arrêté en 1971 autour de la Résistance, et dont il utilisa des bouts dans Lazare, en 1974. Dans le Dictionnaire Malraux[2], j’ai proposé une première étude sur les ébauches de Non, mais venons-en aux lettres. Voici en 370 pages cinquante ans de correspondance d’un écrivain si peu épistolaire contrairement à beaucoup d’autres, et qui, pourtant, répondait volontiers aux lettres d’amis comme aux lettres d’inconnus, de traducteurs, de critiques intelligents. Parmi les amis qui eurent avec lui les plus longues correspondances, citons Louis Guilloux (1899-1980) son exact contemporain, Roger Martin du Gard (mort en 1956), Gide bien sûr (mort en 1951), dès les années 1930. Au lendemain de la guerre, d’autres figures prennent place dans la vie de Malraux, Roger Caillois, Jean Grosjean, le P. Bockel… et le général de Gaulle. Parmi les artistes, Chagall est celui avec qui Malraux aura le plus dialogué. De superbes lettres à découvrir, parfois bouleversantes.
D’emblée, ce livre exclut toutes les lettres reçues par l’écrivain auxquelles il n’a pas répondu par écrit, fussent-elles signées de jeunes intellectuels à l’avenir prometteur ou au nom déjà célèbre, ainsi Régis Debray, Pierre Goldman ou Bernard-Henri Lévy ont-ils écrit à Malraux pour le remercier de son intervention en leur faveur pour les deux premiers ou, dans le cas du plus jeune d’entre eux, après son appel pour le Bengale libre. Le livre n’a pas retenu non plus telle somptueuse lettre d’un ami résistant, écrivain de haut vol, et consul général de France à Los Angeles en 1957, quand il le remerciait avec une fougue altière pour le premier tome de La Métamorphose des dieux : Romain Gary : « J’ai pleuré de beauté devant votre texte. Jamais depuis Sophocle, un auteur de tragédie n’a jeté plus noblement sa tête contre le mur. »
Voilà autant de prémices pour un second tome un jour peut-être…
Mais attachons-nous à ce que nous avons ici. Il y a les lettres sérieuses, les lettres amicales, farfelues, fraternelles. « Je vous confirme l’accord de notre propre Commission sur l’orthographe du mot mynystre, qui exprime de façon synthétique les sentiments du chat de Mallarmé. La Commission avait pourtant envisagé mynistre » (p.276).
L’unique lettre à Picasso datant de 1964, n’est pas moins drôle, après que l’artiste eût appris que Malraux souhaitait – non sans son accord – faire tisser aux Gobelins le grand collage de 1938, Femmes à leur toilette :
« Des amis me disent que vous vous demandez ironiquement (à propos de la tapisserie de Guernica sans doute) si je me souviens que vous êtes aussi un peintre. […] Mais la France ne peut souhaiter de vous que ce que vous souhaiteriez peindre… » (280-281).
Les lettres de ou à Chagall, avant ou après le plafond de l’Opéra, sont, cela va sans dire, d’un tout autre ton, plein de reconnaissance, d’admiration mutuelle et d’amitié profonde entre les deux hommes.
Un dialogue intense sur plus de quarante ans est celui entre Malraux et Louis Guilloux, l’auteur si méconnu aujourd’hui d’un chef-d’œuvre, Sang noir, contemporain du Voyage au bout de la nuit. Malraux lui écrit en 1930 :
« Il me semble que chacun de nous protège l’illusion qu’il a de sa grandeur, mais qu’il ne peut devenir grand qu’en risquant de perdre surtout cette illusion (ou cette réalité) […] Oui, nous n’écrivons que les livres que nous méritons d’écrire ; mais il y a aussi les livres que nous méritons d’écrire et que nous n’écrivons pas, vous le savez bien » (85).
Il lui écrit encore en 1933 : « Si vous choisissez la fiction, reste à savoir si vous ne devez pas renoncer à la bonté ».
Dans une lettre à Louise de Vilmorin de la même année, au temps de leurs premières amours, il écrit à propos de l’un des oiseaux qu’elle vient de lui adresser, qu’il « parlait déjà en farfelu ».
À propos de la fonction de l’art, de l’artiste, il écrit au poète Georges Henein, l’année suivante : « Discuter contre un livre, contre une œuvre, est une des choses les plus vaines. Tout art est un problème de thérapeutique. On a besoin de ce que je signifie, ou on n’en a pas besoin. Mais, du point de vue de la pensée même, aucune œuvre, aucun esprit, ne vaut que par ce qu’il apporte. Reprocher à un livre de n’être pas autre chose que ce qu’il est, ça a autant d’intérêt que de définir pour soi-même les règles d’un jeu imaginaire et engueuler deux voisins parce qu’ils sont en train de jouer aux dames » (113).
Ce livre révèle assurément plusieurs personnages, le jeune écrivain, l’homme engagé, le résistant, le gaulliste, l’artiste, l’écrivain abouti et toujours l’homme du dialogue des cultures. Derrière, se lit un Malraux tour à tour fraternel, humain, parfois humble, toujours attentif à l’autre. Ses lettres à Max Jacob, à Giono, Gide, Roger Nimier, Arthur Koestler, Albert Schweitzer, Indira Gandhi… ou à la photographe Germaine Krull, installée en Inde à la fin des années 1960, sont le plus souvent non seulement intelligentes mais aussi riches d’une présence souvent inconnue, car n’oublions pas l’un des traits puissants de l’esprit de Malraux, dont il parle dans sa préface au Temps du mépris : « Il est difficile d’être un homme. Mais pas plus de le devenir en approfondissant sa communion qu’en cultivant sa différence, et la première nourrit avec autant de force au moins que la seconde, ce par quoi l’Homme est Homme, ce par quoi il se dépasse, crée, invente ou se conçoit ».
En 1946, il écrit à un avocat pour porter témoignage du courage d’un jeune homme, ancien de la Brigade Alsace-Lorraine, Guy Hesling, alors aux prises avec la justice. En 1970, il écrit au maire de Beaumont-du-Périgord, pour que la tombe « de l’un de mes très chers chefs de maquis, Raymond Maréchal », tombé en 1944, qui fut un héros également dans l’escadrille España, fut entretenue, ajoutant qu’il financerait lui-même l’entretien.
On ne saurait trop recommander au lecteur de lire attentivement la correspondance de vingt-deux pages avec Max Jacob entre 1920 et 1921 (car à chaque fois ou presque nous avons la lettre de Jacob), qui est l’un des apports notables de ce livre.
On sait gré à François de Saint-Cheron d’avoir réussi à mettre en forme ce puzzle de plusieurs centaines de lettres, qui ne peut qu’attirer les amateurs de correspondance des grands écrivains, mais à la différence de beaucoup d’entre elles, celle-ci s’inscrit dans les grandes révolutions comme dans les guerres du XXe siècle mais aussi fortement dans l’ère gaullienne, autant de moments d’histoire dont Malraux fut tour à tour témoin, combattant, enfin homme d’Etat mais toujours l’artiste accusateur de la condition humaine.
À Emmanuel Berl, en mai 1972, tout aussi agnostique que lui, il écrit : « je pense, comme vous, que l’athéisme n’a pas grand sens. On n’est jamais que contre les dieux des autres ».
Quelques mois avant sa mort survenue le 23 novembre 1976, il écrit l’une de ses dernières lettres. Nous sommes le 18 juin et il remercie Louis Martin-Chauffier d’un article qu’il a écrit sur Josette Clotis – avec qui Malraux vécut à partir de 1937 jusqu’à sa mort accidentelle en 1944 – et Le Cœur battant que lui a consacré Suzanne Chantal, préfacé par l’écrivain.
« Votre article m’est allé au cœur indépendamment de tous jugements : par le ton. Qu’une amitié si vieille, traversée de tant de morts, puisse rester cela, possède un mystère qui n’est pas tellement éloigné de la survie des œuvres. Chez vous, c’est englobé dans la foi. Mais chez moi ? D’autant plus que les faits ne comptent pas : je n’ai pas été frappé par tel événement, tel souvenir, dont il est difficile de comprendre qu’il émeuve. Il s’agit du ton général, de son amitié si étrangement accordée à la vie et à la mort. »
À vous de jouer ! eût dit Malraux aux lecteurs de son œuvre que nous sommes. Car il dépend de nous seuls qu’elle soit abandonnée ou au contraire vivante, nous prodiguant quelque chose de sa puissance, de son génie, de son universalité… Puisse ce livre permettre de découvrir un autre Malraux, intime, intérieur et encore une fois fraternel !