On s’est plu à faire de Camus un philosophe pour bachelier ; c’était reconnaître sans l’avouer que Camus est, en réalité, un philosophe de l’avenir et, peut-être même celui du troisième millénaire. Celui qui nous mène à penser la révolution autrement. Il faut relire L’homme révolté en ayant à l’esprit sa date de parution pour constater ce qu’il augure de novateur et de réellement dissident. La lucidité de Camus est à faire pâlir, et ses contemporains (de rage) et nous-mêmes (d’admiration). Car s’il prend acte de l’Histoire dans laquelle nous sommes engagés, du nihilisme et ses conséquences, il est aussi l’un des seuls à ne pas s’y soumettre, l’un des seuls à ne pas fermer les yeux sous la pression idéologique ambiante. Il rejoint Voltaire par-delà les siècles et rompt de facto avec Sartre. Ni le surhomme, ni l’homme idéal ou abstrait ne le subjuguent, il leur préfère l’homme de chair. L’homme pour qui la faim n’attend pas. L’homme pour qui l’absolu ne tient pas devant un verre de vin fin. L’unité dans l’humanité, l’homme en tant qu’il est un visage, un regard, une main, ni plus ni moins. Entre l’homme révolté et la révolution, entre l’individu – imparfait par définition – et l’idéal qui ne vous veut que du bien même s’il vous nie vous gaze vous lobotomise, Camus ne balance pas : dès lors où la révolte se laisse gagner par l’absolu tout est fichu. C’est ce qu’exprime Hannah Arendt lorsqu’elle écrit : “Tout absolu détruit la politique, qu’ils s’agisse de l’”arme absolue” ou de la “vérité” absolue. Mais la vérité de fait est précisément le contraire : et lorsqu’elle est altérée tout est détruit”.
L’histoire récente le montra en maintes occasions : l’Absolu est aussi tenace que dévastateur. Même Nietzsche, après avoir constaté le décès clinique de dieu, après avoir déduit que dieu était inutile puisqu’il ne voulait rien et que tout jugement de valeur porté sur le monde revenait à calomnier la vie, même Nietzsche, le grand contempteur de l’idéal, ne put s’empêcher de nous resservir de l’idéal à la louche. Séduisant par certains côtés, le Surhomme n’en reste pas moins un concept, une promesse, un messianisme calqué pour partie sur le précédent. De même, il n’entrait pas au programme des révolutions de se débarrasser de l’Absolu – elles en avaient trop besoin. Elles entendaient, en revanche, le séculariser et y parvinrent en substituant la philosophie de l’histoire à la foi religieuse. Le caractère totalisant et par conséquent totalitaire de l’Absolu ne pouvait que séduire des esprits révolutionnaires : c’est tout ou rien. La révolution ne connaît pas la demi-mesure. Elle ne connaît pas ce langage-là. La négation de l’ordre existant ou bien est totale ou bien stérile.
L’hostilité à l’art d’à peu près tous les révolutionnaires est de ce point de vue on ne peut plus significative. L’art ne saurait, en effet, reposer sur une négation pure, simple et définitive de ce qui est. L’art concilie amour du monde (exigence esthétique) et refus de la réalité telle qu’elle est. Il est par définition ambivalent. C’est une quête de l’impossible qui, finalement, accepte de ne jamais tout à fait atteindre son but. Une quête fabricatrice d’univers de substitutions, là où l’esprit révolutionnaire ne créé que de l’espoir (et le désespoir qui lui est subséquent). En vérité, l’art, comme la révolte, dérange par leur modération laquelle est par définition contre-révolutionnaire. Là encore, l’histoire récente fourmille de procès qui lui furent intentés : Luther en grand promoteur de la morale abjure la beauté ; Rousseau dénonce dans l’art une corruption ajoutée à la nature par la société ; Saint-Just tonne contre les spectacles ; les saint-simoniens exigent un art “socialement utile” ; les nihilistes russes affirment qu’une paire de bottes est plus utile que Shakespeare, etc. Ne parlons même pas de l’art communiste qui, à lui seul, est une condamnation de l’art… “La misère parfois, écrit Camus, se détourne des douloureuses images du bonheur”. L’art, en somme, rappelle et prouve par l’exemple qu’il existe “une transcendance vivante, dont la beauté fait la promesse, qui peut faire aimer et préférer à tout autre ce monde mortel et limité”.
L’art, en ce sens rejoint l’homme révolté. L’art et l’art de vivre. Là où la révolution procède du calcul, et préfère un avenir hypothétique aux réalités du présent ; l’homme révolté, s’il ne prétend pas tout résoudre, se résout à faire face. Son domaine est l’immanence. Son moteur : la mesure, l’amour du monde. Son éthique : une générosité active à l’égard du vivant. Il lui répugne de renvoyer la joie à plus tard, aussi ne perd-il pas son temps à prêcher la terre promise. Le révolté, selon Camus, refuse la divinité pour partager les luttes et le destin communs. Il nous apprend l’art de vivre et rappelle que le monde, ce monde-ci et aucun autre, demeure notre premier et dernier amour. Il a sur les lèvres les mots par lesquels une philosophie d’aujourd’hui commence de s’écrire : Chacun dit à l’autre qu’il n’est pas Dieu ; ici s’achève le romantisme.
Merci Camus.




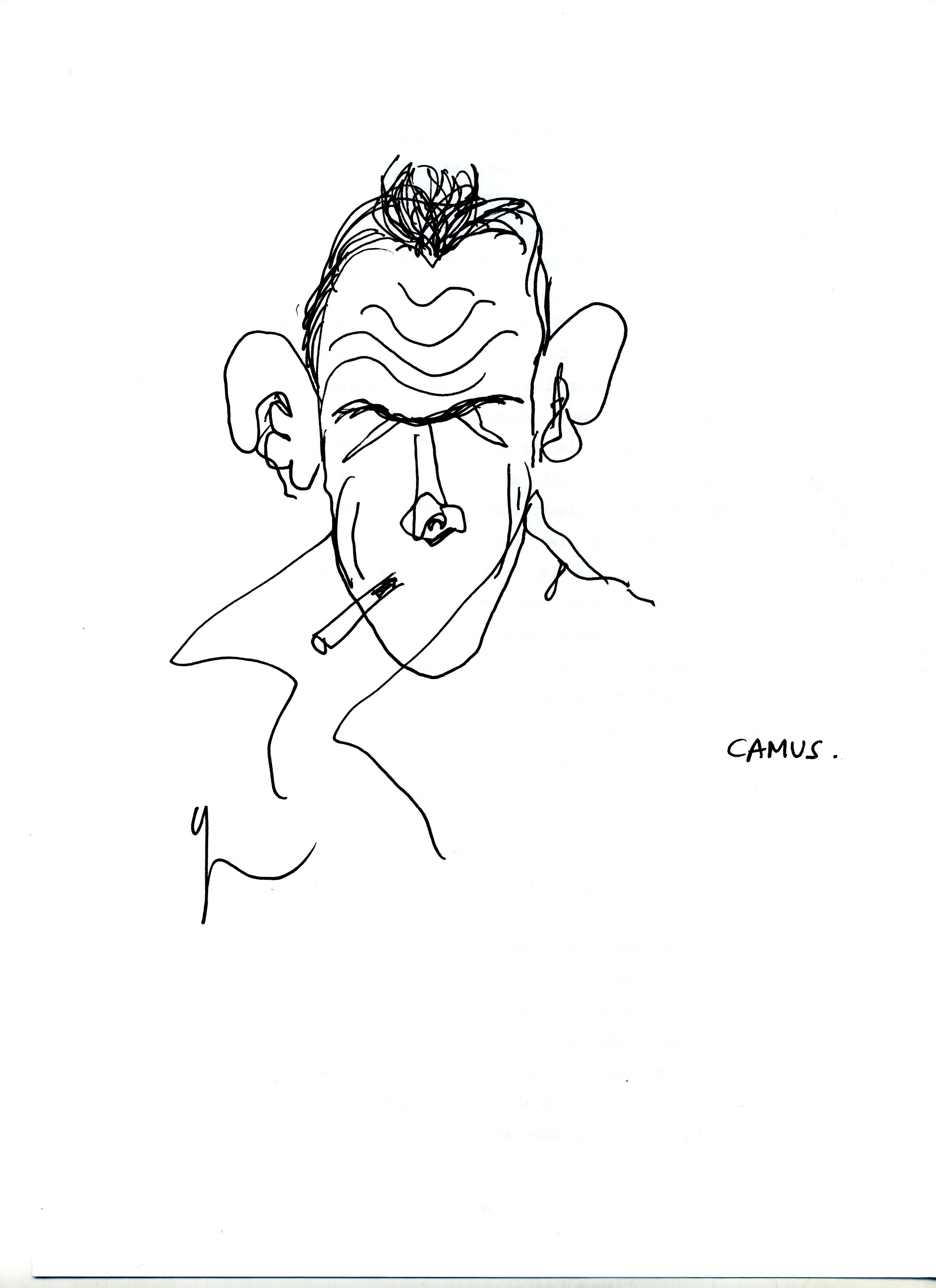



Rien sur le bouquin d’Onfray ?
« L’homme pour qui l’absolu ne tient pas devant un verre de vin fin. » Qu’est-ce que ça veut dire ?
« On s’est plu à faire de Camus un philosophe pour bachelier… » Qui ? Des noms ! Cette manie chez vous récurrente de suggérer encore un complot (du Spectacle ?) est agaçante. Il est tout aussi facile et plus juste d’écrire : « Certains considèrent Camus, etc. », ou parler d’un malentendu à propos de Camus. Maintenant, si ce « on » s’appelle Sartre, vous pouvez le dénoncer, il ne viendra pas vous mordre les orteils dans votre sommeil.
« Il faut relire… » Sous la menace d’un revolver, peut-être ? Ces manières impératives sont une manie de plus chez vous.
« … les nihilistes russes affirment qu’une paire de bottes est plus utile que Shakespeare… » Pas « les » nihilistes, mais un seul, Pisarev, que cite d’ailleurs Camus : « J’aimerais mieux être un cordonnier russe qu’un Raphaël russe. » C’est Camus qui suggère ensuite que, pour Pisarev, une paire de bottes est plus utile que Shakespeare. Or, soyons juste, c’est un peintre qui est visé, un imagier, et non un dramaturge, un homme de l’écrit. Peut-être que Pisarev détestait les images… Mais bon, j’ergote, car le résultat est identique : la haine de l’art, l’art qui transforme, déplace, enrichit, sublime la réalité. C’est d’ailleurs « comique » ces grands idéalistes politiques amoureux du peuple et qui affirment la supériorité de la matière sur les affects humains, la spiritualité, le simple et naturel mouvement d’échapper pour un moment aux contingences de notre chair mortelle. C’est exactement le pendant, à gauche, du nazisme. Mais il est moins blâmé. On se demande bien pourquoi. Ses victimes sont cependant aussi nombreuses. Curieux…
Sinon, rien à redire, et content de voir Camus réhabilité (Onfray s’y est mis aussi, brillamment ai-je cru comprendre).
Votre toujours vigilant vieux complice et ami.