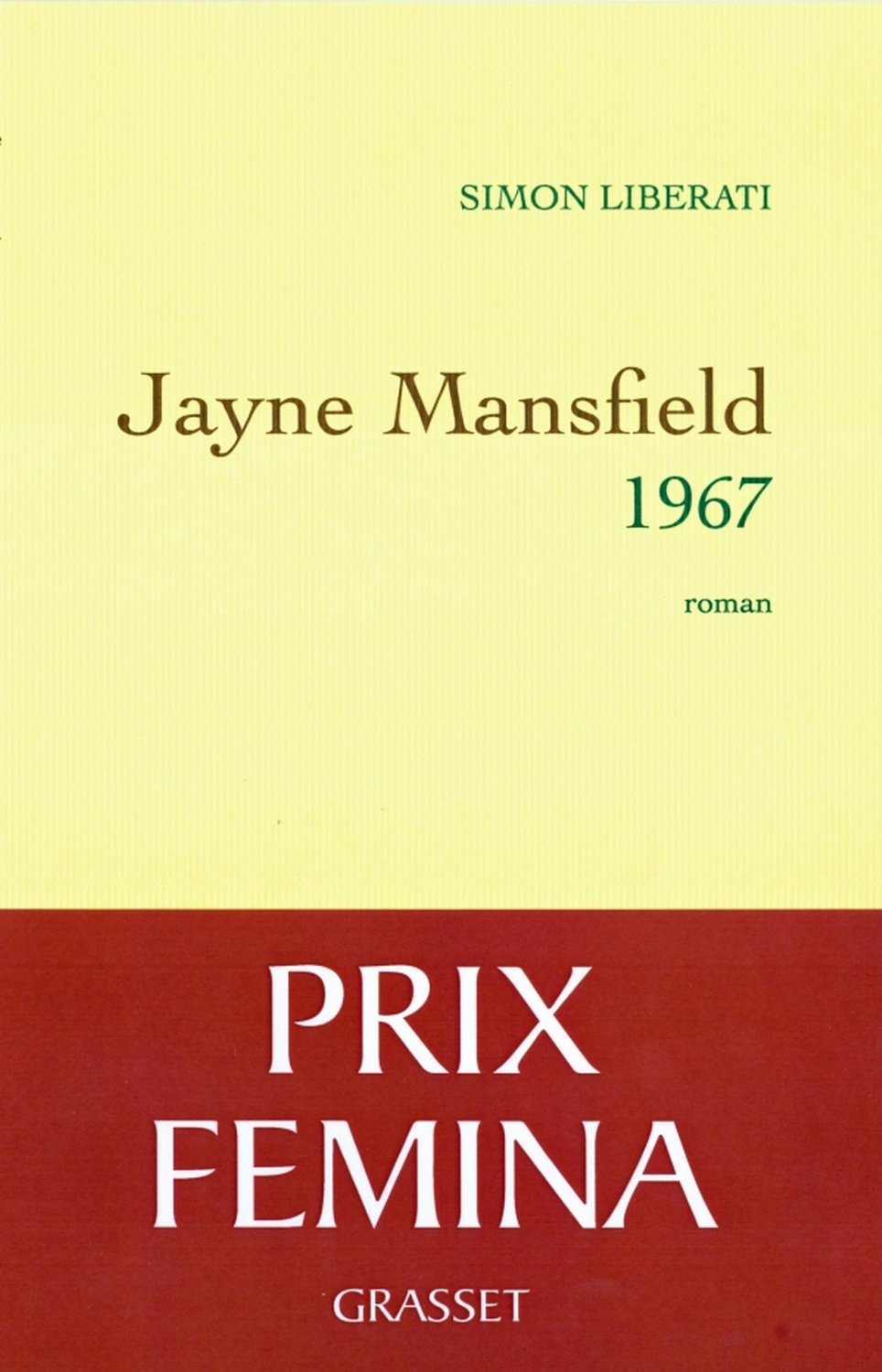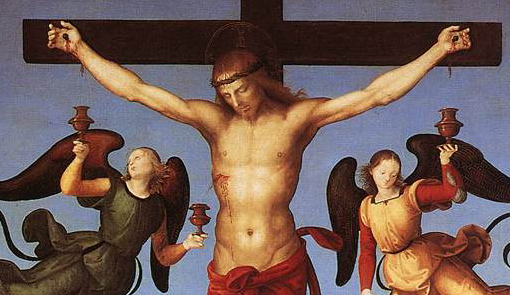De retour après plusieurs mois d’exil. Je respire. Je me laisse glisser dans l’écoulement du temps – le luxe, le grand, le vrai !… Le temps d’une lecture. Mais pas n’importe quelle lecture, puisque cette lecture m’invite au retour. Une lecture qui, au lieu de m’expulser de l’humanité, m’en rapproche. Et quand je dis humanité, je ne parle pas de cette humanité feinte à laquelle mes supposés semblables s’astreignent, cette humanité s’imaginant tellement humaine qu’elle se saborde et se ment à elle-même.
Non, je parle d’une humanité pour laquelle la monstruosité n’est pas sujet à sarcasme. Ce sarcasme tout juste bon à te rassurer avant de t’exploser au visage. À la manière de l’époque qui, à coup de chirurgie esthétique, produit en série ce à quoi elle voudrait vainement remédier.
Eh bien oui, au déni de monstruosité, je préfère – à l’instar de Simon Liberati – une monstruosité assumée. Au visage trop lisse, un peu de difformité. Au confort et à la sécurité, l’appétit de vivre. À la mire mentale de mes contemporains, un encéphalogramme endiablé.
En fait de diable d’ailleurs, je me demande jusqu’à quel point le jury du Femina est réellement conscient de la place qu’il occupe dans le Jayne Mansfield 1967 de Liberati. Car si nous y trouvons, bien sûr, la description minutieuse de l’accident qui vint souffler l’existence hors-norme de Jayne Mansfield le 29 juin 1967 ; si nous avons droit à son éviction du SFIFF (le San Francisco International Film Festival) le 20 octobre 1966 et qui signe – au-delà l’anecdote – la fin d’un monde, celui de la movie star, de Monroe à Mansfield, de Shirley Temple à Carrol Baker ; si nous avons en bout de course et comme autre élément clé, après empoignade conjugale, ce visage charnel, maternel si proche que nous pourrions presque le toucher ; il y a aussi, il y a peut-être surtout la rencontre à priori improbable entre ces deux animaux circassiens que furent Jayne Mansfield et Anton LaVey.
Une bimbo sur le déclin et un excentrique de 36 ans en mal de notoriété. Lola Montès et rien de moins que le chef de file de l’Eglise de Satan. Le Rose et le Noir. Improbable mais archi-signifiante, “leur rencontre eut lieu quelques heures avant sa déchéance du star-system et marqua son entrée définitive sur la scène underground”. Nous sommes le 19 octobre 1966, dans l’antre du mage sise à l’époque 6114, California Street. Coup de foudre ? Coup de pub ? Peu importe. Seul importe la révélation d’un crépuscule. Faussement naïf, Anton LaVey, qui aimait tant la compagnie des freaks, les bêtes fauves et toute l’aristocratie du peuple forain, fut peut-être le seul à percer à jour le destin de Jayne Mansfield. Le reste ? Mise en scène. Rituel ridicule dont nos deux extravagants ne furent jamais dupes. Second degré. Toujours à deux doigts du fou rire. Et derrière ce grand rire lucide, bien sûr, une vérité difficile à admettre. Et peut-être pas tant que cela d’ailleurs. Car Jayne Mansfield n’est pas seulement dotée d’une plantureuse poitrine. C’est aussi une femme puissante, une femme phallus.
Est-elle décidée à devenir prêtresse de l’Eglise de Satan ? Pourquoi pas. C’est l’évidence – ici parodiée – de toute une vie. La vérité crépusculaire qu’Anton LaVey perçoit au travers la chair de Jayne Mansfield c’est qu’avec le temps, les perruques et les scandales, les choses étaient devenues de plus en plus claires et, comme dans les grandes familles du cirque, ses enfants, ses maris et ses amants travaillent dans le numéro et servaient à sa parade. Sorite du cinéma, déchue de son statut de movie star, elle était devenue une gigantesque attraction foraine à la manière de Lola Montès. Une de ces femmes qui, ayant fini d’être belles, deviennent des monstres dans l’espoir d’entretenir l’attention.
Une leçon de lucidité à l’usage des générations présentes et à venir.