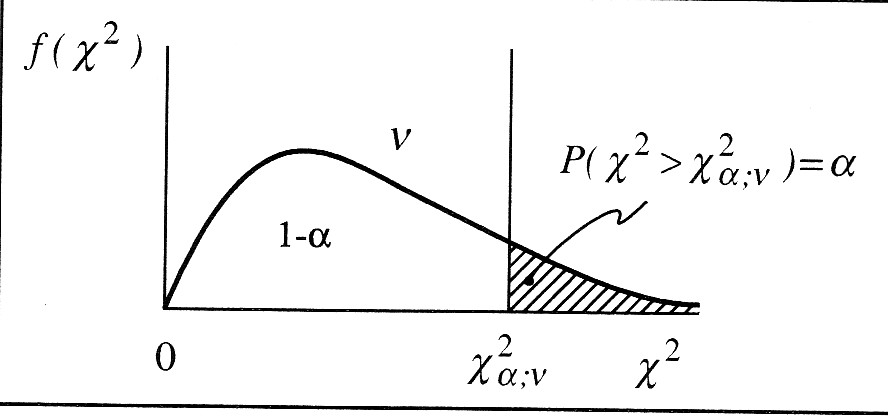Jeter un objet, tirer la chasse d’eau, sortir la poubelle : autant de gestes banals et automatiques par lesquels nous nous débarrassons de ce qui encombre notre espace, de ce qui nous dérange ou nous dégoûte. C’est un acte qui confine à la magie : ce qui était présent, encombrant, intrusif, disparaît. Mais cette disparition est une illusion. Rien ne disparaît vraiment, tout se délocalise.
Derrida parle de « différance » (1972), néologisme qui désigne à la fois le report du sens dans le temps et la différenciation dans l’espace. Selon lui, le sens d’un mot ou d’un concept n’est jamais donné immédiatement mais se construit à travers un réseau de différences et de références différées. Les ordures suivent cette logique : nous croyons les éliminer, mais elles continuent d’exister ailleurs, sous différentes formes. Décharges, incinérateurs, continents de plastique, nappes phréatiques polluées, fonds marins, etc., tous ces lieux portent le poids de ce que nous refusons de voir. Notre rapport aux déchets est un rapport d’oubli, un refus de reconnaître la continuité entre notre espace immédiat et le monde.
Le dégoût joue un rôle crucial dans cette dynamique. En philosophie, le dégoût est souvent défini comme une réaction viscérale qui délimite la frontière entre le moi et l’altérité. Kant le décrit comme une aversion immédiate qui empêche la contemplation esthétique (Critique de la faculté de juger, 1790), tandis que Sartre l’interprète comme un rapport négatif à l’existence, une confrontation à l’absurdité de la matière première (L’Être et le Néant, 1943). Les excréments, en particulier, sont un rappel brutal de la finitude humaine : ils manifestent notre condition organique, notre intégration dans les cycles biologiques et les aspects de nous-mêmes que nous voulons nier. Ernest Becker affirme que pour vivre, nous devons nous comporter comme si nous ne mourrions jamais, ce qui explique la répression culturelle des signes de décomposition (The Denial of Death, 1973). Dans Les Misérables (1862), Victor Hugo critique l’absurdité d’un système qui traite les excréments humains comme de simples « déchets » plutôt que comme une ressource. « Un peuple qui jette son fumier sera bientôt un peuple qui importe son pain », écrivait-il, déplorant la perte de ces nutriments vitaux, jetés par les villes au lieu d’être restitués aux sols agricoles. Ce dégoût viscéral nous empêche de voir dans les ordures autre chose qu’un objet d’exclusion.
Le statut des ordures soulève des questions ontologiques fondamentales. Dans la Métaphysique, Aristote distingue la potentialité de l’actualité : un objet peut exister en puissance avant de réaliser pleinement sa fonction. Le déchet apparaît comme un objet dont l’actualisation est niée, reléguée à une non-existence symbolique malgré sa présence matérielle continue. Un objet cesse-t-il d’exister simplement parce qu’il est retiré de notre champ de perception ? David Hume affirme que toute connaissance découle de l’expérience sensorielle – ce que nous ne percevons plus tend à être considéré comme inexistant, même s’il reste matériellement présent (Traité de la nature humaine, 1739).
Heidegger rappelle que les objets techniques ne sont véritablement perçus (Être et temps, 1927) que lorsqu’ils se décomposent. Ce concept, lié aux notions de « présent à portée de main » (Vorhandenheit) et de « prêt à porter de main » (Zuhandenheit), suggère que les objets quotidiens disparaissent dans leur fonction jusqu’à ce qu’ils échouent, révélant leur essence et notre relation instrumentale avec le monde. De même, les déchets ne deviennent perceptibles que lorsqu’ils refont surface – marées noires, plages chargées de plastique ou pollution insidieuse. C’est l’élément refoulé de la modernité, qui échappe à la conscience et à la responsabilité immédiates. Par exemple, l’exportation massive de déchets électroniques vers des pays comme le Ghana et le Pakistan crée de vastes décharges à ciel ouvert où des travailleurs informels brûlent des composants pour en extraire des métaux précieux, au prix d’une grave pollution du sol et de l’air (Puckett et al., 2002).
En dignes héritiers de l’hygiénisme moderne, notre hypervalorisation de la propreté conduit à une amplification de cette dissociation entre nous et nos ordures. Un bon exemple de cela sont les rituels de désinfection qui pullulent sur les réseaux sociaux à grand renfort de gel hydroalcoolique et de boitiers de stérilisation UV portatifs depuis le Covid. La propreté n’est pas seulement une question physique ou physiologique mais un ordre symbolique structurant les sociétés humaines (M. Douglas, 1966). Ce concept est également présent dans la psychanalyse lacanienne : il renvoie aux structures de sens et aux normes qui façonnent notre rapport au monde. Selon Michel Foucault, l’hygiène s’inscrit aussi dans un cadre scientifique et politique qui devient un outil de régulation démographique et de contrôle social (Naissance de la biopolitique, 1979). Les nombreux débats soulevés par l’obligation vaccinale en France en sont une parfaite illustration.
Cependant, toutes les tentatives d’élimination des ordures, comme celles des virus, se heurtent à une réalité physique : l’impossibilité de disparaître. Nous habitons un monde fini où chaque déchet trouve une destination, où tout ce qui est mis de côté, temporairement éloigné, occupe encore un espace, même s’il est caché.
L’illusion de la disparition des déchets est donc liée à une question ontologique plus large. Aristote, dans sa Métaphysique, associe l’infini à un potentiel inachevé plutôt qu’à une réalité concrète (Métaphysique, Livre IX). L’infini, en tant que tel, ne peut jamais se matérialiser pleinement ; il reste un processus continu, une limite jamais atteinte. Pourtant, la société moderne fonctionne dans l’illusion que la matière, et en particulier les déchets, peuvent être absorbés, oubliés, dissous à l’infini. En réalité, cette vision contredit la finitude du monde physique, nous rappelant que tout ce qui est produit, utilisé et jeté persiste sous une forme ou une autre. Ce déni des limites découle d’une incompréhension fondamentale de la matérialité et de ses inévitables contraintes. Ce mécanisme psychologique fait écho à la croyance en une croissance infinie, comme si l’humanité pouvait se réinventer sans cesse en échappant aux contraintes physiques et biologiques.
Réhabiliter la notion de déchet, c’est s’interroger sur notre rapport au monde, sur notre existence, sur notre responsabilité. Hans Jonas souligne la nécessité d’une éthique du futur, où nos actions doivent être évaluées en fonction de leur impact sur les générations qui viendront après nous (L’impératif de responsabilité, 1979). Cette perspective nous oblige à reconsidérer la gestion des déchets non pas comme une simple élimination, mais comme un acte moral ayant des implications à long terme. Paul Ricoeur affirme que la responsabilité éthique dépend de la capacité à raconter et à reconnaître l’altérité (Soi-même comme un autre, 1990). Appliquer cette réflexion aux ordures nécessite de restaurer leur visibilité et leur présence dans notre discours collectif, plutôt que de les exclure de notre conscience. Cette responsabilité peut également être comprise à travers la philosophie d’Emmanuel Levinas pour qui la responsabilité éthique est une réponse à l’Autre, une obligation qui précède la liberté individuelle (Totalité et Infini, 1961). En ce sens, reconnaître l’existence et les conséquences des ordures implique une responsabilité à l’égard des autres et du monde, en reconnaissant que nos actions ont des répercussions bien au-delà de notre environnement immédiat.
Accepter que ce que l’on jette continue d’exister, c’est embrasser l’interconnexion de toutes les choses, repenser notre approche de ce que l’on rejette et reconnaître la nécessité de réintégrer ces matériaux non désirés dans la société. La circularité de la matière, déjà présente dans certaines traditions agricoles et artisanales, doit être réintégrée au cœur des modèles contemporains. Cette réintégration ne consiste pas seulement à recycler, mais à repenser notre rapport aux objets et aux processus qui les rendent obsolètes. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se… ».
Bibliographie
Derrida, J. (1972). La différance. In Marges de la philosophie, éditions de Minuit, Paris. (pp. 42-78).
Kant, I. (1790). Critique de la faculté de juger. Traduction française par P. Chaumier, Gallimard, 2003. (Partie II, section 3, pp. 255-279).
Sartre, J.-P. (1943). L’Être et le Néant. Édition Gallimard, La Collection Blanche, 1943. (Partie I, chapitre 2, pp. 78-102).
Becker, E. (1973). The Denial of Death. Free Press, New York. (Part I, Chapter 2, pp. 30-55).
Aristote. Métaphysique. Traduction française par J. Aubonnet, Éditions Vrin, 2005, Livre VII.
Heidegger, M. (1927). Être et Temps. Traduction française par F. Fédier, Gallimard, 1973. (Section 2.3, pp. 123-145).
Douglas, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Traduction française : De la souillure, PUF, 1980. (Chapter 2, pp. 44-78).
Foucault, M. (1979). Naissance de la biopolitique. Extraits des cours au Collège de France, Seuil, 1980. (pp. 102-130).
Aristote. Physique. Traduction française par [Nom du traducteur], Éditions Les Belles Lettres, 2006. (Livre II, pp. 89-115).
Smith, A. (1776). La Richesse des nations. Traduction française par P. Diebolt et A. de Sismondi, édition de poche, 1989. (Livre I, chapitre 3, pp. 47-65).
Georgescu-Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press, Cambridge, MA. (Chapter 4, pp. 95-120).Ministry of the Environment and Water Resources, Singapore. (2019). Integrated Waste Manage