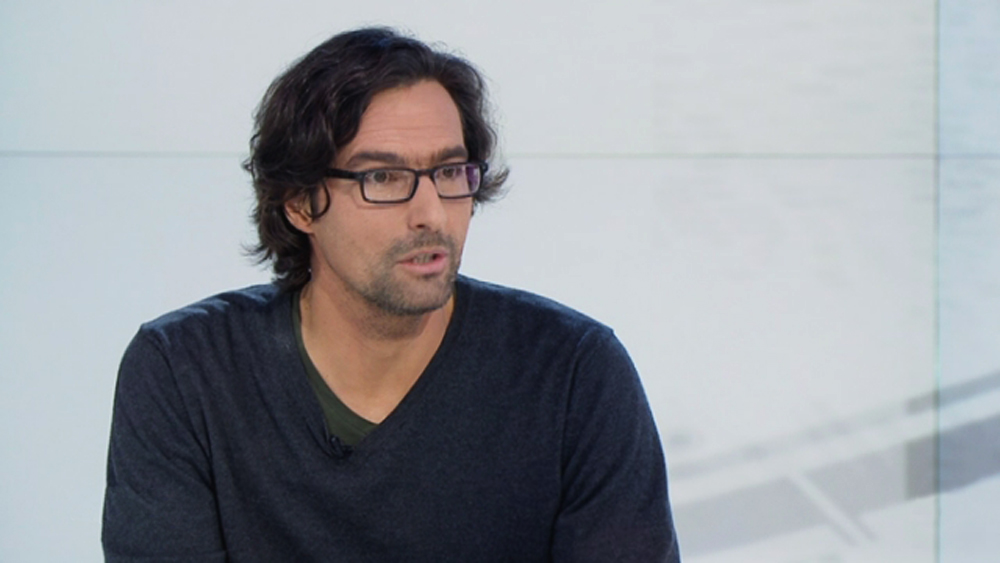Madame Simonetta Sommaruga, Présidente de la Confédération Suisse, et Monsieur Alain Berset, Conseiller fédéral,
Puisque dans l’une de vos déclarations, vous faites allusion à la société du spectacle… pour mieux refuser les consignes que l’on nous donne?; permettez-moi, je vous prie, de vous rappeler que Guy Debord est surtout et avant tout un poète, traducteur du plus célèbre d’entre eux parmi les précurseurs de la langue castillane (Jorge Manrique 1475). Debord, afin de démontrer par son propre exemple (comme il me l’a dit à plusieurs reprises) et prouver qu’une autre vie était possible, a décidé d’écrire son expérience personnelle dans son chef-d’œuvre Panégyrique, dont le style est à juste titre comparé à celui du cardinal de Retz. Panégyrique était un bien meilleur titre qu’Éloge: je crois avec lui qu’éloge aurait été trop faible. [Le Littré précise: …panégyrique dit plus qu’éloge. L’éloge contient sans doute la louange du personnage, mais n’exclut pas une certaine critique, un certain blâme. Le panégyrique ne comprend ni blâme, ni critique].
Guy Debord est né à Paris le jour des Saints Innocents en 1931, huit mois avant que je voie le jour à Melilla. Il s’est euthanasié un mois avant le début de sa grande climatérique. Les années maléfiques étaient, pour les Grecs, les multiples de neuf ou sept ans, mais la plus horrible de toutes était celle qui mariait ces deux nombres en les multipliant : soixante-trois. À la veille de son anniversaire fatidique, le stratège Guy Debord a choisi le vide: il a arrêté sa propre histoire. Il s’est retiré de son milieu et des médias alors qu’il avait atteint la plus haute réputation. Celle de celui qui n’a jamais été couronné que par son prestige! Du solitaire qui n’attend rien de personne. Tout assis et ses prétendus lauriers ne peut que baiser le sol du ridicule. Debord est resté pour le moins à la hauteur de ce qu’il avait sans cesse rejeté.
Mes rapports avec lui, comme avec Beckett, Marcel Duchamp, Benny Lévy, Dalí, Andy Warhol, Topor, Borgès ou Ionesco, les êtres qui ont influencé le plus secrètement la pensée d’aujourd’hui, ont été inattendus et fortuits. Le hasard a dépassé la causalité quantique. Nous étions collègues de laboratoire, chacun avec ses propres films. Nous avons fini par parler principalement de l’enfer lors de nos rencontres… sans Vénus ? Bien que non accepté, très malheureusement, au café La promenade de Vénus, c’était un grand connaisseur du surréalisme et tout particulièrement d’Arthur Cravan. Il a conceptualisé la notion sociopolitique de «spectacle» dans la société. En janvier 2009, l’État français a décidé de classer toutes ses archives «patrimoine national» par un décret en interdisant la vente. Ce dernier précise que «ces documents revêtent une grande importance pour l’histoire des idées de la seconde moitié du XXe siècle et pour la connaissance d’un de ses derniers grands intellectuels» (Journal officiel de la République française du 12 février 2009.) La Bibliothèque nationale de France a signé l’achat de ses archives en mars 2010.
Un des films qu’il montait s’appelait rien de moins que In girum imus nocte et consumimur igni. Ce qui est le seul titre dans l’histoire du cinéma de dix mots latins, et aussi un palindrome. Comme le titre se lit de gauche à droite, comme de droite à gauche, il prend un rythme «spirale» d’infini, d’abîme. La consommation par le feu évoquait pour lui l’enfer. Lui et moi avions reçu dans notre enfance (il avait sept mois de plus que moi, mais hélas! la même taille) une éducation traditionnelle. Les vainqueurs (dans mon cas) ont essayé de nous enseigner (contrairement à ma première institutrice) à craindre un enfer pharaonique, dément et effrayant.
Après près de trente ans d’oubli ou d’indifférence, soudain nous avons été surpris par un enfer adapté à la modernité. Transformation provoquée par la société du spectacle, puisque nous vivons loin de nous, nous contentant de la représentation. Le spectacle de l’enfer moderne découvre la relation sociale entre les êtres à travers les images qui nous entourent. Notre surprise fut semblable à celle de l’équipage de Sinbad le marin. Comme il se sentait heureux (alors que nous étions malheureux dans notre enfance, menacés par des châtiments terrifiants), profitant de ce verger aquatique, de ces eaux cristallines, de ces plantes fabuleuses, de ces rivières et sources édéniques… Mais combien plus grande fut l’horreur de s’apercevoir que la merveilleuse île n’était que le dos d’un poisson monstrueux. D’un coup de queue, le gigantesque animal plongea dans les abysses.
Chaque enfer imaginé depuis que l’homo erectus a commencé à enterrer ses morts a été un miroir du monde. Ce modèle est apparenté à l’Aralu babylonien, à l’Hadès grec, au Scheol hébreu, au Karta ou au Parsana indien… En Mésopotamie, Gilgamesh, dévoré par la même curiosité que Debord et moi éprouvions dans notre enfance, voulait savoir à quoi ressemblait ce lieu situé dans les entrailles du monde. À la mort de son serviteur Enkidu, il creuse un trou dans la croûte terrestre pour communiquer avec lui. Les damnés, déclare ce serviteur, mangent les miettes des banquets, la lie des coupes, ou les ordures de la rue… mais ceux qui n’ont personne pour s’en occuper dans la vie errent sans repos. Et encore plus significative est la légende qui conte comment, pour visiter l’enfer, la reine du ciel Inana a dû franchir sept portes et à chacune d’elles jeter un voile et un bijou, jusqu’à ce qu’elle soit nue, transparente de corps et d’âme.
En vérité, l’enfer a toujours été un spectacle : ses visites ont été fréquentes dans toutes les cultures et mythologies, et surtout en Grèce. Les dieux étaient à portée de main, sur une montagne voisine, l’Olympe. L’entrée de l’enfer n’était pas non plus très éloignée, car elle se trouvait juste au-delà de l’Océan. Homère, et Hésiode dans la Théogonie, nous montrent un antre dans lequel on entre et sort facilement, et même dont le visiteur peut sauver un condamné. Héraclès sauve Alceste, Dionysos sa mère, et Orphée était sur le point de sauver Eurydice.
À ces enfers, comme celui décrit par l’Énéide de Virgile, a suivi ce qui a été décrété après le quatrième siècle et la sanction promulguée en 543 par le Synode de Constantinople. L’inflation de la torture se reflète dans le message qui, à Debord et moi, nous a été inculqué dans nos jeunes années : pas une goutte d’eau ne peut venir calmer les tourments du feu éternel. Dans la lutte contre les religions indigènes au Pérou colonial, je lis ce dialogue exemplaire :
Prédicateur.- Dis-moi fils, de tous les hommes nés dans ce pays avant l’arrivée des Espagnols… combien ont été sauvés?
Autochtone.- Aucun.
Prédicateur.- Combien d’Incas sont allés en enfer?
Autochtone.- Tous.
Le damné, torturé, connaîtra une éternité de douleur: vivre en dehors du bien. C’est l’enfer total que Valdés Leal a illustré à la fin de sa vie. Pendant mes visites d’enfance au musée du Prado et à l’Escurial, je me suis perdu dans les enfers anticonformistes de Bosch et du Greco. Avec génie, ils semblaient se moquer de cet enfer total. Dans le triptyque Le jardin des délices siterrestre, l’enfer n’est pas à gauche mais à droite. Si les religieuses-truies agacent les pécheurs plutôt qu’elles ne les torturent, les libidineux ne sont punis qu’à tourner presque gaiement autour d’une cornemuse, symbole érotique par excellence. Et ceux qui n’ont pas prié pendant leur vie, comme les canons le commandent, joueront, pour pénitence, éternellement au tremplin sur les cordes d’une gigantesque harpe.
Le Greco, dans son désir d’altérer ou d’inverser les rapports entre les valeurs de la société, peint un enfer… en mer! Une baleine expulse une multitude de Jonas qui semblent plus qu’amusés. À propos de ce tableau si à contre-courant, les spécialistes ne se sont pas mis d’accord pour lui donner un titre. L’adoration du Nom de Jésus, pour Camón Aznar; Rêve de Philippe II, pour Polero; Gloire de Felipe II, pour Cossío, et même Allégorie de la Sainte Alliance ou Gloire d’El Greco. Même la confusion peut inspirer la thèse de Francisco de los Santos, qui assure que l’enfer adore Jésus dans ce tableau.
Le Greco et Jérôme Bosch nous exhortent, en tant que lecteurs de l’œuvre de Debord, à ne pas consommer et utiliser les images en les investissant, jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de distinguer la copie du modèle. L’enfer, dans lequel les damnés étaient consumés éternellement par le feu, est devenu celui de la consommation. Le lieu horrible s’éloignait jusqu’à devenir une série d’images de plus en plus consommables, comme celles de la société du spectacle. À New York, une communauté d’hommes vit aujourd’hui sans quitter les égouts profonds de la ville, se lavant avec l’eau chaude du chauffage public et mangeant les restes déversés par les décharges des cuisines dans les grands hôtels. Cette communauté, dirigée par un empereur, a donné à ses catacombes le nom d’Enfer. On m’a raconté l’histoire d’un homme qui, après y avoir vécu dix ans, s’en est échappé, s’est marié et a eu un fils. Mais père et fils sont revenus, «pour toujours», à l’enfer de toute nostalgie le jour où le jeune homme a eu quinze ans.
Dans Le K (Il colombre), Buzzati a imaginé un journaliste qui, accompagné d’un technicien du métro de la construction de Milan (son Virgile), descend comme Dante dans l’enfer contemporain: quel enfer étrange, ce sont des gens comme nous! Dans Huis clos, un personnage de Sartre dit: je préfère le fouet, l’acide à cette souffrance cérébrale, à ce fantôme de douleur… Et c’est l’enfer? Quelle blague! Sans avoir besoin de chaudières, l’enfer c’est… ce sont les autres!
Debord, face à cette terreur minimaliste, a déclaré : lentement et inévitablement je marche vers une vie d’aventures les yeux ouverts. Heidegger croyait, presque comme Lucrèce, que l’enfer est une angoisse existentielle, le désespoir qui naît par la fusion du moi en nous. Debord a répondu: Aujourd’hui, le spectaculaire est intégré, c’est pourquoi l’homme se réveille effrayé, tâtonnant pour la vie. L’enfer que l’on nous donne en spectacle n’est plus le châtiment éternel: a-t-il disparu?… En lui, une seule détresse est connue: l’absence du regard de Dieu.
Nous avons atteint une douce égalité de disgrâce, dans laquelle le spectaculaire est intégré. L’être est pure apparence et la vérité mensonge. L’enfer est devenu moderne… c’est-à-dire modeste! N’oublions pas que Guy Debord a déclaré: l’homme ne meurt pas, il disparaît… alors que lui est maintenant plus vivant que jamais.