Entre désespoir et révolte, les amis du Kurdistan à Paris, réunis au cinéma Saint-Germain par La Règle du Jeu, S.O.S. Racisme, l’UEJF, l’Institut kurde de Paris et la Fondation Danielle Mitterrand ont dit non, par les voix d’Anne Hidalgo, Manuel Valls, Bernard Kouchner, Kendal Nezan, Caroline Fourest et BHL, au lâche assentiment de la communauté internationale à l’agression de l’Irak, de la Turquie et de l’Iran contre le peuple kurde en quête de son indépendance.
Face à l’écroulement de ce rêve partagé, face au néant actuel de notre engagement, tous ont posé l’éternelle question, au lendemain d’une défaite : que faire ? Se résigner et se bronzer l’âme. Ou croire que l’Histoire n’a jamais dit son dernier mot.
On projeta d’abord La bataille de Mossoul. Les orateurs prirent la parole. Un général des Peshmergas, venu à Paris en déjouant le blocus qui s’est abattu sur le Kurdistan, le général Hajar Aumar Ismail donna en conclusion du meeting la réponse des Kurdes. Le choix était simple. C’est Corneille, dans Horace : «– Que voulez-vous qu’il fît contre trois ? –Qu’il mourût ? Ou qu’un beau désespoir le secourût ?» Et c’est l’appel d’un général inconnu en juin 1940 : «La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la guerre.» Apportée par le général Hajar, la réponse des Kurdes fut franche, nette et massive : les Kurdes vont résister.
Face à la tentation de beaucoup, en Europe, en Amérique, de conclure qu’après cent ans de lutte du peuple kurde, la cause du Kurdistan est une cause perdue, les orateurs du Saint-Germain avaient, à l’avance, passionnément défendu la grandeur du rêve kurde et le soutien des Français.
Cela fait un siècle que les Kurdes n’ont pas abandonné leur an prochain. S’y résoudre aujourd’hui, après avoir frôlé la réalisation d’un rêve, au point peut-être de ne pas pouvoir s’en relever ? Rendre les armes, aller à Canossa ?
Trahis par certains en leur sein, abandonnés de tous leurs amis d’hier, en Occident et ailleurs, qui les louaient tellement quand les peshmergas étaient en première ligne contre Daech, croit-on, demandait Anne Hidalgo, que les Kurdes vont se plier à un destin si funeste ? Redevenir des «Irakiens», ce fantôme de nation «fédérale» qui viole continûment sa propre Constitution, cette chimère sanglante, comme le démontrait Kendal ? Rentrer dans l’ombre, retourner dans les montagnes dont nul, jamais, n’a pu les chasser, comme l’évoquait Kouchner qui fut médecin dans les maquis kurdes ? L’heure est-elle encore à la politique, pour tenter de sauver ce qui peut l’être, dans l’espoir, un jour, de rebondir ? Manuel Valls s’en faisait l’écho. Va-t-il, ce peuple fier, qui rêvait de prospérité et de modernité, qui vivait déjà à l’heure de la mondialisation, qui en avait assez, comme le rappelait Bernard Henri Lévy, de devoir tenir chaque jour un fusil dans la main contre d’éternels ennemis et les croyait enfin assagis, acceptant même son existence, va-t-il, face au péril où il est d’être dilué dans une nouvelle arabisation comme du temps de Saddam Hussein, va-t-il retrouver sa flamme de vie et d’indifférence à la mort (c’est le sens même de Peshmerga) pour prix de sa liberté ? Va-t-on, martelaient tous les orateurs, absurdement ouvrir un boulevard aux Iraniens, les vrais maîtres de l’Irak, qui ont, milices chiites et pasdarans à l’appui, arraché Kirkouk, le poumon du Kurdistan que les Kurdes sauvèrent par deux fois, quand l’armée irakienne, après la chute de Mossoul, se débandait, puis face à Daech, comme Lévy le donna à voir dans La Bataille de Mossoul, et le rappelait à tous ceux qui mettent en doute aujourd’hui que Kirkouk soit kurde.
En fin de réunion, Bernard-Henri Lévy, au nom des orateurs, lut un texte intitulé L’Appel de Paris pour le Kurdistan. Ce texte dit en substance ceci. Nous avons, nous Français, héritiers de Voltaire, de Gambetta, Zola, Dreyfus, Jean Moulin, un peuple près de nous, qui s’est inspiré de nous et que nous aimons. Sa flamme fut la nôtre, dans notre Histoire. Ne laissons pas s’éteindre la flamme du Kurdistan.


















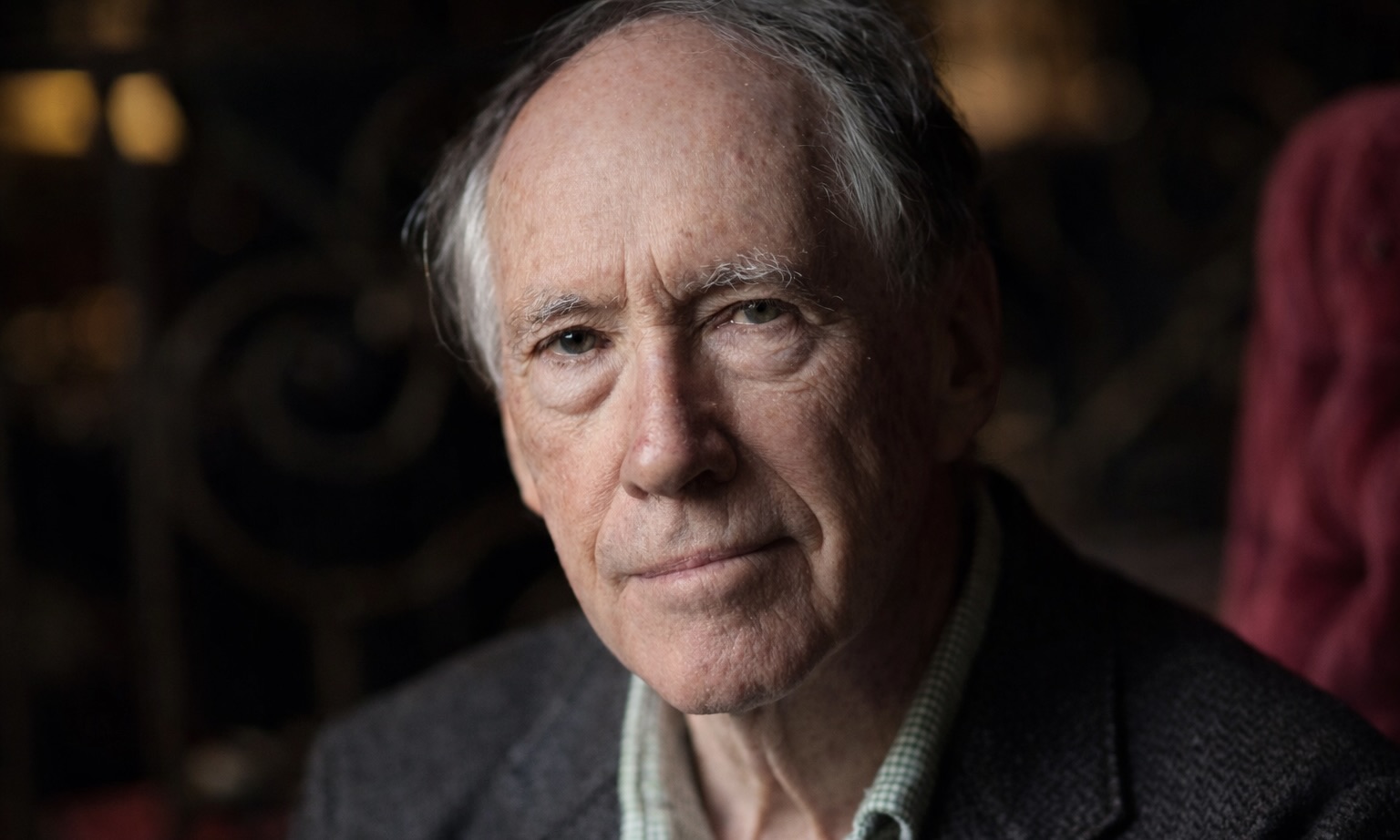


Nous nous sommes fait piéger par notre bouclier. Jamais plus un État de charité n’aurait maille à partir avec un État de cruauté. Anges et démons agenouillés devant l’autel d’une même fantaisie érotique. Le pied, quoi! Le pied, oui… à condition d’oublier qu’aucune nation ne s’est bâtie dans le respect du droit international. Que respecter l’intégrité territoriale des unes, c’est toujours mépriser celle des autres, j’entends par là l’atlas qu’on aura dû désintégrer dans l’optique d’une plus ou moins heureuse unification. Notre paradigme est contre-nature. Si jamais il venait à ne plus être malmené, le droit des nations à disposer de leur corps figerait les équilibres géostratégiques dans l’état actuel où ils nous trouvent et nous perdent jusqu’à la dernière seconde du compte à rebours stoïcien. Il accorderait, en l’espèce, un avantage démographique des plus déloyaux à la Chine ou aux États-Unis, infligeant du même coup un handicap qu’elles n’ont pas toujours connu à la France, à l’Angleterre, mais aussi à la Turquie ou à l’Iran qui, pour leur part, ne se sont pas résignés à bâillonner leur glatissement. Trois ans déjà que nous nous obstinons à refuser la légitimité qu’il s’est octroyée à Daech, acronyme de l’État islamique d’Irak et du Levant. Trois ans à ne pas nommer le calife de Mossoul, puis de Raqqa, préférant lutter contre le groupe État islamique et son ombre de chef, le narcotrafiquant Abou Bakr al-Baghdadi, superstar du grand-banditisme traquée par Interpol. Le nœud de vipères dans lequel nous nous sommes étranglés vise à empêcher l’hémorragie tribale. Reconnaître aux guérillas le statut de guerres à part entière, c’est mettre le pied dans un obscur recoin du droit jouxtant sa pierre de soutènement. Ici, le moindre étirement ferait vaciller la métatour postbabélienne. Dommage. La nature bitotalitaire du choc décivilisateur psalmodiait dans son aile l’augure paradoxal d’une réponse imminente à l’antiquestion kurde. Le fait que les deux pôles fussent parvenus à mettre sur la touche les vainqueurs des deux précédents conflits mondiaux rendait cet avènement d’autant plus imparable. Nous le subodorâmes, et ça, personne ne nous le reprendra. Mais son parfum de justice émanait d’une région ultra-tombale où l’unité artificielle des nations est dépourvue de toute emprise sur le jet d’océan humain au moment où elle l’aperçoit, à cheval sur les horizons, affleurer le réel. Ce qui n’avait, en l’occurrence, rien d’irréel, c’est la conquête d’une partie de l’Irak et de la Syrie par ces Contrebrigades internationales venues se placer sous la férule du Grand Recruteur. Autre occurrence sur notre échelle de probabilité, celle qu’un pays, asseyant sa domination barbare au cours de la nuit de noces de l’âge de pierre et de l’ère postindustrielle, soit sommé, à son tour, de ployer sous le joug d’un métèque, lequel envahisseur, ici le peuple kurde soutenu par une coalition ayant choisi son camp, achèverait de se libérer par une levée de drapeau pour le moins déchanteresse. Sans aller jusqu’à mettre en cause les principes onusiens, la juste appréciation de l’avirtualité de l’État islamique d’Irak et du Levant lors de son incontestable fondation nous aurait libérés du devoir de restituer à deux États-nations les zones de survol dans lesquelles une présence occidorientale avait été dépêchée en raison du fait qu’un groupe terroriste de renom y avait violé le sacro-saint principe de souveraineté des États. Reste la carte de la décolonisation. Forcer les crypto-empires babyloniens, perses et ottomans à rendre au Kurdistan ses libertés individuelles et collectives doublées d’un accès illimité à la forge des destins. Avançant le risque de balkanisation généralisée, l’on suspendra, au-dessus du globe catatonique, le sabre catalan. Mais qu’est-ce que vivre, sinon en prendre le risque? La vie, un état primordial aux abords duquel le sillonneur des causes finales aurait tendance à se débiner, à désailer le vaisseau des concepts. La logique aurait voulu que les courants philosophiques ayant accouché des droits de l’homme soient déclarés vainqueurs, le 8 mai quarante-cinq. Unfortunately, Gavroche n’eut d’autre choix que celui de la compromission avec le titan stalinien pour venir à bout de son jumeau nazi. La déclaration universelle des droits de l’homme s’est ainsi tuée dans l’œuf, — Yalta l’avait prédestinée à constituer une gigantesque farce quand deux régimes parmi les plus liberticides de l’après-guerre débouleraient sur le monde en qualité de membres permanents d’un Conseil de sécurité pourtant censé protéger les nations contre la fin de la période d’hibernation fasciste. Celle-ci, la déclaration sus-nommée, n’en demeure pas moins le ciment unioniste auquel se raccroche la communauté internationale sitôt qu’elle sent clocher quelque chose en une indiscernable région de son corps démantibulé. Les droits de l’homme n’ont jamais été moins obsolètes qu’à l’heure où nous nous heurtons au risque de frôlement des inhumanités et de leurs propres fondamentaux. La question des persécutions du peuple juif ne fut pas pour rien dans la création de l’État d’Israël. Celle des persécutions du peuple kurde nous obligera, un jour ou l’autre, à une résolution du même type. Plus vite qu’on ne le pense si l’on en croit l’héroïne de Margaret Mitchell : le futur proche combinerait les deux principes d’évolution et de révolution.