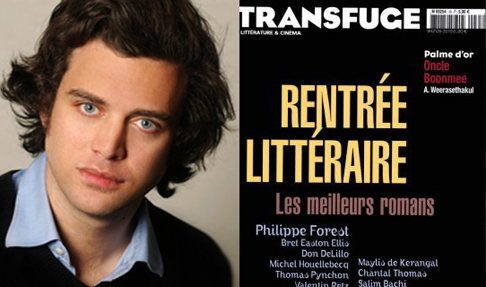La première personne que j’ai rencontrée sur la terre était un Champenois. Je ne l’identifiais pas sur-le-champ comme tel. C’était un homme aux cheveux roux, coupés en brosse, avec des yeux de porcelaine et un visage de buveur d’eau. Un air de grande bonté régnait sur tous ses traits et éclairait son regard, encore juvénile, malgré ses trente-quatre ans. Sa peau était très blanche, et striée sur toute la longueur du front de rides profondes, cicatrices parallèles nées d’une mélancolie dont je soupçonnais qu’elle n’était pas native. Cet homme répondait au prénom de Martial, qui lui allait fort mal, avec sa façon de ne jamais élever la voix, ses gestes paisibles et cet apprêt de douceur qu’il portait sur toute sa personne. Je ne trouvais pourtant chez lui ni faiblesse ni mièvrerie, rien de féminin. Il regardait en face, les sourcils, rouges, savaient se hérisser, et un geste, parfois, trahissait quelque souterraine impatience. Il fumait comme un sapeur et ne quittait pas son paquet de gauloises. L’index et le majeur de sa main droite étaient vernis de nicotine. Je remarquais des traces de craie sur tous ses doigts. Ce n’était pas une craie humide comme celle qui maculait parfois les bourgerons des vignerons remontant de leur cave, mais une poussière sèche et blanche de tableau noir. Il quitta la salle où je me trouvais et rejoignit quelques-uns de ses amis dans une pièce voisine. Ils l’accueillirent avec des cris de joie. Je les entendis proposer de lui livrer un demi-muid de vin pour arroser l’événement. Ce Champenois s’appelait Martial-Léon Rondeau, instituteur au Mesnil-sur-Oger. C’était mon père.
Je crois qu’il y avait peu de secrets dans la vie de mon père. Son âme était claire ; il consacrait ses journées à son travail, à ses élèves. Son ambition était de vivre d’honnête façon, là où il était sans rien envier. Je me suis aperçu, après sa mort, que je ne savais presque rien de sa jeunesse. Il n’en parlait jamais. Mon frère et moi lui posâmes peu de questions, auxquelles il répondit du bout des lèvres. Et nous n’avions jamais le temps d’insister. Ses parents, ses grands-parents et tous ses aïeux avaient toujours vécu dans la nuit des humbles. Mon père avait grandi dans cette obscurité. Il en garda jusqu’à son dernier souffle le don d’humilité. Une lumière trop crue l’éblouissait. Il appartenait à une famille de manouvriers établis dans des hameaux en lisière d’une épaisse forêt, seulement percée par des étangs aux eaux noires, à l’ouest de Sézanne, la forêt du Gault. Ces hommes de la glèbe ne changeaient guère de ciel. Leur vue était limitée. Ils vivaient entre les bois et leurs maisons. L’hiver, houspillant les chevaux, ils débardaient du bois et menaient des fardiers de grumes par des chemins détrempés. L’été, ils travaillaient en meute dans la fournaise des moissons. Le vin était souvent leur seul repos. Ceux qui fuyaient, Paris n’était qu’à une centaine de kilomètres, ne revenaient jamais et ne donnaient jamais de leurs nouvelles. Pourquoi parler de soi ? Ces familles étiques laissèrent peu de traces de leur passage sur la terre, ni or, ni bien, ni papiers, ni souvenirs. C’est comme s’ils n’avaient jamais existé. Même les noms sur leurs tombes ne restaient pas longtemps gravés. La guerre, en août l4, avait brusquement élargi leur horizon. Un certain nombre d’entre eux sont allés mourir ailleurs.
Le père de mon père quitta Neuvy pour rejoindre le 69e bataillon de chasseurs à pied. Je doute qu’il soit parti sous une pluie de fleurs. Mais il était décidé à se battre, et à défendre la patrie. Blessé dès le 7 septembre, à Marcilly, il est évacué. Quelques semaines plus tard, guéri, il retournait au front. Pendant quatre ans, il fera tout le chemin des croix de bois : les Éparges, la Somme, l’Aisne, Verdun. En 1919, après un détour par l’Allemagne occupée, il revient dans son village. Quelques brillantes citations ornent son livret militaire. Il porte la croix de guerre épinglée sur la poitrine, et ses poumons sont en charpie. Gazé à l’ypérite dans les derniers mois des combats, il ne retrouvera pas un souffle régulier. En attendant d’être emporté par un étouffement, à cinquante-quatre ans, il se remet au travail. Il ne dispose plus que de forces chétives et se loue à des cultivateurs, une semaine dans une ferme, la suivante dans une autre, régulièrement terrassé par des crises qui l’asphyxient. Mais attention : pas de plainte. Au contraire, il reste gai, empêché de remâcher ses misères par un caractère taquin qui le pousse souvent à plaisanter avec ses deux fils. Mon père vénérait ses parents, peut-être parce qu’il les admirait d’être restés bons et justes dans un monde qui ne l’était guère.
Martial, l’aîné aux cheveux rouges, va à l’école en sabots. Il fête ses dix ans en 1924. Cette année-là voyait le triomphe du cartel des gauches. Millerand était contraint à la démission, Edouard Herriot formait un gouvernement radical. André Breton publiait le Manifeste du surréalisme. Gide écrivait les Faux-Monnayeurs. Paul Morand se préparait à emménager rue de Suffren, dans un grand atelier au sommet d’un immeuble, sous le ciel : « De mon lit, je vois la tour Eiffel, écrivait-il à son ami Valéry Larbaud. Quand il y a une femme dans mon lit, hier après-midi, c’était dimanche (…), je lui donne des jumelles et elle regarde descendre par les escaliers à claire-voie… ». Mais à Neuvy, le progrès piétinait. Le siècle précédent s’attardait dans l’après-guerre. Le monde vu par la fenêtre de la petite maison des parents de l’écolier ressemble plus à celui de Victor Hugo qu’à la planète moderne, mécanique, publicitaire et galante de Paul Morand. Émile et Madeleine Jugnot, ses instituteurs, se prennent d’affection pour ce garçon têtu qui les surprend chaque jour par son esprit de retenue, sa sincérité, son goût pour les livres. Peut-être se souviennent-ils des Misérables : « Cet enfant du bourbier est aussi un enfant de l’idéal ». Ils le gardent dans leur école après son certificat d’études. L’enfant grandit au fond d’une classe, où les Jugnot lui ont fait une place qui n’est qu’à lui. Il travaille seul toute la journée. Le soir, Émile Jugnot lui donne des cours particuliers, il lui enseigne le violon, et Madeleine, sa femme, se transforme en professeur d’allemand. Trois ans plus tard, ils le présentent avec succès au concours d’entrée à l’École normale d’instituteurs de Châlons-sur-Marne.
L’École normale l’avait dégrossi, mais pas changé. Il avait appris la camaraderie, la vie en dortoirs, les cours en amphi. Il avait couru le cent mètres, l’une de ses grandes joies, mais il était resté ce jeune homme un peu sauvage, économe de ses paroles, aux gestes parfois ombrageux. Tous ses labadens se souviennent de l’agitation épisodique de son sommeil. Il se dressait dans son lit, tout endormi, et faisait des moulinets dans la nuit avec ses poings. Ses camarades faisaient un cercle autour de lui et assistaient en silence à cet étrange combat. Mon père se battait avec des ombres, ou contre lui-même jusqu’au moment, où, soudain, sans que personne ne sache s’il était vainqueur ou vaincu, il se recouchait sans avoir jamais pris conscience de ses gestes de boxeur. C’était un autre homme qui se levait le lendemain avec un visage aimable, et tout à fait oublieux de ces rixes nocturnes. Toujours courtois, mesuré, il n’élevait jamais la voix. Aucun juron ne sortait de sa bouche. Il détestait la bamboche, les jouisseurs, les grands gestes, le laisser-aller, et pratiquait un humour flegmatique qui surprenait ceux qui ne le connaissaient pas. C’était un passionné froid, idéaliste, animé par un petit esprit de contradiction, (je me méfie toujours des généralisations sur les caractères ethniques, je crois pourtant que cet esprit de contradiction appartient en propre à la race champenoise), un rêveur. Sans doute passa-t-il quelques soirées au Café des Oiseaux, sur le quai du Nau, devant un verre d’eau, à rebâtir le monde avec l’illusion de participer à je ne sais quelle autre vie, plus bohème, dont il avait entrevu les lumières désordonnées, admirables et confuses où des statues échevelées s’affrontaient dans des tournois de poésie.
Il n’a pas vingt ans quand il prend son premier poste d’instituteur à Châtillon-sur-Marne, village au sol pierreux éloigné seulement de quelques kilomètres de sa maison natale. Il regarde ses mains, elles sont blanches. Il regarde les premiers brouillards de septembre se former dans la vallée du Petit-Morin. Des floches de brumes montent à l’assaut des prés du bord de l’eau. La campagne n’est plus cette terre nourricière et ennemie à qui il faut arracher sa pitance mais un décor aimable avec lequel il souhaite s’accorder. Il se sent léger, libre. Il regarde l’avenir, et il se voit, en blouse grise, pour toujours, heureux de démêler pour des jeunes âmes les mystères des mots, des nombres, de la grammaire et de l’histoire.
Il travaille du matin au soir, préparant « sa classe » comme s’il rédigeait une leçon inaugurale pour le Collège de France. Quand il prend du repos, c’est pour s’essayer à l’aquarelle ou à l’archéologie. Le pacifisme avait mordu sans peine sur les élèves-maîtres des Écoles normales. Personne n’était pressé de renouer avec la tourmente et l’horreur. On a souvent dit que les instituteurs, ces « hussards noirs de la République » avaient gagné la Première Guerre. Ils participèrent à la défaite générale de la pensée qui amena Munich et le naufrage de 40. Mon père, paisible par nature, fut sensible à la propagande antimilitariste qui n’avait pas cessé avec la fin de la guerre du Rif ; il refusa de préparer les E.O.R. Affecté au Ier régiment de tirailleurs algériens en octobre 35, il accomplit ses deux années de service militaire à Blida, sans jamais rentrer chez lui, trop pauvre pour s’offrir l’aller et retour d’une permission. M’a-t-il jamais parlé de cet exil algérien ? Très peu. Il n’évoqua devant moi que de bons souvenirs, le parfum des fleurs d’orangers dans les rues de Blida ou de Médéa, l’amitié de son capitaine, un cavalier, qui le mit à cheval pour le distraire d’un soleil qu’il trouvait lourd et monotone.
ll m’a souvent raconté, en revanche, comment il pleura de rage au matin du 21 juin 1940, sinistre été, quand il dut se rendre aux Allemands sans combattre. Il avait passé la nuit avec une section à l’entrée du village de Laleuf, en Meurthe-et-Moselle, à côté d’une mitrailleuse. Chacun savait que les Allemands n’étaient plus loin, et tous les hommes apostés sur cette route de campagne étaient décidés à résister. La nuit fut longue, mais calme. À sept heures du matin, les soldats de cette petite garde furent relevés et retournèrent au village, où leurs compagnons dormaient encore dans la paille des granges. Mon père était en train de se laver à la fontaine d’un abreuvoir quand une colonne d’engins blindés allemands, venue par une autre route vide de toute sentinelle, prit en quelques instants possession de la place où il se trouvait: « Les mains en l’air, et vite ! » Torse nu, avec du savon à barbe sur les joues et un vieux coupe-chou à la main, mon père n’eut qu’à s’exécuter. Tout le cantonnement de Laleuf tomba aux mains de l’ennemi sans tirer un seul coup de feu. Mon père resta longtemps humilié par cette « petite aventure personnelle de soldat », comme l’écrit Marc Bloch dans son témoignage sur « l’étrange défaite ». La France de 40 garda toujours pour lui la triste figure de ces hommes endormis ou presque nus livrés par l’imprévoyance nationale, coupable depuis longtemps d’avoir cédé aux prodiges de la force.
Après quelques péripéties, mon père et ses compagnons furent emmenés en wagon à bestiaux vers les Stalag IX A et IX B de Dalherda et de Grossheim, où ils passèrent quelques années de leur jeunesse. Mon père trouva en captivité ses meilleurs amis : le boulanger et des vignerons du Mesnil-sur-Oger, un professeur d’histoire de Bordeaux, un peintre de Saint-Étienne, et d’autres encore, que j’oublie. Ils mirent en commun leur accablement et leur espérance. Leur petit cercle formait une vraie fraternité. Seule la mort la rompit. Ils résistaient comme ils pouvaient. Un peu de sabotage, des chahuts d’étudiants, des farces toutes dirigées contre leurs geôliers. Ils écoutaient Radio-Londres et Radio-Alger et faisaient circuler l’information dans l’ensemble du camp avec la complicité d’un soldat allemand, Karl Kihn. Je crois avoir compris, mais je peux me tromper, que mon père était le juste de cette fine équipe. Chacun avait sa place, sa fonction, ses qualités. Tout était jeté dans le pot commun. Le meilleur de chacun servait à tous. Mon père, qui n’était pas un boute-en-train, trente ans après, riait encore aux larmes des pitreries de René Launois, ce vigneron à l’esprit pétillant qui fut son frère de stalag.
En 1960, pendant l’été, mes parents nous emmenèrent, mon frère et moi, passer dix jours de vacances dans les montagnes du Rhön, à Dalherda, ce village qui tenait une si grande importance dans les conversations des déjeuners dominicaux du Mesnil-sur-Oger. Mon père loua deux chambres dans une auberge rustique, à la façade couverte de lambrequins, avec des géraniums à toutes les fenêtres. Le lendemain de notre arrivée, il nous montra, le long d’un sentier qui taillait à travers une forêt de sapins, des baraques de planches noires. Il s’arrêta et dit simplement : « C’était là ». Nous nous promenâmes sur les routes où il avait trimé, comme prisonnier-terrassier, en admirant l’immensité du ciel et la sauvagerie de ce vieux massif. À notre retour d’Allemagne, René Launois me raconta que mon père, un matin d’hiver 1943, avait jeté sa pioche sur le sol gelé et s’était mis à hurler : « Les Allemands nous prennent tout ! tout ! mais ces salopards ne m’empêcheront jamais de profiter de cela ! », et sans cesser de crier, il jetait ses deux bras tendus vers le ciel et les vallées avoisinantes, comme s’il avait voulu étreindre toute la beauté de cette campagne pétrifiée par la neige. Il avait fallu l’énergie de plusieurs de ses amis pour le ramener à la raison et éviter un incident.
Les prisonniers de Dalherda dormaient peu et s’inventaient, aux heures creuses de la nuit, de longs moments de liberté, sans sortir de leur baraquement. Certaines chambrées faisaient tourner les tables, d’autres répétaient des pièces de théâtre ou des numéros de music-hall. Mon père lisait beaucoup. Il s’était procuré, sans doute par l’intermédiaire de Karl Kihn, un cahier de moleskine bleue où il consignait ses impressions de lectures. Ma mère me l’a prêté dimanche dernier, quand nous sommes allés à Congy pour les Rameaux. Je découvre mon père s’enthousiasmant pour l’essai de Giono sur Melville et trouvant dans Baudelaire une définition de la beauté dont il souligne qu’elle lui convient: « … la Mélancolie est pour ainsi dire l’illustre compagne (de la Beauté), à ce point que je ne conçois guère (…) un type de beauté où il n’y ait du malheur ». Puis je suis mon père jour après jour dans ses lectures. Il dévore Épaves de Julien Green, où il trouve « le premier et lointain appel de la mort », se lasse des Montparnos de Georges Michel, expédié d’un laconique : « pas fameux ! », se montre déçu par Roux le Bandit, d’André Chamson, « l’auteur n’arrivant jamais à s’élever à la hauteur de son sujet ». Ce recueil de notes est clos par quelques pages, toutes rédigées au crayon de mine, d’une écriture ferme, où mon père s’interroge sur l’époque et sur lui-même : « Le monde d’entre les deux guerres en France était complètement détraqué et je suis un bon échantillon de cette époque. Beaucoup d’aspirations, mais sans continuité. J’aurais aimé pouvoir écrire ou peindre. Il me semble que j’ai parfois des idées originales… mais je sais maintenant que je suis incapable d’écrire sous une forme originale… Comme les personnages de Green, je suis perdu dans le monde réel… La mort, que je n’ose pas souhaiter, (manque de courage), serait pourtant mon unique chance de délivrance… ».
Une nuit de décembre 1941, trois jours avant Noël, endormi sur sa paillasse, mon père rêva de la mort de son propre père. Le lendemain, il se réveilla avec une tristesse confuse, qui mit quelques jours à se dissiper, sans jamais disparaître tout à fait. Trois semaines plus tard, le courrier destiné aux Kriegsgefangenen n’était pas très rapide, le vaguemestre lui tendait une lettre l’avertissant que son père était décédé dans la nuit du 22 au 23 du mois précédent. Il mit la lettre dans sa poche et broya du noir, mais refusa de se laisser aller au découragement. Il ne fallait pas avoir l’air de céder aux Allemands.
Dans le courant de l’année 1944, les événements se précipitèrent au Stalag lX B. Karl Kihn, le geôlier antinazi, avertit ses amis français que les autorités du camp avaient pris ombrage du mauvais esprit qui régnait dans certains baraquements. Quelques mouchards avaient été chargés de surveiller leurs camarades, déjà avertis, toujours par Karl Kihn, qu’un petit groupe de meneurs risquait d’être transféré dans un camp de concentration. Quelques-uns tentèrent la belle. René Launois avala de fortes doses de poudre d’acide picrique. Il fut renvoyé dans ses foyers quelques semaines plus tard, jaune et convulsionnaire. Mon père choisit de simuler la folie, peut-être parce qu’il se sentait devenir maniaco-dépressif. La vie au stalag ne lui donnait guère d’occasions de rompre avec sa nature, peu loquace et modérément expansive. Il se tut tout à fait. Muré dans une mélancolie ombrageuse, il n’obéissait plus ni à rien ni à personne, se moquant de tout, des ordres comme des menaces, mangeant à peine, indifférent à son propre sort, et ne descellant les lèvres qu’en présence d’amis sûrs. Transféré à l’infirmerie, il fut soigné par un médecin compréhensif qui se dépêcha de l’expédier, en wagon grillagé, au Val-de-Grace, à Paris, où mon père eut le plus grand mal à prouver sa bonne santé mentale. Après quelques entretiens dignes de figurer dans un répertoire de l’absurde, le médecin-commandant Canot envoya mon père en convalescence à Lhermitte, pour deux mois.
C’est un homme de trente ans qui rentre chez lui. Il souhaite travailler et réclame un poste. On lui confie l’école de Vauchamps, un village de la plaine champenoise où triompha Napoléon pendant la campagne de France. Champaubert, Montmirail, Vauchamps. En « trois coups de hache », (Louis Madelin), alors que Blücher avait déjà écrit à sa femme qu’il espérait être dans les huit jours sous les murs de la capitale, l’empereur avait rétabli la situation. À Vauchamps, la division prussienne avait été en partie capturée : deux mille prisonniers sur trois mille hommes, les canons et les drapeaux restant au soir de la bataille aux mains des Français.
Tous ces villages, d’Étoges à Montmirail, vivaient en ce début d’année 1944 dans un calme précaire. La croix gammée flottait dans les cours des châteaux réquisitionnés par la Kommandantur. Les réfractaires au S.T.O. se cachaient dans les fermes. Le vent tournait. La Résistance commençait à trouver ses partisans. Mon père prit très vite quelques contacts. Il eut à peine le temps de voir passer le printemps. Le 27 août, son frère, employé des chemins de fer, le prévient par téléphone que les Américains ont été signalés à Villenauxe dans les premières heures de la matinée. Mon père a consigné ses impressions de la Libération dans son cahier bleu, rapporté d’Allemagne :
« 27 août. Passe temps du bombardement et des mitraillages du bois de Beaumont. À Vauchamps, trouvé la grande débandande. Deux à trois colonnes sur la route. Une auto-mitrailleuse en position… Neuf heures du soir, cinq ou six chars, et puis plus rien. Une grande explosion, puis le calme.
28 août. Américains annoncés à Chilly et Beaumont. Suis allé les voir, brassard au bras. Midi : parti avec Brocliot à Montmirail dans l’enthousiasme. Rentré le soir avec camion américain, écoeuré ; désorganisation, manque d’armes, etc. Tout de même, une grande joie au cœur : le cauchemar allemand est terminé… ».
C’est la paix. Mon père se frotte les mains : « À nous deux, la vie ». Il rencontre ma mère, Antoinette-Emma Collin, fille de Georges-Charles-Henri Collin et d’Héloïse-Valentine Collard, un couple de vignerons de Congy. Il l’embrasse le 28 décembre (premier baiser attesté par une ligne du cahier bleu), et l’épouse le 3 mars 1945, à Vauchamps.
Entre-temps, « jusqu’au premier mars, nombreuses randonnées, en vélo, par la neige, à Congy, Lhermitte, Sézanne, et de Vauchamps à Bergères, (n’oublions pas les chutes) ». Le 1er octobre 1945, Martial et Antoinette Rondeau entrent dans leur école du Mesnil.
Rendue à la liberté, assise sur un métier, « faire l’école », qui était plus qu’un métier, un sacerdoce, fortifiée par une certaine idée de l’amour conjugal, la vie de mon père, dès lors, eut la simplicité et les couleurs d’un vitrail.
ll enseigna au Mesnil-sur-Orge, puis à Châlons-sur-Marne. Il portait toujours un costume et une cravate ; il fumait des gauloises sans filtre dans un fume-cigarette. Il était obsédé d’honnêteté et heureux de son état.
ll lisait peu, de moins en moins, mais vénérait l’écriture. Il m’a fait lire Giono, Gracq, Dhôtel, Stendhal. J’ai lu aussi, sans sa permission, tous les livres de sa bibliothèque, dont certains de belle facture, parmi lesquels des classiques de l’érotisme, avec des bois gravés, publiés par Roissard à Grenoble, à l’enseigne du Cercle des professeurs bibliophiles de France.
Sa conscience professionnelle lui interdisait d’exhiber devant ses élèves ses opinions philosophiques ou politiques. Il ne se départissait pas de cette discrétion devant ses propres enfants. J’ai cherché plus d’une fois à le provoquer ; en vain.
Ce dévot de l’école laïque n’était pas sans religion. Il se défiait des pharisiens et ne fréquentait pas l’église en dehors des grandes fêtes carillonnées. Mais il portait en permanence un vieux chapelet au fond de sa poche et allait avec ma mère prier secrètement Notre-Dame-de-l’Épine à chaque fois qu’il avait besoin d’Elle.
Cette figure ordinaire en son temps, d’instituteur républicain, figure tempérante, réservée, toute entière vouée à la transmission d’un bagage de base, morale et connaissance, resta jusqu’au bout celle d’un homme simple, qui rayonnait par son unité, seulement compliquée par des à-coups de cafard, toujours cachés, mais dont témoignait sur un front têtu le cryptogramme des rides.
ll avait toujours dit qu’il mourrait jeune, à l’âge où était mort son père, cinquante-deux ans ; il s’était trompé, même s’il ne vécut pas vieux. Les trois dernières personnes qu’il vit avant de quitter la terre, à soixante et onze ans, étaient des Champenois : ma mère, mon frère et moi. Malade depuis plusieurs mois, les poumons, et la tête, étaient touchés, il ne sortait plus guère de sa maison de Congy. Il avait des hauts et des bas, des pertes de mémoire, des regains d’espérance, des moments d’égarement. Il tournait en rond. Il rétrécissait à vue d’oeil. Sa conscience allait et venait. Son retour était toujours un moment affreux. Elle le prenait de plein fouet et il se découvrait, déclinant et perdu dans le désert de l’absence, solitaire dans un monde qui continuait de tourner, dégradé par la maladie, retourné aux confins de l’enfance. Et il pleurait.
Le dimanche 8 mars 1987, nous nous retrouvâmes, chez lui, mon frère et moi, sans vraie concertation. Avions-nous eu un pressentiment ou profita-t-il de notre présence ?
Fatigué, il resta couché toute la matinée, un peu prostré. Il voulait qu’on lui tienne la main. Vers midi, il se redressa dans son lit en cherchant du regard la photo de son père : « Où est papa ? », ma mère lui montra le vieux cadre, mais il demanda, d’une voix très inquiète : « Mais je ne vois pas maman ! ». Ma mère lui montra encore une autre photo, à côté de la précédente. Il sembla très rassuré et tomba dans un demi-sommeil. Il se réveilla en râlant. Ma mère était assise a côté de lui sur le lit, mon frère, debout, lui faisait face. J’étais assis à sa gauche. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il rejeta les draps, pourtant légers, qui le gênaient, et s’étira en travers du lit. Il ne cessait d’agiter ses jambes comme pour se débarrasser de forces invisibles et pesantes. Il semblait engagé dans un combat contre un titan. Il s’arrêta soudain, nous regarda d’un air désolé, et dit dans un pauvre sourire : « C’est plus difficile que de monter la tour Eiffel », puis se laissa tomber sur le flanc droit. Un long soupir sortait de sa bouche de façon très régulière, toutes les trois minutes environ. À chaque fois, c’était un peu de sa vie qui l’abandonnait. Il était accroché aux mains de notre mère, qu’il ne quittait pas du regard. Je pense qu’il ne pouvait plus parler. Tout à coup, ses lèvres enflèrent et devinrent violettes, puis blanches. Il avait jeté ses dernières forces dans ce tête-à-tête avec ma mère, maintenu par le regard, conscient, lucide et tendre. Désespéré. Il lui faisait ses adieux. Puis sa tête retomba sur l’oreiller. Et il expira.