Michel Goldberg, qui enseigne dans cette fac, se retrouve ostracisé après avoir dénoncé l’antisémitisme manifeste d’une pièce de théâtre créée par des étudiants.
En avril dernier, une poignée d’étudiants de l’Université de La Rochelle se lance, dans le cadre d’un atelier théâtral, dans l’écriture d’une pièce qui prétend dénoncer sur un mode humoristique les dérives de la finance mondiale. Ils sont encadrés par un obscur dramaturge, censé garantir la qualité du travail. La pièce est donnée à plusieurs reprises, interprétée par une vingtaine d’étudiants et mise en scène par une dame qui passe localement pour une grande professionnelle. L’un des enseignants de la fac, Michel Goldberg, est invité à la première par quatre de ses étudiants qui font partie de la troupe. Et que découvre-t-il ? Un ramassis de poncifs antisémites dignes de la pire propagande d’extrême droite, façon années 30-40 : on voit, entre autres, d’abjects et odieux financiers juifs (qui portent justement le nom de… Goldberg – sont-ils taquins, ces étudiants !) prêts à tout pour s’enrichir, surtout sur le dos des enfants à naître ; et encore un sordide juif religieux acceptant de renoncer à sa traque d’un (pauvre vieux) nazi en échange d’une liasse de billets…
Michel Goldberg s’est évidemment offusqué et a alerté le président de l’université. Lequel a jugé certains passages certes un peu déplaisants, mais a très mal pris que l’enseignant y voie de l’antisémitisme. Celui-ci s’est finalement résolu à alerter le Figaro. Mal lui en a pris, d’autant que plusieurs articles dans d’autres journaux ont suivi : il s’est retrouvé en butte aux reproches de salir la réputation de la fac, des étudiants, des «professionnels» ayant collaboré à la création de la pièce… Quand même, quelle insupportable obsession chez ces Juifs de voir de l’antisémitisme partout ! Et la liberté de création, hein, M. Goldberg, qu’en faîtes-vous ? Décidément, ce professeur serait même capable de trouver Dieudonné antisémite. Pas comme tous ces braves étudiants ou ces bons collègues qui ne voient pas trace d’antisémitisme même quand ça hurle de la manière la plus immonde.
Une médiatrice a été finalement dépêchée mercredi 3 juillet par le ministère de l’Enseignement supérieur ; elle a réuni les huiles de l’Université de La Rochelle et Michel Goldberg, appliquant en toute innocence le principe du débat contradictoire bien connu «Cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les Juifs». Comme du côté des responsables personne n’a admis que la pièce relève du pur et simple antisémitisme, et comme le déclencheur d’alerte que se trouve être Michel Goldberg subit une véritable ostracisation, une campagne en sa faveur a été lancée. Première étape sur Facebook :




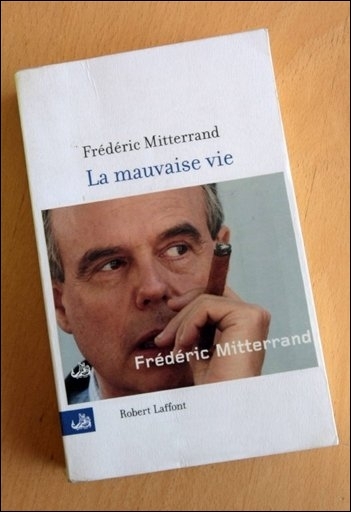


[…] de rapacité et de veulerie le nom même de l’un des enseignants de l’université : Goldberg. La Règle du Jeu s’était fait l’écho de cette sinistre affaire. Les animateurs de l’initiative à prétention théâtrale étaient un auteur canadien, Eric […]
Si je décidais, comme ça, rien que ça, d’écrire L’Avare, je ne serais pas contraint d’y introduire le Don Juan autoconsumériste aux basques duquel j’irais coller l’Alceste savonarolesque, mort de trouille à l’idée qu’on puisse me soupçonner de vouloir dénoncer un certain égoïsme étriqué propre à tous les Français. On retracerait mon motif à la lueur de mon objectif, et ce pour avoir lu mes pièces, les précédentes ou les suivantes, avant de me juger. Je dirais la même chose d’une exposition où l’on accrocherait un seul des deux tableaux que Viktor Hartmann suspendit sous le ciel déchirable du grand cirque social, sous le nez rouge de Moussorgski. Samuel Goldenberg a effectivement été dessiné indépendamment de Schmuyle, mais l’orfèvre qui a comme gravé l’un dans le halo d’une ménorah s’est empressé de lui donner une seconde face dans laquelle se projeter. Attardons-nous sur ces deux Juifs de Sandomir… Le Juif riche, d’abord. Outre un visage d’aigle pétrifié par sa fuite en avant vers l’horizon terrestre, un profil de médaille prenant soin d’éviter ce mauvais œil, qui serait bien capable de le dévisager, jusqu’à faire montre d’une quasi indifférence vis-à-vis des malheurs qui s’abattraient sur son côté, Samuel Goldenberg possède un patronyme, testament spirituel en soi, et sans doute, un tantinet matériel. Accroché justement à son côté, Schmuyle n’a rien à quoi se raccrocher sinon au mât transcendantal que lui offre sa canne de patriarche des Douze tribus. Il représente le Juif pauvre, si pauvre qu’on dirait qu’une brute sans foi ni loi s’est emparée de son identité dans le registre des naissances de son shtetl natal. Et l’on se sent immédiatement investi de la tâche de lui restituer son nom, son patronyme, son histoire, sa responsabilité historique, pauvre Schmuyle à la tête nue en présence de l’Absent, le cheveu et la barbe comme recouverts de cendres à la manière des endeuillés, assis debout sur la stèle du destin. Et pourquoi pas Goldenberg? Schmuyle Goldenberg. Ainsi je rebaptiserai ce trésor de poésie expressionniste de celui qui paradoxalement aura été le moins modeste des Cinq, formellement s’entend : «Goldenberg et Goldenberg». Il y décrit merveilleusement l’arrogance de l’opulence telle qu’elle s’impose tout en s’opposant à l’humilité de l’humilié, chacune des deux ayant l’occasion de se confronter ici avec une évolution possible de sa propre nature. Elle pousse le riche à embrayer sur la voie supérieure de la philanthropie et retient le pauvre de s’enfoncer trop loin dans le désert du mysticisme où ne le trouveraient plus ceux qui auraient besoin qu’il leur tende la main.
À moins que ce ne soit l’inverse. Eh oui! Shmuyle rappelant à Samuel que Chémouel n’eût affublé pour rien au monde son nom biblique d’un symbole panthéiste, ce qui n’empêchait pas le dernier des Juges d’en savoir davantage sur sa natte de lignées qu’un Dupont ou Durand qui la plupart du temps, piétine le nom et le prénom des mères de ses arrière-grand-mères. J’ajoute donc sans le lui substituer au Goldenberg et Goldenberg un Samuel et Shmuyle. Qu’est-ce que vous dites? Du pareil au même? Ah… non. Car là, on a quitté le champ de l’intersubjectivité pour tenter une percée dans la masse dialectique de l’individuel et de l’universel. Quand je pense que nous nous contentions de faire de la figuration… Soyons dès à présent bien emmerdés de voir nos vrais visages en train de s’épancher du col de l’abstraction! À monsieur Klein! et puis aussi, démerdons-nous avec une vérité par essence séparée d’elle-même. Où Shmuyle est aussi primordial que l’est Samuel. Adamique. Kadmonique. Reproduisant la confrontation de l’homme toujours seul et ce quel que soit le nombre de congénères à partager sa situation temporelle et ce quel que soit le nombre de congénères à partager sa situation spatiale devant ce à l’image de quoi il fut fait. En deux mots, que cela nous plaise non, en terme d’économie divine, Samuel Goldenberg et Shmuyle, aussi indispensable que soit l’empathie qu’ils auront eue l’un envers l’autre, n’ont, en l’espèce, rien à changer à leur état. Impeccables ils le seront du point de vue du point final qui tôt ou tard se mettra en travers de leur signe. Et aussi longtemps que ce point ne se sera pas avancé d’une page, chose qui, entre nous soit dit, lui eût été on ne peut plus loisible de faire, gageons que chaque mot qu’il ponctue est aussi nécessaire à l’œuvre dont il va intégrer la composition, que sa déréliction ne l’aura ni transmué ni même déformé dans des convulsions, insécable était-il pour chaque plan-séquence de sa promenade au contrechamp. À condition que. Quoi? Vous croyiez vraiment que ça allait être aussi simple? Mais non, que la montagne dorée ne se frotte pas les mains, elle risquerait l’éboulement! Je disais donc que Samuel et Shmuyle n’étaient pas condamnés à se pousser réciproquement à la mauvaise conscience. Et je dis donc que si ni Samuel ni Shmuyle n’ont été condamnés, c’est à l’expresse condition que leurs deux versions de l’Homme aient pu compter les secousses qu’elles se transmettaient depuis le même barreau de l’échelle sociale, laquelle est une échelle à un seul barreau.
Hartmann fut membre du cercle d’Abramtsevo sans qui Stanislavski, et plus loin Strasberg et une bonne part de ce que le cinéma a produit de plus incontournable, n’auraient jamais vu le contre-jour. L’Actors Studio. On y apprend entre autre à distinguer une blague juive d’une blague antijuive, ce qui n’est pas aussi simple qu’il y paraît quand on connaît les sources d’autodérision dont jaillit la première. Tout réside dans l’intentionnalité. Le premier type d’humour brigue le salut d’un ou plusieurs personnages placés au cœur d’une situation complexe les obligeant à prendre acte de leur impuissance, et aussitôt, à trouver une issue à celle-ci pour se sortir d’affaire. Le second type d’humour, mais peut-on encore parler d’humour lorsque le rire a cédé la place au ricanement, vise, lui, l’humiliation publique. Il cloue l’objet de son envie au rictus-pilori d’une rafale de trous d’histoire. C’est à cela que furent exposés les Juifs depuis qu’un Marcion du Pont ou un Jean Chrysostome comprirent que s’ils ne réagissaient pas suffisamment à temps, les indigènes des provinces romaines allaient se montrer plus disposés à suivre dans leurs pratiques cultuelles leurs frères et sœurs opprimés de Judée que des maîtres romains qui n’en étaient alors qu’à transposer grossièrement les «gesticulations barbares» des Cohanîm du Beit HaMikdach. Juifs sacrés? Sacrés Juifs! Depuis les premiers Adversus Judaeos, la littératose de Christ ou d’Antéchrist ne les lâchera plus. Des Dialogues sur la Trinité de Cyrille d’Alexandrie aux Bagatelles pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline, de La Passion du Christ de Grégoire de Naziance au Regain de Jean Giono, les Juifs seront au mieux physiquement repoussants, au pire mentalement séditieux, bons à jeter au feu. On ne verra plus le mot «juif» entrer par effraction chez son lecteur sans que lui soit apposé dessus un qualificatif immonde et déshumanisant, une analogie bestiale ou diabolique destinée à éveiller la peur panique bien plus que le mépris. Avec les Juifs, le complexe de supériorité de suffit pas. Il impliquerait leur persistance pour l’épreuve de comparaison.
Et maintenant, Shylock. Faut-il en effacer le texte, le nom, le costume et l’enveloppe du coquin qui s’en laisse envahir ou bien vaudrait-il mieux, plus simplement, bannir de nos étagères et balayer de nos planches le murmure insistant de Shakespeare? Oui, deux secondes… OK. On me dit qu’il existerait une autre approche qui permettrait de conserver et le nom de Shakespeare et le nom de Shylock… ça vous branche? Bon, je me lance. Je commencerai par considérer l’épaisseur d’un brouillard de diffamation enveloppant l’errance du Juif de la Nuée, un être, soit dit en passant, plutôt doué pour l’échange des points de vue ou le change aux points de vente, un être pollinisateur, je songe évidemment à Iosseph, auquel Sigmund doit la capacité de Freud à faire passer le génie du judaïsme par-dessus sa judéité, je songe aux Radhanites capables de semer en Al-Andalous les graines d’une civilisation ramenée des antipodes, un être que le virus du mal qu’il avait contracté sur le mont Golgotha destinait tout naturellement à s’éroder les mains au contact de l’usure, quelle aubaine! quand toute une roture eût tant aimé qu’on la laissât patauger dans la mer de la Merde que son prince et son pape lui faisaient contourner de force en échange d’une plus ou moins bonne place au paradis des bons chrétiens, un Juif, un Iehoudi, un homme de Iehouda, un homme de Juda, un Judas en somme, archétype du traître et de l’impur dont deux siècles d’Inquisition hisseraient l’ombre fantomatique dans la caverne crânienne depuis laquelle notre client anglais du Marchand de Venise devrait fendre, de là où il/on se/le retenait, l’armure du jour. J’ose espérer que nous n’en sommes plus là. Et j’en suis d’autant plus à l’aise que je n’imagine pas Shakespeare ne nous faisant pas faire l’économie d’une fastidieuse contextualisation alors qu’on lui passerait commande d’un Marchand de Varsovie postérieur à l’électrochoc mondial de 1945. Mais on pourrait tout aussi bien y prendre Voltaire, le grand Voltaire, le libre Voltaire, en flagrant délit d’injustice faite à une justice aussi indicible que le Nom qui l’annonce est imprononçable, à une énucléation de la sphère des nations qui selon son conspueur demeurait de l’hébreu. Et c’est là que ça se corse. Car dès l’instant que je vous plante au pied de l’Everest avec piolet, corde et pitons, soit je dis la vérité, et c’est alors tout l’œuvre du chantre des Lumières qui mériterait d’être fondu au noir, soit Voltaire est un auteur dont la hauteur ne se mesure plus, et le disciple de son Dico devra s’y engouffrer par la plus venimeuse de ses entrées. Eh bien non. Voltaire est un génie qui a dit des conneries. Voltaire est un génie du fait même qu’il ait pu larguer à un moment ou un autre de sa vie d’homme, un pet de l’esprit. S’il n’en avait jamais commis, Voltaire serait qualifiable de «pur», de «parfait», d’«omniscient», d’«Homo pantocrator». Or, mes Sieurs et Dames issus de la Sorbonne positiviste, nous aimons trop Voltaire pour l’identifier à une chose dont nous ne saurions réaliser la démonstration scientifique. Le génie de Voltaire a été plus que démontré par plusieurs siècles où l’intolérance s’est lamentablement rétamée à chaque fois qu’elle s’était rehaussée. Suivons-le donc dans son génie, et non dans sa connerie.
J’aurais bien voulu revenir sur quelques lignes que j’ai semées plus haut, mais voilà. Ce qui est fait est fait. Alors, permettez-moi d’ajouter là un complément tardif à mon survol de la mappemonde éberluée de l’antisémitisme. Que le grand Georges ne m’en tienne pas rigueur, mais il arrive que «quand on est con», on ne le soit pas jusqu’à son dernier souffle, au point qu’on se réconcilierait même avec le père Giono qui en 1958, déclare que «j’ai depuis longtemps chez moi un village de Provence peint par Willy Eisenschitz. Le cœur y est exprimé à un point qu’il m’est possible depuis des années d’entamer à chaque instant un colloque plein de saveur avec le cœur de ce village.»