Joann Sfar est un tendre. Un sensible comme on n’en fait plus, ou presque. Un Romain Gary à sa manière – c’est peut-être le terrain niçois de l’enfance qui veut ça, et une judéité affirmée mais relativisée, envisagée comme une composante mais jamais comme un principe de base. André Sfar meurt dans les bras de son fils, dans l’hôpital de Nice où il agonisait. Histoire banale, mort triviale. La vie de tout un chacun, un jour ou l’autre. Les singularités familiales, les secrets et les tensions, les reproches et les aveux non prononcés, mal vécus, voilà le récit des hommes. Pour que ce récit devienne un texte littéraire et touchant, légèrement décalé sur la ligne du témoignage, il faut savoir tourner le dos au pathos larmoyant et faire confiance au comique de situation. Ne pas s’interdire de montrer ses larmes, mais entre « montrer » et « étaler », il y a un monde. Celui de l’élégance. Celui de l’émotion juste. Celui de Joann Sfar.
André Sfar, le père de Joann, était un type solaire. Juif séfarade installé à Nice, avocat de renom, élu municipal, séducteur roulant en Alfa Romeo. Son épouse meurt dans son sommeil, seule dans un appartement d’Auron, la station de ski au-dessus de Nice. Le père et l’enfant de 3 ans et demi dormaient dans un autre appartement de l’immeuble. André Sfar était un type solaire, socialement. Mais en famille, il se comportait en saturnien intransigeant. Interdiction de dire à l’enfant que sa mère était morte. Officiellement, elle était en voyage. Joann devra attendre ses 5 ans, et la colère de son grand-père maternel, pour apprendre la vérité. Il aura attendu pendant des mois le retour de sa mère. Ce voile que l’on a posé sur la mort de la mère réapparait, symboliquement et pathologiquement, à la mort du père : Joann Sfar, en vacances en Crète avec ses enfants, perd la vue, ou presque. Il pleure trop. Ses yeux n’en peuvent plus de tant de larmes. Joann pleure son père, et son propre mariage défait. Il pense à sa « fiancée », veut expliquer à ses enfants qu’il doit prier chaque jour pour son père à la synagogue, mais qu’il n’arrive pas à se conformer à la tradition. Les coutumes, la culture du kaddish… et cet épisode tragi-comique de la chemise déchirée lors des obsèques, les ciseaux du rabbin qui taillent dans les manches de la chemise que porte le fils, mais le vêtement a appartenu au père et le fils ne le porte que parce qu’il n’a dans ses bagages que des polos achetés en urgence à l’aéroport… Il est perdu, le fils. Paumé. Aveugle presque. A présent tout à fait orphelin, divorcé et amoureux. « You have bad tears » lui dit l’ophtalmologue crétois, dans un anglais scolaire. Les larmes ne sont pas mauvaises, elles sont empoisonnées. Pleurer s’avère toxique. On en pleurerait de rire.
Comment tu parles de ton père est radicalement scindé en deux parties, de longueur égale. Une première partie semble avoir été écrite sous le coup de l’émotion et de l’urgence. L’épisode crétois avec les enfants après la séparation d’avec l’épouse, le retour sur les obsèques du père, et les souvenirs d’enfance. La seconde partie, plus tardive apparemment, s’attache à la remontée vers l’adolescence, et éclaire les rapports père/fils sous le feu d’autres projecteurs. Le contre-pied ironique y est de rigueur : « C’est cela qui me manque le plus depuis le décès de mon père : je ne parviens plus à avoir peur de quiconque » ; « J’adore prendre des coups, cela enlève la peur. Donner des coups, c’est à la portée du premier con. En prendre constitue un vrai exercice. » La figure paternelle apparaît, soudain, dans toute sa force de contrainte. Deux discours de bar-mitsvah nous sont donnés : celui que Joann a prononcé réellement, et qui a été intégralement rédigé par son père, et celui qu’il aurait aimé prononcer, a posteriori. Un monde sépare les deux discours. Au-delà de l’emprise paternelle, le second discours, émancipateur, est aussi une profession de foi politique et humaniste.
Joann Sfar est un sensible qui sait exprimer, par le dessin, la caméra et les mots, une vérité douce et tendre. Le penchant vers l’imaginaire salvateur est magnifiquement inscrit en fin d’ouvrage : à six ou sept ans, dans la station de ski qui avait vu mourir sa mère, le petit Joann va seul au cinéma voir La Guerre des étoiles. « Les dernières images qu’on voit du Dark Father, c’est son masque inexpressif qui tourne à trois cent soixante degrés, puis son vaisseau qui part en couille dans les étoiles, sans exploser. » André Sfar a-t-il été un Dark Father ? Peut-être. Sans doute. Qu’importe. Joann, père à son tour, envisage l’éducation à donner à ses enfants sous d’autres angles :
« J’ai deux enfants qui s’en foutent d’être juifs, j’y ai veillé. Et je leur ordonne, en guise de deuil, de ne pas être trop tristes. Oui. Du fond de mon cœur je voudrais juste ne pas laisser de trop mauvais souvenirs. Ma petite fille a grandi en aimant les dieux d’Egypte parce qu’ils ont des têtes d’animaux (de chat en particulier) en en lisant Le Chat du rabbin, uniquement à cause du chat. »
Comment tu parles de ton père est un recueil de digressions qui, toutes, convergent vers la paix et ses dérivés. La paix à faire avec son histoire familiale, l’apaisement sentimental à trouver après la séparation matrimoniale et la désertion de la « fiancée », la consolation d’avoir été un bon fils même si le père n’était pas forcément à la hauteur, le réconfort de croire que le monde, un jour, pourra tourner rond. Sous la figure tutélaire du père omnipotent, redouté et pleuré jusqu’à la presque cécité, c’est d’émancipation que nous parle Joann Sfar. Et de la transmission de cette émancipation réussie.
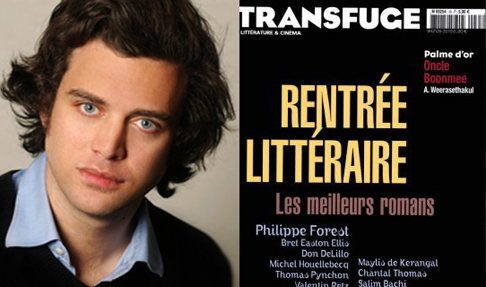
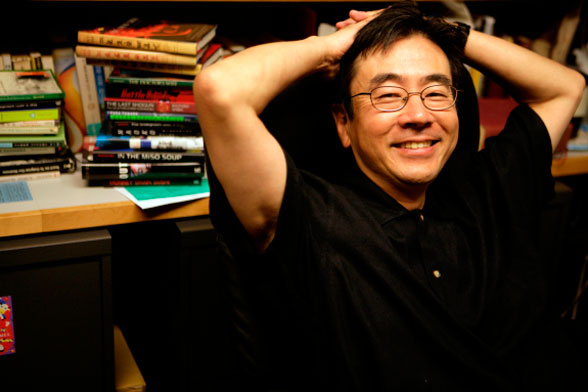





« Comment tu parles de ton père » ou le roman de l’émancipation
par Christine Bini
5 octobre 2016
Le dessinateur et réalisateur Joann Sfar consacre un livre sensible à son père disparu et aux singularités, secrets et tensions familiales.
Joann Sfar est un tendre. Un sensible comme on n’en fait plus, ou presque. Un Romain Gary à sa manière – c’est peut-être le terrain niçois de l’enfance qui veut ça, et une judéité affirmée mais relativisée, envisagée comme une composante mais jamais comme un principe de base. André Sfar meurt dans les bras de son fils, dans l’hôpital de Nice où il agonisait. Histoire banale, mort triviale. La vie de tout un chacun, un jour ou l’autre. Les singularités familiales, les secrets et les tensions, les reproches et les aveux non prononcés, mal vécus, voilà le récit des hommes. Pour que ce récit devienne un texte littéraire et touchant, légèrement décalé sur la ligne du témoignage, il faut savoir tourner le dos au pathos larmoyant et faire confiance au comique de situation. Ne pas s’interdire de montrer ses larmes, mais entre « montrer » et « étaler », il y a un monde. Celui de l’élégance. Celui de l’émotion juste. Celui de Joann Sfar.
André Sfar, le père de Joann, était un type solaire. Juif séfarade installé à Nice, avocat de renom, élu municipal, séducteur roulant en Alfa Romeo. Son épouse meurt dans son sommeil, seule dans un appartement d’Auron, la station de ski au-dessus de Nice. Le père et l’enfant de 3 ans et demi dormaient dans un autre appartement de l’immeuble. André Sfar était un type solaire, socialement. Mais en famille, il se comportait en saturnien intransigeant. Interdiction de dire à l’enfant que sa mère était morte. Officiellement, elle était en voyage. Joann devra attendre ses 5 ans, et la colère de son grand-père maternel, pour apprendre la vérité. Il aura attendu pendant des mois le retour de sa mère. Ce voile que l’on a posé sur la mort de la mère réapparait, symboliquement et pathologiquement, à la mort du père : Joann Sfar, en vacances en Crète avec ses enfants, perd la vue, ou presque. Il pleure trop. Ses yeux n’en peuvent plus de tant de larmes. Joann pleure son père, et son propre mariage défait. Il pense à sa « fiancée », veut expliquer à ses enfants qu’il doit prier chaque jour pour son père à la synagogue, mais qu’il n’arrive pas à se conformer à la tradition. Les coutumes, la culture du kaddish… et cet épisode tragi-comique de la chemise déchirée lors des obsèques, les ciseaux du rabbin qui taillent dans les manches de la chemise que porte le fils, mais le vêtement a appartenu au père et le fils ne le porte que parce qu’il n’a dans ses bagages que des polos achetés en urgence à l’aéroport… Il est perdu, le fils. Paumé. Aveugle presque. A présent tout à fait orphelin, divorcé et amoureux. « You have bad tears » lui dit l’ophtalmologue crétois, dans un anglais scolaire. Les larmes ne sont pas mauvaises, elles sont empoisonnées. Pleurer s’avère toxique. On en pleurerait de rire.
Comment tu parles de ton père est radicalement scindé en deux parties, de longueur égale. Une première partie semble avoir été écrite sous le coup de l’émotion et de l’urgence. L’épisode crétois avec les enfants après la séparation d’avec l’épouse, le retour sur les obsèques du père, et les souvenirs d’enfance. La seconde partie, plus tardive apparemment, s’attache à la remontée vers l’adolescence, et éclaire les rapports père/fils sous le feu d’autres projecteurs. Le contre-pied ironique y est de rigueur : « C’est cela qui me manque le plus depuis le décès de mon père : je ne parviens plus à avoir peur de quiconque » ; « J’adore prendre des coups, cela enlève la peur. Donner des coups, c’est à la portée du premier con. En prendre constitue un vrai exercice. » La figure paternelle apparaît, soudain, dans toute sa force de contrainte. Deux discours de bar-mitsvah nous sont donnés : celui que Joann a prononcé réellement, et qui a été intégralement rédigé par son père, et celui qu’il aurait aimé prononcer, a posteriori. Un monde sépare les deux discours. Au-delà de l’emprise paternelle, le second discours, émancipateur, est aussi une profession de foi politique et humaniste.
Joann Sfar est un sensible qui sait exprimer, par le dessin, la caméra et les mots, une vérité douce et tendre. Le penchant vers l’imaginaire salvateur est magnifiquement inscrit en fin d’ouvrage : à six ou sept ans, dans la station de ski qui avait vu mourir sa mère, le petit Joann va seul au cinéma voir La Guerre des étoiles. « Les dernières images qu’on voit du Dark Father, c’est son masque inexpressif qui tourne à trois cent soixante degrés, puis son vaisseau qui part en couille dans les étoiles, sans exploser. » André Sfar a-t-il été un Dark Father ? Peut-être. Sans doute. Qu’importe. Joann, père à son tour, envisage l’éducation à donner à ses enfants sous d’autres angles :
Comment tu parles de ton père est un recueil de digressions qui, toutes, convergent vers la paix et ses dérivés. La paix à faire avec son histoire familiale, l’apaisement sentimental à trouver après la séparation matrimoniale et la désertion de la « fiancée », la consolation d’avoir été un bon fils même si le père n’était pas forcément à la hauteur, le réconfort de croire que le monde, un jour, pourra tourner rond. Sous la figure tutélaire du père omnipotent, redouté et pleuré jusqu’à la presque cécité, c’est d’émancipation que nous parle Joann Sfar. Et de la transmission de cette émancipation réussie.
Comment tu parles de ton père
Joann Sfar
Albin Michel
1 septembre 2016
160 p.