Bleu sur blanc… Jaune du temps… Les douanes du hasard comme des portes ouvertes sur le ciel… J’ai découvert François Sureau ici, dans Le Point, il y a un quart de siècle, alors qu’il venait de publier, sous la houlette de Jean Schmitt, notre directeur de la rédaction d’alors, un reportage sur les Balkans qui précéda de peu mon propre premier voyage à Sarajevo. Je le retrouve aujourd’hui avec ce livre étrange, mi-poème mi-récit, où l’on se souvient de civils apeurés forniquant à froid dans les caves des immeubles bombardés, de tireurs à l’affût du moindre signe de vie, de morts jamais vraiment enterrés et d’une Europe commençant de crouler sous le poids de ses abandons et de ses lâchetés. Que reste-t-il d’une ville quand nul ne songe plus à la raconter? Que reste-t-il du lieutenant de vaisseau Passavant des Baleines, sinon cette légende incertaine dont l’auteur s’ingénie, de livre en livre, et dans celui-ci plus que jamais, à déposer et, dans le même geste, effacer les rares traces? Et qui est cet écrivain passé, en trente ans, d’un art du roman juvénile qui faisait roucouler les vieux académiciens au goût des mystères évangéliques, des ascèses à perdre le souffle ou, comme ici, des chansons de geste oublieuses de toute odyssée? Peu de contemporains, en tout cas, semblent aussi prodigues en vies que lui. Avocat dans l’une. Officier de la Légion étrangère dans la deuxième. Fondateur, dans une autre, d’un centre d’accueil pour réfugiés en France. Amateur, dans une autre encore, de combats spirituels et de vies de saints. Et, ici («Sur les bords de tout», Gallimard), cet énigmatique écrivain dans la lignée d’un Cendrars qui se serait frotté au «Crabe-Tambour» et à la «Double vie» de Gottfried Benn.
Autre amateur, autre praticien de cette double vie, mon «petit camarade» Renaud Girard, comme on disait dans le folklore de l’Ecole normale dont nous sommes, l’un et l’autre, des produits irréguliers. Dans la première de ses deux existences, il a sa dégaine de dandy sarcastique qui fait la leçon, depuis trente ans, à tous les ministres des Affaires étrangères de la République; qui épate, avec sa géopolitique d’état-major, les habitués des grandes conférences du Figaro ; et qui, dans son nouveau livre, «Le monde en guerre» (Carnets Nord/Montparnasse), disserte sur l’«humiliation de la Russie», les «pièges» de l’ingérence en Libye ou la «nouvelle hégémonie américaine». Dans la seconde, en revanche, il est ce grand reporter au même Figaro, agrégé en charniers, technicien de tous les coups d’Etat de la planète et dont le goût de l’aventure, l’intelligence des corps et du terrain, le sens du temps sans Histoire, le mépris souverain d’un danger qu’il m’a toujours paru tenir pour quantité négligeable et ne le concernant finalement pas, l’audace, pourraient en remontrer à la plupart de ses confrères, y compris anglo-saxons. Alors, qui est, au juste, cet homme? Est-il, dans la première de ces deux vies, une sorte de Barrès qui, considérant qu’on ne peut pas courir les guerres toute la journée, passerait ses après-midi au Cercle de l’Interallié? Ou est-ce dans la seconde qu’il est comme un James Brooke qui aurait perdu son royaume de Sarawak mais aurait eu le temps de lire «L’homme qui voulut être roi», «Lord Jim» ou le texte de Jacques Rivière marquant, bien avant celui de Roger Stéphane, la naissance de l’aventurier moderne? Normalien et baroudeur… Enarque et fantassin de la vérité… Le mixte n’est pas banal.
Et puis, vivant «au carré» s’il en est, il y a le cas de Pierre Leroy. Les initiés connaissent le très discret patron d’un groupe de communication mondial dont les performances défraient la chronique du CAC 40. Les amateurs de littérature, qui sont d’autres sortes d’initiés, ne vont pas tarder à découvrir, dans une grande exposition qui se tiendra à la bibliothèque de l’Arsenal du 21 avril au 24 mai, le sulfureux collectionneur de tel dessin original de Philippe Chéry pour le frontispice de la «Justine» de Sade; de telles lettres à Fouché réclamant la mise en liberté du seul écrivain moderne à avoir passé, pour crime de volupté, le plus clair de sa vie en prison; ou de telle épître à son épouse qui venait de lui demander de faire sortir de la Bastille son «vieux linge sale». Qui est alors, et de nouveau, ce «voyageur du temps» dont Philippe Sollers décrit, dans la belle préface qu’il donne au catalogue de l’exposition, le «pessimisme très informé»? Comment ce bibliophile fantasque et précis que l’on devine prêt à se damner pour tel manuscrit d’Albert Camus, telle lettre autographe de Diderot ou la dernière note d’honoraires adressée par Freud, au lendemain de la mort du musicien, à la famille de Mahler cohabite-t-il avec l’ancien lieutenant de Jean-Luc Lagardère promu, au décès de celui-ci, maréchal de son empire? Est-ce l’histoire, classique encore, de l’aventurier compensant ce que peut avoir d’aliénant, c’est-à-dire de soumis au temps d’autrui, la part convenable de sa vie? Ou est-ce celle, au contraire, du Wakefield de Nathaniel Hawthorne qui avait besoin d’une vie normale pour, sinon dissimuler, du moins refroidir ce que sa vraie passion pouvait avoir de dévorant? Ou celle, ce qui revient au même, de Georges Bataille expiant, au cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale, le crime d’avoir écrit «Histoire de l’œil» et «Madame Edwarda»? Autre façon d’être soi tout en étant un autre. Ou de vivre, comme voulaient les pythagoriciens, ce mélange de plusieurs vies simultanées. A l’Arsenal !


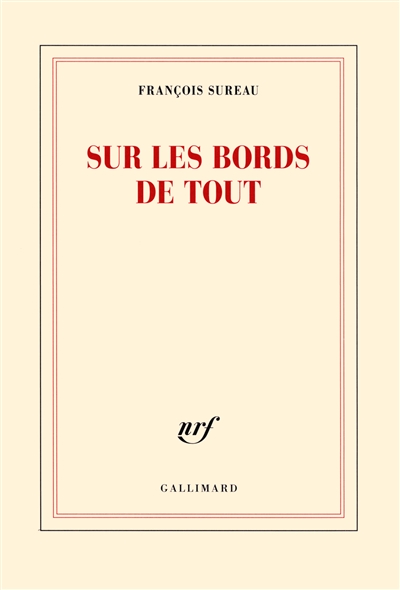






Ce n’est pas par hasard si le prolétariat dictateur campe sur ses positions place de la République, il s’y arrête pour prendre la place de la république. Non… dis plutôt qu’il prend la tête à une démocratie que la lettre foulerait du pied, préfigurant une drôle de guerre aux lendemains qui chantent faux. Si tu veux. Quoi qu’il en soit, il n’est pas étonnant que sa révolution foutraque chasse Alain Finkielkraut du cénotaphe des derniers martyrs de la République qui, dans leur patinoire de sang, sont venus confirmer quelques-unes des intuitions obsessives propres au lanceur d’alerte antitotalitaire. Un mémorial spontané. Il sera rebaptisé Nuit Debout par les nettoyeurs d’une Histoire que ses occultateurs n’ont plus le pouvoir d’effacer. Selon un porte-parole du mouvement immobile, ledit fasciste Finkielkraut aurait été expulsé de la France pour cette raison, au petit parfum reconnaissable, qu’il l’avait bien cherché, que ses propos nauséabonds, fussent-ils inconséquents, ne pouvaient espérer a fortiori, à treize mois du Concours Le Pen, rester sans conséquences. Quels propos? La dénonciation de l’islamisme… vécue comme délation par les élaborateurs du concept d’islamophobie, ceux-là mêmes qui prétendent que Valls est une réincarnation de Laval passant commande à Cazeneuve d’un fichier musulman préalable à la déportation de ses concitoyens, auxquels le naturalisé, jaloux de sa nationalité toute fraîche, n’aura pas hésité un instant à infliger une déchéance de citoyenneté. Quoi d’autre? La dénonciaton de l’antisionisme… vécue comme complicité à l’égard d’un État pluraliste, multiethnique, multiculturel et néanmoins juif, car l’État souverain du peuple juif porte la responsabilité de transmettre aux générations futures une Histoire dont elle ne laissera jamais plus un idéologue nationaliste ou internationaliste le forcer à en éprouver de la honte. Une Histoire qui éclaire les Juifs autant sur eux-mêmes qu’elle partage sa Haskala avec ceux qui ont conscience ou demeurent inconscients qu’ils le firent, le font, le feront, sur la place de la République mondiale ou depuis les hauteurs du plateau du Golan face à la Révolution islamique permanente, pour des raisons qui les dépassent, et c’est très bien ainsi.
Le réformateur se refermera aussi vite qu’il se sera ouvert au dialogue avec l’antihistoire de la philosophie. L’union de la gauche n’ira pas de Macron à Varoufákis car l’un n’est pas mariable à l’autre dès lors que l’un est voué à remplacer l’autre. Il est temps que la gauche de gouvernement assume ce qu’elle est. Dans ce dessein, qu’elle se recentre! — ce qui ne signifie pas qu’elle incline au Centre mais qu’elle retrouve les inflexions qui sont de nature à justifier son évolution plurielle et singulière. Éviter, par exemple, de nous dire qu’elle n’est n’est ni de droite ni de gauche et nous assurer que, si elle n’est pas de droite, elle se dissocie avec une égale énergie de l’extrême gauche et de l’extrême droite. La gauche qui a accepté d’être aux responsabilités n’est pas une masse compacte hermétique à elle-même. Ses divisions internes sont transparentes et, à ce titre, peuvent, bien mieux que ne le ferait le glacis craquelant d’une cohésion coercitive, l’éclairer sur elle-même. Si, comme elle cherche à en atténuer les effets, la réduction de la marge de manœuvre des membres impermanents de l’a(communauté) internationale est un sujet bien trop sensible pour être relégué au merchandising des bobos guévaristes, nous aimerions voir le ministre de l’Économie installer ses bureaux au quai d’Orsay. Entre l’isolationnisme des provinces de l’empire et la globalisation des marchés complice du néoféodalisme des multinationales, il y a l’Internationale sociale. L’erreur de Varoufákis c’est d’avoir rappliqué le doigt sur la gâchette à la table des négociations. Le camp ultralibéral est passé maître dans l’art mafieux de l’intimidation. Les masses salariales doivent le convaincre qu’elles se conçoivent comme ses associées si elles veulent obtenir de lui l’inflexion sociale la plus rentable pour l’ensemble des acteurs sociaux. Une authentique économie de gauche se montrerait capable de faciliter la conversion du grand patronat au libéralisme social — phase transitoire entre la loi du plus fort et l’empyrée qu’est la justice pour tous — visant à briser les dernières chaînes de l’esclavage postindustriel.
Notre pays est sous tension. L’insurrection qui le guette incite au repli immunitaire. L’État marche sur les œufs de son propre bourreau, l’ire des peuples qui n’ont plus le temps de lire dans leurs propres pensées. L’État doit comprendre qu’il y a belle lurette que la Bête est sortie de sa coquille. Or le totem du mal, relativement véloce, marche toujours sur deux pattes. Arrivé à ce stade d’autogénération, il doit trouver la tête qui le nourrira, faute de quoi il la dévorera. Le Président nous dit qu’il fait tout ce qu’il est possible de faire pour que ses compatriotes vivent dans un monde plus juste. De fait, il leur paraît un tantinet suffisant. Ils attendent de lui davantage d’insatisfaction. Ils voudraient être sûrs qu’il lutte chaque jour contre l’inertie engendrée par le détonateur des fronts monétaires. Ils veulent le voir désamorcer la bombe anomique. L’inefficience des normes civilisationnelles ne laisse plus d’autre choix aux dirigeants des États de droit que de prôner un modèle de civilisation hors-norme. L’harmonisation fiscale mondiale n’implique pas l’uniformisation quand l’harmonie dont nous avons besoin devrait rompre avec ce médiévisme que représente un progressisme à l’unisson. Évitons donc la monodie des impératifs catégoriques en sorte que celui qui interprète sa mélodie en doubles-croches apprenne (à estimer à sa juste valeur = à valoriser) l’assise triomphale que synchronise sur elle l’octobassiste de l’ingénieur Berlioz avant qu’un tremblement de rage ne vienne à transformer une ronde en trille et ne le fasse vaciller sur son estrade.
Je suis à 10 000…% , d’accord avec cette brillante et fine analyse