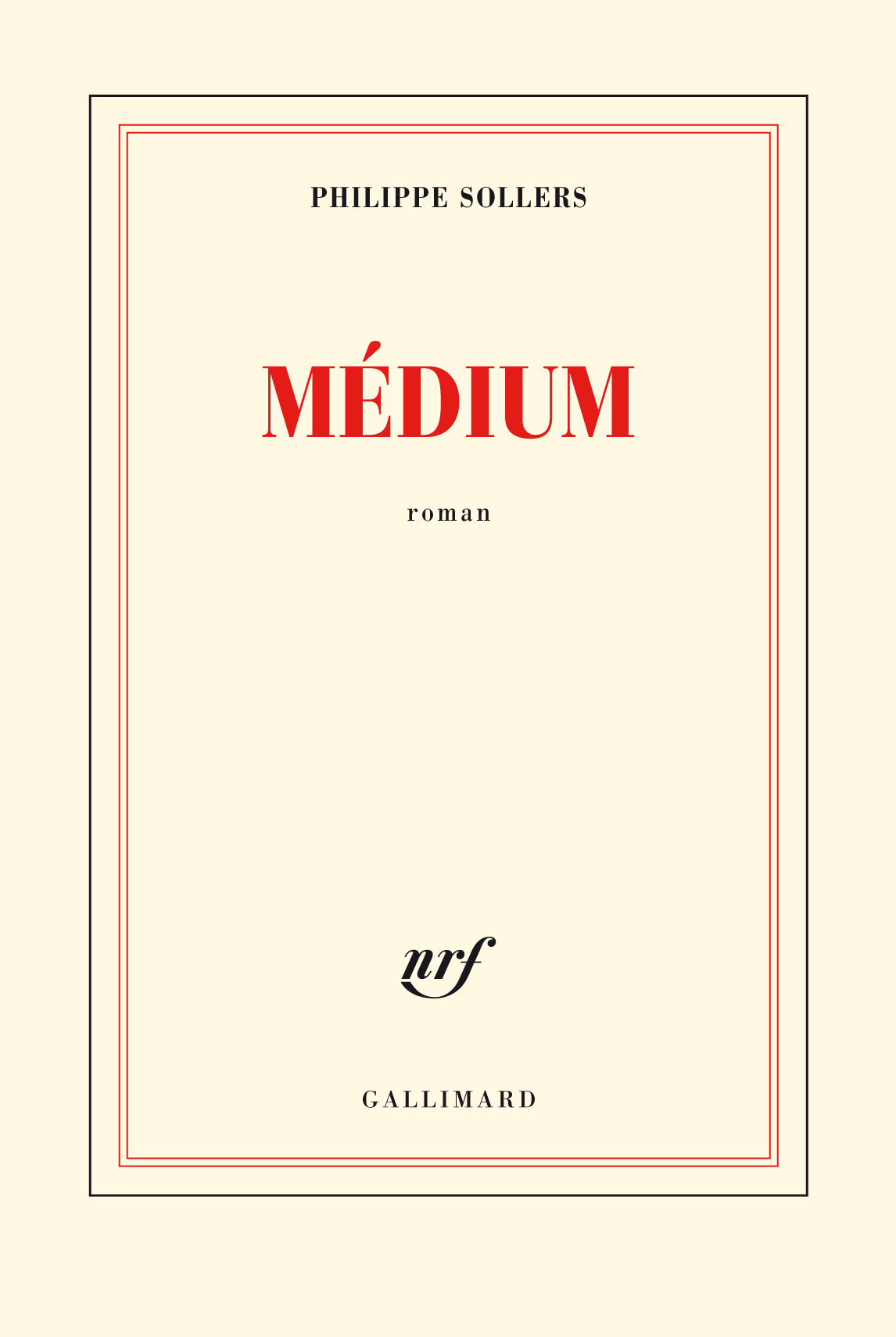Depuis le temps que je lis Philippe Sollers, je vois se succéder, dans son oeuvre, quatre grandes « périodes ».
Les romans de jeunesse : curieuse solitude, apprentissage mêlé du désir et de la langue, art du roman déjà conçu comme art du secret et de la coulisse.
Son époque dite avant-gardiste : longs romans non ponctués, les pages comme une lave, le monde comme un déferlement d’images et de mots inutiles, de la prosodie avant toute chose, des performances avant la lettre.
L’époque « Femmes » et son prétendu retour au récit traditionnel quand ce qui s’y joue s’apparente à la naissance, sur fond de « guerre du goût », d’une des pensées les plus construites, les plus systématiquement élaborées qui soient.
Une longue, très longue, période qui va, en gros, de « Studio » à « L’éclaircie » – normal, il fallait bien ce temps, tout ce temps, pour mener, sur ces bases, en s’adossant à la double histoire d’une métaphysique revisitée et d’une littérature réappropriée, la guerre de longue durée de l’Infini contre le Nihilisme.
Eh bien, j’ai le sentiment qu’avec le texte qu’il publie aujourd’hui, avec ce vingt-cinquième roman qui s’intitule « Médium » et qui est l’un des plus enlevés, et des plus allègres, de ce mozartien des lettres qu’il est aussi, s’ouvre une cinquième période dont on verra bien ce qu’elle donnera mais qui s’annonce déjà comme la plus combative, la plus offensive et, au fond, la plus politique de l’auteur de « Guerres secrètes ».
Plus que jamais, la voix contre la langue.
Plus que jamais, le romancier contre les momies.
Plus que jamais le goût du secret, de la clandestinité, de la double vie, comme propédeutiques de la liberté.
Mais, aussi, la résistance organisée, méthodique, à l’esprit d’un temps où tous les hommes sont remplaçables.
Le refus, chez ce Girondin définitif, d’une religion nationale dont les roulements de tambour se font ces jours-ci assourdissants.
Cette autre religion, celle de « la vie », dont il énonce l’envers morbide et criminel : ventes d’organes ; cellules souches mises en culture et laissant, pour de bon, le mort s’emparer du vif ; « procréation médicalement assistée » qui peut se lire « parfaite mort assistée » ; non plus l’école des cadavres, mais leur trafic, leur recyclage monstrueux, leur usinage radieux.
L’identification d’une « folie » à laquelle, dans un retournement qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Antonin Artaud établissant que, s’il n’y avait pas eu de médecins, il n’y aurait pas de malades, il oppose une « contre-folie » paradoxale, mélange de grande sagesse et de fantaisie, de lenteur bien tempérée et d’affolement calculé des humeurs et des affects, de petits gestes simples (laisser passer trois bus sans les prendre, lire des classiques chinois cinq heures par jour) et d’écart fondamental (le refus, sans appel, de la collaboration communautaire et de ses camisoles sociales).
Des exercices de mémoire pour temps d’amnésie ou, ce qui revient au même, banques de données aidant, d’hypermnésie généralisée.
Un stylo à pompe, ou une encre rapportée d’Italie, qui, à l’âge du « traitement de texte », suffisent à recréer la « circulation sanguine » des phrases.
Le réapprentissage du temps, le vrai, celui où les minutes durent parfois des heures, où les heures paraissent tour à tour trop denses ou trop poudreuses, passant en rafales ou, au contraire, s’éternisant, et où le narrateur, c’est-à-dire aussi bien vous, ou moi, a tous les âges à la fois.
Et puis – substances aidant : Sollers ne nous dira pas lesquelles, mais j’ai mon idée sur la question… – un affolement des perceptions ; le corps qui s’allège comme celui des cosmonautes ; le paysage qui gagne en précision ; l’espace soudain sans limites ; et la beauté d’une femme aimée qui semble, tout à coup, « une apparition de l’au-delà ».
Rimbaud appelait cela le dérèglement raisonné de tous les sens.
Ou Lautréamont la réinvention de la Poésie comme alternative à la fatale bassesse de l’homme, cette « bête fauve ».
Sollers en est là.
C’est-à-dire qu’il est évidemment très en avance sur tous les clergés philosophiques qui n’ont fait que régresser, pense-t-il, par rapport à cette deuxième révolution française fomentée, en pleine Commune de Paris, par une paire de « voyants », ou de « veilleurs », dont il reprend le fil.
Quand, en écho à la mort de Lautréamont dont le corps, enveloppé dans son linceul de mots et aussi, nous apprend-il, dans ceux de l’étrange absoute dite par un abbé Sabattier massacré quelques jours plus tard par les communards, ne fut jamais retrouvé, il imagine son propre cadavre jeté dans le Grand Canal par un mari jaloux mais remontant, lui, un beau matin, recouvert d’une carapace portant les signes d’une écriture indéchiffrable, puis quand il s’amuse, ensuite, des « experts » requis par la direction des musées de Venise pour se pencher sur le mystère de ce nouveau linéaire B et s’exclamant « du chinois ? non, du français ! », il donne la clé du programme.
Reste à le réaliser, bien sûr : mais un jeune Sollers est là – dont ce sont les débuts et qui, avec une insolence devenue bien rare, annonce la couleur des combats à venir.