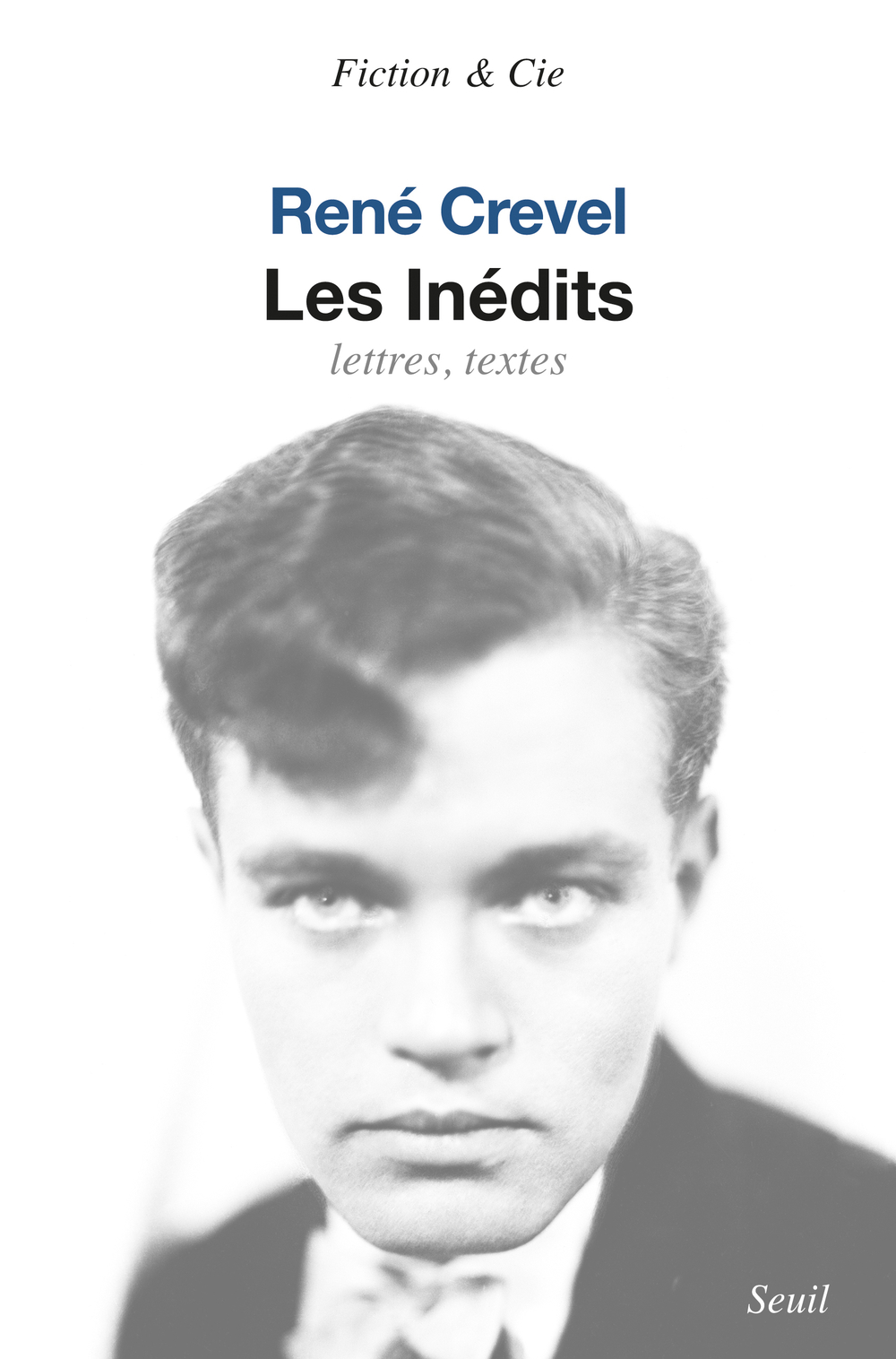Parmi une population constante d’adeptes secrets, le surréalisme, comme objet de fascination, produit une sorte de culte, déguisé, dissimulé et évanescent mais soudain trahi par l’éclat d’un regard ou l’éloquence inusuelle de l’un de ces sectateurs. Ils étaient jeunes, beaux, rebelles et ironiques, la grâce habillaient leurs rires enfantins, ils étaient des demi-dieux potaches et lumineux, invincibles et fulgurants, sarcastiques et engagés, une certaine idée de la camaraderie, de la vie, des revues, des femmes et du champagne, l’Europe et les mansardes, la Méditerranée et la révolution, des nuits bouleversantes et bleues comme un orage, une cohorte d’aventuriers du langage sous les nuages du fascisme, tous figurant pour nous un panthéon éternel et suggestif, un empire de la jeunesse, du courage et de la poésie dans la géographie de l’esprit. Comme dans toutes les religions de caves clandestines, nous adorons silencieusement et avec nostalgie ces jeunes gens inconscients de l’ombre portée de leurs légendes, pressés d’écrire et furieux de vivre, le tract à la main et le cœur embué de songes. Et, parmi nos idoles, René Crevel est un apôtre décisif et modeste, central et maudit, trop vite écrasé par ses compagnons plus brillants, plus fanfarons et moins suicidés. Car Crevel, au final, est trop souvent réduit à son geste fatal, qui le résume et le présente, et c’est un pur scandale que celui-là, puisque précisément, Crevel s’est tué à cause de son suicide, ce suicide, qui, pour tous ceux qui le tentent et le réussissent est, toujours, une fatalité nécessaire : non seulement le père de Crevel était mort ainsi, ce qui tissait dans une vie nouvelle la trame d’un sombre destin, mais, comme pour chacun de ceux voulant mettre fin à ses jours, le suicide chez Crevel n’est pas un dénouement, c’est un commencement. C’est parce que l’on sait dès le départ que l’on ne pourra pas faire mieux que de mourir ainsi, seul et oublié, c’est parce que l’on a l’intime conviction de sa condition d’homme-à-suicide par un défaut natal, c’est parce que l’on devine que chacun de nos gestes nous rapproche de cette issue absurde et forcée à cette existence qui la réclame, que, au final, on endosse cet acte où, comme dans un adultère ou un amour évitable, on épouse avec dégoût ce que l’on ne cessait justement de hâter en le fuyant. C’est comme naître dans des sables mouvants. Le suicide est l’horizon indépassable et ricaneur du suicidé, et c’est une sinistre vengeance de la vie que cette camisole poursuive Crevel jusque dans sa postérité. Si la mort est une incarnation, elle a figé Crevel dans la posture qui était sa malédiction, elle a, comme une Méduse cruelle, fait de son épouvante un tombeau, de son angoisse un linceul.
Il est donc fascinant de lire, dans une édition inédite de lettres et de textes originaux publiée ces jours-ci au Seuil, Crevel se débattre avec ce que, pour une fois, il est permis, sans illusion de reconstruction rétrospective, de prendre pour une intrigue sans suspense : cette course au suicide, ce voyage comme une ligne de métro, que même une femme plus fidèle ou un corps moins malade ne devaient empêcher, puisque tout, malheurs et tuberculoses sont presque des conséquences de cette singulière façon d’être-au-monde qui décidera du geste ultime. Alexandre Mare, qui dirige cette édition et a passé de longues heures à retrouver au fin fond des bibliothèques ces documents exceptionnels (et notamment une correspondance jamais lue de Crevel avec la femme décisive des dernières années de sa vie, Tota Cuevas) raconte avec beaucoup de justesse en introduction ce jeune poète au physique de boxeur, cadet brillant et mélancolique du surréalisme, gamin solitaire et lecteur de Diderot et de Lénine, ami de lycée de Jean-Michel Frank et d’Allégret, avec qui il partageait une homosexualité occasionnelle, fidèle de Tzara depuis les années dada, prenant ses vacances chez Dali ou Stefan Zweig, commensal de Giacometti et proche de Klaus Mann, tantôt potache onirique, tantôt tuberculeux aux milles fêlures, cette « sorte de somnambule » (Leiris), « né révolté comme d’autres naissent avec les yeux bleus » (Soupault) est mort quelques heures après un rendez-vous, où, comme après la soirée du « cœur à barbe », celle de la rupture entre dadas et surréalistes, dont Crevel fut le scribe impuissant et horrifié, il cherchait à rabibocher, panser les orgueils et ménager les connivences. Cette fois, en 1935, Crevel tâchait de réconcilier communistes et surréalistes, Aragon et Breton, le parti du prolétariat et la religion des météores rêveurs. Il faut retrouver, sous la plume de Crevel, cet âge d’or dont nous, les fanatiques sectateurs du surréalisme et tremblants idolâtres de ses titans, connaissons les rebondissements et les drames, les lieux sacrés et les anecdotes, les encycliques et les chapitres, les missels et les apôtres. On retrouve, ou découvre, les plus fameux et les moins connus, de Georges Hugnet au comte de Beaumont, de la visite de Saint-Julien-le-Pauvre aux fêtes d’Antibes, des manifestes épidermiques aux chefs-d’œuvres immortels. Au final, c’est le portrait épistolaire et bouleversant d’un poète prisonnier des sanatoriums, s’échappant de l’albumine et du pneumothorax pour courir à Tolède en guerre, embrasser les Noailles et saluer Eluard. Il faut lire encore cet autre texte exhumé par Alexandre Mare et placé à la suite des lettres dans le même ouvrage, « L’Arbre à Méditation », bric-à-brac sarcastique et douloureux, torturé et rageur, avec des angoisses d’Européen face aux fascismes, des révoltes de Français indigne dans des années 30 misérables, et des fulgurances, métaphores et images où nagent les hippocampes, dignes des Chants de Maldoror. Il fantasme, désire, affabule, réinterprète à la loufoque le mythe d’Aristophane, et c’est infiniment pathétique, car l’on sent, derrière la parade poétique, le pressentiment d’une fin que, de toutes façons, la maladie rendait contemporaine de ses nuits d’insomnie. Au passage, il livre un des plus beaux arts poétiques qu’il soit, explicitant ce procédé qui commande au poète, par un nécessité originelle, d’offrir un sens plus pur aux mots de la tribu, Crevel livrant une version fiduciaire et cratyléenne de la théorie du langage : « La fêlure, au plus intime, révèle les syllabes très chères et très sonores, sœurs de ces monnaies impossibles à s’imaginer sur l’actuel velours des collections, espèce jadis sonnantes et trébuchantes, contre quoi s’échangeaient les choses de la vie » (page 290). Il avait tout compris, du nazisme monstrueux qui imposait toutes les réconciliations dans la lutte, et de son couple, dont, à le lire, on sent qu’il était le spectateur engagé du désastre (« Ne crois pas qu’il y a de la dureté dans cette lettre. Si tu le penses, si tu penses que la vie telle que je te la propose est impossible, dis-le moi et ne perpétuons pas l’impossibilité de nous entendre dans une vie crocodilesque », page 218). Il est triste puis heureux comme le sont les enfants, il est universel dans ses douleurs comme le sont les vrais poètes. Extraordinairement courageux, dépourvu de ridicules, d’égotisme ou d’affection, généreux sans compter, il était « un papillon des trèfles », le meilleur des hommes aux dires de René Char ; en cure à Davos ou en résidence chez Nancy Cunard, en voyage politique à Amsterdam ou à la table de Marie Laurencin, René Crevel conclut sur sa solitude, sa désespérance et l’inconvénient d’être né. Il était le prophète interloqué du désastre, le mouton noir et malade du surréalisme, contant les catastrophes immenses dont il se proposait d’être le coupable supplicié. Celui qui, transi par la douleur et l’ennui des hauts glaciers, se décrira comme « un épinard gelé », écrit comme une épitaphe « J’ai froid d’être seul ». Grâce à cet ouvrage remarquable, nous avons désormais mieux froid avec lui.
A noter une excellente réédition, par Alexandre Mare encore, du Dictionnaire du dadaïsme de Georges Hugnet (Bartillat), qui fut non seulement un fêtard, un grand Résistant et un libraire, le mémorialiste génial et trop oublié du mouvement.
Des nouvelles de Crevel
par Baptiste Rossi
6 janvier 2014
Une fascinante édition inédite de lettres et textes originaux de René Crevel.